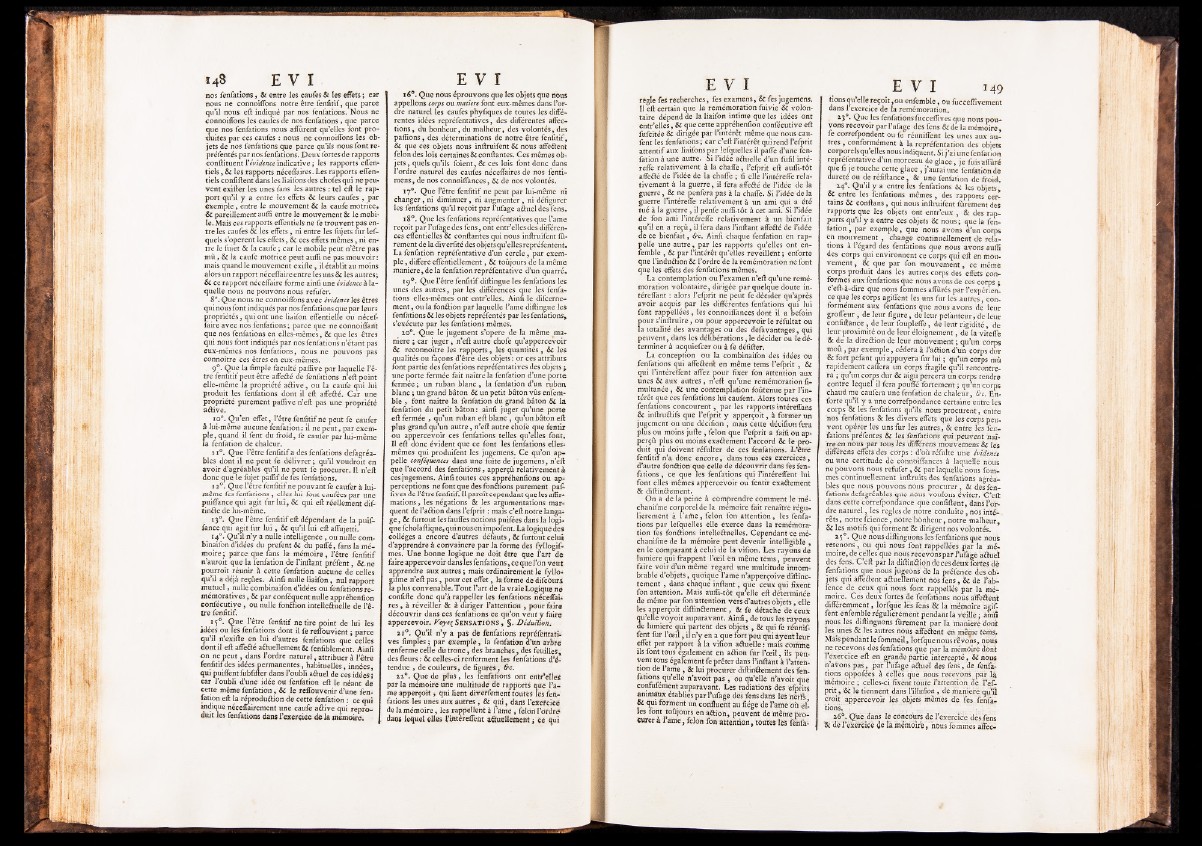
nos fenfations, & entre les caufes& les effets; car
nous ne connoifTons notre être fenfitif, que parce
qu’il nous eft indiqué par nos fenfations. Nous ne
connoifTons les caufes de nos fenfations, que parce
que nos fenfations nous affûrent qu’elles font produites
par ces caufes : nous ne connoifTons les objets
de nos fenfations que parce qu’ils nous font re-
préfentés par nos fenfations. D eux fortes de rapports
conftituent l'évidence indicative ; les rapports efl'en-
tiels, & les rapports néceffaires. Les rapports effen-
tiels confident dans les liaifons des ebofes qui ne peuvent
exifter les unes fans les autres : tel eft le rapport
qu’il y a entre les effets & leurs caufes , par
exemple, entre le mouvement &: la caufe motrice,
& pareillement auffi entre le mouvement & le mobile.
Mais ces rapports effentiels ne fe trouvent pas entre
les caufes & les effets, ni entre les fujets lur lesquels
s’opèrent les effets, & ces effets mêmes, ni entre
le fujet & la caufe ; car le mobile peut n’être pas
mû , & la caufe motrice peut aiifli ne pas mouvoir :
mais quand le mouvement exifte, il établit au moins
alors un rapport néceffaire entre les uns & les autres;
& ce rapport néceffaire forme ainfi une évidence à laquelle
nous ne pouvons nous refufer.
8°. Que nous ne connoifTons avec évidence les êtres
qui nous font indiqués par nos fenfations que par leurs
propriétés, qui ont une liaifon effentielle ou néçef-
faire avec nos fenfations; parce que ne connoiffartt
que nos fenfations en elles-mêmes, & que les êtres
qui nous font indiqués par nos fenfations n’étant pas
eux-mêmes nos fenfations, nous ne pouvons pas
connoître ces êtres en eux-mêmes.
9°. Que la fimple faculté pafîlve par laquelle l’être
fenfitif peut être affrété de fenfations n’eft point
elle-même la propriété aétive, ou la caufe qui lui
produit les fenfations dont il eft affrété. Car une
propriété purement paffxve n’eft pas une propriété
aétive.
io°. Qu’en effet, l’être fenfitif ne peut fe caufer
â lui-même aucune fenfation: il ne peut, par exemple,
quand il fent du froid, fe caufer par lui-même
la fenfation de chaleur.
i i °. Que l’être fenfitif a des fenfations defagréa-
bles dont il ne peut fe délivrer ; qu’il voudroit en
avoir d’agréables qu’il ne peut fe procurer. Il n’eft
donc que le fujet paflif de les fenfations.
12°. Que l’etre fenfitif ne pouvant fe caufer à lui-
même fes fenfations, elles lui font caufées par une
puiffance qui agit fur lui, & qui eft réellement dif-
tinéte de lui-même.
. i.3°. Que l’être fenfitif eft dépendant de la puiffance
qui agit fur lu i , & qu’il lui eft affujetti.
140. Qu’il n’y a nulle intelligence, ou nulle com-
binaifon d’idées du prefent & du paffé, fans la mémoire
; parce que fans la mémoire, l’être fenfitif
n’auroit que la fenfation de l’inftant préfent, &c ne
pourroit réunir à cette fenfation aucune de celles
qu’il a déjà reçues. Ainfi nulle liaifon, nul rapport
mutuel, nulle combinaifon d’idées ou fenfations re-
mémoratives, & par confisquent nulle appréhenfion
confécutive , ou nulle fonction intelleétuelle de l’être
fenfitif.
1 5°. Que l’être fenfitif ne tire point de lui les
idées ou les fenfations dont il fe reffouvient ; parce
qu’il n’exifte en lui d’autres fenfations que celles
dont il eft affrété actuellement & fenfiblement. Ainfi
on ne p eu t, dans l’ordre naturel, attribuer à l’être
fenfitif des idées permanentes, habituelles innées
qui puiflentfubfifter dans l’oubli aétuel de ces idées 1
car l’oubli d’une idée ou fenfation eft le néant dé
cette même fenfation, & le reffouvenir d’une fenfation
eft la réproduétion de cette fenfation : ce qui
indique néceffairement une caufe adive qui reproduit
les fenfations dans l’exerçice de la mémoire.
i6°. Que nous éprouvons que les objets que nous
appelions corps ou matière font eux-mêmes dans l’ordre
naturel les caufes phyfiques de toutes les différentes
idées repréfentatives, des différentes affections,
du bonheur, du malheur, des volontés, des
pallions, des déterminations de notre être fenfitif,
& que ces objets nous inftruifent & nous affedent
félon des lois certaines & confiantes. Ces mêmes objets
, quels qu’ils foient, & ces lois font donc dans
l’ordre naturel des caufes néceffaires de nos fentimens,
de nos connoiffances, & de nos volontés.
170. Que l’être fenfitif ne peut par lui-même ni
changer, ni diminuer, ni augmenter, ni défigurer
les fenfations qu’il reçoit par l’ufage aétuel des fens.
i8°. Que les fenfations repréfentatives que l’ame
reçoit par l’ufage des fens, ont entr’elles des différences
effentielles & confiantes qui nous inftruifent furent
ent de la diverfité des objets qu’elles repréfentent.
La fenfation repréfentative d’un cercle, par exemple
, différé effentiellement, & toûjours de la même
maniéré, de la fenfation repréfentative d’un quarré.
19®. Que l’être fenfitif diftingue les fenfations les
unes des autres, par les différences que les fenfations
elles-mêmes ont entr’elles. Ainfi le difeernement,
ou la fondion par laquelle l’ante diftingue les
fenfations & les objets feprelentés par les fenfations,
s’exécute par les fenfations mêmes.
20°. Que le jugement s’opère de la même maniéré
; car juger, n’eft autre chofe qu’appercevoir
Si reconnoître les rapports, les quantités , & les
qualités ou façons d’être des objets : or ces attributs
font partie des fenfations repréfentatives des objets ;
une porte fermée fait naître la fenfation d’une porte
fermée ; un ruban blanc , la fenfation d’un ruban
blanc ; un grand bâton & un petit bâton vus enfem*
ble , font naître la fenfation du grand bâton & la
fenfation du petit bâton : ainfi juger qu’une porté
eft fermée , qu’un ruban eft blanc , qu’un bâton eft
plus grand qu’un autre, n’eft autre chofe que fentir
ou appercevoir ces fenfations telles qu’elles font*
Il eft donc évident que ce font les fenfations elles»
mêmes qui produifent les jugemens. Ce qu’on ap*
pelle conféquences dans une fuite de jugemens, n’eft
que l’accord des fenfations, apperçu relativement à
ces jugemens. Ainfi toutes ces appréhenfions ou ap-*
perceptions ne font que des fondions purement paf*
fives de l’être fenfitif. II paroît cependant que les affir*
mations, les négations & les argumentations marquent
de l’adion dans l’efprit : mais c’eft notre Ianga»
g e , & furtout lesfauffes notions puifées dans la logique
fcholaftique, qui nous en impofertt. La logique des
collèges a encore d’autres défauts, & furtout celui
d’apprendre à convaincre par la forme des fyllogif*
mes. Une bonne logique ne doit êtfe que l’art de
faire appercevoir dans les fenfations, ce que l’dn veut
apprendre aux autres ; mais ordinairement le fyllo»
gifine n’eft pas, pour cet effet, la forme de difcôursi
la plus convenable. Tout l’art de la vraie Logique né
confifte donc qu’à rappeller les fenfations néceffaires
, à réveiller & à diriger l’attention , pour faire
découvrir dans ces fenfations ce qu’on veut y faite
appercevoir. Voyt^ Sensations , §. Déduction.
2 i° . Qu’il n’y a paS dè fenfations repréfentatives
fimples ; par exemple, la fenfation H’tm arbre
renferme celle du tronc, des branches, des feuilles,
des fleurs : & celles-ci renferment les fenfationS d é tendue
, de couleurs, de figures, &c.
220. Que de plus, les fenfations ont entféllei
par la mémoire une multitude de rapports que l’ame
apperçoit j qui lient divetfertient toutes les feti-
fations les unes aux autres , & qùi, dans PeXefciéë
de la mémoire, les rappellent à l ’âttie * fêlori l’Ofdré
dan* lequel elles l’ihtéreffent aûuellefnefit ; çe qui
réglé fes recherches, fes examens, & fes jugemens.
II eft certain que la remémoration fuivie & volontaire
dépend de la liaifon intime que les idées ont
entr’elles, & que cette appréhenfion confécutive eft
fufeitée & dirigée par l’intérêt même que nous cau-
fent les fenfations ; car c’eft l’intérêt qui rend i’èfprit
attentif aux liaifons par lefquelles il paffe d’une fenfation
à une autre. Si l’idée aétuelle d’un fufil inté-
reffe relativement à la chaffe, l’efprit eft aufli-tôt
affrété de l’idée de la chaffe ; fi elle l ’intéreffe relativement
à la guerre, il fera affrété de l’idée de la
guerre, & ne penfera pas à la chaffe. Si l’idée de la
guerre l’intéreffe relativement à un ami qui a été
tué à la guerre, il penfe aufli-tôt à cet ami. Si l’idée
de fon ami l’intéreffe relativement à un bienfait
qu’il en a reçu, il fera dans l’inftant affrété de l’idée
de ce bienfait, &c. Ainfi chaque fenfation ën rappelle
une autre, par les rapports qu’elles ont en-
iemble , & par l’intérêt qu’elles réveillent ; enforte
que l’induétion & l’ordre de la remémoration ne font
que les effets des fenfations mêmes.
La contemplation ou l’examen n’eft qu’une remémoration
volontaire, dirigée par quelque doute in-
téreffant : alors l’efprit ne peut fe décider qu’après
avoir acquis par les différentes fenfations qui lui
font rappellées, lés connoiffances dont il a befoin
pour s’inftruire, ou pour appercevoir le réfultat où
la totalité des avantages ou des defavantagès, qui
peuvent, dans les délibérations, le décider ou le déterminer
à acquiefcer ou à fe défifter.
La conception du la combinaifon des idées ou
fenfations qui affrètent en même tems l’èfprit , &
qui l’intéreffent affez pour fixer fon attention aux
unes & aux autres, n’éft qu’uné remémoration fi-
multanée, & une contemplation fôûtehue par l’in- j
térêt que ces fenfations lui caufent. Alors toutes ces
fenfations concourent, par les rapports ihtéreffans
& inftruétifs que l’efprït y apperçoit, à former un
jugement ou une décifion ; mais cette décifton fera
plus ou moins jufte , félon que l’efprit a faifi Ou ap»
perçu plus ou moins exaétement l’accord & le produit
qui doivent réfulter de ces fenfations. L ’être
fenfitif n’a donc encore, dans tous ces exercices,
d’autre fonétion que celle de découvrir dans fes fenfations
, te que lès fenfations qui l’intéreffent lui
font elles mêmes appercevoir ou fentir exaétement
&. diftinétement.
On a de la peiné à comprendre comment lé fnë-
chanifme corporel de la mémoire fait renaître régulièrement
à Partie, félon fon attention, les fenfations
par lefquèlles elle exerce dans la remémoration
fes fonétions intelleétuelles. Cependant ce mé-
chanifme de la mémoire peut devenir intelligible ,
en le comparant à celui de la vifion. Les rayons de
lumière qui frappent l’oeil ën même tèms, peuvent
faire voir d’un même regard une multitude innombrable
d’objets, quoique l’ame n’apperçoive diftinc-
tement, dans chaque inftant, que ceux qui fixent
fon attention. Mais aufli-tôt qu’elle eft déterminée
de même par Ton attention vers d’autres objets, elle
les apperçoit diftinétement, & fe détache de ceux
qu’elle voyoit auparavant. Ainfi, de tous les rayons
de lumière qui partent dès objets , & qui fe réuhi'f-
fent fut l’oe il, il n’y en a que fort peu qui âyènt leur
effet par rapport à lâ vifion aétuelle ; mais comme
ils font tous également en aétion für l’oe il, ils pèù-
Vent tous également fe prêter dans l’inftânt à l’attén-
tion de l’âme , & lui procurer diftinétement des fenfationsqu’elle
n’a voit p a s , ou qu’elle n’avoit que
confufement auparavant. Les radiations dés efpritS
animaux établies par Pufagè des fens dans Tes n'erft
& qui forment un confluent au fiége de l’ame où elles
font toûjours en aétion, peuvent de même procurer
à 1 ame, feion fon attention, toutes les fenfa- j
Hons qu’elle reçoit, ou enfemble, ou fucceifivement
dans l’exercice de la remémoration.
. 230. Que les fenfationsfiicceflives que nous pouvons
recevoir par l’ufage des fens & d e la mémoire,
fe correfpondent ou fe réunifient les unes aux autres
, conformément à la repréfentation des objets
corporels qu elles nous indiquent. Si j ’ai une fenfation
repréfentative d’un morceau de glace, je fuisaffûré
que fi je touche cette glace , j’aurai une fenfation de
dureté ou de réfiftance, & une fenfation de froid.
24°. Qu’il y a entre les fenfations & les objets,
& entre les fenfations mêmes, des rapports cer»
tains & conftans, qui nous inftruifent lïirement des
rapports que les objets ont entr’eux , & des rapports
qu’il y a entre ces objets & nous ; que la fenfation
, par exemple, que nous avons d’un corps
èn mouvement , change continuellement de relations
à l’égard des fenlàtions que nous avons auffi
des corps qui environnent ce corps qui eft en mouvement
, & que par fon mouvement , ce même
corps produit dans les autres corps des effets conformes
aux fenfations que nous avons de ces corps ;
c’eft-à-dire que nous fortunes affûrés par fexpérience
que les corps agiffent lés uns fur les autres, conformément
aux fenfations que nous avons de leur
groffeur, de leur figure, de leur pefanteur, de leur
confiftànce , de leur foupleffe, de leur rigidité, de
leur proximité ou de leur éloignement, de la vîteffe
& de la direétion de leur mouvement ; qu’un corps
mou, par exemple, cédera à l’aéHond’un corps dur
& fort pefant qui appuyer à fur lui ; qu’tirt corps mû
rapidement caffera uii corps fragile qu’il rencontrera
; qu’un corps dur & aigu percera un corps tendre
contre lequel il feraq>ouffé Fortement ; qu’un corps
chaud me caufera une fenfation de chaleur, &c. En-
forte qu’il y a une correfpondance certaine entre les
corps ôt les fenfations qu’ils nous procurent, entre
nos fenfations & les divers effets que les corps peuvent
opérer Tes uns für les autres, & entre les fenfations
préfentes & les fenfations qui peuvent maître
en nous par tous lès dflrérens rfiouvemens <5c les
difféfêns effets des côrps : d’où réfulte uhe évidtnet
ou une Certitude dé connoiffances à laquelle nous
ne pouvons nous refufer, & par laquelle nous fom-
mès continuellement inftruits dès fenfations agréables
que nous pouvons nous procurer, & desfert-
fatiôns defagréables que nôus voulons éviter. C ’eft
dans cette côrrëfpôndancè que confident, d'ahs lVr-
dre naturel, les regies de notre conduite, hôs intérêts,
notre fciencé, nôtre "bonheur, notre malheur,
& les motifs qui forment S i dirigent nos volôfités.
250. Que nous diftingùohs les fènfàtiOns que noüs
retenons, ou qui nous fônt rappellées par la mémoire,
de celles que nous recevons par l’ufagé aélueï
des fens. C ’eft par la diftinéliôn de ces deux fortes de
fenfations que nous jugeons' âe la piëfencè des Objets
qui affrètent aéluellèment nos fens, & dè l’ab-
fence dé ceux qui nous font rappellés par la mémoire.
Cés deux fortes de fenfations noùs afferent
différemment, lorTque les fens & la mémoire agif-
fént enfemble régulièrement pendant là veille ; àmï»
nous lès diftinguons fûrtement par là maniéré dont
lès unes & tes autres nous affrètent en même téms.
Mais pendant le foinmèii, lotfque nous rê vons, nous
ne recevons des fenfations que par la mémoire dont
^fx,erc*ce en grande partie intercepté , Si nous
n’a^ons pas, parTufage aéluel des fens , dë fenfar
tions oppofées à cellës q’uè nous irecevôns par lâ
mémoire ; celles-ci fixent 'toute l’attention dè l’ef-
prit, & le tiennent dans filktfion , de maniéré qu’il
croit appercèvoir lès Objets mêmes de Tes fenfations."
.
26^. QrtV dans Iè concours de rexercicè "dés fens
St de l’èxércicè 4e là mémoire ,'nous tommes aflec