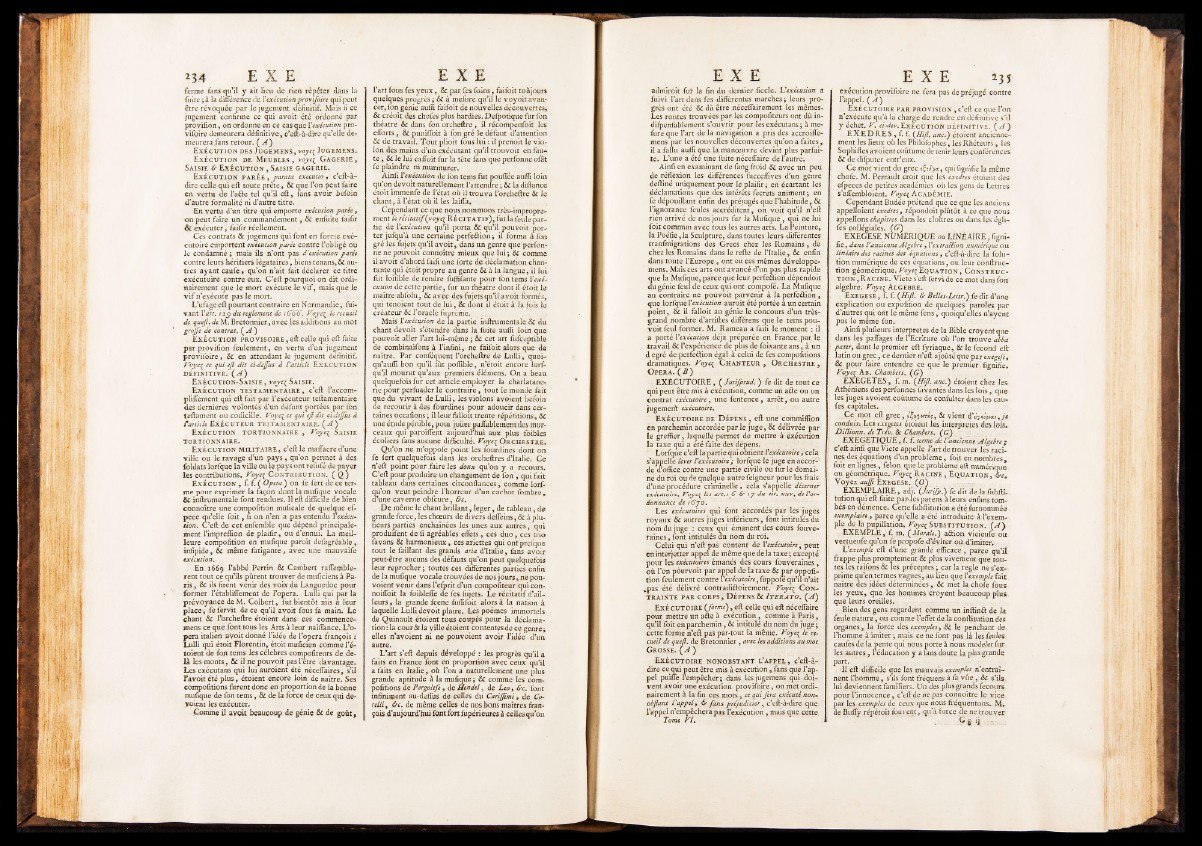
ferme fans qu’il y ait lieu de rien répéter dans la
fuite ;à la différence de l’exécution provifoire qui peut
être révoquée par le jugement définitif. Mais fi ce
jugement confirme ce qui avoit été ordonné, par
provifion, on ordonne en ce cas que l ’exécution pro-
vifoire demeurera définitive, c’eft-à-dire qu’elle demeurera
/ans retour. ( A )
. E x é c u t io n d e s Ju g e m e n s , voye^ Ju g em e n s .
E x é c u t io n d e M e u b l e s , v o y e i G a g e r ie ,
Sa i s ie & E x é c u t io n , Sa is ie g a g e r i e .
Ex é c u t io n p a r é e , parata executio, c’eft-à-
dire celle qui eft toute prête, & que l’on peut faire
en vertu de l'aâe tel qu’il e ft , lans avoir befoin
d’autre formalité ni d’autre titre.
En vertu d’un titre qui emporte exécution parce,
on peut faire un commandement, & enfuite faifir
& exécuter, faifir réellement.
Ces contrats & jugemens qui font en forme exécutoire
emportent exécution parée contre l’obligé ou
le condamné ; mais ils n’ont pas d'exécution parée
contre leurs héritiers légataires, biens tenans,ôc autres
ayant caufe, qu’on n’ait fait déclarer ce titre
exécutoire contre eux. C’eft pourquoi on dit ordinairement
que le mort exécute le v i f , mais que le
v i f n’exécute pas le mort.
L’ufage eft pourtant contraire en Normandie, fui-
vant Y art, / 20 du reglement de 1 CGC. Voye\[ le recueil
de queß, de M. Bretonnier, avec les additions au mot
große de contrat. { A )
E x é c u t io n p r o v i s o ir e , eft celle qui eft faite
par provifion feulement, en vertu d’un jugement
provifoire, & en attendant le jugement definitif.
Foye[ ce qui eß dit ci-deßits à l'article EXÉCUTION
DÉFINITIVE. { A )
E x é c u t io n -S a is ie , yoye^ S a i s ie .
E x é c u t io n t e s t a m e n t a ir e , c’eft l’accom-
pliffement qui eft fait par l’exécuteur teftamentaire
des dernieres volontés d’un défunt portées- par fon
teftament ou codicille. Voyei ce qui eß dit ci-deßits à
(article Ex é c u t e u r t e s t a m e n t a ir e . { A )
E x é c u t io n t o r t io n n a ir e , Voye^ Sa is ie
t o r t io n n a ir e .
E x é c u t io n m i l i t a i r e , c’eft le maffacre d’une
ville ou le ravage d’un p a y s , qu’on permet à des
foldats lorfque la ville ou le pays ont refufé de payer
les contributions. Voye{ C o n t r i b u t io n . ( Q )
Ex é cu t io n , f. f. ( Opera ) on fe fert de ce terme
pour exprimer la façon dont la mufique vocale
& inftrumentale font rendues. Il eft difficile de bien
connoître une compofition muficale de quelque ef-
pece qu’elle fo it , fi on n’en a pas entendu Y exécution.
C ’eft de cet enfemble que dépend principalement
l’impreffion de plaifir, ou d’ennui. La meilleure
compofition en mufique paroît defagréable,
infipide, & même fatigante, avec une mauvaife
exécution.
En 1669 l’abbé Perrin & Cambert raffemble-
rent tout ce qu’ils pûrent trouver de muficiens à Par
is , & ils firent venir des voix du Languedoc pour
former l’établiffement de l’opera. Lulli qui par la
prévoyance de M. Colbert, fut bientôt mis à leur
place, fe fervit de ce qu’il avoit fous fa main. Le
chant & l’orcheftre étoient dans ces commence-
mens ce que font tous les Arts à leur naiflance. L’opera
italien avoit donné l’idée de l’opera françois :
Lulli qui étoit Florentin, étoit muficien comme l’é-
toient de foji tems les célébrés compofiteurs de delà
les monts, & il ne pouvoit pas l’être davantage.
Les exécutans qui lui auroient été néceffaires., s’il
l’avoit été plus, étoient encore loin de naître. Ses
compofitions furent donc en proportion de la bonne
mufique de fon tems, & de la force de ceux qui dévoient
les exécuter.
Comme il avoit beaucoup de génie & de goût,
Part fous fes y e u x , & par fes foins, faifoit toujours
quelques progrès ; & à mefure qu’il le voyoit avancer,
fon genie auffi faifoit de nouvelles découvertes,
&c créoit des chofes plus hardies. Defpotique fur fon
théâtre & dans fon orcheftre, il récompenfoit les
efforts, & puniffoit à fon gré le défaut d’attention
&: de travail. Tout plioit fous lui : il prenoit le violon
des mains d’un exécutant qu’il trouvoit en faute
; &c le lui çaffoit fin- la tête fans que perfonne ofât
fe plaindre ni murmurer.
Ainfi P'exécution de fon tems fut pouffée auffi loin
qu’on devoit naturellement l’attendre ; & la diftance
étoit immenfe de l’état oîi il trouva l’orcheftre & le
chant, à l’état oh il les laiffa.
Cependant ce que nous nommons très-improprement
le récitatif (yoyti R é c i t a t i f ) , fut la feule partie
de l’exécution qu’il porta & qu’il pouvoit porter
jufqu’à une certaine perfection ; il forma à fon
gré les fujets qu’il a voit, dans un genre que perfonne
ne pouvoit connoître mieux que lui ; & comme
il avoit d’abord faifi une forte de déclamation chantante
qui étoit propre au genre & à la langue, il lui
fut loifible de rendre fuffifante pour fon tems Y exécution
de cette partie, fur un theatre dont il étoit le
maître abfolu, & avec des fujets qu’il avoit formés,
qui tenoient tout de lu i, & dont il étoit à la fois le
créateur & l’oracle fuprème.
Mais Y exécution de la partie inftrumentale & du
chant devoit s’étendre dans la fuite auffi loin que
pouvoit aller Part lui-même ; & cet art fufçeptible
de combinaifons à l’infini, ne faifoit alors que de
naître. Par conféquent l’orcheftre de Lu lli, quoi-
qu’auffi bon qu’il fût poffible, n’étoit encore lorsqu'il
mourut qu’aux premiers élémens. On a beau
quelquefois fur cet article employer la charlatane-
rie pour perfuader le contraire, tout le monde fait
que du vivant de Lulli, les violons avoient befoin
de recourir à des fourdmes pour adoucir dans certaines
occafions ; il leur fhlloit trente répétitions, &
une étude pénible, pour jouer paffablement des morceaux
qui paroiffent aujourd’hui aux plus foibles
écoliers fans aucune difficulté. V o y e ^ O r c h e s t r e .
Qu’on ne m’oppofe point les fourdines dont on
fe fert quelquefois dans les orcheftres d’Italie. Ce
n’eft point pour faire les doux qu’on y a recours.
C ’eft pour produire un changement de fon , qui fait
tableau dans certaines circonftances} comme lorf-
qu’on veut peindre l’horreur d’un cachot fombre,
d’une caverne obfcure, &c.
D e même le chant brillant, leger, de tableau, de
grande force, les choeurs de divers deffeins, & à plusieurs
parties enchaînées les unes aux autres, qui
produifent de fi agréables effets, ces duo, ces trio
lavans & harmonieux, ces ariettes qui ont prefque
tout le faillant des grands aria d’Italie, fans avoir
peut-être aucuns des défauts qu’on peut quelquefois
leur reprocher ; toutes ces différentes parties enfin
de la mufique vocale trouvées de nos jours, ne pou-
voient venir dans l’eforit d’un compofiteur qui con-
noiffoit la foibleffe de fes fujets. Le récitatif d’ailleurs
, la grande feene fuffifoit alors à la nation à
laquelle Lulli devoit plaire. Les poëmes immortels
de Quinault étoient tous coupés pour la déclamation
: la cour & la ville étoient contentes de ce 1 genre ;
elles n’avoient ni ne pouvoient avoir l’idée d’un
autre.
L ’art s’eft depuis développé : les progrès qu’il a
faits en France font en proportion avec ceux qu’il
a faits en Italie, où l’on a naturellement une plus
grande aptitude à la mufique; & comme les compofitions,
de Pergolefe , de Hendel, de Léo, &c. font
infiniment au-deffus de celles du CariJJimi, de Co-
relli, &c. de même celles de nos bons maîtres françois
d’aujourd’hui font fort fupérieures à celles qu’on
1
E X E
admiroit fur la fin du dernier fiecle. L’'exécution a
fuivi l’art dans Tes différentes marches ; leurs progrès
ont été & dû être néceffairement les mêmes.
Les routes trouvées par les compofiteurs ont dû in-
difpenfablement s’ouvrir pour les exécutans ; à mefure
que l’art de la navigation a pris des accroiffe-
mens par les nouvelles découvertes qu’on a faites,
il a fallu auffi que. la manoeuvre devînt plus parfaite.
L’une a été une fuite néceffaire de l’autre.
Ainfi en examinant de fang froid & avec un peu
de réflexion les différences fucceffives d’un genre
deftiné uniquement pour le plaifir ; en écartant les
déclamations que des intérêts feçrets animent ; en
fe dépouillant enfin des préiugés que l’habitude, &
l ’ignorance feules accréditent, on voit qu’il n’ eft
rien arrivé de nos jours fur la Mufique, qui ne lui
foit commun avec tous les autres arts. La Peinture,
la Poéfie, la Sculpture, dans toutes leurs différentes
tranfmigrations des Grecs chez les Romains, de
chez les Romains dans le refte de l’Italie, & enfin
dans toute l’Europe, ont eu ces mêmes développe-
mens. Mais ces arts ont avancé d’un pas plus rapide
que la Mufique, parce que leur perfection dépendoit
du génie feul de ceux qui ont compofé. La Mufique
au contraire ne pouvoit parvenir à la perfeftion ,
que lorfque Y exécution auroit été portée à un certain
point, & il falloit au génie le concours d’un très-
grand nombre d’artiftes différens que le tems pouvoit
feul former. M. Rameau a faifi le moment : il
a porté Y exécution déjà préparée en France par le
travail & l’expérience de plus de foixante ans, à un
d egré de perfection égal à celui de fes compofitions
dramatiques. Voye1 C h a n t e u r , O r c h e s t r e ,
O p é r a . ( B )
EXÉCUTOIRE, Ç Jurifprud. ) fe dit de tout ce
qui peut être mis à execution, comme un a&e ou un
contrat exécutoire, une fentence, arrêt, ou autre
jugement exécutoire,
E x é c u t o ir e d e D é pens , eft une commiffion
en parchemin accordée par le juge, & délivrée par
le greffier, laquelle permet de mettre à exécution
la taxe qui a été faite des dépens.
Lorfque c’eft la partie qui obtient Y exécutoire, cela I
s’appelle lever Cexecutoire; lorfque le juge en accor-J
de d’office contre une partie civile ou fur le domaine
du roi ou de quelque autre feigneur pour les frais
d’une procédure criminelle, cela s’appelle décerner
exécutoire. Voye{ les art.i € (f t y du tit. xxv, de l'ordonnance
de iGyo.
Les executoires qui font accordés par les juges
royaux & autres juges inférieurs, font intitulés du
nom du juge : ceux qui émanent des cours fouve-
raines, font intitulés au nom du roi.
Celui qui n’eft pas content de Y exécutoire, petit
eninterjetter appel de même que de la taxe; excepté
pour les exécutoires émanés des cours fouveraines,
où l’on pourvoit par appel de la taxe & par oppofi-
fion feulement contre Xexécutoire, fuppofë qu’il n’ait
»pas été délivré contradiftoirement. Voye^ C o n t
r a in t e p a r c o r p s , D é p e n s & I t e r a t o . {A )
E x é c u t o ir e {formé) , eft celle qui eft néceffaire ;
pour mettre un a&e à exécution, comme à Paris,
qu’il foit en parchemin, & intitulé du nom du juge ;
cette forme n’eft pas par-tout la même. Voyt{ le recueil
de quejl. de Bretonnier, avec les additions au mot
G r o s s e . ( A )
Ex é c u t o ir e n o n o b s t a n t l ’a p p e l , c’eft-à-
dire ce qui peut être mis à exécution, fans que l’appel
puiffe l’empêcher; dans les jugemens qui doivent
avoir une exécution provifoire, on met ordinairement
à la fin ces mots, ce qui fera exécuté non-
objlant l'appel, <S* fans préjudicier, c’eft-à-dire que.
l’appel n’empêchera pas l’exécution, mais que cette
Tome Kl»
E X E 1 3 5
exécution provifoire ne fera pas de préjugé contre
l’appel. { A )
. E x é c u t o ir e p a r p r o v is io n , c’eft ce que l’on
n’exécute qu’à la charge de rendre en définitive s’il
y échet. V. d-dev. Ex e c u t io n d é f in it iv e . ( A )
EXEDRE S , f. f. {Hifi. anc.) étoient anciennement
les lieux où les Philofophes, les Rhéteurs, les
Sophiftes avoient coûtume de tenir leurs conférences
& de difputer entr’eux.
Ce mot vient du grec qui lignifie la même
chofe. M. Perrault croit que les exedres étoient des
efpeces de petites académies où les gens de Lettres
s’affembloient. Voye^ A c a d é m ie .
Cependant Budée prétend que ce que les anciens
appelloient exedres, répondoit plutôt à ce que nous
appelions chapitres dans les cloîtres ou dans les égli-
fes collégiales. (G)
EXEGESE NUMÉRIQUE ou LINÉAIRE, figni-
fie, dans Vancienne Algèbre , Y extraction numérique ou
linéaire des racines des équations , c’eft-à-dire la folu-
tion numérique de ces équations, ou leur conftruc-
tion géométrique. Voye^É q u a t io n , C o n s t r u c t
io n , R a c in e ; Viete s’eft fervi de ce mot dans fon
algèbre. Voye[ A l g è b r e .
E x e g e s e , 1. f. (Hifl. & Belles-Lettré) fe dit d’une
explication ou expofition de quelques paroles par
d’autres qui ont le même fens, quoiqu’elles n’ayent
pas le même fon.
Ainfi plufieurs interprètes de la Bible crdyentque
dans les paffages de l’Ecriture où l’on trouve abba
pater, dont le premier eft fyriaque, & le fécond eft:
latin ou grec, ce dernier n’eft ajouté que par exegefe,
& pour faire entendre ce que le premier fignifie.
Voye^ A b . Chambers. (G )
EXEGETES, f. m. {Hifl. anc Y) étoient chez les
Athéniens des perfonnes favantès dans les lo is, que
les juges a voient,coutume de confulter dans les eau-,
fes capitales.
Ce mot eft grec ; , & vient d-'éyto/Mzi ,j e
conduis. Les exegçtes étoient les interprètes des lois.
Dictionn. de Trév. & Chambers. {G)
ÉXÉGETIQUË, f. f. terme de l'ancienne Algèbre ;
c’eft ainfi que Viete appelle l’art de trouver les racines
des,équationç d’un problème, foit en nombres,
foit en lignes, félon que le problème' eft numérique
ou géométrique. Voyeç R a c in e , E q u a t io n , &c„
Voyez auffi È x e g ESE. (O)
EXEMPLAIRE, adj. {Jurifp.) fe dit delà fubfti-
tution qui eft faite par4es parens à leurs enfans tombés
en démence. Cette fubftitution a été furnommée
exemplaire, parce qu’elle a été introduite à l’exemple
de la pupillation. Voye^S u b s t i t u t io n . ( A )
EXEMPLE, f. m. {Morale.) aétion viçieufe ou
vertueufe qu’on fe propofe d’éviter ou d’imiter.
Vexemple eft d’une grande efficace, parce qu’il
frappe plus promptement & plus vivement que toutes
les raifons & les. préceptes ; car la réglé ne s’exprime
qu’en termes vagues, au lieu que Y exemple fait
naître des idées déterminées, & met la chofe fous
les yeux, que les hommes croyent beaucoup plus
que leurs oreilles.
Bien des gens regardent comme un inftintt de la
feule nature, ou comme l’effet de la çonftitution des
organes , la force des exemples, & le penchant de
l’homme à imiter ; mais ce ne font pas là les feules
caufes de ia pente qui nous porte à nous modeler fur
les autres, l’éducation y a lans doute la plus grande
part.
'Il eft difficile que les mauvais exemples n’entraînent
l’homme, s’ils font fréquens à fa vue , & s’ils,
lui deviennent familiers. Un des plus grands fecours
pour l’innocence, c’eff de ne pas connçntre le vice
par les exemples de ceux que nous fréquentons. M.
de Buffy répétoit fou vent, qu’à force de ne trouver;