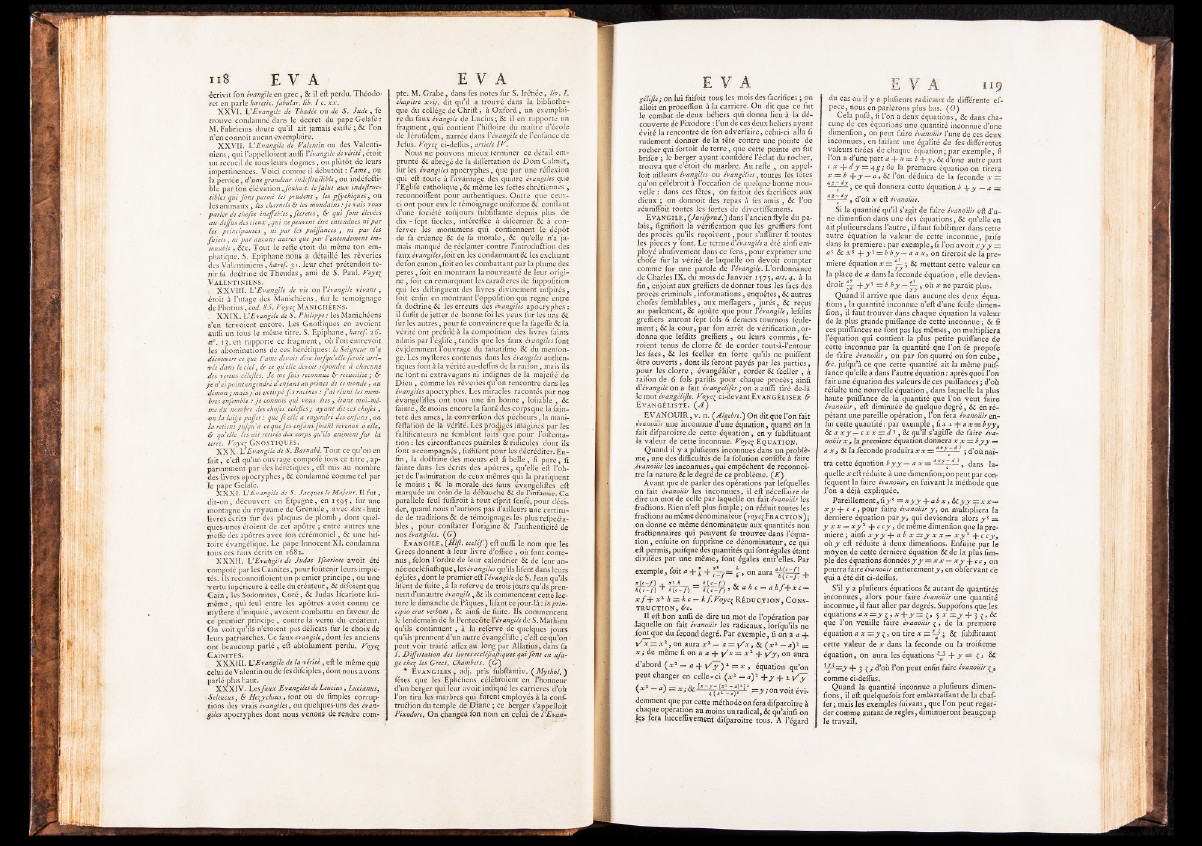
■ écrivit fon évangile en grec, & il eft perdu. Théodo-
ret en parle hceretic. fabular. lib. I c. x x.
XXVI. L’Evangile de Thadée ou de S. Jude , fe
trouve condamné dans le decret du pape Gelafe :
M. Fabricius doute qu’il ait jamais exifté ; & l’on
n’en connoît aucun exemplaire.
XXVII. L'Evangile de Valentin ou des Valentiniens
, qui l’appelloient auffi l’évangile devérité, étoit
un recueil de tous leurs dogmes, ou plûtôt de leurs
impertinences. Voici comme il débutoit : Vame, où
la peniée, d'une grandeur indefiruclible, ou indéfectible
par fon élévation ,fouhaité lefalut aux indejlruc-
tibles qui font parmi Les prudens , les pfychiques, OU
les animaux, l'es charnels & les mondains : je vais vous
■ parler de chofes ineffables.rfecretes, & qui font élevées
■ au-deffus des deux, qui ne peuvent être entendues ni par
les principautés , ni par les puiffances , . ni par les
fujets, ni par aucuns autres que par l'entendement immuable
, & c . Tout le relie étoit du même ton emphatique.
S. Epiphane nous a détaillé les rêveries
des Valentiniens, haref. g i. leur chef prétendoit tenir
fa doCtrine de Theudas, ami de S. Paul. Voyc{ Valentiniens.
: XXVIII. L’Evangile de vie ou l’évangile vivant,
étoit à l’ufage des Manichéens, fur le témoignage
de-Photius ,=cod. 85. Voye^ Manichéens.
. XXIX. Evangile de S. Philippe: les Manichéens
s’en lervoient encore. Les Gnoftiques en a voient
auffi un fous le même titre. S. Epiphane, haref 2G.
n°. 13. en rapporte ce fragment, oh l’on entrevoit
les abominations de ces hérétiques : le Seigneur m'a
découvert-ce que l'ame dev oit dire Lorfqu'elle fer oit arrivée
dans le ciel, & ce qiielle devoit répondre à chacune
des vertus céleftes. Je me fuis reconnue & recueillie ; &
j e riai point engendré d'enfans auprince de ce monde , au
démon • mais fa i extirpé f s racines : f a i réuni les membres
enfemble-: je connais qui vous êtes, étant moi-même
du nombre des chofes céleftes; ayant dit ces chofes ,
on la laiffe paffér : que f i elle a engendré des enfans, on
la retient juj'quà ce que fies enfans foient revenus à elle,
£> quelle les ait retirés des corps qu'ils animent fur la
terre. Voye^ GnoSTIQUES.
X X X . L’Evangile de S . Barnabe. Tout ce qu’on en
fa it , c’eft qu’un ouvrage compofé fous ce titre, apparemment
par des hérétiques , eft mis au nombre
des livres .apocryphes, & condamné comme tel par
îe pape Gelafe.
XXXI. L'Evangile de S. Jacques le Majeur. Il fu t,
dit-on, découvert en Efpagne, en 1595, fur une
montagne du royaume de Grenade, avec dix - huit
livres écrits fur des plaques de plomb, dont quelques
unes étoient de cet apôtre ; entre autres une
meffe des apôtres avec fon cérémoniel, & une hif-
toire évangélique. Le pape Innocent XI. condamna
tous ces faux écrits en i68z.
XXXII. L'Evaûgi/e de Judas Tfcariote avoit été
compofé par les Cainites , pour foûtenir leurs impiétés.
Ils reconnoiflbient un premier principe, ou une
■ vertu fupérieure à celle du créateur, & difoient que
G a in , les Sodomites, C o ré , & Judas Ifcariote lui-
même , qui fèùl entre les apôtres avoit connu ce
'myflere d’iniquité, avoient combattu en faveur-de
-ce premier principe , contre la vertu du créateur.
On voit qu’ils n’étoient pas délicats fur le choix de
•leurs patriarches. Ce faux évangile, dont les anciens
ont beaucoup parlé, eft abfolument perdu. Voyei
C aïnites. v . XXXIII. L’Evangile de la vérité, eft le même qùe
.celui de Valentin ou de fes difciples, dont nous avons
.parlé plus haut.
XXXIV. Les faux Evangiles de Leuçius, Lucianus,
. Seleucus, 6* He^ychiüs, font ou de fimples corruptions
des vrais.évangiles, ou quelques-uns des évangiles
apocryphes dont nous venons de rendre compte;
M. G rabe, dans fes notes fur S. Iréftée, Uv. I.
chapitre xvij. dit qu’il a trouvé dans la bibliothèque
du collège de Chrift, à Oxford, un exemplaire
du faux évangile de Lucius; & il en rapporte un
fragment, qui contient l’hiftoire du maître d’école
de Jérufalem, narrée dans l’évangile de l’enfance de
Jefus. Voyeç ci-deffus, article IV.
Nous ne pouvons mieux terminer ce détail emprunté
& abrégé de la differtation de Dom Calmet,
lur les évangiles apocryphes, que par une réflexion
qui eft toute à l’avantage des quatre évangiles que
l’Eglife catholique, & même les feéles chrétiennes ,
reconnoiffent pour authentiques. Outre que ceux-
ci ont pour eux le témoignage uniforme &c confiant
d’une fociété toûjours fubfiftante depuis plus de
dix - fept fiecles, intéreffée à difcerner & à con-
ferver les monumens qui contiennent le dépôt
de fa créance & de fa morale, & qu’elle n’a jamais
manqué de réclamer contre l’introduûion des
faux évangiles fort en les condamnant & les excluant
de fon canon ,foit en les combattait par la plume des
peres, foit en montrant la nouveauté de leur origine
, foit en remarquant les carafreres de fuppofition
qui les diftinguent des livres divinement infpirés ,
foit enfin en montrant l’oppofition qui regne entre
fa doôrine & les erreurs des évangiles apocryphes :
il fuflit de jetter de bonne foi les yeux fur les uns &
fur les autres, pour fe convaincre que la fageffe & la
vérité ont préfidé à la compofition des livres faints
admis par l’églife, tandis que les faux évangiles font
évidemment l’ouvrage du fanatifme & du menfon-
ge. Les myfteres contenus dans les évangiles authentiques
font à la vérité au-deffus de la raifon, mais ils
ne font ni extra vagans ni indignes de la majefté de
D ie u , comme les rêveries qu’on rencontre dans les
évangiles apocryphes. Les miracles racontés par nos
évangéliftes ont tous une fin bonne , loiiable , &c
fainte, & moins encore la fanté des corps que la fain-
teté des âmes, la converfion des pécheurs, la mani-
feftation de la vérité. Les prodiges imaginés par les
falfificateurs ne femblent faits^ que pour l’oflenta-
tion : les circonftances puériles & ridicules dont ils
font accompagnés, fuflifent pour les décréditer. Enfin,
la doôrine des moeurs eft fi belle, fi pure, fi
fainte dans les écrits des apôtres, qu’elle eft l’objet
de l’admiration de ceux mêmes qui la pratiquent
le moins ; & la morale des faux évangéliftes eft
marquée au coin de la débauche & de l’infamie. Ce
parallele feul fuflïroit à tout efprit fenfé, pour décider,
quand nous n’aurions pas d’ailleurs une certitude
de traditions & de témoignages les plus refpefra-
bles , pour conftater l’origine ôc l’authenticité de
nos évangiles. (G) Evangile, (.Hlfi. eccléf) eft auffi le nom que les
Grecs donnent à leur livre d’office, où font contenus
, félon l’ordre de leur calendrier & de leur année
eccléfiaftique, les évangiles qu’ils lifent dans leurs
églifes, dont le premier eft l’évangile de S. Jean qu’ils
lifent de fixité, à la referve de trois jours qu’ils prennent
d’un aiitre évangile, & ils commencent cette lecture
le dimanche de Pâques, lifant ce jour-là:i/zprin-
cipio erat verbum, & ainfi de fuite. Ils commencent
le lendemain de la Pentecôte l'évangile de S. Mathieu
qu’ils continuent , à la referve de quelques jours
qu’ils prennent d’un autre évarigélifte ; c’eft ce qu’on 1
peut voir traité affez au long par Allatius, dans fa
I. Differtation des livres eccléfiajtiques qui font en ufa-
ge ehe£ les Grecs. Chambers. (G)
* Evangiles, adj. pris fubftàritiv. ( Mythol. )
fêtes que les Éphéfiens célébroient en l’honneur
d’un berger qui leur avoit indiqué les carrières d’où
l’on tira les marbres qui furent employés à la conf-
trufrion du temple de Diane ; ce berger s’appelloit
Pixodore, On changea fon nom en celui de l ’Evangélifie;
on lui faifoit tous les mois des facrifices ; on
alloit en proceffion à la carrière. On dit que ce fut
le combat de deux béliers qui donna lieu à la découverte
de Pixodorç : l’un de ces deux béliers ayant
évité la rencontre de fon advêrfaire, celui-ci alla fi
rudement donner de la tête contre une pointé de
rocher qui fortoit de terre, que cette pointe en frit
brifée ; le berger ayant oonlidéré l’éclat du rocher,
trouva que c’etpit du marbre. An relie , on appel-
■ loit ailleurs évangiles ou évangèlies, toutes lès fêtes
.qu’on çélébroit à l’occafion de quelque-bonhe nouvelle
: dans ces fêtes, on faifoit des facrifices aux
dieux ; on donnoit des repas à fes amis., oc l’on
réunifïbit toutes les fortes de divertifTemens. Evangile , ( Jurifprud.) dans l’ancien ftyle du palais
, fignifioit la vérification que les greffiers font
des procès qu’ils reçoivent, pour s’àfTùrer fi toutes
les pièces y font. Le terme d'évangile a été âinfi employé
abufivement dans ce fens, pour exprimer une
chofe fur la vérité de laquelle on devoit compter
comme fur une parole de l’évangile. L’ordonnance
de Charles IX. du mois de Janvier 1575, art. 4. à la
fin, enjoint aux greffiers de donner tous les fàcs des
procès criminels, informations, enquêtes, & autres
Chofes femblables, aux meflagers , jurés, & reçus
au parlement, & ajoute que pour l'évangile, lefdits
greffiers auront fept fols 6 deniers tournois feuler
ment ; 6ç la cour, par fon arrêt de vérification, or-
.donna que lefdits greffiers , ou leurs commis, feraient
tenus de clorre & de corder tout-à-l’ento.ur
les faes, Sc les fçeiler en forte qu’ils ne puiflent
.être ouverts , dont ils feront payés par les parties,
pour les clorre, évangélifer, corder & fcèller , à
raifon de 6 fols parifis pour chaque procès; ainfi
à?évangile on a. fait éyangélifer; on a aiiffi tiré de-là
le mot évangélifie. Voyeç çi-devant Evangéliser & Evangéliste.
EVANOUIR, v. n. (AlgèbreJ) On dit que l’on fait
.évanouir une inconnue d’ fait difparoîtrede cette éuqnue aétqiouna,t ieonn , quand on la la valeur de cette inconnue. y fubftituant Voye^ Equation.
Quand il y a plufieurs inconnues dans un problème,
une des difficultés de la folution conûûe à faire
fvanoiiir les inconnu.es, qui empêchent de reconnoî-
.tre la nature & le degré de ce problème. (E )
Avant que de parler des opérations par lefquelles
.on fait évanouir les inconnues, il eft néceflaire de
.dire un mot de celle par laquelle on fait évanouir les
•frafrions. Rienn’eft plus fimple; on réduit toutes les
fraélions au même dénominateur (yoyeçfiR action);
.on donne ce même dénominateur aux quantités non.
frafripnnaires qui peuvent fe trouver dans l’équa-
lion , enfuite on fupprime ce dénominateur, ce qui
eft permis, puilque des quantités qui font égales étant
.divifé.es par une même, font égales entr’elles. Par
.exemple^ foit a + J .+ f—f ~ J-, on aura^ 7 ^ . 4 .
,s(7^7) "T hÇZJ) — Â{c—7) ,< S t a h c - a h f + x c -
x x h^=.k c —kf.Voye{ RÉDUCTION, Construction,
&ç.
Il eft,bon auffi de dire un mot de l’opération par
■ laquelle on fait évanoiiir les radicaux, lorfqu’ils ne
Tonique du fécond degré. Par exemple, fi on a a.-j-
V x = y 1 , on aura x 7-.— a — y / x 3 & (# 2 — a fi ■ =.
x ; de même fi on a a -\-yrx zz x x q- \ fy , on aura
d’abord ( x 1 — a + \J y ) 1 = x , équation qu’on
peut changer en ce lle-ci ( x 1 - a )1 + y + 2
demment que par cette méthode on fera difparoître
chaque operation au moins un radical, & qu’ainfi c
les fera fucceffiveinent difparoître tous. A l’égai
du cas où il y a plufieurs radicaux de différente ef-
peçe, nous en parlerons plus bas. (O)
Cela pofé, fi l’on a deux équations, & dans chacune
de ces équations une quantité inconnue d’une
dimenfion, on peut faire évanouir l’une de ces deux
inconnues, en faifant une égalité de les différentes
valeurs tirees de chaque équation; par exemple, fi
l’on a dfune part a 4- x = b -j-y, & d’une autre part
c x + d y = A g i de la première équation on tirera
x b + y — a , Sc l’on déduira de la fécondé x ==
— £— , te qui donnera cette équation b q- y — a =;
y , d’o.ù x eft évanouie.
Si la quantité qu’il s’agit de faire évanouir eft d’une
dimenfion dans une des équations, & qu’elle en
ait plufieurs dans l’autre, il faut fubftituer dans cette
autre équation la valeur de cette inconnue, prife
dans la première : par exemple, fi l’on avoit $ y y
al ÔC x 1 -j- y } =zb b y— a a x , on fireroit de la première
équation x = a— ; & mettant cette valeur en
la place de x dans la fécondé équation, elle devien»
droit j j - -jryl — b b y ~ » où x ne paraît plus.
Quand il arrive que dans aucune des deux équations,
la quantité inconnue n’efl d’une feule dimenfion,
il faut trouver dans chaque équation la valeur
de la plus grande puiffance de cette inconnue ; & fi
ces puiffances ne font pas les mêmes, on multipliera
l’équation qui contient la plus petite puiffance de
cette inconnue par la quantité que l’on fe propofe
de faire évanouir, ou par fonquarré ou fon cube,
&c. jufqu’à cè que cette quantité ait la même puiffance
qu’elle ^ dans l’autre équation : après quoi l’on
faitune équation des valeurs de ces puiffances ; d’où
réfulte une nouvelle équation, dans laquelle la plus
haute puiffance de la quantité que l’on veut faire
évanouir , eft diminuée de quelque degré, & en répétant
une pareille opération, l’on fera évanouir enfin
cette quantité : par exemple ,û x x - j - a x = b y y ,
& a x y — c x x zp d ? , 8c qu’il s’agiffe de faire évanouir
x , la première équation donnera x x — b y y —
a x , & la féconde produira x x= z ; d’où naîtra
cette équation b y y — a x = — , dans laquelle
a: eft réduite à une dimenfion; on peut par con-
fequent la faire évanouir, en fuivant la méthode que
l’on a déjà expliquée.
Pareillement, fi y * = x y y f r a b x ,& c y y ~ x x —
x y -\ - c c , pour faire évanouir y , on multipliera la
derniere équation par y , qui deviendra alors y ? =3;
y x x — x y x -j- c c y , de même dimenfion que la première
; ainfi x y y -J- a b x ■ =* y x x — X y 2 + ç c y ,
où y eft réduite à deux dimenfions. Enfuitê par le
moyen de cette derniere équation & de la plus fimple
des équations données y y — x x — x y 4-c e , oix
pourra faire évanouir entièrement y , en ôbfervant ce
qui a été dit ci-deffus.
S’il y a plufieurs équations & autant de quantités
inconnues, alors pour faire évanouir une quantité
inconnue, il faut aller par degrés. Suppofons qûe.les
équations ax-=.y ç , x - j - y — ç , ç x = y q- 3 &
que l’on veuille faire évanouir de la première
équationa x — y on tire x=2A- • & fubftituant
cette valeur de x dans la fécondé ou la troifietne
équation, on aura les équations y-^ + y — l»
~^ = y + 3 U d’où l’on peut enfin faire évanouir £ ,
comme ci-deffus.
Quand la quantité inconnue a plufieurs dimenfions,
il eft quelquefois fort embarraffant de l.a chaf.
fer; mais les exemples fui vans, que l’on peut regarder
comme autant de réglés, diminueront beaucoup
le travail.