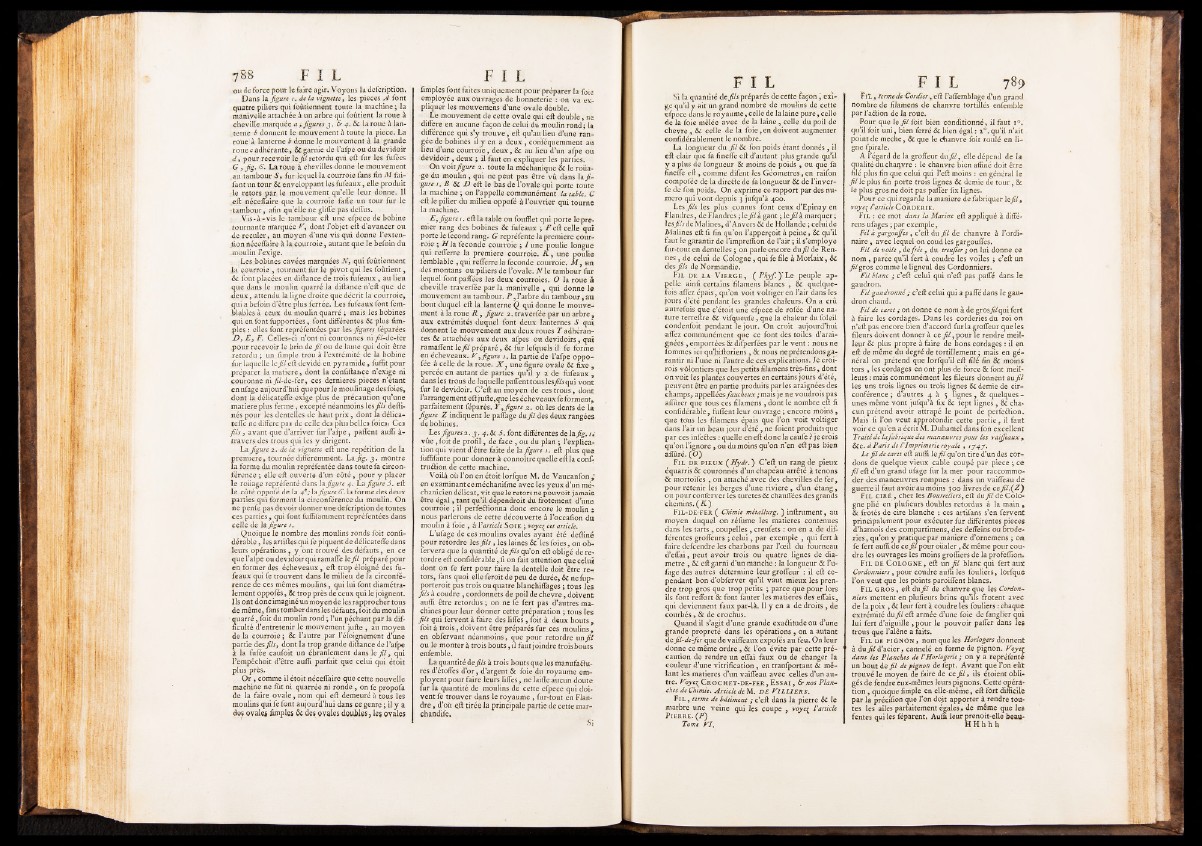
ou de force pour le faire agir. Voyons la defcription.
Dans la figure i. de la vignette, les pièces A font
quatre piliers qui foûtiennent toute la machine ; la
manivelle attachée à un arbre qui foûtient la roue à
cheville marquée a -, figures j . & 4. 8c la roue à lanterne
b donnent le mouvement à toute la piece. La
roue à lanterne b donne le mouvement à la grande
roue c adhérante, & garnie de l’afpe ou du dévidoir
d , pour recevoir le f i l retordu qui eft fur les fufées
G , fig. C. La roue, à chevilles donne le mouvement
,au (tambour S , fur lequel la courroie fans fin M fai-'
fant un tour & enveloppant les Fufeaux, elle produit
■ le retors par. le mouvement qu’elle leur donne. 11
eft néceffaire que la courroie faffe un tour fur le
•tambour, afin qu’elle ne gliffe pas deffus.
: Vis-à-vis le tambour eft une efpece de bobine
. tournante marquée V , dont l’objet eft d’avancer ou
de reculer, au moyen d’une vis qui donne l’exten-
fion néceffaire à la; courroie, autant que le befoin du
-moulin l’exige.
Lesrbobines cavées marquées N , qui foûtiennent
la courroie ., tournent fur le pivot qui les foûtient,
& font placées en diftance de trois fufeaux, au lieu
que dans le moulin quarré la diftance n’eft que de
.deux, attendu la ligne droite que décrit la courroie,
qui a befoin d’être plus ferrée. Les fufeaux font fem-
blables à ceux du moulin quarré ; mais les bobines
qui en font fupportées, font différentes 8c plus Amples
: elles font repréfentées par les figures féparées
D , E , F. Celles-ci n’ont ni couronnes ni j?/-de-fer
.pour recevoir le brin de f i l ou de laine qui doit être
retordu ; un fimple trou à l ’extrémité de la bobine
fur laquelle le f i l eft dévidé en pyramide, fuffit pour
préparer la matière, dont la confiftance n’exige ni
couronne ni fil-d e -ïe r , ces dernieres pièces n’étant
enufage aujourd’hui que pour le moulinage des foies,
dont la délicateffe exige plus de précaution qu’une
matière plus ferme, excepté néanmoins les fils defti-
nés pour les dentelles de haut prix, dont la délicateffe
ne différé pas de celle des plus belles foies. Ces
f i l s , avant que d’arriver fur l’afpe, paffent aufli à-
travers des trous qui les y dirigent.
La figure 2 . de la vignette eft une répétition de la
première j tournée différemment. La fig. 3. montre
la forme-du moulin repréfentée dans toute fa circonférence
; elle eft ouverte d’un côté , pour y placer
le rouage repréfenté dans la figure 4. La figure 5 . eft
le côté oppofé de la 4e; la figure S. la forme des deux
parties qui forment la circonférence du moulin. On
ne penfe pas devoir donner une defcription de toutes
ces parties, qui font fuffifamment repréfentées dans
celle de la figure 1.
Quoique le nombre des moulins ronds foit confi-
dérable, les artiftes qui fe piquent de délicateffe dans
leurs opérations, y ont trouvé des défauts, en ce
que l’afpe ou dévidoir qui ramaffe le f i l préparé pour
en former des écheveaux, eft trop éloigné des fufeaux
qui fe trouvent dans le milieu de la circonférence
de ces mêmes moulins, qui lui font diamétralement
oppofés, 8c trop près de ceux qui le joignent.
Ils ont donc imaginé un moyen de les rapprocher tous
de même, fans tomber dans les défauts, foit du moulin
uarré, foit du moulin rond ; l’un péchant par la dif-
culté d’entretenir le mouvement jufte , au moyen
de la courroie ; 8c l’autre par l’éloignement d’une
partie des fils , dont la trop grande diftance de l ’afpe
à la fufée caufoit un ébranlement dans le f i l , qui
l’empêchoit d’être aufli parfait que celui qui étoit
plus près.
Or , comme il étoit néceffaire que cette nouvelle
machine ne fut ni quarrée ni ronde, on fe propofa
de la faire ovale, nom qui eft demeuré à tous les
moulins qui fe font aujourd’hui dans ce genre ; il y a
des ovale« Amples & des ovales doubles, le« ovales
iimples font faites uniquement pour préparer la foie
employée aux ouvrages de bonneterie : on va expliquer
les mouvemens d’une ovale double.
Le mouvement de cette ovale qui eft double, ne
différé en aucune façon de celui du moulin rond ; la
différence qui s’y trouve, eft qu’au lieu d’une rangée
de bobinêà il y en a deux , conféquemment au
lieu d’une courroie, deux, 8c au lieu d’un afpe ou
dévidoir , deux ; il faut en expliquer les parties.
On-voitfigure 2 . tôute la méchanique 8c le rouage
du moulin, qui ne peut pas être vû dans la ƒ -
'gure /. B 8c D eft le bas de l’ovale qui porte toute
la machine ; on l’appelle communément la table. C
eft le pilier du milieu oppofé à l’ouvrier qui tourne
la machine.
^■ ifigure '• eft la table ou foufflet qui porte le premier
rang des bobines 8c fufeaux ; F eft celle qui
porte le fécond rang. G repréfente la première courroie
; H la fécondé courroie ; I une poulie longue
qui refferre la première courroie. K , une poulie
iemblable , qui refferre la fécondé courroie. M , un
■ des montans ou piliers de l’ovale. N le tambour fur
lequel font paffées les deux courroies. O la roue à
cheville traverfée par la manivelle , qui donne le
mouvement au tambour. P , l’arbre du tambour, au
bout duquel eft la lanterne Q qui donne le mouvement
à la roue R , figure 2 . traverfée par un arbre ,
aux extrémités duquel font deux lanternes S qui
donnent le mouvement aux deux roues T adhérantes
8c attachées aux deux afpes ou dévidoirs, qui
ramaffent le f i l préparé, 8c fur lefquels il fe forme
en écheveaux. y , figure 1. la partie.de l’afpe oppo-
fee à celle de la roue. AT, une figure ovale 8c fixe ,
percée en autant de parties qu’il y a de fufeaux ,
dans les trous de laquelle paffent tous lesfils qui vont
fur le dévidoir. C’eft au moyen de ces trous, dont
l’arrangement eft jufte,que les écheveaux fe forment,
parfaitement féparés. Y , figure 2 . oit les dents de la
figure Z indiquent le paffage du f i l des deux rangées
de bobines.
Les figures 2 . 3 .4 .8 c 5 . font différentes de la fig. r,
vûe, foit de profil, de face , ou du plan ; l’explication
qui vient d’être faite de la figure 1. eft plus que
fuflifante pour donner à connoître quelle eft la confi
traétion de cette machine.
Voilà oit l’on en étoit lorfque M. de Vaucanfon ;
en examinant ce méchanifme avec les yeux d’un mé-
chanicien délicat, vit que le retors ne pou voit jamais
être égal, tant qu’il dépendrait du frotement d’une
courroie ; il perfeftionna donc encore le moulin ï
nous parlerons de cette découverte à l’occafion du
moulin à foie , à Varticle S o i e ; voye%_ cet article.
L’ufage de ces moulins ovales ayant été deftiné
pour retordre les f i l s , les laines 8c les foies, on ob-
lervera que la quantité de fils qu’on eft obligé de retordre
eft conlidérable, fi on fait attention que celui
dont on fe fert pour faire la dentelle doit être retors,
fans quoi elle ferait de peu de durée, 8c ne Apporterait
pas trois ou quatre blanchiffages ; tous les
fils à coudre , cordonnets de poil de chevre, doivent
aufli être retordus ; on ne le fert pas d’autres machines
pour leur donner cette préparation ; tous les
fils qui fervent à faire des liffes, (oit à deux bouts ,
foit à trois, doivent être préparés fur ces moulins ,
en obfervant néanmoins, que pour retordre un f i l
ou le monter à trois bouts, il faut joindre trois bouts
enfemble.
La quantité de fils à trois bouts que les manufactures
d’étoffes d’o r, d’argent & foie du royaume em-
ployent pour faire leurs liffes, ne laiffe aucun doute
fur la quantité de moulins de cette efpece qui doivent
fe trouver dans le royaume , fur-tout en Flandre
, d’oit qft tirée la principale partie de cette mar-
çhandife.
Si
Si la quantité de f i l s préparés de cette façon ] exige
qu’il y ait un grand nombre de moulins de cette
■ efpece dans le royaume, celle de la laine pure, celle
de la foie mêlée avec de la laine , celle du poil de
chevïe, 8c celle de la foie,en doivent augmenter
confidérablement le nombre.
La longueur du f i l 8c fon poids étant donnés , il
eft clair que fa fineffe eft d’autant plus grande qu’il
y a plus de longueur & moins de poids , ou que fa
nneffe eft, comme difent les Géomètres, en raifon
compofée de la dire&e de fa longueur & de l’inver-
fe de fon poids. On exprime ce rapport par des nu*
mero qui vont depuis 3 jufqu’à 400.
Les f i l s les plus connus Lfont ceux d*Epinay en
Flandres, de Flandres ; le f i l à gant ; le f i l à marquer ;
lesfils de Malines, d’Anvers 8c de Hollande ; celui de
JMalines eft fi fin qu’on i’apperçoit à peine, 8c qu’il
faut le garantir de l’impreflîon de l’air ; il s’employe
Fur-tout en dentelles ; on parle encore du f i l de Rennes
, de celui de Cologne, qui fe file à Morlaix, 8c
d e s f i l s de Normandie.
F i l d e l a V i e r g e , ( P h y fi )' Le peuple appelle
ainfi certains filamens blancs , 8c quelquefois
allez épais, qu’on voit voltiger en l’air dans les
jours d’été pendant les grandes chaleurs. On a crû
autrefois que c’étoit une efpece de rofée d’une nature
terreltre 8c vifqueufe, que la chaleur du foleil
condenfoit pendant le jour. On croit aujourd’hui
affez communément que ce font des toiles d’araignées
, emportées & difperfées par le vent : nous ne
fommes ici qu’Jfiftoriens , & nous ne prétendons garantir
ni l’une ni l’autre de ces explications. Je croirais
vôlontiers que les petits filamens très-fins, dont
on voit les plantes couvertes en certains jours d’été,
peuvent être en partie produits parles araignées des
champs, appellées fa u ch e u x ; mais j e ne voudrais pas
affurer que tous ces filamens , dont le nombre eft fi
conlidérable, fiiffent leur ouvrage ; encore moins,
que tous les filamens épais que l’on voit voltiger
dans l’air un beau jour d’é té, ne foient produits que
par ces infeôes ; quelle en eft donc la caufe ? je crois
qu’on l’ignore , ou du moins qu’on n’en eft pas bien
affûré. (O )
F i l d e p i e u x ( H y d r . ) C’eft un rang de pieux
équarris & couronnés d’un chapeau arrêté à tenons
8c mortoifes , ou attaché avec des chevilles de fer,
pour retenir les berges d’une riviere , d’un étang,
ou pour conferver les turetes 8c chauffées des grands
chemins. (J£ )
F i l - d e -FER ( Chimie métallurg. ) infiniment, au
moyen duquel on réfume les matières contenues
dans les tarts , coupelles , creufets : on en a de différentes
groffeurs ; celui, par exemple , qui fert à
faire defeendre les charbons par l’oeil du fourneau
d’effai, peut avoir trois ou quatre lignes de diamètre
, 8c eft garni d’un manche : la longueur & l’ufage
des autres détermine leur groffeur : il eft cependant
bon d’obferver qu’il vaut mieux les prendre
trop gros que trop petits ; parce que pour lors
ils font reffort & font fauter les matières des effais,
qui deviennent faux par-là. Il y en a de droits, de
courbés, & de crochus.
Quand il s’agit d’une grande exactitude ou d’une
grande propreté dans les opérations , on a autant
de fil-d e - fe r que de vaiffeaux expofés au feu. On leur
donne ce même ordre, & l’on évite par cette précaution
de rendre un effai faux ou de changer la
couleur d’une vitrification, en tranfportant & mêlant
les matières d’un vaiffeau avec celles d’un autre.
V jy e i C r o c h e t -DE-FER , ESSAI, & nos P la n ches
de Chimie. A r t i c le d eM . D E V lL L lE R S .
F i l , terme de bâtiment ; c’eft dans la pierre & le
marbre une veine qui les coupe , voyez l'article
P i e r r e . ( P )
Tome y i .
F i t , terme de Cordier r éû l’affemblage cPurt grand
nombre de filamens de chanvre tortillés enfemble
par l’aCtion de la roûè.
Pour que le f i l foit bien conditionné, il faut i°.' .
qu’il foit uni, bien ferré 8c bien égal : z°. qu’il n’ait
point de meche, 8c que le dianvre foit roulé en ligne
fpirale.
A l’égard de la groffeur du.ƒ/, elle dépend de la
qualité du chaqvre : le chanvre bien affiné doit être
filé plus fin que celui qui l’eft moins : en général le
f i l le plus fin porte trois lignes 8c demie de tour, &
le plus gros ne doit pas paner fix lignes.
Pour ce qui regarde la maniéré de fabriquer le f i l ,
voye{ tarticle CORDERIE.
Fi l : ce mot dans la Marine eft appliqué à diffé-
rens ufages ; par exemple,
F il à gargoujfes, c’eft du f i l de chanvre à l’ordinaire
, avec lequel on coud les gargouffes.
F i l de voile , de f ié e , du treufier ; on lui donne ce
nom, parce qu’il fert à coudre les voiles ; c’eft un
f i l gros comme leligneul des Cordonniers.
F i l blanc ; c’eft celui qui n’eft pas paffé dans le
gaudron.
F i l gaudronné ; c’eft celui qui a paffé dans le gau-
dron chaud.
F il de caret ; on donne Ce nom à de gros f i l qui fert
à faire les cordages. Dans les corderies du roi on
n’eft pas encore bien d’accord fur la groffeur que les
fileurs doivent donner à ce.ƒ / ,pour le rendre meilleur
8c plus propre à faire de bons cordages : il en
eft de même du degré de tortillement ; mais en général
on prétend que lorfqu’il eft filé fin & moins
tors , les cordages en ont plus de force & font meilleurs
: mais communément les fileurs donnent au f i l
les uns trois lignes ou trois lignes 8c demie de circonférence
; d’autres 4 à 5 lignes, & quelques -
unes même vont jufqu’à fix 8c l'ept lignes , 8c chacun
prétend avoir attrapé le point de perfection*
Mais fi l’on veut approfondir cette partie, il faut
voir ce qu’en a écrit M. Duhamel dans fon excellent
Traité de la fabrique des manoeuvres pour les vaiffeaux ,
8CC. à Paris de l 'Imprimerie royale , tJ 4 J .
Le f i l de caret eft aufli le f il qu’on tire d’un des cordons
de quelque vieux cable coupé par piece ; cé
f i l eft d’un grand ufage fur la mer pour raccommoder
des manoeuvres rompues : dans un vaiffeau de
guerre il faut avoir au moins 300 livres de ce f il.(Z ')
F i l c i r é , chez les Bourreliers, eft du f i l de Cologne
plié en plufieurs doubles retordus à la main ,
& frotés de cire blanche : ces artifans s’en fervent
principalement pour exécuter fur différentes pièces
d’harnois des compartimens, des deffeins ou broderies,
qu’on y pratique par maniéré d’ornemens ; on
fe fert aufli de ce f i l pour oiialer, & même pour coudre
les ouvrages les moins grofliers de la profeflion»
F i l d e C o l o g n e , eft un f il blanc qui fert aux
Cordonniers, pour coudre aufli lès fouliers, forfquô
l’on veut que les points paroiffent blancs.
F i l g r o s , eft du f i l de chanvre que les Cordonniers
mettent en plufieurs brins qu’ils frotent avec
de la poix , & leur fert à coudre les fouliers : chaque
extrémité du f il eft armée d’une foie de fanglier qui
lui fert d’aiguille , pour le pouvoir paffer dans les
trous que l’alêne a faits.
F i l d e p i g n o n , nom que les Horlogers donnent
à du f i l d’acier, cannelé en forme de pignon, yoyer
dans les Planches de l'Horlogerie ; on y à repréfenté
un bout de f i l de pignon de fept. Avant qüé l’on eût
trouvé le moyen de faire de c e f i l , ils étoiënt obligés
de fendre eux-mêmes leurs pignons. Cette opération
, quoique fimple en elle-même, eft fort difficile
par la précifion que l’on doit apporter à rendre toutes
les ailes parfaitement égales, de même que les
fentes qui les féparent, Aufli leur prenoit-elle beatt-
H H h h h