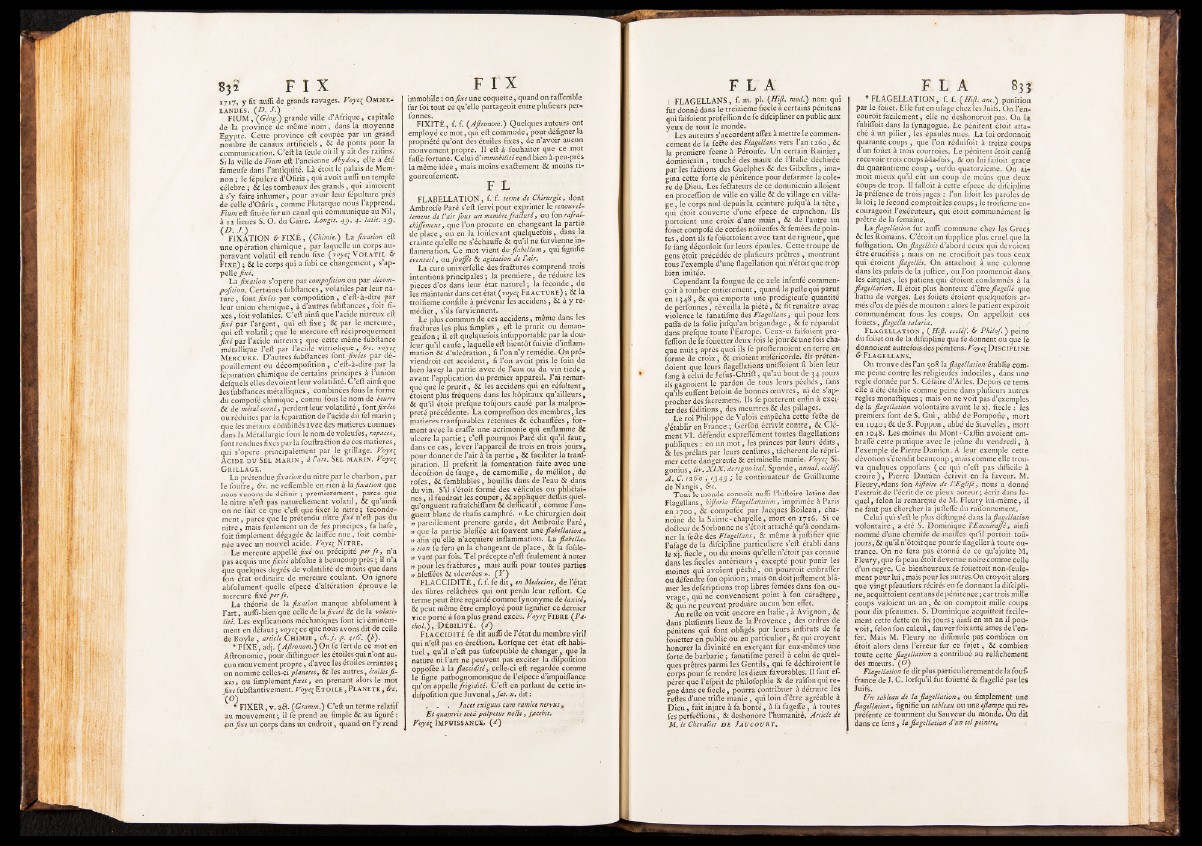
83£ F I X 1717, y fit auffi de grands ravages. Foye^ Omme-
1. AND ES. (D . 7 .)
FIUM, (Géog.) grande ville d’Afrique, capitale
de la province de même nom, dans la moyenne
Egypte. Cette province eft coupée par un grand
nombre de canaux artificiels , 8c de ponts pour la
communication. C’eft la feule oii il y ait des raifins.
Si la ville de Fiurn eft l’ancienne Abydos, elle a été
fameufe dans l’antiquité. Là étoit le palais de Mem-
jion ; le fépulcre d’Ofiris, qui avoit auffi un temple
célébré ; 8c les tombeaux des grands, qui aimoient
à s’y faire inhumer, pour avoir leur fepulture près
de celle d’Ofiris, comme Plutarque nous l’apprend.
Fiurn eft fituée fur un canal qui communique au Nil,
à 12 lieues S. O. du Caire. Longit. 4 9 . 4. latit. 2 9 .
( D . ƒ.)
FIXATION & FIXÉ, (Chimie.) La fixation eft
une opération chimique , par laquelle un corps auparavant
volatil eft rendu fixe (voye^ V o l a t il 6*
Fix e) ; & le corps qui a fub'i ce changement, s’appellent
«.
La fix a tio n s’opère par com pofition ou par décom-
p o fu io n . Certaines fubftances » volatiles par leur nature
, font fixées par compofition , c’eft-a-dire par
leur union chimique, à d’autres fubftances, foit fixes
, foit volatiles. C’eft ainfi que l’acide nitreux eft
fix e par l’ argent, qui eft fixe ; & par le mercure,
qui eft volatil ; que le mercure eft réciproquement
f ix é par l’acide nitreux ; que cette même fubftance
métallique l’eft par l’acide vitriolique &c. voyey
M e r c u r e . D’autres fubftances font fix é e s par dépouillement
ou décompofition, c’eft-à-dire par la
Réparation chimique de certains principes à l’union
defquels elles dévoient leur volatilité. C ’eft ainfi que
les {ubftances métalliques, combinées fous là forme
du compofé chimique, connu fous le nom de beurre
& de m étal corné, perdent leur volatilité, font fixées
ou réduites par la féparation de l’acide du fel marin ;
que les métaux combinés avec des matières connues
dans la Métallurgie fous le nom de voleufes, rapaces,
font rendues fixes par la fouftra&ion de ces matières,
qui s’opère principalement par le grillage. Foye.1
A cide du Sel marin , à Part. Sel m a rin . F oy ei
G r il l a g e .
La prétendue fixation du nitre par le charbon, par
le foufre, &c. ne reffemble en rien à h fixation que
nous venons de définir ; premièrement, parce que
le nitre n’eft pas naturellement volatil, 8c qu’ainfi
on ne fait ce que c’eft que fixer le nitre ; feconde-
ment, parce que le prétendu nitre fix é n’eft pas du
nitre, mais feulement un de fes principes, fa bafe,
foit Amplement dégagée 8c laiffée nue, foit combinée
avec un nouvel acide. Foye^ Ni t r e .
- Le mercure appellé fix é ou précipité per fie, n’a
pas acquis une fix ité abfolue à beaucoup près ; il n’a
que quelques degrés de volatilité de moins que dans
fon état ordinaire de mercure coulant. On ignore
abfolument quelle efpece d’altération éprouve le
mercure fixé per fie. .
La théorie de la fixation manque abfolument à
l’art, auffi-bien que celle de la fix ité 8c de la volatilité.
Les explications méchaniques font ici éminemment
en défaut ; voyei ce que nous avons dit de celle
de Boyle , article C himie , c h . j . p. 416. (b).
* FIXE, adj. ( Aftronom.) On fe fert de ce mot en
Aftrbnomie, pour diftinguer les étoiles qui n’ont au-
cun mouvement propre, d’avec les étoiles errantes ;
on nomme celles-ci planètes, 8c les autres, étoiles f i x
e s , ou Amplement fix e s , en prenant alors le mot
f ix e fubftantivement. Foye%_ Eto il e , Planete ÿ&c.
(O) • ■
* FIXER, v. a£L (Gramm.) C’eft un terme relatif
au mouvement ; il fe prend au fimple 8c au figuré : pn fixe un corps dans un endroit, quand on l’y .rend
F I X immobile : on fix e une coquette, quand on raflemble
fur foi tout ce qu’elle partageoit entre plufieurs per-,
fonnes.
FIXITÉ, f. f. {Afironom.) Quelques auteurs ont
employé ce mot, qui eft:commode, pour defigner la
propriété qu’ont des étoiles fixes, de n’avoir aucun
mouvement propre. Il eft à fouhaiter que ce mot
faffe fortune. Celui d'immobilitérend bien à-peu-près
la même idée, mais moins exactement 8c moins ri-
eoureufement.
F L
FLABELLATION, f. f. terme de Chirurgie, dont
Ambroife Paré s’eft fervi pour exprimer le renouvellement
de l'air fious un membre fracturé, ou fon rafraU
chijfement, que l’on procure en changeant la partie
de place, ou en la foûlevant quelquefois, dans la
crainte qu’elle ne s’échauffe & qu’il ne furvienne inflammation.
Ce mot vient de flabellum , qui fignifie
éventail, ou fioufile & agitation de l'air.
La cure univerfelle des fraCtures comprend trois
intentions principales ; la première, de réduire les
pièces d’os dans leur état naturel ; la fécondé, de
les maintenir dans cet état (yoye^ F r a c t u r e ) ; 8c la
troifieme confifte à prévenir les accidens, 8c à y remédier,
s’ils furviennent.
Le plus commun de ces accidens, même dans les
fraCtures les plus fimples , eft le prurit ou deman-
geaifon ; il eft quelquefois infupportable par la douleur
qu’il caufe, laquelle eft bientôt fuivie d’inflammation
& d’ulcération, fi l’on n’y remédie. On pre-
viendroit cet accident, fi l’on avoit pris le foin de
bien lavqj: la partie avec de l’eau ou du vin tiede ,
avant l’application du premier appareil. J’ai remarqué
que le prurit, & les accidens qui en réfultent,
etoient plus fréquens dans les hôpitaux qu’ailleurs ,
& qu’il étoit prefque toûjours caufé par la malpropreté
précédente. La compreffion des membres, les
matières tranfpirables retenues & échauffées, forment
avec la craffe une acrimonie qui enflamme &
ulcéré la partie ; c’eft pourquoi Paré dit qu’il faut,
dans ce cas, lever l’appareil de trois en trois jours ,
pour donner de l’air à la partie, 8c faciliter la transpiration.
Il preferit la fomentation faite avec une
décoûion de fauge, de camomille, de mélilot, de
rofes, 8c Semblables, bouillis dans de l’eau & dans
du vin. S’il s’étoit formé des véficules ou phliCtaines
, il faudroit les couper, 8c appliquer deffus quel-
qu’onguent rafraîchiffant & deflicatif, comme l’onguent
blanc de rhafis camphré. « Le chirurgien doit
» pareillement prendre garde, dit Ambroife Paré ,
» que la partie bleffée ait Souvent une fiabellation »
» afin qu’elle n’acquiere inflammation. La flabella-
» tion le fera çn la changeant de place, & la foûle-
» vant par fois. Tel précepte n’eft feulement à noter
» pour les fraftures, mais auffi pour toutes parties
» bleffées & ulcérées ». (T )
FLACCIDITÉ, f. f. fe dit, en Mcdecint, de l’état
des fibres relâchées qui ont perdu leur reffort. Ce
terme peut être regardé comme fynonyme de laxité,
& peut même être employé pour Signifier ce dernier
vice porté à fon plus grand excès. Voyeç F i b r e ( Pathol.)
, D é b i l i t é , (d )
F l a c c i d i t é fe dit auffi de l’état du membre viril
qui n’eft pas eu. éreâion. Lorfque cet état eft habituel
, qu’il u’eft pas fufceptible de changer, que la
nature ni l’art ne peuvent pas exciter la difpofition
oppofée à la fiaccidité, celle-ci eft regardée comme
le figne pathognomonique de l’efpece d’impuiffance
qu’on appelle frigidité. C’eft en parlant de cette in-
difpofition que J uvénal, fat. x , dit :
, . •. Jacet exiguus cum ramice nervus,
E t quamvis totâ palpetur nocte , jacebie.
Voyt{ I m p u i s s a n c e , (d )
F L A ; FLAGELLANS, f. m. pi. (Hifi. mod.) nom qui
fut donné dans le treizième fiecle à certains pénitens
qui faifoient profeffion de fe difeipliner en public aux
yeux de tout le monde. ^
Les auteurs s’accordent affez à mettre le commencement
de la fefte des Flagellans vers l’an 12.60, 8c
la première feene à Péroufe. Un certain Rainier,
dominicain , touché des maux de l’Italie déchirée
par les faâions des Guelphes 8c des Gibelins, imagina
cette forte de pénitence pour defarmer la colère
de Dieu. Les feâateurs de ce dominicain alloient
en proceffion de ville en ville 8c de village en village,
le corps nud depuis la ceinture jufqu’à la tête.,
qui étoit couverte d’une efpece de capuchon. : Ils
portoient une croix d’une main, & de l’autre un
foiiet compofé de cordes noüeufes & femées de pointes
, dont ils fefoiiettoient avec tant de rigueur, que
le fang déçouloit fur leurs épaules. Cette troupe de
gens étoit précédée de plufieurs prêtres , montrant
tous l’exemple d’une flagellation qui n’étoit que trop
bien imitée.
Cependant la fougue de ce zele infenfé commen-
çoit à tomber entièrement, quand la pelle qui parut
en 1348, 8c qui emporta une prodigieufe quantité
de pèrfonnes, réveilla la piété, & fit renaître avec
violence le fanatifme des Flagellans, qui pour lors
paffa de la folie jufqu’au brigandage, & fe répandit
dans prefque toute l’Europe. Ceux-ci faifoient profeffion
de fe fouetterdeux fois le jour & une fois chaque
nuit ; après quoi ils fe profternoient en terre en
forme de croix, 8c crioient mifericorde. Ils preten-
doient que leurs flagellations uniffoient fi bien leur
fang à celui de Jefus-Chrift, qu’au bout de 3 4 jours
ils gagnoient le pardon de tous leurs péchés, fans
qu’ils euffent befoin de bonnes oeuvres, ni de s’approcher
des facremens. Ils fe portèrent enfin à exciter
des féditions, des meurtres 8c des pillages.
Le roi Philippe de Valois empêcha cette fe&e de
s’établir en France ; Gerfon écrivit contre, 8c Clément
VI. défendit expreflement toutes flagellations
publiques : en un mot, les princes par leurs édits,
& les prélats par leurs cenfures, tâchèrent de réprimer
cette dangereufe & criminelle manie. Foye^ Si-
gonius, liv. X I X . deregno ï'w/. Sponde, annal, eccléf.
A . C. 12 C 0 , 1 3 4 9 S le continuateur de Guillaume
de Nangis , &c.
Tout le monde connoît auffi l’hiftoire latine des
Flagellans, hifioria FLagellantïum, imprimée à Paris
en, 1700, & compofée par Jacques Boileau, chanoine
de la Sainte-chapelle, mort en 1716. Si ce
doâeur de Sorbonne ne s’éîôit attaché qu’à condamner
la fe&e des Flagellans, & même à juftifier que
l’ufage de la difeipline particulière s’eft établi dans
le xj. fiecle, ou du moins qu’elle n’étoit pas connue
dans les fiecles antérieurs , excepté pour punir les
moines qui avoient péché,, on pourroit embraffer
ou défendre fon opinion ; mais on doit juftement blâmer
les deferiptions trop libres femées dans fon ouvrage
, qui ne convenoient point à fon caraftere,
& qui ne peuvent produire aucun bon effet.
Au refte on voit encore en Italie, à Avignon, 8ç
dans plufieurs lieux de la Provence , des ordres de
pénitens qui font obligés par leurs inftituts de fe
fouetter en public ou en particulier, 8c qui croyent
honorer la divinité en exerçant fur eux-mêmes une
forte de barbarie ; fanatifme pareil à celui de quelques
prêtres parmi les Gentils, qui fe déchiroient le
corps pour fe rendre les dieux favorables. Il faut ef-
pérer que l’efprit de philofophie & de raifon qui régné
dans ce fiecle, pourra contribuer à détruire les
relies d’une trille manie , qui loin d’être agréable à
Dieu, fait injure à fa bonté, à fa fageffe, à toutes
fes perfedions, & déshonoré l’humanité. Article de
M . lé Chevalier d e J a v c o u R T ,
F L A 833 * FLAGELLATION, f. f. (H ifi. anc.) punition
par le foiiet. Elle fut en ufage chez les Juifs. OnTén-
couroit facilement, elle, ne deshonoroit pas. On la
fubiffoit dans la fynagogue. Le pénitent étoit attaché
à un pilier, les épaules nues. La loi ordonnoit
quarante coups, que l’on réduifoit à treize coups
d’un foiiet à trois courroies. Le pénitent étoit cenfç
recevoir trois coups à-la-fois, & on lui faifoit grâce
du quarantième coup, ou*du quatorzième. On ai-
moit mieux qu’il eût un coup de moins que deux
coups de trop. Il falloit à cette efpece de difeipline
la préfence de trois juges : l’un lifoit les paroles de
la loi ; le fécond comptoit les coups ; le troifieme en-
courageoit l’exécuteur, qui étoit communément le
prêtre de la femaine.
La flagellation fut auffi commune chez les Grecs
& les Romains. C’étoit un fupplice plus cruel que la
fuftigation. On flagelloit d’abord ceux qui dévoient
être crucifiés ; mais on ne crucifioit pas tous ceux
qui étoient flagellés. On attachoit à une colonne
dans les palais de la juftice, ou l’on promenoit dans
les cirques, les patiens qui étoient condamnés à la
flagellation. Il étoit plus honteux d’être flagellé que
battu de verges. Les foiiets étoient quelquefois armés
d’os de piés de mouton : alors le patient expiroit
communément fous les coups. On appelloit ces
foiiets , flagella talaria.
F l a g e l l a t i o n , (H ifi. eccléf. & Philof. ) peine
du foiiet ou de la difeipline que fe donnent ou que fe
donnoient autrefois des pénitens. /^byeçDlSClPLiNE
«S-Fl a g e l l a n s.
On trouve dès l’an 508 la flagellation établie comme
peine contre les religieufes indociles, dans une
réglé donnée par S. Céfaire d’Arles. Depuis ce tems
elle a été établie comme peine dans plufieurs autres
réglés monaftiques ; mais.on ne voit pas d’exemples
d e là flagellation volontaire avant le xj. fiecle : les
premiers font de S. Gui', abbé de Pompofie, mort
en 1040; & de S . Poppon, abbé de Stavelles, mort
en 1048. Les moines du Mont-Caffin avoient em-
brafle cette pratique avec le jeûne du vendredi, à
l’exemple de Pierre Damien. A leur exemple cette
dévotion s’étendit beaucoup ; mais comme elle trouva
quelques oppofans (ce qui n’eft pas difficile à
croire), Pierre Damien écrivit en fa faveur. M.
Fleury,^dans fon hifloire de l'E glife, nous a donné
l’extrait de l’écrit de ce pieux auteur ; écrit dans lequel
, félon la remarque de M. Fleury lui-même, il
ne faut pas chercher la jufteffe du raifonnement.
Celui qui s’eft le plus diftingué dans la flagellation
volontaire, a été S . Dominique YEncuirajjè, ainfi
nommé d’une chemife de mailles qu’il portoit toûjours
, & qu’il n’ôtoit que pour fe flageller à toute outrance.
On ne fera pas étonné de ce qu’ajoûte M.'
Fleury, que fa peau étoit devenue noire comme celle
d’un negre. Ce bienheureux fe foiiettoit non-feulement
pour lui, mais pour les autres.On croyoit alors
que vingt pfeautiers récités en fe donnant la difeipline,
acquittoient cent ans de pénitence ; car trois mille
coups valoient un an, & on comptoit mille coups
pour dix pfeaumes. S . Dominique acquittoit facilement
cette dette en fix jours ; ainfi en un an il pou*
voit, félon fon calcul, fauver foixante âmes de l’enfer.
Mais M. Fleury ne diffimule pas combien on
étoit alors dans l’erreur fur ce fujet, & combien
toute cette flagellation a contribué au relâchement
des moeurs. (O )
Flagellation fe dit plus particulièrement de la fouf»
france de J. C. lorfqu’il fut fouetté & flagellé par les
Juifs.
Un tableau de la flagellation, ou Amplement une
flagellation, fignifie un tableau ou une efiampe qui repréfente
ce tourment du Sauveur du monde. On dit
dans ce fens, la flagellation d'un tel peintre,