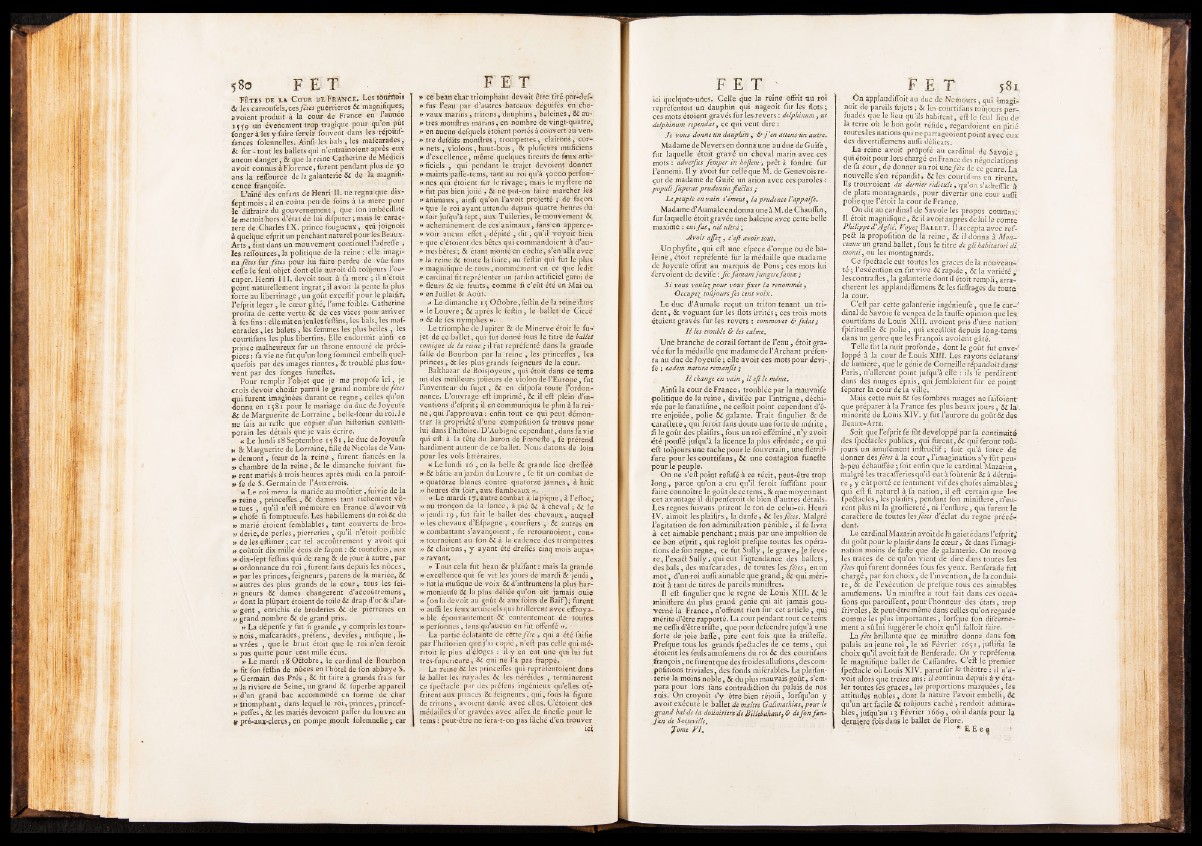
F êtes de ia . C oxjr de Franc e. Les toufrtôîs
& les carroufels,ces fêtes guerrières & magnifiques,
a voient produit -à la cour de France en 1 année
j 5 59 un événement trop tragique pour qu’on put
fongeràies y Faire fervir fouvent dans les rejouif-
Fances folennelles. Ainfi les bals1, les mafcarades,
& fur-tout les ballets qui n’entraînoient après ^eux
aucun danger, & que ia reine Catherine deMedicis
avoit connus à Florence, furent pendant plus dp ço
ans la réffource de la galanterie & de la magnificence
françoife. , 1 1:i , . '1' :
L’aîhé des enfans de Henri H. ne .régnante dïx-
fept mois ; il en coûta peu dé Foins à fa mere pour
le diftraire du gouvernepieht, que fon imbécillité
le mettoit hors' d’état dé lui difputer ; mais le- caractère
de.Charles IX . prince Fougueux, qui joignoit à quelque efprit un penchant naturel pourlesBedux-
Arfs , tint dans un mouvement continuel l ’adrefle,
les reflources, la politique de la reine: elle imagina
fêtes Fur fêtes pour lui faire perdre de vûe fans
ceffe le feul objet dont elle aiiroit dû toujours l’occuper.
Henri I I I . de voit tout à: fa mere ; il n’étoit
point naturellement ingrat; il avoit la pente la plus
Forte au libertinage, un goût exçefllf pour.le plaifif,
l ’efprit leger , le coeur gâté, l’ame foible. Catherine
profita de cette vertu & de ces vices pour arriver
à Fes fins : elle mit en jeulesfeftins, les bals, les mafcarades
, les balets, lès femmes les plus belles , les
courtifans les plus libertins. Elle endormit ainfi. ce
prince malheureux fur un throne entouré de précipices
: fa vie ne fut qu’un long fommeil embelli quelquefois
par des images riantes, & troublé plus fou-
vent par dés fonges funeftes.
Pour remplir l’objet que je me propofe i c i , je
crois devoir choifir parmi le grand nombre d e fêtes
qui furent imaginées durant ce régné, celles qu’on
<lonna en 1581 pour le mariage du duc de Joyeufe
& de Marguerite de Lorraine , belle-foeur du roi. Je
ne fais au refie que copier d’un hiflorien contemporain
les détails que je vais écrire.
« Le lundi 18 Septembre 1581 , le duc de Joyeufe
» & Marguerite de Lorraine, hile de Nicolas de Vau-
» demont, foeur de la reine , furent fiancés en la
» chambre de la reine, & le dimanche fuivant fu-
» rent mariés à trois heures après midi en la paroif-
» fe de S. Germain de l’Auxerrois.
» Le roi mena la mariée au moûtier ,fuivie de la
» reine , princeffes , & dames tant richement vê-
» tues , qu’il n’eft mémoire en France d’avoir vû
» chofe fi fomptueufe. Les habillemens du roi & du
» marié étoient femblables, tant couverts de bro-
» derie, de perles, pierreries , qu’il n’étoit poffible
» de les eftimer ; car tel accoûtrement y avoit qui
» coûtoit dix mille écus de façon : & toutefois, aux
» dix-fept feflins qui de rang & de jour à autre , par
» ordonnance du ro i, furent faits depuis les noces,
» par les princes, feigneurs, parens de la mariée, &
» autres des plus grands de la cour, tous les fei-
» gneurs & dames changèrent d’aCcoûtremens,
» dont la plûpart étoient de toile & drap d’or & d’ar-
» gent , enrichis de broderies &c de pierreries en
» grand nombre & de grand prix.
» La dépenfe y fut fi grande, y compris les tour-
ÿ> nois, mafcarades, préfens, devifes, mufique, li-
» vrées , que le bruit étoit que le roi n’en feroit
y> pas quitte pour cent mille écus.
» Le mardi 18 Oétobre, le cardinal de Bourbon
» fit fon feftin de noces en l ’hôtel de fon abbaye S.
» Germain des Prés , & fit faire à grands frais fur
» la riviere de Seine, un grand & fuperbe appareil
» d ’un grand bac accommodé en forme de char
»triomphant, dans lequel le roi,princes, princef-
» ceffes, & les mariés dévoient paffer du louvre au
y pré-aux-clerçs, en pompe moult folemnelle ; car
» cebean char triomphant devait êttetire par-def-'
» fus l ’eau par d ’autres bateaux dégitifés éri éhé*
» vaux marins, tritons , dauphins, baleines ,' & air»
» très monftres marins , en nombre de vingt-quatre,•
» en aucun defquels étoient portés à couvert auven-
» tre defdits monftres ; trompettes, clairons ,c o r -
» nets ,-violons, haut-bois, & plufiettrs muficiens
» d’excellence, même quelques tireurs de feux artï-
» ficiels , qui pendant le trajet dévoient donner
» maints pafle-tems, tant aii roi qu’à 5000a perfo n-
».nes qui étoient fur le rivage; mais le myftere ne
» fut pas bien joiié, & ne put-on faire marcher les
» animaux, ainfi qu’on l’$voit projèttë Idè1 façon
» que le roi ayant attendu depuis quatre heures du
» loir jufqu’à lèpt, aux Tuileries , le mouvement &
»acheminement de ces'animaux, fans’en apperce-
» voir aucun effet, dépité , d it , qu’il voyoit'bien
» que c’étoient des bêtes qui commàndoient à d’au-
» très bêtes ; & étant monté en coche , s’en alla avec
» la reine & toute la fuite, au feftin qui fut le plus
» magnifique de tous , nommément en ce que ledit
» cardinal fit repréfenter un jardin artificiel garni de
» fleurs & de fruits ; comme fi c’eût été en Mai ou
» en Juillet & Août.
» Le dimanche 15 O&obre, feftin de la reine dans
» le Louvre ; & après le feftin , le ballet de Circé
» & de fes nymphes ».
Le triomphe de Jupiter & de Minerve étoit'le fu-
jet de ce ballet, qui fut donné fous lé titre de ballet
comique de la reine ; il fut repréfenté dans la grande
falle de Bourbon par la reine , les prinCefles, les
princes , & les plus grands feigneurs de là'cour.
Balthazar de Boisjoyeux , qui étoit dans ce tems
un des meilleurs joueurs de violon de l ’Europe, fut
l’inventeur du fujet ; & en difpofa toute l’ordonnance.
L’ouvrage eft imprimé, & il eft plein d’inventions
d’efprit ; il en communiqua le plan à la reine
, qui l’approuva : enfin tout ce qui peut démontrer
la propriété d’une compofition fe trouve pour
lui dans l’hiftoire. D ’Aubigné cependant, dans fa vie
qui eft. à la tête du baron de Fcenefte , fe prétend
hardiment auteur de ce ballet. Nous datons de loin
pour les vols littéraires.
« Le lundi 16 , en la belle & grande lice drefféè
» & bâtie au jardin du Louvre, fe fit un combat de
» quatorze blancs contre quatorze jaunes, à huit
» heures du foir, aux flambeaux ».
» Le mardi 17, autre combat à la pique, à l’eftoc,
» au tronçon de la lance, à pié &c à cheval ; & le
»jeudi 19 , fut fait le-ballet des chevaux, auquel
» les chevaux d’Efpagne ,- courfiers , & autres en
» combattant s’avânçoient, fe retournoient, con-
» tournoient au fon & à la cadence des trompettes
» & clairons, y ayant été dreffés cinq mois aupa-
» ravant.
» Tout cela fut beau & plàifant : mais la grande
» excellence qui fe vit les jours de mardi & jeudi,
» fut la mufique de voix & d’inftrumens la plus har-
» monieufe & la plus déliée qu’on ait jamais ouie
» (onia devoit au goût & aux foins de Baïf); furent
» auffi les feux artificiels qui brillèrent avec effroya-
» ble épouvantement & contentement de toutes
» perfonnes, fans qu’aucun en fût offenfé ». 1
La partie éclatante de cette fête , qui a été faifie
par rhiftorien que j’ai copié, n’eft pas celle qui mé-
ritoit le pius d’éloges : il y en eut une qui lui fut
très-fupérieure, & qui né l’a pas frappé.
. ’ La reine & les princeffes qui repréfentoient dans
le ballet les nayades & les néréides , terminèrent
ce fpeétacle par des préfens ingénieux qu’elles ofir
•frirent aux princes &c feigneurs, qui, fou,s la figure
de tritons , avoient danfé avec elles. G’étoient des
médaiiles d’or gravées avec affez de fineffe pour le
tems : peut-être ne fera-t-on pas fâché d’en, trouver
ici quelques-urtes. Celle q u e la reine offrit-au roi
repréfentoit un dauphin qui nageoit fur les flots ;
ces mots étoient gravés fur les-revers-: delphirium yut
ddphinum repenàat, ce qui veut dire :
Je voks donne un dauphin, ■ & j'en attens'itn autre.
Madame de Nevers en donna une au due de Guife,
fur laquelle étoit grave un cheval marin avec ces
mots ': advcYfus femper hï/hoflem -, prêt à fondre Fur
l’ennemi, il y aVoit Fur celle que M. de Genevois reçut
dé madame de Guife un arion avec ces paroles :
populi fuperat prudentiafuclus ;
Le peuple en vain s’émeut, la ‘prudence Vàppaife.
Madame d’Aumale en donna une à M. de Chauflin -,
Fur laquelle étoit gravée une baleine avec cette belle
maximè •: •ciii fd t , nil 'ultra ;
■ Avoir ajfei, c'ejl. avoir tout. .
Un phyfite, qui eft une efpece d’orque ou de baleiné
, étoit repréfenté Fur la médaille que madame
de Joyeufe offrit au marquis de Pons; ces mots lui
Fér voient de devife : fie famam jungere famee ;
Si vous voulez pour vous fixer la renommée >
Occupe^ toujours fes cent voix.
Le duc d’Aumale reçut un triton tenant un trident
, & voguant fur les flots irrités ; ces trois mots
étoient gravés Fur les revers commovet &.fedat^
I l les trouble & les calme.
Une branche de corail fortant de l’eaü , étoit gravée
fur la médaille que madame de l’Archant préfen-’
ta au duc de Joyeufe ; elle avoit ces mots pour devi-,
fe : eadem natura remanfit ;
I l change en vain , il èfi le même.
Ainn la cour de France, troublée par la maiivaife
politique de la reine, divifée par l’intrigue, déchirée
par le fanatifme, né ceffoit point cependant d’ê-
tfe enjoiiée, polie & galante. Trait fingulier & de
caraélere, qui feroit fans doute une forte de mérite,
A le goût des plaifirs, fous un roi efféminé, n y avoit
été pouffé jiifqu’à la licence la plus effrénée ; ce qui
eft toûjoursune tache pour le fouverain, une ïlétrifi
fure pour les courtifans, & une contagion fiinefte
pour le peuple.
On ne s’eft point refufé à ce récit , peut-être trop
lon g , parce qu’on a cru qu’il feroit fuffifant pour
Faire connoître le goût de ce tems, & que moyennant
cet avantage il dilpenferoit de bien d’autres détails*
Les régnés fuivans prirent le ton de celui-ci. Henri
IV . aimoit les plaifirs, la danfe, & les fêtes. Malgré
l ’agitation de fon adminiftration pénible, il fe livra
à cet aimable penchant ; mais par une impulfion de
ce bon efprit, qui regloit prefque toutes les opérations
de fôn régné, ce fut S u lly , le grave > le feve-
r e , l ’exaft Sully, qui eut l’intendance des ballets,
des bals, des mafcarades, de toutes les fêtes > en un
mot , d’un roi àuffi aimable que grand ; &*qui méri-
toit à tant de titres de pareils miniftres.
Il eft fingulier que le régné de Louis XIII. & ïe
miniftere du plus grand génie qui ait jamais gouverné
là France, n’offrent rien fur cet article, qui
mérite d’-être rapporté. La cour pendant tout ce tems
ne ceffad’être trille, que pour defeendre jufqu’à une
forte de joie baffe, pire cent fois que la triftefle.
Prefque tous les grands fpeftacles de ce tems, qui
étoient les feuls amufemens du roi & des courtifans
François, ne furent que des froides allufions, des com-
pofitions triviales, des fonds miférables. Laplaifan-
terie la moins noble, & du plus mauvais goût, s’empara
pour lors fans contradiftion du palais de nos
rois. On croyoit s’y être bien réjoiii, lorfqu’on y
avoit exécuté le ballet de maître Galimathiasipour le
grand bal de la douairière de Billebahaut» & de fon fan-
fan de Sotteville,
fomt VI.
On àpplaudiffoit au duc dé Nemours, qui imagi-
noit de pareils fujè'ts ; & les courtifans toujours persuadés
que le lieu qu’ils habitent, éft le fêul lieu dé
la terre où le bon g o û t réfide, regardoient en pitié
t o u t e s l e s nations qui ne partageoient point avec eux
des divertiffemens auffi délicats.
La reine avoit prôpofé au cardinal de Savoie j
qui étoit pour lors chargé en France des négociations
dé fa cour, de donner au roi une fête de ce genre. La
nouvelle s’en répandit, & lès courtifans en rirent«.
Ils trouvoierit du dernier ridicule, qu’on s’adreffât à
de plats montagnards, pour divertir une cour auffi
polie que l’étoit la cour de France.
On dit au cardinal de Savoîé lés propos coitrans^
Il étoit magnifique, & il avoit auprès de lui le comte
P h i l i p p e d 'A g l i é . V o y e { Ba l l e t . Il accepta avec rèf-
peél la propôfition de la reine, & il donna à M o n - -
c e a u x un grand ballet, fous le titré d e g l i h a b i ta to r i d f
m o n t i , ou les montagnards.
Gé fpeélacléeut toutesles grâces delà nouveauté^
l’exécution en fut vive & rapide, & la variété ÿ '
lès contraftes, la galanterie dont il étoit rempli, arra-,
cherent lés applaudiffemens & les fuffrages de. toute
la cour.
C ’eft par cette galanterie ingénieufè, que le car-7
dinâl dé Savoie fe vengea de la fauffe opinion que les.
courtifans de Louis XIII. avoient pris d’une nation
fpirituêllè & poiie, qui etfcellôit depuis long-tems
dans lin genre que les François avoient gâté.
T elle fut la nuit profonde, dont le goût fut enve-f
lôppé à la cour de Louis XIII. Les rayons éclatansr1
de lumieré, que le génie de Corneille répandoitdansr
Paris, n’allerent point jüfqu’à elle : ils fe perdirent
dans dés ûuages épais, qui/embloient fur ce point
féparer la cour de la ville.
Mais cette nuit St fes fombjres. nuages ne faifoièntr
que préparer à la France (es plus beaux jours, & la .
minorité de Louis XIV. y flit l’aurore du goût & des
Beaux-Arts. '
Soit que l’efprit fe fût deVeloppë par là continuité
des fpetftacles publics, qui furent, & qui feront tou-;
jours un âmüfémènt inftruélif ; foit qu’à force de
donner- des fêtes à la cour, l’imagination s’y fût peu-
à-peü échauffée ; foit enfin que le cardinal Mazarin ,
malgré les tracafferies qu’il eut àfoûtenir & à détruire
, y eut porté ce fentiment v if des çhofes aimables
qui éft fi naturel à fa nation, il eft certain que les
fpeûacles, les plaifirs, pendant fon miniftere , n’eurent
plus ni la groffiereté, ni l’enflure, qui furent le
caractère de toutes les fêtes d’éclat du régné précédent.
Le cardinal Mazarin avoit de fô gaieté dans l’efprit^
du goût pour le plaifir dans le coeur, & dans l’imagi-
natron moins de fafte que de galanterie. On trouvé
les traces de c'e qu’on vient de dirè dans toutes les
fêtes qui furent données fôüs fes yeux. Benferade fut
chargé, par fon choix, de l’invention, de la conduite
, & de l’exécution de prefque tous ces aimables
amufemens. Un miniftre a tout fait dans ces oceâ^
fions qui paroiffent, pour l’honneur des états, trop
frivoles, & peut-être même dans celles qu’on regarde
comme les plus importantes , lorfquê Fort difeerne-
ment a sû.lui fuggérer le choix qu’il falloit faire. ‘ •
La fête brillante que ce miniftré donna dans fort
palais au jeune r o i, le ï <5 Févri'er 1651, juftifia lé
choix qu’il avoit fait de Benferade. On y repréfenta
le magnifique ballet de Caffandre. C ’eft le premier
Fjpeélaclé'où Louis XIV. parut fur le théâtre : il n’â-
voit alors que treize ans : il continua depuis à y étaler
toutès fes gfaces, les proportions marquées, lés
attitudes noblés, dont la nature l’avoit embelli, &
qu’un art facile & toûjours caché , rendoit admirables,
jufqu’au 13 Février 1669, où il danfa pour là
derniçre fois dans le ballet de Flore.
^ • ' - < r 7 a « .