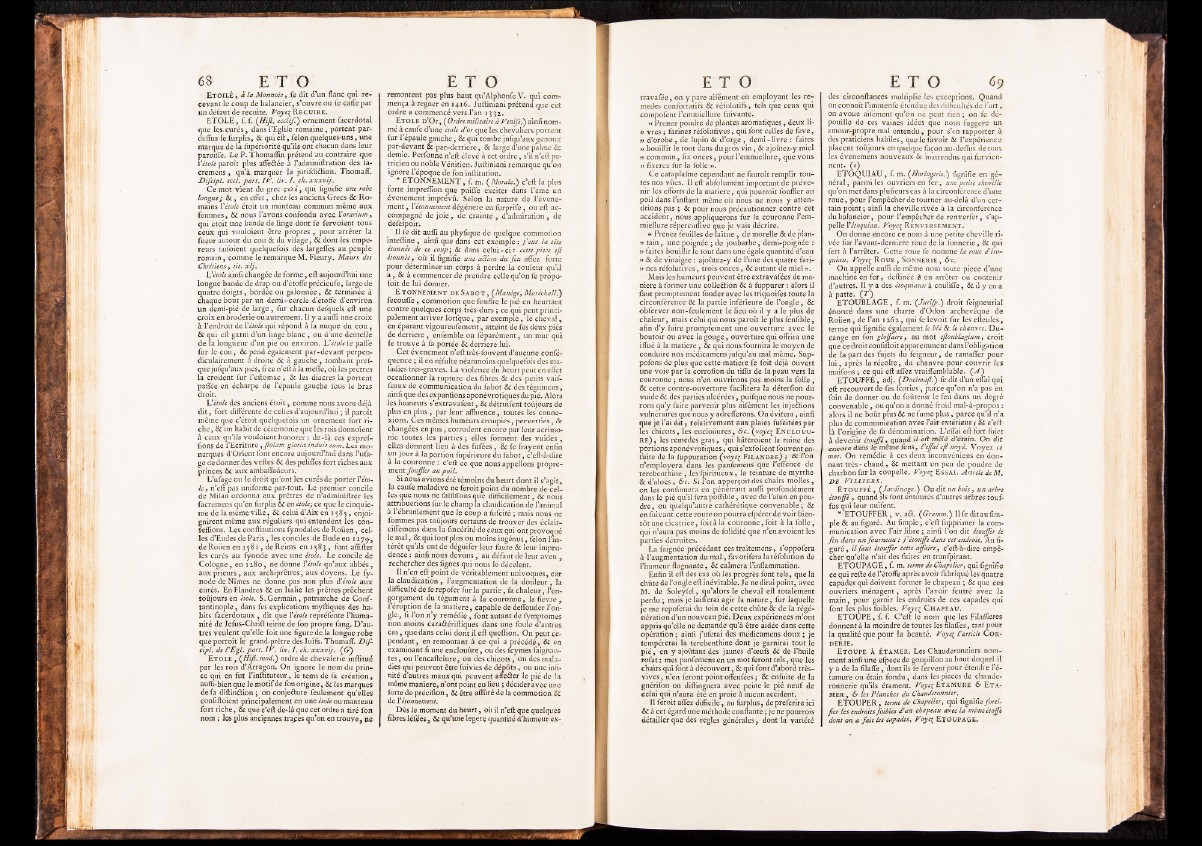
Etoile , à la Monnoie,cevant le coup de balancie rf,e s d’oitu dvr’uen o ufl afne cc qafufie prear
un défaut de recuite. Voyeç Rec.üirE.
E TO LE , f. f. (Hiji, eccléf) ornement facerdotal
que les. curés, dans l’Eglilè romaine, portent par-
deffus • le furplis, & qui eft, félon quelques-uns, une
marque.de la fupériorité qu’ils ont chacun dans leur
paroille. Le P. Thomaflin prétend au contraire que
Y étole paroît plus affeôée à l’adminiftration des fa-
cremens, qu’à marquer la jurifdiûion. ThomalT.
Difcipl. eccl. part. IV. liv. I ; ch. xxxvij.
Ce mot vient du grec çox», qui lignifie une robe
longue; & , en effet, chez les anciens Grecs & Romains
Y école étoit un manteau commun même aux
femmes, & n ou s l’avons confondu avec Yorarium,
qui étoit une bande de linge.dont fe fervoient tous
ceux qui vouloient être propres, pour arrêter la
fueur autour du cou & du vif âge, 6c dont les empereurs
faifoient quelquefois des largeffes au peuple
romain, comme le remarque M. Fleury. Moeurs des
Chrétiens » tic. x lj.
U étole ainfi changée de forme, eft aujourd’hui une
longue bande de drap ou d’étoffe précieufe, large de
quatre doigts, bordée ou galonnée, 6c terminée à
chaque bout par un demi-cercle d’étoffe d’environ
un demi-pié de large, fur chacun defquels eft une
croix en broderie ou autrement. Il y a aufîi une croix
à l’endroit de Y école qui répond à la nuque du co u ,
& qui eft garni d’un linge blanc , .ou d’une dentelle
de la longueur d’un pié ou environ. U étole le paffe
fur le cou , & pend également par-devant perpendiculairement
à droite 6c à gauche, tombant pref-
que jufqu’aux piés, fi ce n’eft à la meffe, oit les prêtres
la croilent fur l’eftomac, & les diacres la portent
paffée en écharpe de l’épaule gauche fous le bras
droit.
L ’école des anciens étoit, comme nous avons déjà
d it , fort différente de celles d’aujourd’hui ; il paroît
même que c’étoit quelquefois un ornement fort rich
e, 6c un habit de cérémonie que les rois donnoient
à ceux qu’ils vouloient honorer : de-là ces expref-
fions de l’Ecriture ,fiolam gloria induit eum. Les monarques
d’Orient font encore aujourd’hui dans l’ufa-
ge de donner des veftes 6c despeliffes fort riches aux
princes 6c aux ambafladeurs.
L’ufage ou le droit qu’ont les curés de porter Y école
, n’eft pas uniforme par-tout. Le premier concile
de Milan ordonna aux prêtres de n’adminiftrer les
facremens qu’en furplis 6c en école; ce que le cinquième
de la même v ille , & celui d’Aix en 1 5 8 5 , enjoignirent
même aux réguliers qui entendent les con-
feflions. Les conftitutions fynodales de Roiien, celles
d’Eudes de Paris, les conciles de Bude en 1270*,
de Roiien en 1581 , de Reims en 1583, font aftifter
les curés au fynode avec une étole. Le concile de
Cologne, en 1280, ne donne Y étole qu’aux abbés,
aux prieurs, aux archiprêtres , aux doyens. Le fynode
de Nîmes ne donne pas non plus d'étole aux
curés. En Flandres & en Italie les prêtres prêchent
toûjours en étole. S. Germain, patriarche de Conf-
tantinople, dans fes explications myftiques des habits
facerdotaux , dit que Y étole repréfente l’humanité
de Jefus-Chrift teinte de fon propre fang. D ’autres
veulent qu’elle foit une figure de la longue robe
que portoit le grand-prêtre des Juifs. Thomaff. Difcipl.
de l'Egl. part. IV. liv. I . ch. xxxvij. (G) Etole , (Hift. mod.) ordre de chevalerie inftitué
par les rois d’Arragon. On ignore le nom du prince
qui en fut l’inftituteur, le tems de fa création,
aufli-bien que le motif de fon origine, & les marques
de fa diftin&ion ; on conjeâure feulement qu’elles
confiftoient principalement en une étole ou manteau
fort riche, 6c que c’eft de-là que cet ordre a tiré fon
nom ; les plus anciennes traces qu’on en trouve, ne
remontent pas plus haut qu’Alphonfe V . qui commença
à regner en 1416. Juftiniani prétend que cet
ordre a commencé vers l’an 1332. Etole D’O r , ( Ordre militaire d Venife.) ainfi nommé
à caufe d’une école d'or que les chevaliers portent
fur l’épaule gauche, & qui tombe jufqu’aux genoux
par-devant & par-derriere, & large d’une palme 6c
demie. Perfonne n’eft élevé à cet o rdre, s’il n’eft patricien
ou noble Vénitien. Juftiniani remarque qu’on
ignore l’époque de fon inftitution.
* ETONNEMENT, f. m. ( Morale.) c’eft la plus
forte impreflïon que puiflé exciter dans l’ame un
événement imprévu. Selon la nature de l’évene-
ment, Y étonnement dégénéré en furprife, ou eft accompagné
de jo ie , de crainte , d’admiration, de
defeipoir.
II fe dit aufîi au phyfique de quelque commotion
inteftine , ainfi que dans cet exemple : j'eus la tête
étonnée de ce coup ; & dans c e lu i- c i: cette piece ejl
étonnée, où il lignifie une action du feu affez forte
pour déterminer un corps à perdre la couleur qu’il
a , & à commencer de prendre celle qu’on fe propo-
foit de liii donner. E tonnement de Sabot, (Manège» MarèchallY)
fecouflc, commotion que fouffre le pié en heurtant
contre quelques corps très-durs ; ce qui peut principalement
arriver lorfque, par exemple, le cheval,
en éparant vigoureufement, atteint de fes deux piés
de derrière, enfemble ou féparément, un mur qui
fe trouve à fa portée & derrière lui.
Cet événement n’eft très-fouvent d’aucune confé-
quence ; il en réfulte néanmoins quelquefois des ma:
ladies très-graves. La violence du heurt peut en effet
occafionner la rupture des fibres & des petits vaif-
feaux de communication du fabot 6c des tégumens ,
ainfi que des expanfions aponévrotiques du pié. Alors
les humeurs s’extravafent, 6c détruifent toûjours de
plus en plus , par leur affluence, toutes les connexions.
Ces mêmes humeurs croupies, perverties, &
changées en pus, corrodent encore par leur acrimonie
toutes les parties ; elles forment des vuides ,
elles donnent lieu à des fiifées, 6c fe frayent enfin
un jour à la portion fupérieure du fabot, c’eft-à-dire
à la couronne : c’eft ce que nous appelions proprement
fouffler au poil.
Si nous avions été témoins du heurt dont il s’agit,
la caufe maladive ne feroit point du nombre de celles
que nous ne faififfons que difficilement, 6c nous
attribuerions fur le champ la claudication de l’animal
à l’ebranlement que le coup a fufeité ; mais nous ne
fommes pas toûjours certains de trouver des éclair-
ciffemens dans la fincérité de ceux qui ont provoqué
le mal, 6c qui font plus ou moins ingénus, félon l’intérêt
qu’ils ont de déguifer leur faute & leur imprudence
: ainfi nous devons, au défaut de leur aveu ,
rechercher des lignes qui nous le décelent.
Il n’en eft point de véritablement univoques, car
la claudication , l’augmentation de la douleur, la
difficulté de ferepofer fur la partie, fa chaleur, l’en-
gorgemént du tégument à la couronne, la fievre ,
l’éruption de la matière, capable de deffouder l’ongle
, fi l’on n’y remédie, font autant de fymptomes
non moins caraâériftiques dans une foule d’autres
cas, que dans celui dont il eft queftion. On peut cependant,
en remontant à ce qui a précédé, 6c en
examinant fi une enclouûre, ou des feymes faignan-
tes, ou l’encaftelure, ou des chicots, ou des maladies
qui peuvent être fuivies de dépôts, ou une infinité
d’autres maux qui peuvent afreéler le pié de la
même maniéré, n’ont point eu lieu ; décider avec une
forte de précifion, 6c être affûré de la commotion &
de Y étonnement.
Dès le moment du heurt., où il n’eft que quelques
fibres léfées , 6c qu’une legerç quantité d’humeur extravafée
» on y pare aifément en employant les re-
medes confortatifs 6c réfolutifs, tels que ceux qui
compofent l’emmiellure fuivante.
« Prenez poudre de plantes aromatiques, deux li-
» vres ; farines réfolutives, qui font celles de fev e,
» d’orobe, de lupin & d’orge , demi-livre : faites
» bouillir le tout dans du gros v in , & ajoûtez-y miel
» commun, fix onces, pourl’emmiellure, que vous
» fixerez fur la folle ».
Ce cataplafme cependant ne fauroit remplir toutes
nos vûes. Il eft abfolument important de prévenir
les efforts de la matière, qui pourrait fouffler au
poil dans l’inftant même où nous ne nous y attendrions
pas ; & pour nous précautionner contre cet
accident, nous appliquerons fur la couronne l’emmiellure
répereuflive que je vais décrire.
« Prenez feuilles de laitue , de morelle & de plaii-
» tain, une poignée ; de joubarbe, dèmi-poignée :
» faites bouillir le tout dans une égale quantité d’eau
» & de vinaigre : ajoûtez-y de l’une des quatre fari-
» nés réfolutives, trois onces, 6c autant de miel ».
Mais les humeurs peuvent être extravafées de maniéré
à former une colle&ion & à fuppurer : alors il
faut promptement fonder avec les triquoifes toute la
circonférence 6c la partie inférieure de l’ongle, 6c
ob fer ver non-feulement le lieu où il y a le plus de
chaleur, mais celui qui nous paroît le plus fenfible,
afin d’y faire promptement une ouverture avec le
boutoir ou avec la gouge, ouverture qui offrira une
iffuë à la matière, 6c qui nous fournira le moyen de
conduire nos médicamens jufqu’au mal même. Sup-
pofons de plus que cette matière fe foit déjà ouvert
une voie par la corrofion du tiffu de la peau vers la
couronne ; nous n’en ouvrirons pas moins la folle ,
6c cette contre-ouverture facilitera la déterfion du
vuide 6c des parties ulcérées, puifque nous ne pourrons
qu’y faire parvenir plus aifément les injeftions
vulnéraires que nous y adrefferons. On évitera, ainfi
que je l’ai d it, relativement aux plaies fufeitées par
les chicots, les encloiiures, &c. (voyeç En c lo dure)
, les remedes gras, qui hâteraient la ruine des
portions aponévrotiques, qui s’exfolient fouvent en-
fuite de la fuppuration (voye^ Filandre) * & l’on
n’employera dans les panfemens que l’effence de
terebenthine , les fpiritueux, la teinture de myrrhe
& d’aloes , &c. Si l’on apperçoit des chairs molles,
on les confumera en pénétrant aufli profondément
dans le pié qu’il fera polfible, avec de l’alun en poudre
, ou quelqu’autre cathérétique convenable ; 6c
en fuivant cette route on pourra efpérer de voir bientôt
une cicatrice, foit à la couronne, foit à la folle,
qui n’aura pas moins de folidité que n’en avoient les
parties détruites.
La faignée précédant ces traitemens, s’oppofera
à l’augmentation du mal, favorifera la réfolution de
Fhumeur ftagnante, 6c calmera l’inflammation.
Enfin il eft des cas où les progrès font tels, que la
chûte de l’ongle eft inévitable. Je ne dirai point, avec
M. de Soleyfel, qu’alors le cheval eft totalement
perdu ; mais je laifferai agir la nature, fur laquelle
je me repoferai du foin de cette chûte & de la régénération
d’un nouveau pié. Deux expériences m’ont
appris qu’elle ne demande qu’à être aidée dans cette
opération ; ainfi j’uferai des médicamens doux ; je
tempérerai la terebenthine dont je garnirai tout le
pié , en y ajoûtant des jaunes d’oeufs 6c de l’huile
rofat : mes panfemens en un mot feront tels, que lés
chairs qui font à découvert, & qui font d’abord très-
vives , n’en feront point offenfées ; 6c enfuite de la
guérifon on diftinguera avec peine le pié neuf de
celui qui n’aura été en proie à aucun accident.
Il feroit affez difficile, au furplus, de preferire ici
6c à cet égard une méthode confiante ; je ne pourrais
détailler que des réglés générales, dont la variété
des circonftancés multiplie les exceptions. Quand
on connoît l’immenfe étendue des difficultés de l’art,
on avoue aifément qu’on ne peut rien ; on fe dépouille
de ces vaines idées que nous fuggere un
amour-propre mal entendu, pour s’en rapporter à
des praticiens habiles, quelefavoir & l’expérience
placent toûjours en quelque façon au-deffus de tous
les évenemens nouveaux & inattendus qui furvien-
nent. («)
E TO QU IAU , f. m. (Horlogerie.) fignifie en général
, parmi les ouvriers en fer, une petite cheville rqouu’oen, mpoeut dr al’nesm ppluêfciheeurr sd cea tso àu rlna ecri racuo-ndfeélràe ndc’uen d ’cuenre
tdauin b aploainnct i;e ra,i npfio luar c hl’eevmilpleê crhiveér ed eà rlean cviercrofenrf,é rse’nacpe
pelle Yétoquiau. Voye{ RENVERSEMENT.
On donne encore ce nom à une petite cheville rivée
fur l’avant-derniere roue de la fonnerie, 6c qui
fert à l’arrêter. Cette roue fe nomme la roue d'éto-
quiau. Voye^ R O UE , SONNERIE, &c.
On appelle aufîi de même nom toute piece d’une
machine en fe r , deftinée à en arrêter ou contenir
d’autres. Il y a des étoquiaux à couliffe, ÔC il y en a
à patte. (T )
ETOUBLAGE, f. m. ( Jurifp.) droit feigneurial
énoncé dans une charte d’Odon archevêque de
Roiien, de l’an 1262, qui fe levoit fur les efieules,
terme qui fignifie également le blé & le chanvre. Du-
cange en fon gloffaire, au mot efoublagium, croit
que ce droit confiftoit apparemment dans l’obligation
de la part des fujets du feigneur, de ramaffer pour
lu i, après la récolte, du chanvre pour couvrir les
maifons ; ce qui eft affez vraiffeinblable. (A')
ÉTOUFFÉ, adj. (Docimaft.) fe dit d’un effai qui
eft recouvert de fes feories, parce qu’on n’a pas eu
foin de donner ou de foûtenir le feu dans un degré
convenable, ou qu’on a donné froid mal-à-propos :
alors il ne boût plus & ne fume p lus, parce qu’il n’a
plus de communication avec l’air extérieur; & c’eft-
là l’origine de fa dénomination. L’effai eft fort fujec
à devenir étouffé» quand il eft mêlé d’étain. On dit
encore dans le même fens, l ’effai ejl noyé. Voyez ce
mot. On remédie à ces deux inconvéniens en donnant
très - chaud, & mettant un peu de poudre de
charbon fur la coupelle. Voye1 Essai. Article dtM.
DE VlLLIERS. Etouffé , ( Jardinage.) On dit un bois, un arbre
étouffé, quand ils font entourés d’autres arbres touffus
qui leur nuifent.
* ETOUFFER, v . aft. (Gramm. ) Ilfeditaufim-
ple & au figuré. Au fimple, c’eft fupprimer la communication
avec l’air libre ; ainfi l’on dit étouffer le
feu dans un fourneau : j'étouffe dans cet endroit. Au figuré
, il faut étouffer cette affaire, c’eft-à-dire empêcher
qu’elle n’ait des fuites en tranfpirant.
ETOUPAGE, f. m. terme de Chapelier, qui fignifie
ce qui refte de l’étoffe après avoir fabriqué les quatre
capades qui doivent former le chapeau ; 6c que ces
ouvriers ménagent, après l’avoir feutré avec la
main, pour garnir les endroits de ces capades qui
font les plus foibles. Voye£ Chapeau.
ETOUPE, f. f. C ’eft le nom que les Filafîleres
donnent à la moindre de toutes les filaffes, tant pour
la qualité que pour la beauté. Voye^ l'article Cor-
DERIE. Etoupe à étamer. Les Chauderonniers nomment
ainfi une efpece de. goupillon au bout duquel il
y a de la filaffe, dont ils fe fervent pour étendre l’ é-
tamure ou étain fondu, dans les pièces de ehaude-
ronnerie qu’ils étament. Voyei Et amure & Eta-
mer , & les Planches du Chauderonnier.
ETOUPER, terme de Chapelier, qui fignifie fortifier
les endroits foibles d'un chapeau avec la même étoffe
dont on a fait les capades, Voyei ETOUPAGE.