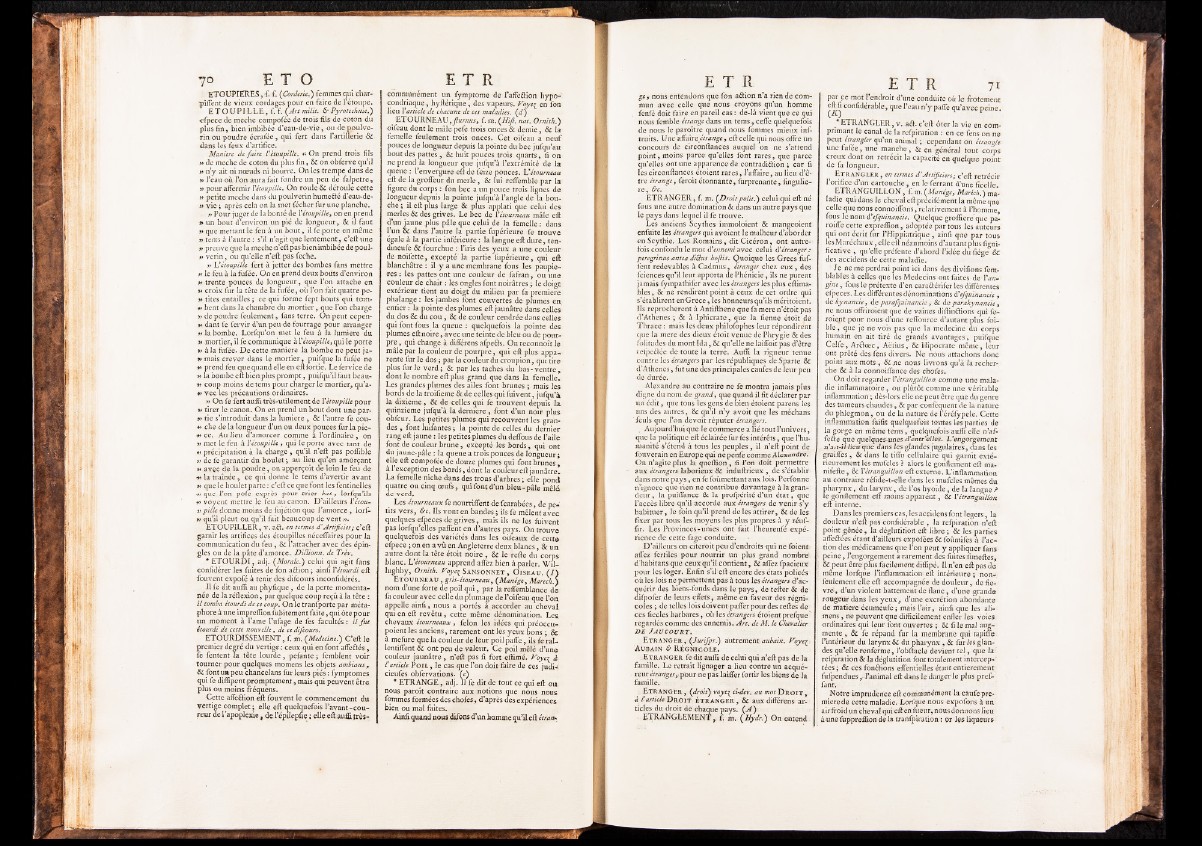
ETOUPIERES, -f. f . (Corderie.) femmes qui chsr-
xfiffent de vieux cordages pour en faire de l’étoupe.
E T O U P I L L E , f . f. (Art milit. & Pyrotechnie.')
■ efpece de meche compofée de trois fils de coton du
plus fin, bien imbibée d’eau-de-vie , ou de poulve-
rin ou poudre écrafée, -qui fert dans l’artillerie &
dans les -feux d’artifice.
Maniéré de faire l'étoupille. « On prend trois fils
» de meche de coton du plus fin, & on obferve qu’il
» n’y ait ni noeuds ni bourre. On les trempe dans de
» l’eau oii l’on aura fait fondre un peu de falpetre,
» pour affermir Xétoupille. On roule & déroule cette
» petite meche dans du poulverin humeâé d’eau-de-
» vie ; après cela on la met fécher fur une planche.
- » Pour juger de la bonté de Xétoupille, on en prend
» un bout d’environ un pié de longueur, & il faut
» que mettant le feu à un bout, il fe porte en même
» tems à l’autre : s’il n’agit que lentement, c’eft une
» preuve que la meche n’eft pas bien-imbibée de poul-
» vérin, ou qu’elle n’eft pas feche.
» L’étoupille fert à jetter des bombes fans mettre
t> le-feu à la fufée. On en prend deux bouts d’environ
» trente pouces de longueur, que l’on attache en
» croix fur la tête de la fufée, oii l’on fait quatre pe-
» tites entailles ; ce qui forme fept bouts qui tom-
■ » bent dans la chambre du mortier, que l’on charge
» de poudre feulement, fans terre. On peut cepen-
» dant fe fervir d’un peu de fourrage pour arranger
» la bombe. Lorfqu’on met le feu -à la lumière du
» mortier, il fe communique à VitoupiUe, qui le porte
» à la fufée. De cette maniéré la bombe ne peut ja-
» mais crever dans le mortier, puifque la fufée ne
» prend feu que quand elle en eftlortie. Le fervice de
» la bombe eu bien plus prompt, puifqu’ilfaut beau-
» coup moins de tems pour charger le mortier, qu’a-
♦ > vec les précautions ordinaires.
» On fe fert aufli très-utilement de Xétoupille pour
» tirer le canon. On en prend un bout dont une par-
»> tie s’introduit dans la lumière , & l’autre fe cou-
♦ > che de la longueur d’un ou deux pouces fur la pie-
*> ce. Au lieu d’amorcer comme à l’ordinaire, on
» met le feu à l’étoupille, qui le porte avec tant de
♦> précipitation à la charge , qu’il n’eft pas poflible
» de fe garantir du bpulet ; au lieu qu’en amorçant
» avec de la poudre, on apperçoit de loin le feu de
•*> la traînée, ce qui donne le tems d’avertir avant
»> que le boulet parte : c’eft ce que font les fentinelles
que T on pofe exprès pour crier bas, lorfqu’ils
» voyent mettre le feu au canon. D ’ailleurs Xétou-
» pille donne moins de fujétionque l ’amorce , lorf-
» qu’il pleut ou qu’il fait beaucoup de vent ».
ETOUPILLER, v . aft. en termes d’Artificier; c’eft
garnir les artifices des étoupilles néceffaires pour la
communication du feu , & l’attacher avec des épingles
ou de la pâte d’amorce. DicUonn. de Trév.
* ETOURDI , adj. (Morale.) celui qui agit fans
confidérer les fuites de fon attion ; ainfi l’étourdi eft
louvent expofé à tenir des difcours inconfidérés.
Il fe dit aufli au phyfique , de la perte momentanée
de la réflexion, par quelque coup reçû à la tête :
i l tomba étourdi de ce coup. On le tranfporte par métaphore
à une impreflion fubitement faite, qui ôte pour
un moment à l’ame l’ufage de fes facultés : il fut
étourdi de cette nouvelle, de ce difcours.
ETOURDISSEMENT, f. m. (Medecine.) C ’eft le
premier degré du vertiges ceux qui en font affe&és,
fe fentent la tête lourde, pefante ; femblent voir
tourner pour quelques momens les objets ambiant,
& fontu» peu chancelans fur leurs piés : fymptomes
qui fe diflipent promptement, mais qui peuvent être
plus ou moins fréquens.
Cette affeâion eft fouvent le commencement du
vertige complet; elle eft quelquefois l ’avant-coureur
de l ’apoplexie, de l’épilepfie ; elle eft aufli trèscommunément
un fymptome de l’affe&ion hypocondriaque
, hyftérique, des vapeurs. Voye^ en fon
lieu Xarticle de chacune de ces maladies, (d)
ETOURNEAU,flurnus, f. m. (Hifi. nat. Ornith.)
oifeau dont le mâle pefe trois onces & demie, & la
femelle feulement trois onces. Cet oifeau a neuf
pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu’au
bout des pattes, & huit pouces trois quarts, fi on
ne prend la longueur que jufqu’à l’extrémité de la
queue : l’envergure eft de feize pouces. L’étourneau
eft de la grofleur du merle, & lui reffemble par la
figure du corps : fon bec a un pouce trois lignes de
longueur depuis la pointe jufqu’à l’angle de la bouche
; il eft plus large & plus applati que celui des
merles & des grives. Le bec de Xétourneau mâle eft
d’un jaune plus pâle que celui de la femelle : dans
l’un & dans l’autre la partie fupérieure fe trouve
égale à la partie inférieure : la langue eft dure, ten-
dineufe & fourchue : l’iris des yeux a une couleur
de noifette, excepté’ la partie fupérieure, qui eft
blanchâtre : il y a une membrane fous les paupières
: les pattes ont une couleur de fafran, ou une
couleur de chair : les ongles font noirâtres ; le doigt
extérieur tient au doigt du milieu par fa première
phalange : les jambes font couvertes de plumes en
entier : la pointe des plumes eft jaunâtre dans celles
du dos & du c o u , & de couleur cendrée dans celles
qui font fous la queue : quelquefois la pointe des
plumes eft noire, avec une teinte de bleu ou de pourpre
, qui change à differens afpefts. On reconnoît le
mâle par la couleur de pourpre, qui eft plus apparente
fur le dos ; par la couleur du croupion, qui tire
plus fur le verd ; & par les taches du bas-ventre,
dont le nombre eft plus grand que dans la femelle.
Les grandes plumes des ailes font brunes ; mais les
bords de la troifieme & de celles qui fuivent, jufqu’à
la dixième, & de celles qui fe trouvent depuis la
quinzième jufqu’à la derniere , font d’un noir plus
obfcur. Les petites plumes qui recouvrent les grandes
, font luifantes ; la pointe de celles du dernier
rang eft jaune : les petites plumes du deflous de l’aile
font de couleur brune, excepté les bords, qui ont
du jaune-pâle : la queue a trois pouces de longueur ;
elle eft compofée de douze plumes qui font brunes ,
à l’exception des bords, dont la couleur eft jaunâtre.
La femelle niche dans des trous d’arbres ; elle pond
quatre ou cinq oeufs, qui font d’un bleu-pâle mêla
de verd.
Les étourneaux fe nourriflent de fcarabées, de petits
vers, &c. Ils vont en bandes ; ils fe mêlent avec
quelques efpeces de grives, mais ils ne les fuivent
pas lorfqu’elles paffent en d’autres pays. On trouve
quelquefois des variétés dans les oilëaux de cetta
efpece ; on en a vû en Angleterre deux blancs, & un
autre dont la tête étoit noire , & le refte du corps
blanc. Vétourneau apprend allez bien à parler. Wil-
lughby, Ornith. Voyeç SANSONNET, Oiseau. ( J ) Etourneau , gris-étourneau, (Manège, Marech.y
nom d’une forte de poil qui, par la reffemblance de
fa couleur avec celle du plumage de l’oifeau que l’on
appelle ainfi, nous a portés à accorder au cheval
qui en eft revêtu , cette même dénomination. Les
chevaux étourneaux, félon les idées qui préoccu-
poient les anciens, rarement ont les yeux bons ; &
à mefure que la couleur de leur poil paffe, ils fe rai-
lentiffent & ont peu de valeur. Ce poil mêlé d’uno
couleur jaunâtre , n’eft pas fi fort eftimé. Voye{ à
Varticle Poil , le cas que l’on doit faire de ces judi-l
cieufes obfervations. (e)
* ETRANGE, adj. Il fe dit de tout ce qui eft ou
nous paroît contraire aux notions que nous nous
femmes formées des chofes, d’après des expériences
bien ou mal faites.
Ainfi quand nous difoos d’un homme qu’il eft étran»
ge9' notis entendons que fon a&ion n’a rien de commun
avec celle que nous croyons qu’un homme
. fenfé doit faire en pareil cas : de-là vient que ce qui
nous femble étrange dans un tems, cefle quelquefois
de nous le paroître quand nous fommes mieux inf-
trüits. Une affaire étrange , eft celle qui nous offre un
concours de eirconftanees auquel on ne s’attend
point, moins parce qu’elles font rares, que parce
qu’elles ont une apparence de contradiction ; car fi
les eirconftanees étoient rares, l’affaire, au lieu d’être
étrange, ferait étonnante, furprenante, fingulie-
r e , &c.
ETRANGER, f. m. (Droit polit.) celui qui eft né
fous une autre domination & dans un autre pays que
le pays dans lequel il fe trouve.
Les anciens Scythes immoloient & mangeoient
enfuite les étrangers qui avoient le malheur d’aborder
en Scythie. Les Romains, dit Cicéron, ont autrefois
confondu le mot d'ennemi avec celui d’étranger :
peregrinus antea diclus hofiis. Quoique les Grecs fuf-
fent redevables à Gadmus, étranger chez eu x , des
fciences qu’il leur apporta de Phénicie, ils ne purent
jamais fympathifer avec les étrangers les plus eftima-
bles, & ne rendirent point à ceux de cet ordre qui
s’établirent enGrece, les honneurs qu’ils méritoient.
Ils reprochèrent à Antifthene que fa mere n’étoit pas
d ’Athenes ; & à Iphicrate, que la fienne étoit de
Thrace : mais les deux philofophes leur répondirent
que la mere des dieux étoit venue de Phrygie & des
folitudes du mont Ida, & qu’elle ne laiffoit pas d’être
refpe&ée de toute la terre. Aufli la rigueur tenue
contre les étrangers par les républiques de Sparte &
d’Athenes, fut une des principales caufes de leur peu
de durée.
Alexandre au contraire ne fe montra jamais plus
digne du nom de grand, que quand il fit déclarer par
un édit, que tous les gens de bien étoient parens les
uns des autres, & qu’il n’y avoit que les méchans
’ feuls que l’on devoit réputer étrangers.
, Aujourd’hui que le commerce a lié tout l’univers,
que la politique eft éclairée fur fes intérêts, que l’humanité
s’étend à tous les peuples , il n’eft point de
fouverain en Europe qui nepenfe comme Alexandre.
On n’agite plus la queftion, fi Fon doit permettre
aux étrangers laborieux & induftrieux , de s’établir
dans notre pa ys, en fe foûmettant aux lois. Perfonne
n’ignore que rien ne contribue davantage à la grandeur
, la puiffance & la profpérité d’un é ta t, que
l’accès libre qu’il accorde aux étrangers de venir s’y
habituer, le foin qu’il prend de les attirer, & de les
fixer par tous les moyens les plus propres à y réuf-
fir. Les Provinces-unies ont fait l’heureufé expérience
de cette fage conduite.
D ’ailleurs on citerait peu d’endroits qui ne loient
aflez fertiles pour nourrir un plus grand nombre'
d’habitans que ceux qu’il contient, & affez fpacieux
pour les loger. Enfin s’il eft encore des états policés
oit les lois ne permettent pas à tous les étrangers d’acquérir
des biens-forids dans le pays, de tefter & de
difpofer de leurs effets, même en faveur des régni-
coies ; de telles lois doivent paffer pour des reftes de
ces fiecles barbares, oit les étrangers étoient prefque
regardés comme des ennemis. Art. de M. le Chevalier
D E J A U C O U R T . Etranger, (Jurifpr.) autrement aubain. Voye^> Aubain & Régnigole.
Etranger fe famille. Le retraitd liitg anuafglie dr ea c leileuni qcuoin ntr’ee fut np aasc dqeu éla
fraemuri lélter.anger y pour ne pas laiffer fortir les biens de la
. Etranger, (droit) voye^ ci-dev. au mot Droit ,
àti cll'aerst idcule Droit. Étranger , & aux differens ardroit
de chaque pays. (A )
ETRANGLEMENT, f. m. (Hydr.) On entend
l v-au il \
* ETRANGLER, v . aft. c ’eft ôter la vie en comprimant
le canal de la refpiration : en ce fens on ne
peut étrangler qu’un animal ; cependant on étrangle
ùne fufee, une manche, & en général tout corps
creux dont on rétrécit la capacité en quelque point
de fa longueur.
l’orEifticrea dn’gunl ecra r,t oenu tcehrme,e se dn' Aler tfiefircriaernst; dc’u’enfet rféictreélclei.r
ETRANGUILLON, f. m .(Manège, Marich.) maladie
qui dans le cheval eft precifément la même que
celle que nous connoiffons, relativement à l’homme,
fous le nom d'efquinancie. Quelque groflxere que pa-
roifle cette expreflion, adoptée par tous les auteurs
qui ont écrit fur THippiatrique, ainfi que par tous
les Maréchaux, elle eft néanmoins d’autant plus figni-
ficative , qu’elle préfente d’abord l’idée dufiége &C
des accidens de cette maladie.
Je ne me perdrai point ici dans des divifions fem-
blables à celles que les Médecins ont faites de Xan-
gine, fous le prétexte d’en cara&érifer les différentes
eljpeces. Les différentes dénominations d'efquinancie ,
de kynancie , de parafquinancie , & de parakynancie ,
ne nous offriraient que de vaines diftin&ions qui fe-
roiept pour nous d’une reflburce d’autant plus foi-
ble, que je ne vois pas que la medecine du corps
humain en ait tiré de grands avantages, puifque
C e lfe, Arélcec, Aëtius, & Hipocrate même, leur
ont prêté dès fens divers. Ne nous attachons donc
point aux mots , & fie nous livrons qu’à la recherche
& à la connoiffance des chofes.
On doit regarder Xétranguillon comme une maladie
inflammatoire, ou plutôt comme une véritable
inflammation ; dès-lors elle ne peut être que du genre
des tumeurs chaudes, & par conféquent de la nature
du phlegmon, ou de la nature de l’éréfypele. Cette
inflammation faifit quelquefois toutes les parties de
la gorge en même tems, quelquefois aufli elle n’af-
feéle que quelques-unes A’entr’elles. L ’engorgement
n’a-t-il lieu que dans les glandes jugulaires, dans les
graifles , & dans le tiffu cellulaire qui garnit extérieurement
les mufcles ? alors le gonflement eft ma-
nifefte, Sç Xétranguillon eft externe. L’inflammation
au contraire réfide-t-elle dans les mufcles mêmes du
pharynx, du larynx, de l’os hyoïde, de la langue ?
le gonflement eft moins apparent, & Xétranguillon
eft interne.
Dans les premiers cas, les accidens font légers, la
douleur n’eft pas confidérable , la refpiration n’eft
point gênée, la déglutition eft libre ; & les parties
affeélées étant d’ailleurs expofées & foûmifes à l’action
des médicamens que l’on peut y appliquer fans
peine, l’engorgement a rarement des fuites tiineftes,
& peut être plus facilement diflipé. Il n’en eft pas de
même lorfque l’inflammation eft intérieure ; non-
feulement elle eft accompagnée de douleur, defie-
v ré , d7un violent battement de flanc, d’une grande
rougeur dans les y eu x , d’une excrétion abondante
de matière écumeufe ; mais l’air, ainfi que les ali-
mens, ne peuvent que difficilement enfler les voies
ordinaires qui leur font ouvertes ; & fi le mal augmente
, & fe répand fur la membrane qui tapiffe
l’intérieur du larynx & du pharynx , & furies glandes
qu’elle renferme, l’obftacle devient te l, que la
refpiration & la déglutition font totalement interceptées
; & ces fondions effentieïles étant entièrement
fufpendues,- l’animal eft dans le danger le plus pref-
fant.
Notre imprudence eft communément la caufe première
de cette maladie. Lorfque nous expofons à un
air froid un cheva l qu i eÛ en fiteur, nous donno ns lieu
àmne fuppreflion de la tranfpiration : or- les liqueur»