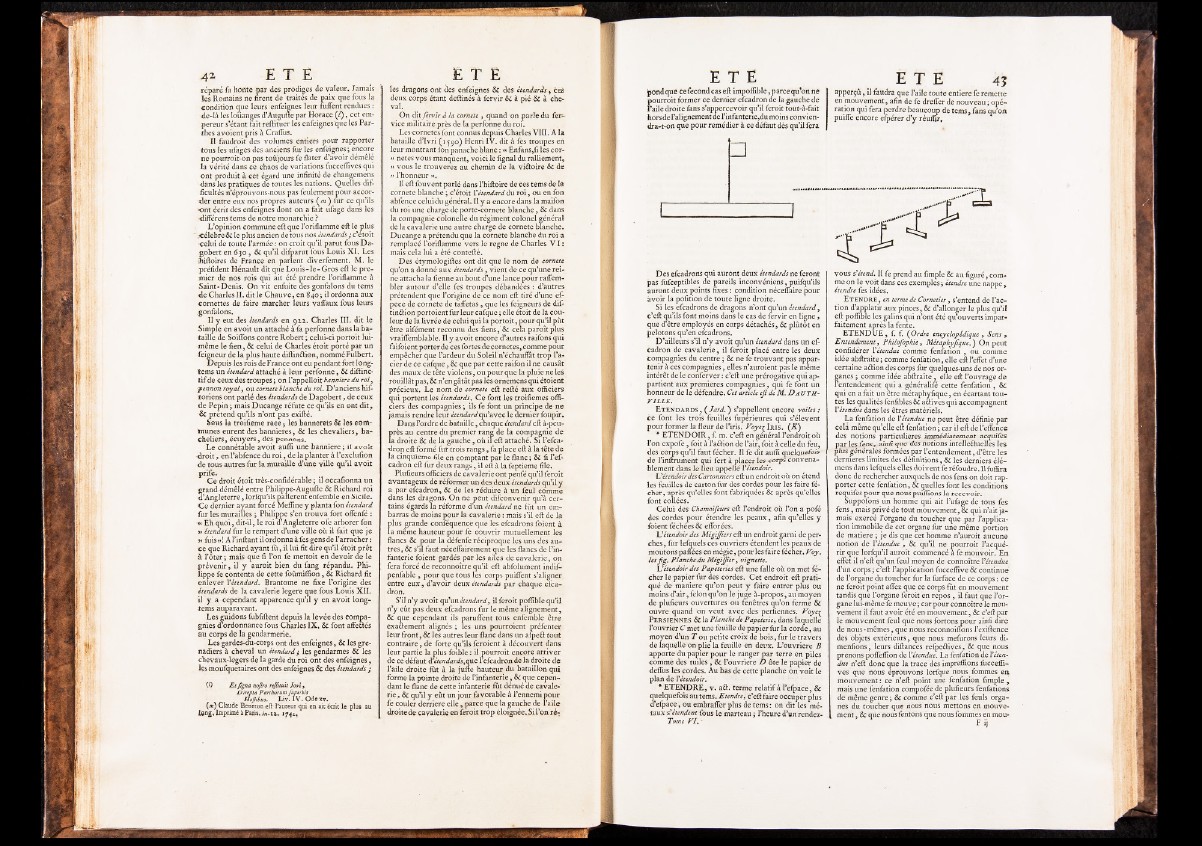
réparé fa honte par des .prodiges de valeur. Jamais
les Romains ne firent de traites de paix que fous la
condition que leurs enfeignes leur fiiffent rendues :
de-là les loiianges d’Àugufte par Horace (/), cet empereur
s’étant fait reftituer les enfeignes que les Par-
thes avoient pris à Craflus.
Il faüdroit des volumes entiers pour rapporter
tous les ilfages des anciens fur les enfeignes; encore
ne pourroit-on pas toujours fe dater d’avoir démêlé
la vérité dans ce chaos de variations fucceflives qui
ont produit à cet égard une infinité de changemens
dans les pratiques de toutes les nations. Quelles difficultés
n’éprouvons-nous pas feulement pour accorder
entre eux nos propres auteurs ( m ) lut ce qu’ils
o n t écrit des enfeignes dont on a fait ufage dans les
differens tems de notre monarchie ?
L’opinion commune eft que l’oriflamme eft le plus
~ ..célébré ÔC le plus ancien de tous nos étendards ; c’etoit
ce lu i de toute l’armée-: on croit qu’il parut fous Dagobert
en 630, Ôc qu’il difparut fous Louis XI. Les
Æiiftoires de France en parlent diverfement. M. le
préfident Hénault dit que L ouis-le-Gros eft le premier
de nos rois qui ait été prendre l’oriflamme à
Saint-Denis. On v it enfuite des gonfalons du tems
de Charles IL dit le Chauve, en 840 ; il ordonna aux
cornettes de faire marcher leurs vaffaux fous leurs
.gonfalons.
Il y eut des étendards en 91 1 . Charles ÏII. dit le
Simple en avoit un attaché à fa perfonne dans la bataille
de Soiflbns contre Robert ; celui-ci portoit lui-
même le fien, ôc celui de Charles étoit porté par un
feigneur de la plus haute diftin&ion, nommé Fulbert.
Depuis les rois de France ont eu pendant fort long-
tems un étendard attaché à leur perfonne, ôc diftinc-
t if de ceux des troupes ; on l’appelloit bannière du roi,
■ pennon royal, ou corneteblanche du roi. D ’anciens hif-
toriens ont parlé des étendards de Dagobert, de ceux
de Pépin ; mais Ducange réfute ce qu’ils en ont dit,
ôc prétend qu’ils n’ont pas exifté.
Sous la troifieme race, les bannerets 6c lès communes
eurent des bannières, 6c les chevaliers, bacheliers,
écuyers, des pennons.
Le connétable avoit aufli une bannière; il avoit
droit, en l’abfence du ro i, de la planter à l’exclufion
de tous autres fur la muraille d’une ville qu’il avoit
prife.
Ce droit étoit très-confidérable ; il occafionna un
grand démêlé entre Philippe-Augufte 6c Richard roi
d ’Angleterre, lorfqu’ils paflerent enfemble en Sicile.
C e dernier ayant forcé Mefline y planta fon étendard
fur les murailles ; Philippe s’en trouva fort offenfé :
>« Eh quoi, dit-il, le roi d’Angleterre ofe arborer fon
» étendard fur le rempart d’une ville oii il fait que je
» fuis »! A l’inftant il ordonna à fes gens de l’arracher :
ce que Richard ayant fû , il lui fit dire qu’il étoit prêt
à l’ôter ; mais que fi l’on fe mettoit en devoir de le
prévenir, il y auroit bien du fang répandu. Philippe
fe contenta de cette foumiffion, 6c Richard fit
enlever l’étendard. Brantôme ne fixe l’origine des
étendards de la cavalerie legere que fous Louis XII.
il y a cependant apparence qu’il y en avoit long-
tems auparavant.
Les guidons fubfiftent depuis la levée des compagnies
d’ordonnance fous Charles IX, ôc font affeâés
au corps de la gendarmerie.
Les gardes-du-corps ont des enfeignes, 6c les grenadiers
à cheval un étendard ; les gendarmes 6c les
chevaux-légers de la garde du roi ont des enfeignes,
les moufquetaires ont des enfeignes 6c des étendards ;
<0 E t fana noftro reftituit Jovi,
Direpta Parthorum fuperbis
Hoflibus. Liv. IV. Ode xv.
(m) Claude Beneton .eft-l'auteur qui en ait écrit le plus au
long« Imprimé à Paris, in - ix . 174z.
les dragons ont des enfeignes 6c des étendards, tes
deux corps étant deftinés à fervir 6c à pié 6c à cheval.
On dit fervir à la cornete , quand !on parlé du fers-
vice militaire près de la perfonne du roi.
Lescornetes font connus depuis Charles VIII. A la
bataille d’Ivri (1590) Henri IV. dit à fes troupes en
leur montrant fon panache blanc : « Enfans,fi les cor-
» netes vous manquent, voici le lignai du ralliement,
» vous le trouverez au chemin de la vi&oire 6c dé
» l’honneur ».
Il eft fou vent parlé dans l’hiftoire de ces tértis de là
cornete blanche ; c’étoit Y étendard du ro i, ou en fon
abfence celui du général. Il y a encore dans la maifon
du roi une charge de porte-cornete blanche, 6c dans
la compagnie colonelle du régiment colonel général
de la cavalerie une autre charge de cornete blanche.
Ducange a prétendu que la cornete blanche du roi a
remplacé l’oriflamme vers le régné de Charles V I :
mais cela lui a été contefté.
Des étymologiftes ont dit que le nom de cornete
qu’on a donné aux étendards, vient de ce qu’une reine
attacha la fienne au bout d’une lance pour raffem-
bler autour d’elle fes troupes débandées : d’autres
prétendent que l’origine de ce nom eft tiré d’une ef-
pece de cornete de taffetas, que les feigneurs de dif-
tin&ion portoient fur leur cafque ; elle étoit de la couleur
de la livrée de celui qui la portoit, pour qu’il put
être aifément reconnu des fiens, 6c cela paroît plus
vraiffemblable. Il y avoit encore d’autres raifons qui
faifoient porter de ces fortes de cornetes, comme pour
empêcher que l’ardeur du Soleiln’é chauffât trop l’acier
de Ce cafque, ôc que par cette raifon il ne causât
des maux de tête violens, ou pour que la pluie ne les
rouillât pas, & n’en gâtât pas les ornemens qui étaient
précieux. Le nom de cornete eft tefté aux officiers
qui portent les étendards. C e forit les troifiemes officiers
des compagnies ; ils fe font un principe de ne
jamais rendre leur étendard qu’avec le dernier foupir.
Dans l’ordre de bataille, chaque étendard eft à-peu*
près au centre du premier rang de la compagnie de
la droite ôc de la gauche, oii il eft attaché. Si l’efca-
•dron eft formé fut trois rangs, fa place eft à la tête de
la cinquième file en comptant par le flanc ; 6c fi l’ef*
cadron eft fur deux rangs, il eft à la feptieme file.
Plufieurs officiers de cavalerie ont penfé qu’il feroit
avantageux de réformer un des deux étendards qu’il y
a par efeadron, 6c de les réduire à un feul comme
dans les dragons. On ne peut difeonvenir qu’à certains
égards la réforme d’un étendard ne fût un embarras
de moins pour la cavalerie : mais s’il eft de la
plus grande conféquence que les efeadrons foient à
la même hauteur pour fe couvrir mutuellement les
flancs 6c pour la défenfe réciproque les uns des autres,
6c s’il faut néceffairement que les flancs de l’infanterie
foient gardés par les ailes de cavalerie, on
fera forcé de reconnoître qu’il eft abfolument indif-
penfable , pour que tous les corps puiffent s’aligner
entre eu x, d’avoir deux étendards par chaque efeadron.
S’il n’y avoit qu’un étendard, il feroit poffible qu’il
n’y eût pas deux efeadrons fur le même alignement,
6c que cependant ils paruffent tous enfemble être
exaaement alignés ; les uns. pourraient préfenter
leur front, 6c les autres leur flanc dans un alpeft tout
contraire, de forte qu’ils feroient à découvert dans
leur partie la plus foible : il pourroit encore arriver
de ce défaut d’étendards,que l’efcadron de la droite de
l’aile droite fût à la jufte hauteur du bataillon qui
forme la pointe droite de l’infanterie, 6c que cependant
le flanc de cette infanterie fut dénué de cavalerie
, 6c qu’il y eût un jour favorable à l’ennemi pour
fe couler derrière e lle, parce que la gauche de l ’aile
droite de cavalerie en feroit trop éloignée, Si l’on répond
que ce fécond cas eft impoflible, p arce qu’on ne
pourroit former ce dernier efeadron de la gauche de
l’aile droite fans s’appercevoir qu’il feroit tout-à-fait
hors de l’alignement de l’infanterie,du moins conviendra
t-on que pour remédier à ce défaut dès qu’il fera
Des efeadrons qui auront deux étendards ne feront
pas fufceptibles de pareils inconvéniens, puifqu’ils
auront deux points fixes : condition néceffaire pour
avoir la pofition de toute ligne droite.
Si les efeadrons de dragons n’ont qu’un étendard,
c’ eft qu’ils font moins dans le cas de fervir en ligne ,
que d’être employés en corps détachés, 6c plûtot en
pelotons qu’en efeadrons.
D ’ailleurs s’il n’y avoit qu’un étendard dans un efeadron
de cavalerie, il feroit placé entre les deux
fcompagnies du centre ; ôc ne fe trouvant pas appartenir
à ces compagnies, elles n’auroient pas le même
intérêt de le conferver : c’eft une prérogative qui appartient
aux premières compagnies, qui fe font un
honneur de le défendre. Cet article ejl de M. D a u t h -
VILLE. Etendards , ( Jard. ) s’appellent encore voiles :
ce font les pour former tlrao fisle uferu diell el’si rfius.p erieures qui s’élèvent Voyeç Iris. (X)
* ETENDOIR, f. m. c’eft en général l’endroit oii
l’on expofe, foit à l’aftion de l’air, foit à celle du feu,
des corps qu’il faut fécher. Il fe dit aufli quelque^«*
de l’inftrument qui fert à placer les corps convenablement
dans le lieu appelle Yétendoir.
lesU feétueinlldeosi rd dee cs aCratnoonn fnuire rdse esf ct uonrd eens dproouitr olieis o fna iertee nféd
cher, après qu’elles font fabriquées ÔC après qu’elles
font collées.
Celui des Chamoifeurs eft l’endroit où l’on a pofé
des cordes pour étendre les peaux, afin qu’elles y
foient féchées ôc efforées.
Uétendoir des MégiJJîers eft un endroit garni de perches
, fur lefquels ces ouvriers étendent les peaux de
moutons paflées en mégie, pour les faire fécher. Voy.
les fig. Planche du MégiJJîer, vignette.
Uétendoir des Papeteries eft une falle oii on met fécher
le papier fur des cordes. Cet endroit eft pratiqué
de maniéré qu’on peut y faire entrer plus ou
moins d’air, félon qu’on le juge à-propos, au moyen
de plufieUrs ouvertures ou fenêtres qu’on ferme 6c
ouvre quand on veut avec des perfiennes. Voye^ Persiennes 6c la Planche de Papeterie, dans laquelle
l’ouvrier C met une feuille de papier fur la corde, au
moyen d’un T ou petite croix de bois, fur le travers
de laquelle on plie la feuille en deux. L’ouvriere B
apporte du papier pour le ranger par terre en piles
comme des tuiles, 6c l’ouvriere JD ôte le papier de
deffus les cordes. Au bas de cette planche on voit le
plan de Uétendoir.
* ETENDRE, v . aft. terme relatif à l’efpace, 6c
uelquefois au tems. Etendre; c’eft faire occuper plus
’efpace, ou embraffer plus de tems : on dit les métaux
détendent fous le marteau ; l’heure d’un rendez-
Torne VI. •
apperçû, il faudra que l’aile toute entière fe remette
en mouvement, afin de fe dreffer de nouveau; opération
qui fera perdre beaucoup de tems, fans qu’on
puiffe encore efpérer d’y réuflir.
vous détend. Il fe prend au fimple 6c au figuré, comme
on le voit dans ces exemples; étendre une nappe ,
étendre fes idées. Etendre, en terme de Cornetier, s’entend de l’action
d’applatir aux pinces, 6c d’allonger le plus qu’il
eft poffible les galins qui n’ont été qu’ouverts imparfaitement
après la fente.
ETENDUE, f. f. {Ordre encyclopédique , Sens ,
Entendement, Philofophic, Mètaphyfique.') On peut
confidérer Yétendue comme fenfation , ou comme
idée abftraite; comme fenfation, elle eft l’effet d’une
certaine aâion des corps fur quelques-uns de nos organes
; comme idée abftraite, elle eft l’ouvrage de
l’entendement qui a généralifé cette fenfation , 6c
qui en a fait un etre mètaphyfique, en écartant toutes
les qualités fenfibles 6c aftives qui accompagnent
Y étendue dans les êtres matériels.
La fenfation de Y étendue ne peut être définie par
cela même qu’elle eft fenfation ; car il eft de l’effence
des notions particulières immédiatement acquifes
par leslens, ainû que des notions intellectuelles les
plus généra les formées par l’entendement, d’être les
aernieres limites des définitions, 6c les derniers élé-
mens dans lefquels elles doivent fe réfoudre. Ilfuffira
donc de rechercher auxquels de nos fens on doit rapporter
cette fenfation, ôc quelles font les conditions
requifes pour que nous puiflîons la recevoir.
Suppofons un homme qui ait l’ufage de tous fes
fens, mais privé de tout mouvement, 6c qui n’ait jamais
exercé l’organe du toucher que par l’application
immobile de cet organe fur une même portion
de matière ; je dis que cet homme n’auroit aucune
notion de Y étendue , 6c qu’il ne pourroit l’acquérir
que lorfqu’il auroit commencé à fe mouvoir. En
effet il n’eft qu’un feul moyen de connoître Y étendue
d’un corps ; c’eft l’application fuccelïïve 6c continué
de l’organe du toucher fur la furface de ce corps : ce
ne feroit point affez que ce corps fut en mouvement
tandis que l’organe feroit en repos , il faut que l’organe
lui-même fe meuve ; car pour connoître le mouvement
il faut avoir été en mouvement, 6c c’eft par
le mouvement feul que nous fortons pour ainfi dire
de nous-mêmes, que nous reconnoiffons l’exiftence
des objets extérieurs, que nous mefurons leurs di-
menfions , leurs diftances refpeftives, 6c que nous
prenons poffeflion de Y étendue. La fenfation de Y étendue
n’eft donc cpe la trace des impreflions fucceflives
que nous éprouvons lorfque nous fommes en,
mouvement : ce n’eft point une fenfation fimple ,
mais une fenfation compofée de plufieurs fenfations
de même genre ; 6c comme c’eft par les feuls organes
du toucher que nous nous mettons en mouvement
, 6c que nousièntons que nous fommes en mou