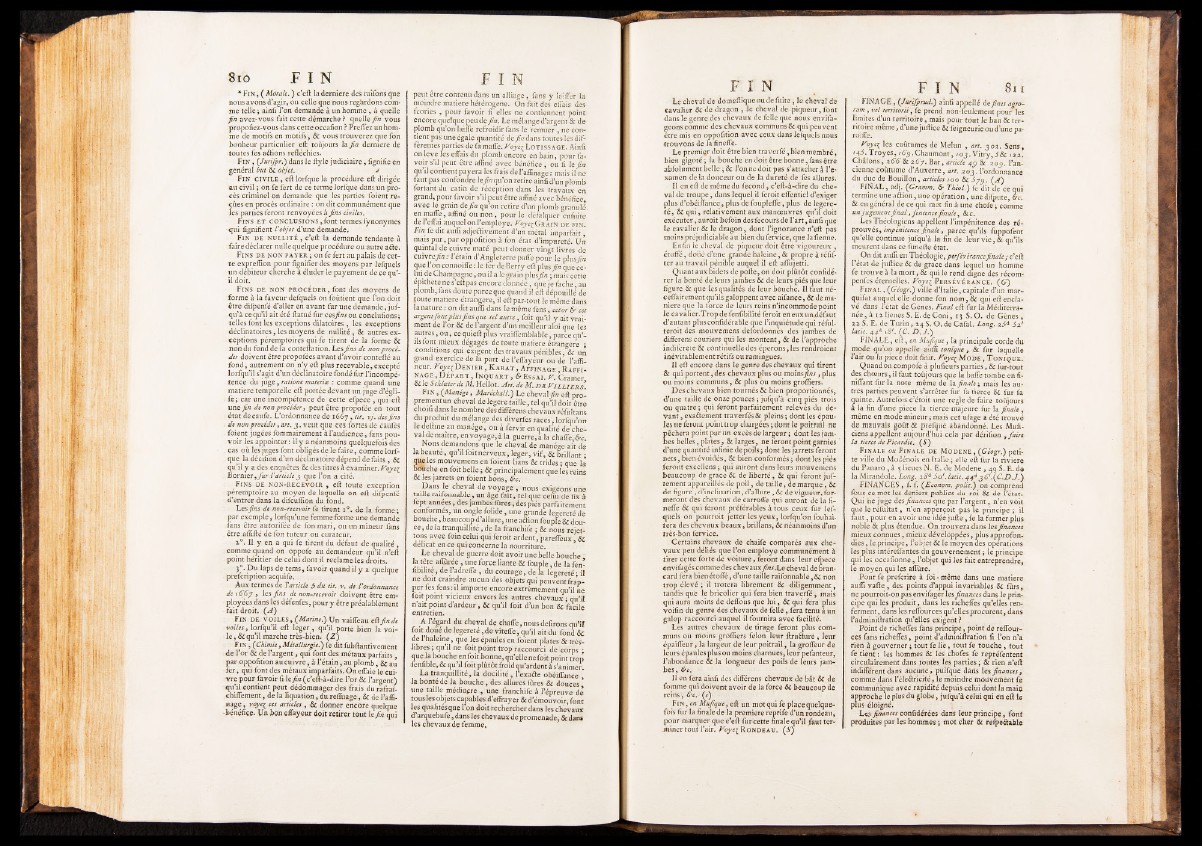
S i o F I N
* Fin , ( Môrale. ) c’eft la derniere des iraiforls que
nous avons d’agir, ou celle que nous regardons comme
telle ; ainfi l’on demande à un homme , à quelle
fin avez-vous fait cette démarche ? quelle fin vous
propofiez-vous dans cette occafion ? Preffez un homme
de motifs en motifs, & vous trouverez que fon
bonheur particulier eft toûjours la fin derniere de
toutes fes aôions refléchies.
Fin , (Jurifpr.) dans le flyle judiciaire, lignifie en
général but & objet. j
Fin c iv il e , eft lorfque la procédure eft dirigée
au civil ; on fe fert de ce terme lorfque dans, un procès
criminel on demande que les parties foient reçues
en procès ordinaire : on dit communément que
- les parties feront renvoyées à f in s civiles.
Fins et co n c lusio n s, font termesfynonymes
qui lignifient l'objet d’une demande.
Fin de nullité , c’eft la demande tendante à
faire déclarer nulle quelque procédure ou autre aôe.
Fins de non payer ; on fe fert au palais de cette
expreflion pour lignifier des moyens par lefquels
un débiteur cherche à éluder le payement de ce qu’il
doit.
Fins de non procéder , font des moyens de
forme à la faveur defquels on foûtient que l’on doit
être difpenfé d’aller en avant fur une demande, juf-
qu’à ce qu’il ait été ftatué fur cesfins ou conclufions;
telles font les exceptions dilatoires , les exceptions
déclinatoires, les moyens de nullité, & autres exceptions
péremptoires qui fe tirent de la forme &
. non du fond de la conteftation. Les fins de nonproce-
der doivent être propofées avant d’avoir contefté au
fond, autrement on n’y eft plus recevable, excepté
lorfqu’il s’agit d’un déclinatoire fondé fur l’incompétence
du juge, ratione materia : comme quand une
matière temporelle eft portée devant un juge d’égli-
: fe ; car une incompétence de cette efpece , qui eft
une fin de non procéder, peut être propofée en tout
état decaufe. L’ordonnance de 1667, tit. vj. des fins
- de non procéder, art. 3 . veut que ces fortes de caufes
foient jugées fommairement à l’audience, fans pouvoir
les appointer : il y a néanmoins quelquefois des
. cas où les juges font obligés de le faire, comme lorfque
la décifion d’un déclinatoire dépend de faits , &
qu’il y a des enquêtes & des titres à examiner. Voyeç
Bornier ,fu r l'article 3 que l’on a cité.
Fins d e .non-rec evo ir , eft toute exception
péremptoire au moyen de laquelle on eft difpenfé
d’entrer dans la difcuflion du fond.
Les fin s .d e non-recevoir fe tirent i°. de la forme*
par exemple , lorfqu’une femme forme une demande
fans être autorifée de fon mari, ou un mineur fans
, être aflifté de fon tuteur ou curateur.
i° . Il y en a qui fe tirent du défaut de qualité,
comme quand on oppofe au demandeur qu’il .n’eft
point héritier de celui dont il reclameJes droits.
30. Du laps de tems, favoir quand il y a quelque
prefcription acquife.
Aux termes de 1 article 3 du tit. v . de Vordonnance
de 1 6 6 J , les f in s de non-recevoir doivent être employées
dans les défenfes, pour y être préalablement
fait droit ( A )
Fin de VOILES, (Marine. ) Un vaiffeau eft f in de
v o ile s , lorfqu’il eft leger , qu’il porte bien la voile
, & qu’il marche très-bien. (Z)
Fin , {Chimie , Métallurgie.') fe dit fubftantivement
de J’or & de l’argent, qui font des métaux parfaits
par oppofition au cuivre , à l’étain, au plomb & au
fer, qui font des métaux imparfaits. On effaie le cuivre
pour favoir fi le f in (c’eft-à-dire l’or & l’argent)
qu’il contient peut dédommager des frais du rafraî-
chiffement, de la liquation, du reffuage, & de l’affinage,
voyei ces articles,, & donner encore quelque
-bénéfice. Un bon effayeur doit retirer tout le f in qui
F I N
peut être contenu dans Un alliage, fans ÿ laiffer k
moindre matière hétérogène. On fait des effais des
fcories , pour favoir fi elles ne contiennent point
encore quelque peu de fin. Le mélange d’argent & de
plomb qu’on laiffe refroidir fans le remuer , ne contient
pas une égale quantité de /«dans toutes lés différentes
parties de fa maffe. Voye^ Lo t is sag e . Ainfi
On leve les effais du plomb encore en bain, pour fa-;
voir s il peut etre affine avec bénéfice , ou fi 1 g fin
qu’il contient payera les frais de l’affinage : mais il ne
faut pas confondre fin qu’on retire ainfi d’un plomb
fortant du catin de réception dans les travaux en
grand, pour favoir s’il peut être affiné avec bénéfice*
avec le grain de fin qu’on retire d’un plomb granulé,
en maffe, affiné ou non, pour le défalquer enfuite
de 1 effai auquel on l’employe. V?yc£ Grain de fin.
Fin fe dit aufli adjeéiivement d’un métal imparfait,
mais pur, par oppofition à fon état d’impureté. Un
quintal de cuivre maté peut donner vingt livres de
cuivre/«.* l’étain d’Angleterre paflé pour le plus/«
que l’on connoiffe : le fer de Berry eft plus/« que celui
de Champagne, ou il a le grain plusfin ; mais cette
épithetenes’eltpas encore donnée, que jè fâche, au
plomb, fans doute parce que quand il eft dépouillé de
joute matière étrangère, il eft par-tout le même dans
la nature : on dit auffi dans le même fens, cet or & cet
argent fon t plus fins que tel autre, foit qu’il y ait vraiment
de l’or Ôc de l’argent d’un meilleur aloi que les
autres, ou, ce quieft plus vraiffemblable, parce qti’-
ilsfont mieux dégagés de toute matière étrangère ;
conditions qui exigent des travaux pénibles , & un
grand exercice de la part de l’effayeur ou de l’affi-
neur. Voye^D en ier, K a r a t , Affinage , Raffinage
, D épart , Inq uart , & Es sai. V. Cramer
6c le Schluterde M . Hellot. Ar t. de M. d e V i l l i e r s !
Fin , {Manège, Maréchall.) Le cheval fin eft proprement
un cheval de legere taille, tel qu’il doit être
choifi dans le nombre des différens chevaux réfultans
du produit du mélange des diverfesraces, Iorfqu’on
le deftine au manège, ou à fervir en qualité de che-
val de maître, en voyage, à la guerre, à la chaffe,£c.
Nous demandons que le cheval de manège ait de
la beauté, qu’il foit nerveux, leger, vif, & brillant ;
que les mouvemens en foient lians & trides ; que la
bofiche en foit belle ; & principalement que lés reins
&les jarrets en foient bons, &c.
Dans le cheval de voyage , nous exigeons une
taille raisonnable;, un âge fait, tel que celui de fix à
fept années, des jambes fûres, des piés parfaitement
conformés, un ongle folide, une grande legereté de
bouche, beaucoup d’allure, une adion fouple & douce,
de la tranquillité, de la franchife ; & nous rejet-
tons avec foin celui qui feroit ardent, pareffeux &
délicat en ce qui concerne la nourriture.
Le cheval de guerre doit avoir une belle bouche "
la tête affûrée, une fojce liante & fouple, de la fen-
fibilité, de l’adreffe , du courage, de la legereté; il
ne doit craindre aucun des objets qui peuvent frapper
fes fens : il importe encore extrêmement qu’il ne
foit point vicieux envers les autres chevaux ; qu’il
n’ait point d’ardeur, & qu’il foit d’un bon & facile
entretien.
A l’égard du cheval de chaffe, nous délirons qu’il
foit doué de legereté, de vîteffe, qu’il ait du fond &
de l’haleine, que les épaules en foient plates & très-
libres ; qu’il ne foit point trop raccourci de corps ;
que la bouche en foit bonne, qu’elle ne foit point trop
•lenfible, & qu’il foit plutôt froid qu’ardent à s’animer.
La tranquillité, la docilité, Pexafte obéiffance '
la bontéde la bouche, des allures fûres & douces ’
une taille médiopre , une franchife à l’épreuve de
tous lesobjets capables d’effi-ayer & d’émouvoir, font
les qualités que l’on doit rechercher dans les chevaux
d’arquebufe, dans les chevaux de promenade, & dans
les chevaux de femme.
Le cheval de domeftiqueoudefuite ; le cheval de
cavalier & de dragon , Je cheval de piqueur, font
dans le genre des chevaux de felle que nous envifa-
geons comme des chevaux communs & qui peuvent
être mis en oppofition avec ceux dans lefquels nous
trouvons de la fineffe.
Le premier doit être bien traverfé, bien membre,
bien gigoté ; la bouche en doit être bonne, fans être
abfolument belle ; & l’on ne doit pas s’attacher à l’examen
de la douceur ou de la dureté de fes allures.
Il en eft de même du fécond, c’eft-à-dire du cheval
de troupe, dans lequel il feroit effentiel d’exiger
plus d’obéiffance , plus de foupleffe, plus de legereté,
& qui, relativement aux manoeuvres qu’il doit
exécuter, auroit befoin des fecours de l’art, ainfi que
le cavalier & le dragon, dont l’ignorance n’eft pas
moins préjudiciable au bien dufervice, que lafienne.
Enfin le cheval de piqueur doit être vigoureux ,
étoffé, doité d’une grande haleine, & propre à réfif-
ter au travail pénible auquel il eft affujetti.
Quant aux bidets de pofte, on doit plûtôt confidé-
rer la bonté de leurs jambes & de leurs piés que leur
figure & que les qualités de leur bouche. Il faut né-
ceffairement qu’ils galoppent avec aifance, & de maniéré
que la force de leurs reins n’incommode point
le cavalier.Trop de fenfibilité feroit eneuxurndéfaut
d’autant plus confidérable que l’inquiétude qui réful-;'
teroit des mouvemens defordonnés des jambes de
differens couriers qui les montent, & de l’apprbche
indifcrete & continuelle des éperons,les rendroient
inévitablement rétifs ou ramingues.
Il eft encore dans le genre des chevaux qui tirent
& qui portent, des chevaux glus ou moinsf in s , plus
ou moins communs, & plus ou moins grofliers.
Des chevaux bien tournés & bien proportionnés,
d’une taille de onze pouces ; jufqu’à cinq piés trois
ou quatre ; qui feront parfaitement relevés du devant
, exactement traverfés& pleins ; dont les épaules
ne feront point trop chargées ; dont le poitrail ne
pêchera point par un excès de largeur ; dont les jambes
belles, plates, & larges, ne feront point garnies
d’une quantité infinie de poils ; dont les jarrets feront
nets, bien évuidés, & bien conformés ; dont les piés
feront excellens ; qui auront dans leurs mouvemens
beaucoup de grâce & de liberté, & qui feront justement
appareillés de poil, de taille, de marque, &
de figure , d’inclination, d’allure, & de vigueur, formeront
des chevaux de earroffe qui auront de la fineffe
& qui feront préférables à tous ceux fur lefquels
on pourroit jetter les yeux, lorfqu’on fouhai-
tera des chevaux beaux, brillans, & néanmoins d’un
très-bon fervice.
Certains chevaux de chaife comparés aux chevaux
peu déliés que l’on employé communément à
tirer cette forte de voiture , feront dans leur efpece
envifagés comme des chevaux fins. Le cheval de brancard
fera bien étoffé, d’une taille raiforthable ,& non
trop élevé ; il trotera librement & diligemment,
tandis quê le bricolier qui fera bien traverfé, mais
qui aura moins de deffous que lui, & qui fera plus
voifin du genre des chevaux de felle, fera tenu à un
galop raccourci auquel il fournira avec facilité.
Les attires chevaux de tirage feront plus communs
ou moins grofliers félon leur ftruâure , leur
épaiffeur, la largeur de leur poitrail, la groffeur de
leurs épaules plus ou moins charnues, leur pefanteur,
l’abondance & la longueur des poils de leurs jambes
, &c.
Il en fera ainfi des différens chevaux de bât & de
fomme qui doivent avoir de la force & beaucoup de
reids, &e. (e)
Fin , en Mufique, eft un mot qui fe place quelquefois
fur la finale de la première reprife d’un rondeau,
pour marquer que e’eft fur cette finale qu’il faut ter-
.miner tout l’air, V o y e1 Rondeau. (3)
FINAGE, {Jutifp fud. ) ainfi appelle de fines agro-
tum, vel territorii, fe prend non-feulement pour les
limites d’un territoire, mais pour tout le ban & territoire
meme, d une juftice & feigneurie ou d’une pareille.
Foyei les coutumes de Melun , art. 3 0 1 . Sens,
/.fi.Troyes, / 65». Chaumont, / 03. Vitry, 5 & i z z .
Châlôns , z 6 G § l z 6 j . Bar, ariicle 4 9 & 209. [’ancienne
coutume d’Auxerre, art. 2 0 3 . l’ordonnance
du duc de Bouillon, articles 100 & 5 y c>. {A )
FilŸAL, adj. {Gramm. & Thèol.') fe dit de ce qui
termine une aêlion, une opération, unedilpute, &c.
& en général de ce qui met fin à une chofe ; comme
un jugement fin a l, fentence finale, &c.
Les Théologiens appellent l’impénitence des réprouvés,
impénitente finale, parce qu’ils fuppofent
qu’elle continue jufqu’à la fin de leur vie, & qu’ils
meurent dans ce funefte état.
On dit aufli en Théologie , perfèvérance finale ; c’eft
l’etat de juftice & de grâce dans lequel un homme
fe trouve à la mort, & qui le rend digne des récom-
penfes éternelles. Voye£ Persévérance. (G )
Final , (Géogr.) ville d’Italie, capitale d’un mar-
quifat auquel elle donne fon nom, & qui eft enclavé
dans l’état de Gènes. Final eft fur la Méditerranée
, à 11 lieues S. E. de Coni, 13 S. O. de Gènes ,
21 S. E> de Turin, 24 S. O. de Cafal. Long. z J d 5 f i
latit. 44d 181. {C. D ./ .)
FINALE, eft, en Mufique, la principale corde du
mode qu’on appelle aùlfi tonique , & fur laquelle
l’air ou la pièce doit finir. Voyeç Mode , T onique.
Quandon compofe à plufieurs parties, & fur-tout
des choeurs, il faut toûjours que la baffe tombe en fi-
niffant fur la note même de la finale ; mais les autres
parties peuvent s’arrêter fur fa tiercé & fut fa
quinte. Autrefois c’étoit une réglé de faire toujours
à la fin d’une piece la tierce majeure fur la finale ,
même en mode mineur ; mais cet ufage a été trouvé
de mauvais goût & prefque abandonné. Les Mufi-
ciens appellent aujourd’hui cela par dérifion , faire
la tierce de Picardie. (3 )
Finale ou Finale de Modene, {Géogr.') petite
ville du Modénois en Italie ; elle eft fur la riviete
du Panaro, à 5 lieues N. È. de Modene , 49 S. E. de
la Mirandole. Long. z8 d S o i. latit. 44A3fifi{C.JD.J.)
FINANCES , f. f. {Econom. polit.) on comprend
fous ce mot les deniers publics du roi & de l’état.
Qui ne juge des finances que par l’argent, n’en voit
que le réfultat, n’en apperçoit pas le principe ; il
faut, pour en avoir une idée jufte, fe la former plus
noble & plus étendue. On trouvera dans les finances
mieux connues, mieux développées, plus approfondies
, le principe, l’objet & le moyen des opérations
les plus intéreffantes du gouvernement ; le principe
qui les occafionne, l’objet qui les fait entreprendre,
le moyen qui les affûre.
Pour fe preferire à foi - même dans une matière
aufli vafte , des points d’appui invariables & furs ,
ne pourroit-on pas envifager les finances dans le principe
qui les produit, dans les richeffes qu’elles renferment
, dans les reffources qu’elles procurent, dans
l’adminiftration qu’elles exigent ?
Point de richeffes fans principe, point de reffources
fans richeffes, point d’adminiftrafion fi l’on n’a
rien à gouverner ; tout fe lié, tout fe touche, tout
fe tient : les hommes & les chofes fe repréfentent
circülâirement dans toutes les parties ; & rien n’eft
indifférent dans aucune, puifque dans les finances,
comme dans l’éleâricifé, le moindre mouvement fe
communiqué avec rapidité depuis celui dont la main
approche le plus du globe, jufqu’à celui qui en eft le
plus éloigné.
Les finances confidérées dans leur principe, font
produites pat les hommes ; moi cher & refpeftable