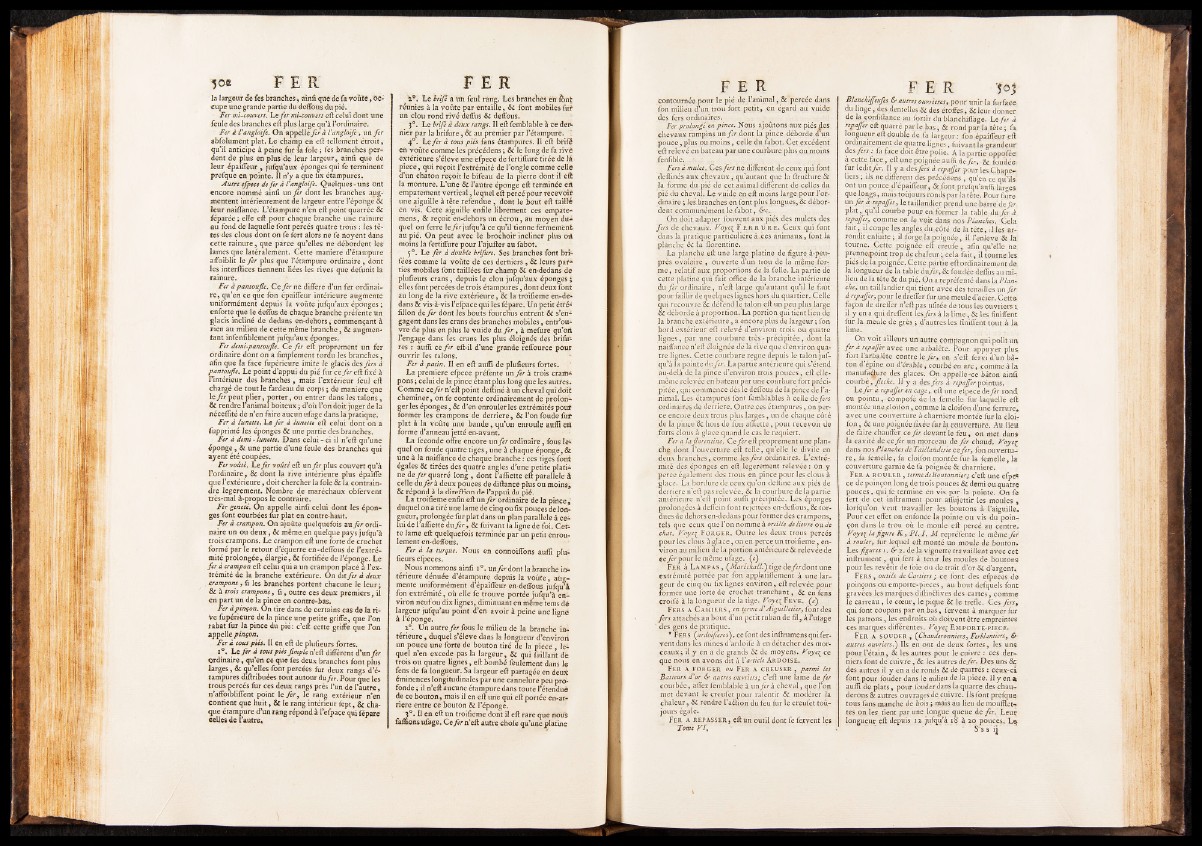
im F ER
la largeur de fes braftches-, âinfique de fa voûte » Occupe
une grande partie du deffous du pié.
Fer mi-couvert, h t fer mi-couvert eft celui dont une
feule des branches eft plus large qu’à l’ordinaire.
■ Fer à Vangloife. On appelle./« à Vangloife -, un fer
abfolument plat. Le champ en eft tellement étroit,
qu’il anticipe à peine fur la foie ; fes branches perdent
de plus en plus de leur largeur, ainfi que de
leur épaiffeur , jufqu’aux éponges qui fe terminent
prefque en pointe. Il n’y a que fix étampures.
Autre efpece de fer à Vangloife. Quelques - uns ont
encore nommé ainli un fer dont les branches augmentent
intérieurement de largeur entre l’éponge &
leur naiflance. L’étampure n’en eft point quarrée &
féparée ; elle eft pour chaque branche une rainure
au fond de laquelle font percés quatre trous : les têtes
des clous dont on fe fert alors ne fe noyent dans
cette rainure, que parce qu’elles ne débordent les
lames que latéralement. Cette maniéré d’ étampure
aftoiblit le fer plus que l’étampure ordinaire, dont
les interftices tiennent liées les rives que defunit la
rainure.
Fer à pantoufle. Ce fer ne différé d’un fer ordinaire,
qu’en ce que fon épaiffeur intérieure augmenté
uniformément depuis la voûte jufqu’aux éponges ;
enforte que le deffus de chaque branche préfente un
glacis incliné de dedans en-dehors, commençant à
rien au milieu de cetie même branche, & augmen-»
tant infenfiblement julqu’aux éponges.
Fer demi-pantoufle. Ce fer eft proprement un fer
ordinaire dont on a Amplement tordu les branches,
afin que la face fupérieure imite le glacis des fers à
pantoufle. Le point d’appui du pié fur e t fer eft fixé à
l’intérieur des branches , mais l’extérieur feul eft
chargé de tout le fardeau du corps ; de maniéré que
Itfer peut plier, porter, ou entrer dans les talons,
& rendre l’animal boiteux ; d’oii l’on doit juger de la
néceflité de n’en faire aucun ufage dans la pratique.
Fer à lunette. Le fer à lunette eft celui dont on a
fupprimé les éponges & une partie des branches.
Fer à demi - lunette. Dans celui - ci il n’eft qu’une
éponge, & une partie d’une feule des branches qui
ayent été coupées.
Fer voûté. Le fer voûté eft un fer plus couvert qu’à
l’ordinaire, & dont la rive intérieure plus épaiffe
que l’extérieure, doit chercher la foie & la contraindre
legerement. Nombre de maréchaux obfervent
très-mal à-propos le contraire.
Fer geneté. On appelle ainfi celui dont les éponges
font courbées fur plat en contre-haut.
Fer à crampon. On ajoute quelquefois au fer ordinaire
un ou deux, & même, en quelque pays jufqu’à
trois crampons. Le crampon eft une forte de crochet
formé par le retour d’équerre en-deffous de l’extrémité
prolongée, élargie, & fortifiée de l’éponge. Le
fer à crampon eft celui qui a un crampon placé à l’extrémité
de la branche extérieure. On dit fer à deux
crampons , fi les branches portent chacune le leur ;
& à trois crampons , f i , outre ces deux premiers, il
en part un de la pince en contre-bas.
Fer a pinçon. On tire dans de certains cas de la ri-
Ve fupérieure de la pince une petite griffe, que l’on
rabat fur la pince du pié: c’eft cette griffe que l’on
appelle pinçon»
Fer à tous piés. Il en eft de plufieurs fortes.
i ° . h t fer à tous piés fîmple n’eft différent d’un fer
ordinaire, qu’en ce que fes deux branches font plus
larges, & qu’elles font percées fur deux rangs d’é-
tampures diftribuées tout autour du fer. Pour que les
trous percés fur ces deux rangs près l’un de l’autre
n’affoibliffent point le fe r , lé rang extérieur n’en
contient que huit, & le rang intérieur fept, & chaque
étampure d’un rang répond à l’efpace qui fépare
celles de l’autre.
F E R
'l®. Le brifé a ttn feul rang. Les branches en font
réunies à la voûte par entaille, & font mobiles fur
un clou rond rivé defftis & deffous.
3°. Le brifé à deux rangs. Il eft femblàble à Ce dernier
par la brifure, & au premier par l’étampure. :
4°. h t fer à tous piés fans étaiïipures. Il eft brifé
en voûte comme les précédens ; & le long de fa rivé
extérieure s’élève une efpece de fertiffure tirée de là
piece, qui reçoit l’extrémité de l ’ongle comme cellô
d’un chaton reçoit le bifeau de la pierre dont il eft
la monture. L’une & l’autre éponge eft terminée eri
empâtement vertical, lequel eft percé pour recevoir
une aiguille à tête refendue, dont le bout eft taillé
ên vis. Cete aiguiHe enfile librement ces empate-
mens, & reçoit en-dehors un écrou, au moyen du-*
quel on ferre le fer jufqu’à ce qu’il tienne fermement
au pié. On peut avec le brochoir incliner plus oit
moins la fertiffure pour l’ajufter au fabot.
5°. Le fer à double brifure. Ses branches font bri4-
fées comme la voûte de ces derniers , & leurs par*
ties mobiles font taillées fur champ & en-dedans de
plufieurs crans, depuis le clou jufqu’aux éponges ;
elles font percées de trois étampures, dont deux font
au long de la rive extérieure, & la trôifieme en-de*
dans & vis-à-vis l’efpace qui les fépare. Un petit être-*
fillon de fer dont les bouts fourchus entrent & s’en*
gagent dans les crans des,branches mobiles, entr’ou-
vre de plus en plus le vuide du f e r , à mefure qu’oii
l’engage dans les crans les plus éloignés des brifu*
res : aufli ce fer eft-il d’une grande reffource pour
ouvrir les talons.
Fer à patin. Il en eft aufli de plufieurs fortes.
La première efpece préfente un fer à trois craift*
pons ; celui de la pince étant plus long que les autres»
Comme e t fer n’eft point deftiné à un cneval qui doit
cheminer, on fe contente ordinairement de proion*
ger les éponges, & d ’en enrouler les extrémités pou*
former les crampons de derrière, & l’on foude fu*
plat à la voûte une bande, qu’on enroule aufli ert
forme d’anneau jetté en-avant.
La fécondé offre encore un fer ordinaire, fous le*
quel on foude quatre tiges, une à chaque éponge,
une à la naiflance de chaque branche : ces tiges font
égales & tirées des quatre angles d’une petite platine
de fer quarré long , dont l’affiette eft parallèle à
celle du fer à deux pouces de diftançe plus ou moins,
& répond à la dire&ion de l’appui du pié.
La trôifieme enfin eft un ferordinaire de la pince,’
duquel on a tiré une lame de cinq ou fix pouces de longueur,
prolongée fur plat dans un plan parallèle à ce*
lui de l’afliette du fe r , & fuivant là ligne de foi. Cefr
te lame eft quelquefois terminée par un petit enroulement
en-deffous.
Fer à la turque. Nous en connoiffons aufli plufieurs
efpeces.
Nous nommons ainfi i° . un fer dont la branche in térieure
dénuée d’étampure depuis la vôûfe, augmente
uniformément d’épaiffeur en-deffous jufqu^â
fon extrémité, où elle fe trouve portée jufqu’à environ
neuf ou dix lignes, diminuant en même tems dé
largeur jufqu’au point d’en avoir à peine une ligné
à l’éponge.
i° . Un autre fer fous le milieu de la branche intérieure
, duquel s’élève dans la longueur d’environ
un pouce une forte de bouton tiré de la pièce lequel
n’en excede pas la largeur, & qui faillant dè
trois ou quatre lignes, eft bombé feulement dans le
fens de fa longueur. Sa largeur eft partagée en deuA
éminences longitudinales par une cannelure peu profonde
; il n’eft aucune étampure dans toute l’étenduè
de ce bouton, mais il en eft une qui eft portée en-ar-
riere entre ce bouton & l’éponge.
3°. Il en eft un trôifieme dont il eft rare que noii's
faflions ufage. C t fer n’eft autre choie qu’une platine
F E R
C o n to u rn ée p o u r le p ié d e l ’a n im a l , & p e r c é e d an s
fo n m ilie u d ’ u n t ro u fo rt, p e t i t , e u é g a rd au v u id e
d e s f e r s o rd in a ir e s .
Fer prolongé en pince. Nous ajoutons aux piés des
chevaux rampins un fer dont la pince déborde aun
pouce, plus ou moins, celle du fabot. Cet excédent
eft relevé en bateau par une courbure plus ou moins
Fenfible... —
Fers à, mulet. Ges fers he.different de .ceux qui font
deftinés, aux chevaux, qu’autant que la ftruëture &
la forme du pié de cet. animal different de celles du
pié du cheval. Le vuide en eft moins large.pour l’ordinaire
; les.branches en font plus longues, & débordent
communément le .fabot,. &c,.....
On doit adapter fou vent aux piés des mulets des
fers de chevaux. Voye{ F E R R U R E. Ceux, qui fpnt
dans la pratique particulièreà.ces animaux, font la
planche ,& la florentine.
La planche eft une large, platine de figure à-peu^
près ovalaire , ouverte d’un trou de la même,fort
me, relatif aux proportions de .la folle. La partie de
cette platine qui fait office de la branche intérieure
du fer ordinaire, n’eft large qu’autant qu’il le faüt
pour faillir de quelques lignes hors du quartier. Celle
qui recouvre défend le talon eft un peu plus large
& déborde à proportion. La portion qui tient lieu de
la branche extérieure, a encore plus de largeur ; fon
bord extérieur eft relevé d’environ trois ou quatre
lignes, par une courbure très-précipitée, dont la
naiflance n’eft éloignée dè là rive que d’environ quatre
lignes. Cette courbure régné depuis le talon jufqu’à
la pointe du fer. La partie antérieure qui s’étend
au-delà de, la pince d’environ trois pouces, eft elle-
même releyée en bateau par une courbure fort précipitée
, qui commence dès le deffous de la pince de l’animal.
Les étampures font femblables à celle dt fers
ordinaires de derrière. Outre ces étampures, on.perce
encore deux trous plus larges, un de chaque coté
de la pince & hors de fon afliette, pour recevoir de
forts clous à glace quand le. cas le requiert.
Fer a la florentine. Ce fer tld. proprement une planche
dont l’ouverture eft telle, qu’elle le divife en
. deux branches, comme les fers ordinaires. L’extrér
mité des éponges en eft, legerement relevée : on y
perce également des trous en pince pour les clous à
glace. La bordure de ceux qu’on deftine aux piés de
derrière n’eft pas relevée, & la courbure de la partie
antérieure n’eft point aufli précipitée. Les éponges
prolongées à deffein font rejettées en-deffous, & tordues
de dehors en-dedans pour former des crampons,
tels que ceux que Ton npmme à or«7/« de lievre ou de
chat. Voyc^ F o r g e r . Outre les deux trous percés
pour les clous àglace, on en perce un trôifieme, environ
au milieu de la portion antérieure & relevée de
ce fer pour le même ufage. («)
F ER à L a m p a s , (Maréchall.) t ig e d e y « d o n t u n e
e x t rém ité p o r té e p a r fo n a p p la t iffem e n t à u n e la r g
e u r de c in q o u f ix lign e s e n v i r o n , e ft r e le v é e p o u r
fo rm e r u n e fo r te d e c ro c h e t t r a n c h a n t , & en fen s
c r o i f é à la lo n g u e u r d e la t ig e . Voyei Fe v e . («)
FERS A C a h i e r s , en terme d’Aiguilletier, font des
fers attachés au bout d’un petit ruban de fil, à l’ulage
~ des gens de pratique.
* F e r s ( ardoifieres) , c e fo n t d es in ftrum en s q u i fe rv
e n t d ans le s mines d’ a rd o ife à en d é ta c h e r d e s mo rc
e a u x ; il y e n a de g rands & de m o y e n s . Voyè^ c e
q u e n o u s en a v o n s d it à Y article A r d o i s e .
F e r a f o r g e r ou F e r a c r e u s e r , parmi les
Batteurs d'or & autres ouvriers; c’eft une lame de fer
courbée, affez femblàble à un fer h cheval, que l’on
met devant le creufet pour ralentir & modérer la
chaleur, & rendre l’aérion du feu fur le creufet toû-
jours égale.
F e r a r e p a s s e r , eft un outil dont fe fervent les
Tome V I%
F E R
Blanchiffeufes & autres ouvrières,, pour unir la furface
du linge, des dentelles & des étoffes, & leur donner
de lacqnfiftance au fprtir du blanchiffage. Le fer à.
repayer eft quarré par le-bas, & rond par la .tête ; fa.
longueur eft .double de ,fa largeur : fon épaiffeur eft
ordinairement de quatre lignes, fuivant la grandeur
dtsfers : fa face doit etre polie. A la partie oppofée
a cette face, eft une poignée aufli dt fer-, & fondée:
fur ledit _ƒ«. II y a des fers à repaffer pour les Chapeliers
; ils ne.different des précédens , qu’en ce qu’ils
ont un pouce d’épaiffeur, ■ &font,prefqu’auffi larges
que longs , mais t o u j o u r s ronds par la tête. Pour faire
un fer à. repaffer, le taillandier prend une barre de fer
plat, qu’il courbe pour-,'en! former la table du fer. à,
repaffer, comme on le voit dans nos Planches. Gela
fait, il . c o u p e fies angles, du côté, de la tête, il les arrondit
enfuite ; il forge la poignée, il Fenleye & la
tourne...Cette poignée eft creufe , afin qu’elle ne
Pf^uneqjoint trop dechaleur; cela fait, il tpnrn.eles
pies dç la poignee. Cett e partie eft ordinairement de
la longueur de la table-dii/«, & foudée deffus au milieu
cle la tête & du pié. On a repréfenté dans la Planche,
un taillandier qui tient avec, des tenailles un fer
a repaffer, pour le dreffer fur une meule d’acier. Cette
façon de dreffer n’eft pas ufitée de tous les ouvriers
il y en a qui.dreffent les fers à la lime, &-les finiffent
fur la. meule de grès ; d’autres les finiffent tout .à la
lime.
On voit ailleurs un autre compagnon qui polit un
fer a repaffer avec une arbalète. Pour appuyer plus,
fort l’arbalète contre \ tfe r ,on s’efl fervi d’un bâton
d epine ou d’érable, courbé en arc , ,çom,me à la
manufadure des glaces. On appelle -ce bâton ainfi
courbt , fléché. Il y a àts fers a repaffer-pointus.
Le^r à repaffer en cage, eft une efpece de fer rond
ou pointu, v compofé de la femelle fur laquelle eft
montée une floifon, comme la cloifon d’.une ferrure,
avec une couverture à charnière montée fur la cloi-
fon, & une poignée,fixée fur la equverture. Au lieu
de faire chauffer ce fer. devant'le feu, on met dans
la cavité de ce fer un morceau de fer chaud. Voye£
dans nos F tanches de Taillanderie ce fer, fon ouverture
, .fa femelle » fa cloifon montée fur la femelle, la
couverture garnie de fa poignée & charnière.
Fer a rouler , termedeBoutonnier; c’eft une efpe*
ce de poinçon long de trois pouces & demi ou quatre
pouces, qui fe termine en vis par la poiçite. On fe
fert de cet inftrument pour affujettir les moules ,
lorfqu’on veut travailler les boutons à l’aiguille.
Pour cet effet on enfonce la pointe ou vis du poinr
çon dans le trou où le moule' eft percé au centre.
Vyye{ la figure K , PL:I . fil repréfente le. mêm tfe r
à rouler, fur lequel eft monté un moule de bouton.
Les figures 1. & 2. d t la vignette travaillent avec cet
inftrument, qui fert à tenir les moules de boutons
pour les revêtir de foie ou de trait d’or & d’argent«,
Fers , outils de Cartiers ; ce font des; efpeces, de
poinçons ou emporte-piee.es, au bout defquels font
gravées,les marques diftin&ives des cartes , comme
le carreau, le coeur, le pique & le trefle. Ces fers,
qui font coupans par en bas, fervent à marquer fur
les patrons, les endroits où doivent être empreinres
ces marques différentes. Voye^ Emporte-piece.
Fer A SOUDER , ( Chauderonniers, Ferblantiers, &
autres ouvriers.') Ils. en ont de deux fortes, les uns
pour l’étain, & les autres pour le cuivre : ces derniers
font de cuivre les autres de fer. Des uns &
des autres il y en a de ronds &,de quarrés : ceux-ci
font pour fouder dans le milieu de la piece. Il y en %
aufli de plats, pour fouder dans la quarré des chau-
derons & autres ouvrages de cuivre. Ils font prefque
tous fans manche de bois ; mais au lieu de mou filet*,
tes on les tient par une longue queue de fer. Leuç
longueur eft depuis ix jufqu’à 18 à 10 pouces. Lq
S~$ s ij