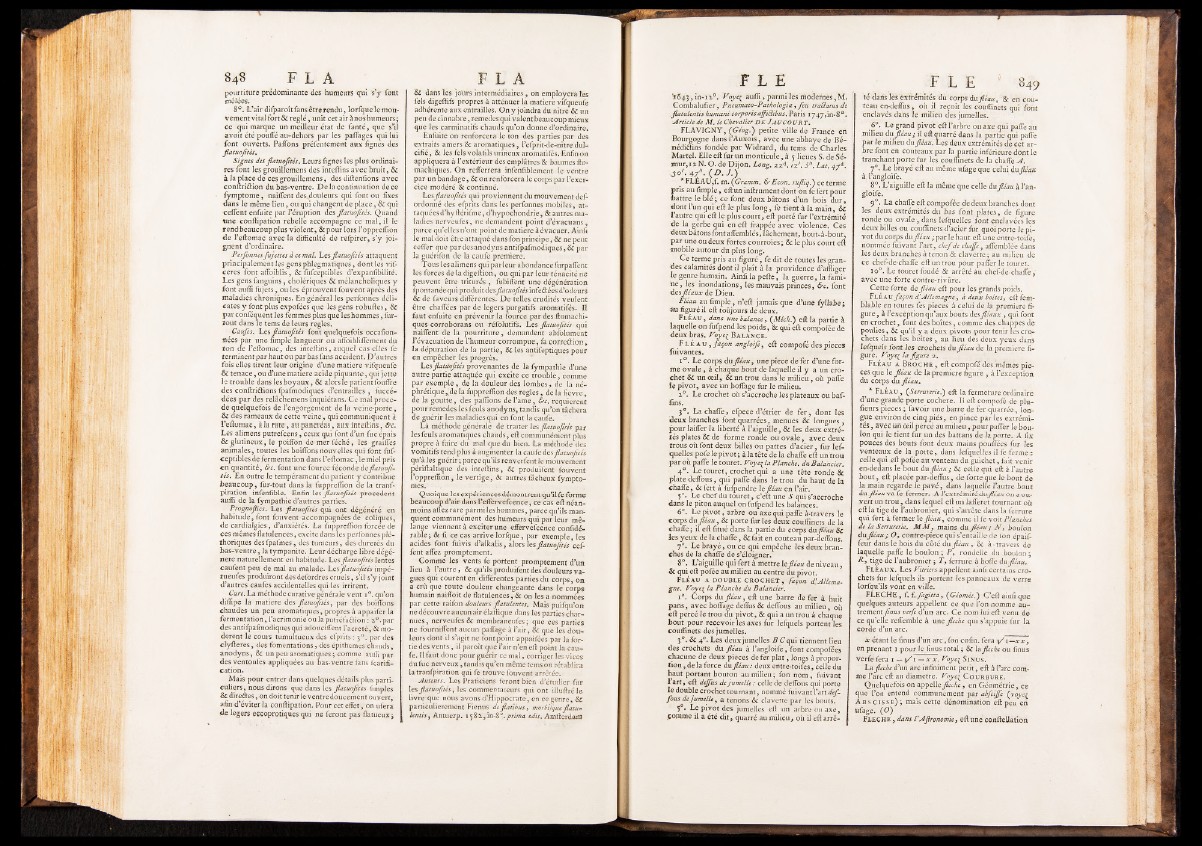
B43 F L A
pourriture prédominante des humeurs qui s*y font
mêlées.
8°. L’air dilparoît fans être rendu, lorfquelemouvement
vit al fort & réglé, unit cet air à nos humeurs;
ce qui marque un meilleur état de fanté, que s’il
«voit été pouffé au-dehors par les paffages qui lui
font ouverts. Paffons préfentement aux lignes des
jlatuojités. ■
Signes des jlatuojités. Leurs lignes les plus ordinaires
font les grouillemens des inteftins avec bruit, 6c
à la place de ces grouillemens, des diftenlions avec
conftriélion du bas-ventre. De la continuation de ce
fymptome, naiffent dessdouleurs qui font ou fixes
dans le même lieu, ou qui changent de place, 6c qui
ceffent enfuite par l’éruption des jlatuojités. Quand
«ne conftipation rebelle accompagne ce mal, il le
rendbeaucoup plus violent, & pour lors l’opprelîion
de l’eftomac avec la difficulté de refpirer, s’y joignent
d’ordinaire.
Perfonnes fujettes à. ce mal. Les jlatuojités attaquent
principalement les gens phlegmatiques, dont les vif-
ceres font affoiblis, ôc fufceptibles d’expanfibilité.
Les gens fanguins, cholériques & mélancholiqties y
font auffi fujets, ou les éprouvent fouvent après des
maladies chroniques. En général les perfonnes délicates
y font plus expofées que les gens robuftes, 6c
par conféquent les femmes plus que les hommes, fur-
ïout dans le tems de leurs réglés.
Caufes. Les jlatuojités font quelquefois occafion-
nées par une fimple langueur ou affoibliffement du
ton de l’effomac, des inteffins, auquel cas elles fe
terminent par haut ou par bas fans accident. D ’autres
fois elles tirent leur origine d’une matière vifqueufe
& tenace, ou d’une matière acide piquante, qui jette
le trouble dans les boyaux, 6c alors le patient fouffre
des conftri&ions fpafmodiques d’entrailles , fuccé-
dées par des relâchemens inquiétans. Ce mal procédé
quelquefois de l’engorgement de la veine-porte,
& des rameaux de cette veine, qui communiquent à
l’eftomac, à la rate, au pancréas, aux inteffins, &c.
Les alimens putrefcens, ceux qui font d’un fuc épais
& glutineux, le poiffon demerféché, les graiffes
animales, toutes les boiffons nouvelles qui font fufceptibles
de fermentation dans l’eftomac, le miel pris
en quantité, &c. font une fource féconde Aq jlatuojités.
En outre le tempérament du patient y contribue
beaucoup, fur-tout dans la fuppreffion de la tranf-
piration infenfible. Enfin les jlatuojités procèdent
auffi de la fympathie d’autres parties.
Prognojlics. Les jlatuojités qui ont dégénéré en
habitude, font fouvent accompagnées de coliques,
de cardialgies, d’anxiétés. La fuppreffion forcée de
ces mêmes flatulences, excite dans les perfonnes pléthoriques
des fpafmes, des tumeurs, des duretés du
bas-ventre, la tympanite. Leur décharge libre dégénéré
naturellement en habitude. Les jlatuojités lentes
caufent peu de mal au malade. Les jlatuojités impé-
iueufes produiront desdefordres cruels, s’il s’y joint
d’autres caufes accidentelles qui les irritent.
Cure. La méthode curative générale vent i°. qu’on
diffipe la matière des jlatuojités, par des boiffons
chaudes un peu aromatiques, propres à appaifer la
fermentation, l’acrimonie ou la putréfa&ion : z ° . par
des antifpafmodiquesqui adouciffent l’acreté, & modèrent
le cours tumultueux des efprits : 30. par des
clyfteres, des fomentations, des épithemes chauds,
anodyns, 6c un peu aromatiques ; comme auffi par
des ventoufes appliquées au bas-ventre fans fcarifi-
cation.
Mais pour entrer dans quelques détails plus particuliers,
nous dirons que dans les jlatuojités {impies
& direétes, on doit tenir le ventre doucement ouvert,
afin d’éviter la conftipation. Pour cet effet, on ul'era !
de légers eccoprotiques qui ne feront pas flatueux ;
F L A ÔC dans les jours intermédiaires, on employera les
fels digeftifs propres à atténuer la matière vifqueufe
adhérente aux entrailles. On y joindra du nitre & un
peu de cinnabre, remedes qui valent beaucoup mieux
que les carminatifs chauds qu’on donne d’ordinaire.
Enfuite on renforcera le ton des parties par des
extraits amers 6c aromatiques, l’efprit-de-nitre dulcifié,
& les fels volatils urineux aromatifés.Enfih on
appliquera à l’extérieur des emplâtres & baumes fto-
machiques. On refferrera infenfiblement le ventre
par un bandage, & on renforcera le corps par l’exercice
modéré & continué.
Les jlatuojités qui proviennent du mouvement désordonné
des efprits dans les perfonnes mobiles, attaquées
d’hy ftérifme, d’hypochondrie, & autres maladies
nerveufes, ne demandent point d’évacuans,
parce qu’elles n’ont point de matière à évacuer. Ainli
le mal doit être attaqué dans fon principe, 6c ne peut
ceffer que pardesanodynsantifpafmodiques, 6c par
la guérifon de la caufe première.
Tous les alimens qui parleur abondance furpaffent
les forces de la digeftion , 011 qui par leur ténacité ne
peuvent être triturés , fubiffent une dégénération
fpontanée qui produit d es jlatuojités infeétées d’odeurs
6c de faveurs différentes. De telles crudités veulent
être chaffées par de légers purgatifs aromatifés. Il
faut enfuite en prévenir la fource par des ftomachi-
ques corroborans ou réfolutifs. Les jlatuojités qui
naiffent de la pourriture, demandent ablblument
l’évacuation de l’humeur corrompue, fa correction,
la dépuration de la partie, 6c les antifeptiques pour
en empêcher les progrès.
Les flatüojités provenantes de la fympathie d’une
autre partie attaquée qui excite ce trouble, comme
par exemple, de la douleur des lombes, de la néphrétique
ÿde la fuppreffion des réglés, de la fievre,
de la goutte, des pallions de l’ame, &c. requièrent
pour remedes les feuls anodyns, tandis qu’on tâchera
de guérir lés maladies qui en font la caufe.
La méthode générale de traiter 1 es flatüojités, par
les feuls aromatiques chauds, eft communément plus
propre à faire du mal que du bien. La méthode des
vomitifs tend plus à augmenter la caufe des jlatuojités
qu’è les guérir ; parce qu’ils renverfent le mouvement
périftaltique des inteftins, 6c produifent fouvent
l’oppreffiôn, le vertige , & autres fâcheux fympto-
mes.
Quoique les expériences démontrent qu’il fe forme
beaucoup d’air dans l’effervefcence, ce cas eft néanmoins
affezrare parmi les hommes, parce qu’ils manquent
communément des humeurs qui par leur mélange
viennent à exciter une effervefcence confidé-
rable ; & li ce cas arrive lorfque, par exemple les
acides font fuivis d’alkalis, alors les jlatuojités ceffent
affez promptement.
Comme les vents fe portent promptement d’un
lieu à l’autre, & qu’ils produifent des douleurs vagues
qui courent en différentes parties du corps, on
a cru que toute douleur changeante dans le corps
humain naiffoit de flatulences, & on les a nommées
par cette raifon douleurs flatulentes. Mais puifqu’on
ne découvre aucun air élaltique dans les parties charnues
, nerveufes & membraneufes ; que ces parties
ne fourniffent aucun paffage à l’air, & que les douleurs
dont il s’agit ne font point appaifées par la for-
tie des vents , il paroît que l’air n’en eft point la caufe.
Il faut donc pour guérir ce mal, corriger les vices
du fuc nerveux, tandis qu’en même tems on rétablira
latranfpiration qui fe trouve fouvent arrêtée.
Auteurs. Les Praticiens feront bien d’étudier fur
les jlatuojités, les commentateurs qui ont illuftré le
livre- que nous avons d’Hippocrate, en ce genre, 6c
particulièrement Fienus de flatibus, morbifque fla tu -
lentis, Antuerp. 1581,111-8". prima edit. Amfterdam
F L E
‘*643, in-i l 0. Voye{ auffi, parmi les modernes, M.
Combalufier, Pneumato-Pathologia , feu traclatus de
.flatulerilis humani corporis affeclibus. Paris 1747,^-8°.
Article de M. leChevalier DE Ja u c o u r t .
FLAVIGNY, {Géog.') petite ville de France en
Bourgogne dans l’Auxois, avec une abbaye de Bénédictins
fondée par Widrard, du tems de Charles
Martel. Elle eft fur un monticule, à 5 lieues S. de Sé-
*nur,i 2 N. O. de Dijon. Long. z z d. i z ' .S " , Lat. 4 7 d.
j o ' 4 f . { D . J . )
* FLEAU,f. m. {Gramm. & E con . rufliq.) ce terme
pris au fimple, eft un inftrument dont on fe fert pour
battre le blé ; ce font deux bâtons d’un bois dur,
«lont l’un qui eft le plus long, fe tient à la main, 6c
l ’autre qui eft le plus court, eft porté fur l’extrémité
de la gerbe qui en eft frappée avec violence. Ces
deux bâtons font affemblés, lâchement, bout-à-bout,
par une ou deux fortes courroies; 6c le plus court eft
mobile autour du plus long.
Ce terme pris au figuré, fe dit de toutes les grandes
calamites dont il plaît à la providence d’affliger
le genre humain. Ainfi la pefte, la guerre, la famine,
les inondations, les mauvais princes, &c. font
des jlèa u x de Dieu.
Fléau au fimple, n’eft jamais que d’unè lyflabe ;
-au figuré il eft toujours de deux. Fléau, dans une balance,laquelle on fufpend les poids , (&M qécuhi. )ef te fctô lma ppoafréteie d eà deux bras. Voyeç Balance.
fuiFvalnéteas.u , façon angloife, èft compofé des pieces
i° . Le corps du f lé a u , une piece de fer d’une forme
ovale, à chaque bout de laquelle il y a un crochet
& un oeil, êc un trou dans le milieu, oit paffe
le pivot, avec un boffage fur le milieu.
20. Le crochet où s’accroche les plateaux ou baf-
fins.
30. La chaffe, efpece d’étrier de fer, dont lés
deux branches font quarrées, menues 6c longues,
pour laiffer la liberté à l’aiguille, 6c lès deux extré-
îés plates 6c de forme ronde ou ovale, avec deux
trous oit font deux billes ou pattes d’âcier, fur lesquelles
pofe le pivot ; à la tête de la chaffe eft un trou
paroît paffe le touret. Voye^la Planche, du Balancier. pla4te0 .d eLfef otuosu,r eqtu, ic proafcfhee dt aqnusi lae turnoeu tdêute h arount ddee &la chaffe, & fert à fufpendre le fléau en l’air.
5°. chef du touret, c’eft une S qui s’accroche
dans le piton auquel on fufpend les balances.
6°. Le pivot, arbre ou axe qui paffe à-travèfs le
corps du fléa u , 6c porte fur les deux couffinets de la
chaffe ; il eft fitué dans la partie du corps du fléau &
les yeux de la chaffe, & fait en couteau par-deffous.
70. Le brayé, ou ce qui empêche les deux branches
de la chaffe de s’éloigner.
8°. L’aiguille qui fert à mettre lefléau de niveau,
& qui eft pofée au milieu au centre du pivot. Fléau a double crochet, façon dlAllema-
gne. Voye^ la Planche du Balancier.
i°. Corps du fléa u , eft une barre de fer à huit
pans, avec boffage deffus & deffous au milieu, où
eft percé le trou du pivot, & qui a un trou à chaque
bout pour recevoir les axes fur lefquels portent les
couffinets des jumelles.
30. 6c 40. Les deux jumelles B C qui tiennent lieu
cdheas ccurnoec hdeet sd eduux fpléiaecue sà dl’ea fnegrl poilfaet,, floonngt sc Oà mprpoopféoerS
tion , de la force du fléau : deux entre-toiles, celle du
haut portant bouton au milieu ; fon nom , fuivant
l’art, eft deffus de jumelle : celle de deffous qui porte
le double crochet tournant, nommé fuivant l’art deffous
de jumelle ^ a tenons 6c clavette par les bouts.
f . L e pivot des jumelles eft un arbre Cm axe, I
comme il a été dit, quarré au milieu, où il eft arrê-
F L E I 849
té dans lès extrémités dû corps du fléau, & en couteau
en-deffus, où il reçoit les couffinets qui font
enclavés dans le milieu des jumelles.
6°. Le grand pivot eft l’arbre ou axe qui paffe au
milieu du fléau ; il eft qùarré dans la partie qui paffe
par le milieu du fléau. Les deux extrémités de cet arbre
font en couteaux par la partie inférieure dont le
tranchant porte fur lès couffinets de la chaffe A .
70. Le brayé eft au même ufage que celui dufléau
à, l’angloife.
8°. L’aiguille eft la même que celle du fléau à l’angloife.
90. La chaffe eft compofée de deux branches dont
les deux extrémités du bas font plates, de figuré
ronde ou ovale, dans lefquelles font enclavées les
deux billes ou couffinets d’acier fur quoi porte le pivot
du corps du fléau ; par le haut eft une entre-toife,
nommée fuivant l’art, chef de chaffe, affemblée dans
les deux branches à tenon & clavette ; au milieu de
ce chef-de-chaffe eft un trou pour paffer le touret.
io°. Le touret foùdé & arrêté àù chef-de-chaffe j
avec une forte contre-rivûre.
Cette forte d e fléau eft. pour lès grands poids. Fléau façon d’Allemagne, à deux boites, eft fem-
blable en toutes fes pièces à celui de la première fi*
gure, à l’exception qu’aux bouts desflé a u x , qui font
en crochet, font des boîtes, comme des chappes de
poulies, 6c qu’il y a deux pivots pour tenir les cro-
i chets dans les boîtes -, au lieu des deux yeux dans
lefquels font les crochets Au fléau de la première figure.
Voye^la figure ;z,. Flea.u a Bro.che , eft compofé*dès mêmes pièces
que le.fléau de là première figure , à l’exception
du corps du fléau.
* Fléau, {Serrurerie i) eft la fermeture ordinaire
d’une grande porte cochere. Il eft compofé de plu-
fieurs pièces ; favoir une barre de fer quarrée, longue
environ de cinq piés, en pince par les extrémités
, avec un oeil percé au milieu, pour paffer le boulon
qui le tient fur un des battans de la porte. A fix
pouces des bouts font deux mains pouffées fur les
venteaux de la porte, dans lefquelles il fe ferme :
celle qui eft pofée au venteau du guichet, fait venir
en-dedans le bout du fléau .; 6c celle qui eft à l’autre
bout, eft placée par-deffus, de forte que le bout de
la main regarde le pavé, dans laquelle l’autre bout
du fléau va fe fermer. A f extrémité du fléau on a ouvert
un trou, dans lequel eft un lafferet tournant où
eft la tige de l’aubronier, qui s’arrête dans la ferrure
qui fert à fermer le fléa u , comme il fe voit Planches
de la Serrurerie. M M , mains du flé a u ; N , boulon
dufléau ; O, confre-piece qui s’entaille de fon épaif-
feur dans le bois du côté dn.fléau, 6c à-travers de
laquelle paffe le boulon ; P , rondelle du boulon ;
P> tige de l’aubronier ; T , ferrure à bojffe dn fléau. Fléaux. Les Vitriers appellent ainfi certains crochets
fur lefquels ils portent les panneaux de verre
lorfqu’ils vont en ville.
FLECHE, f. f.fa g it ta , (Géomété) C’eft ainfi que
quelques auteurs appellent ce que l’on nomme autrement
jinu s i>erfe d’un arc. Ce nom lui eft venu de
ce qu’elle reffemble à une fléché qui s’appuie fur la
corde d’un arc.
en A prenant étant le 1 finus pourl d’un finus arc,e total fon colin, fera j/ i—x x , ; 6 c la fléché ou finus
verfe fera 1 — y/i x . Voye1 Si NUS.
meL la’a flrécc heéft da’uu nd aiarmc ièntfrien. iment petit, Courbure.
eft à l’arc comVoye^
Quelquefois on appelle flé ché, en Géométrie, ce
que l’on entend communément par abfcijfe {voyez
A bs c i s s e ) ; mais cette dénomination eft peu eh
ufagèï‘(0)
Fléché , dans VAflronomie, èft une conftellation