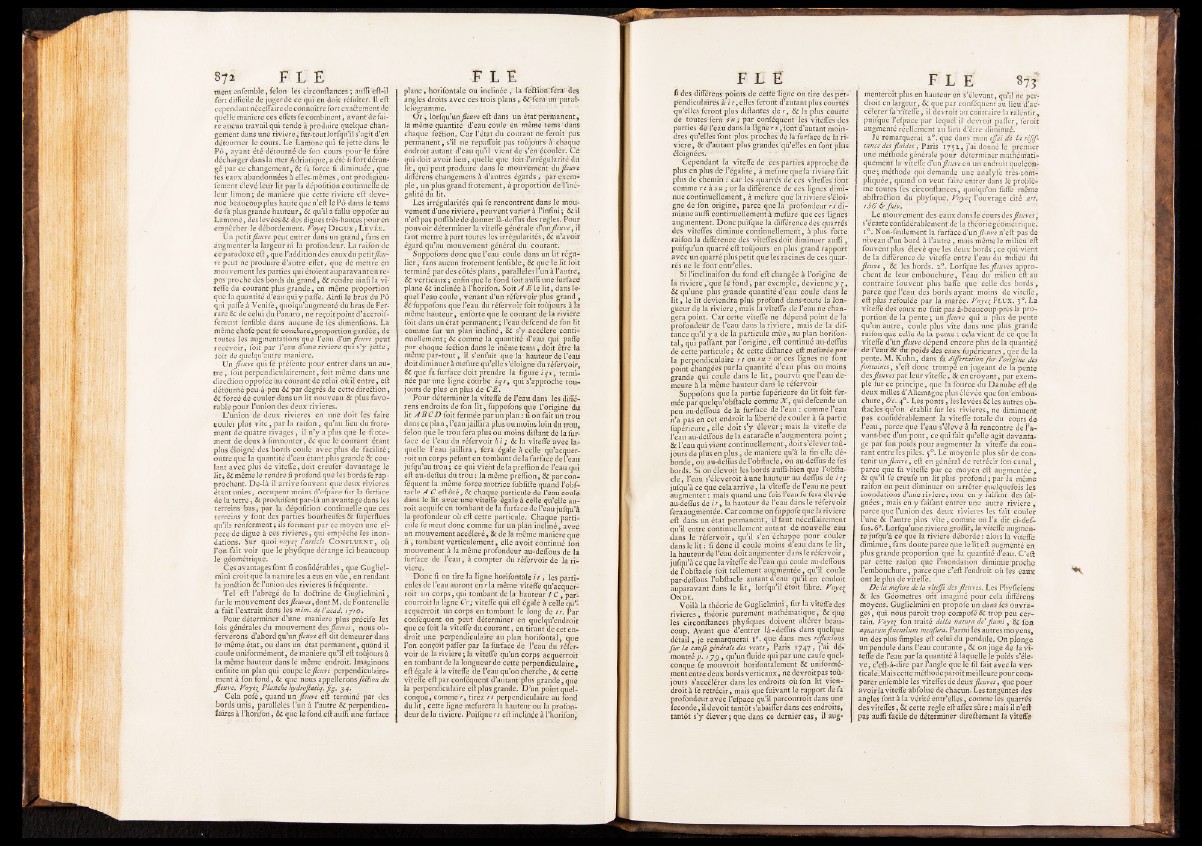
SI* F L E
ment enfemble, félon lés circonftances ; auffi èft-il
fort difficile de juger de ce qui en doit rélultèf. Il eft
cependant néceffaire de connoître fort exactement dé
quelle maniéré ces effets fe combinent , avant dé faire
aucun travail qui tende à produire quelque changement
dans une riviere ,• fur-tout lorfq'u’il S’agit d’en
détourner le cours. Le Lâmone qui fe jette dans lé
P ô , ayant été-détourné de1 fon cours pour le faire
décharger dans la mer Adriatique, a été fi fort dérangé
par ce changement, & fa force li diminuée, que
les éaux abandonnées à elles-mêmes, ont prodigieu-
fement élevé leur lit parla dépofition continuelle de
leur limon ; de manière qiiè cette riviere eft devenue
bèâucoupplus haute que n’eft le Pô dans le tems
dé fài plus grande hauteur, & qu’il a failli oppofer au
Larnoné, des levées & des digues très-hautes pour en
empêcher le débordement. :Foye^ D i g u e , L e v é e .
Un petit fleu ve peut entrer dans un grand, fans en
augmenter la largeur ni la profondeur. La raifon de
ce paradoxe eft, que l’addition des eaux du petit fleuve
peut ne produire d’autre-effet, que de mettre en
mouvement les parties qui étoient auparavant en repos
proche des bords du grand, & rendre ainli la vî-
teffe du courant plus grande, en même proportion
què la quantité d’eau qui y paffe. Ainli le bras du Pô
qui paffe à Venife, quoiqu’augmenté du bras dé Fer-
rare & dé celui du Panaro, ne reçoit point d’accroif-
fement fenlible dans aucune de les diiiienfions. La
même chofepeut fe conclure',proportion gardée, de
toutes les augmentations que l’eau d’un fleu ve peut
recévoir, foit par l ’eau d’une riviere qui s’y jette,
foit d e quelqu’autre maniéré.
\Jn fleu ve qui fé préfente pour entrer dans un autre
, foit perpendiculairement, foit même dans une
direction oppofée au courant de celui oMI entre, eft
détourné peu-à-peu & par dègrés de cetté direction,
& forcé de couler-dans un lit nouveau & plus favorable
pour l’union des deux rivières.
L’union de deux rivières en mie doit les faire
couler plus vite, par la raifon, qu’au lieu du frote-
rnent de quatre rivages, il n’y a plus què le ffrote-
ment de deux à furmonter, & que le courant étant
plus éloigné des bords coule avec plus de facilité ;
outre que la quantité d’eau étant plus grande & coulant
avec plus de vîteffe, doit creufer davantage le
lit, & même le rendre fi profond que lés bords fe rapprochent.
De-là il arrive fouvent que deux rivières
étant unies, occupent moins d’efpace fur la furface
de la terre, & produifent par-là un avantage dans les
terrains bas, par la dépolition continuelle que ces
îerreins y font des parties bourbeuïes & fupèrflues
qu’ils renferment ; ils forment par ce moyen une ef-
pece de digue à ces rivières, qui empêche les inondations.
Sur quoi voye^ Varticle C o n f l u e n t , oii
l’on fait voir que lephylique dérange ici beaucoup
le géométrique.
Ces avantages font li conlidérables, que Guglielmini
croit que la nature les a eus en vûe, en rendant
la jonètion & l’union des rivières li fréquente.
Tel eft l ’abrégé de la doârine de Guglielmini,
furie mouvement des^e«v«,dontM. deFontenelle
a fait l’extrait dans les mém. de L'acad. i f i o .
Pour déterminer d’une maniéré plus précife les
lois générales du mouvement des fleu ves, nous ob-
ferverons d’abord qu’un fleu ve eft dit demeurer dans
le même état, ou dans un état permanent, quand il
coule uniformément, de maniéré qu’il eft toujours à
la même hauteur dans le même endroit. Imaginons
enfuite un plan qui coupe le fleu ve perpendiculairement
à fon fond, & que nous appellerons fictio n du
fle u v e . Voye%_ Planche hydroflatiq. flg . 3.4.
Cela pofé, quand un fleu ve eft terminé par des
bords unis, parallèles l’un à l’autre & perpendiculaires
à l’horifon, & que le fond eft auffi une furface
F L Ë
plane, horifontale ou inclinée , la ffëfriôfffera-' des
angles droits avec cès' trois plans ,■ &Pfôi<â-‘ un parallélogramme.
O r , lorfqu’unJ&Kve eft dans un étatypèrmanent,
la même quantité d’eau coule en même ternis: dans
chaque feûion. Car l’état du courant rte ferait pas
permanent , s’il ne repaffoit pas toûfours à'. chaque
éndroif autant d’eau qu’il vient de s’énécôulër. Cé
qui doit avoir lieu, quelle que foit •l’irrégularité dit
lit, qui peut produire dans le mouvement dw fleuve
différens changemens à d’autres égards, par exemple,
un plus grand frotement, à proportion de'l’inégalité
du lit.
Les irrégularités qui fe rencontrent dans lè mouvement
d’une riviere ; peuvent varier à l’infini ; & il
n’éftpas poffible de donner là-deffus dès règles. Pour
pouvoir déterminer la vîtèfle générale d’un fleuve', il
faut mettre à part toutes les irrégularités; & n’avôir
égard qu’au mouvement général du courant.
Suppofons donc que l’eau coule dans un lit régulier
j fans aucun frotement fenlible, & que Iélit foit
terminé par des côtés plans, parallèles l’un à l’autre,
& verticaux ; enfin que le fond foit auffi une furface
plane & inclinée à l’horifon. Soit A E le lit, dans lequel
l’eau coule, venant d’un réfervoir plus grand ,
&-fuppofons que l’eau du réfervoir foit toujours à la
même hauteur, enforte que le courant de la rivière
foit dans un état permanent ; l’eau dèfcend de fon lit
comme fur un plan incliné, & s’y.accéléré conti-.
nuellement ; & comme la quantité d’eau qui paffe
par chaque feftion dans le même tems , doit être la
même par-tout, il s’enfuit que la hauteur de l’eau
doit diminuer à mefure qu’elle s’éloigne du réfervoir,
& que fa furface doit prendre la figure i q s , terminée
par une ligne courbe iq s , qui s’approche toujours
de plus en plus de C E .
Pour déterminer,1a vîteffe de l’eau dans les différent
endroits de fon lit, fuppofons que l’origine du
lit A B C D foit fermée par un plan : fi on fait un trou
dans ce plan, l’eau jaillira plus ou moins loin du trou,
félon que le trou fèra plus ou moins diftant de la fur-
face de l’eau du réfervoir h i ; & la vîteffe avec laquelle
l’èau. jaillira, fera égale à celle qu’acquerrait
un corps pefant en tombant delà furface de l’eau
jufqu’au trou ; ce qui vient delà preffion de l’eau qui
eft au-deflus du trou : la même preffion, & par con-
féquent la même force motrice fubfifte quand l’obf-
tacle A Ç eft ôté, & chaque particule de l’éau coule
dans le lit avec une vîteffe égale à celle qu’elle aurait
acquife en tombant de la furface de l’eau jufqu’à
la-profondeur oü eft cette particule. Chaque particule
fe meut donc comme fur un plan incliné, avec
un mouvement accéléré, & de la même maniéré què
fi , tombant verticalement, elle avoit continué fort
mouvement à la même profondeur au-deffous de la
furface de l’eau, à compter du réfervoir de la riviere.
'
Donc fi on tire la ligne horifontale i t , les particules
de l’eau auront en r la même vîteffe qu’acquerrait
un corps, qui tombant de la hauteur I C , parcourrait
la ligne C r ; vîteffe qui eft égale à celle qu’l
acquerrait un corps en tombant le long de tr . Par
conféquent on peut déterminer en quelqu’endroit
que ce foit la vîteffe du courant, en tirant de cet endroit
une perpendiculaire au plan horifontal, que
l’on conçoit paffer par la furface de l’eau du réfervoir
de la riviere ; la vîteffe qu’un corps acquerrait
en tombant de la longueur de cette perpendiculaire,
eft égale à la vîteffe de l’eau qu’on cherche, & cette
vîteffe eft par conféquent d’autant plus grande, que
la perpendiculaire eft plus grande. D’un point quelconque,
comme r, tirez rs perpendiculaire au fond
du lit, cette ligne mefurera la hauteur ou la profond
deur de la riviere. Puifque rs eft inclinée à l’horifon,
F L Ë
fi des différens points de ce'fië 'ligne on tire des perpendiculaires
à i t , elles feroüt d’autant plus courtes
qu’elles feront plus diftantes ,de r , & la plu,s courte
de toutes*’fera ri« ; par conféquent les vîteffès des
parties dë-l’eaü dans lalignè r s ,Tortt d’autant moindres
qu’elles font plus proches de la furface def à riviere,
& d’autant plus grandes'qh’èliès en font plus
éloignées1.“ -' ;-
Cependant la vîteffe de ces parties approche de
plus en plus de l’égalité, à mëfurè que là riviere fait
plus de chemin : car les quartés de Ces vîteffès’font'
comme r« à su ; or la différence de Ces lignes diminue
continuellement, à mefure què l'a riviere s?ëloi-
gne de fon origine, parce, què la ' profondeur r s diminue
auffi continuellement à mefüre que ces lignés
augmentent. Donc puifque la différence des quarrés
des vîteffes diminue continuellemèft't, à plus‘forte
raifon la différence des vîteffes doit diminuer auffi ,
puifqu’un quarré eft toujours en plus grand rapport1
avec un quarré plus petit que les racines de ces quar-,
rés ne le font entr’elles.
Si l’inclmaifon du fond eft changée à l’origine de
la riviere, que lé fond, par exemple, devienne^,.
& qu’une plus grande quantité d’eau coule dans le
lit, le lit deviendra plus profond dàns'toute la longueur
de la riviere, mais la vîteffe de l’eau ne changera
point. Car cette vîteffe ne dépend point de la'
profondeur de l’eau dans la riviere, mais de la distance
qu’il y a de la particule mue , au plan hôrifon-
tal, qui panant.par l’origine, eft continué au-deffus
de cette particule ; & cette diftance eftmefuréepar
la perpendiculaire r t ou su / or ces lignes ne font
point changées parla quantité d’eau plus ou moins
grande qui coule dans le lit, pourvu que l’eau demeure
à la même hauteur dans le réfervoir
Suppofons que la partie fupérieure du lit foit fermée
par quelqu’obftacle comme X , qui defeende un
peu au-deffous de la furface de l’eau : comme l’eau
n’a pas en cet endroit la liberté de couler à fa partie
fupérieureH elle doit s’y élever ; mais la vîteffe de
l’eaii au-dëffOus de la catara&e n’augmentera point ;
& l ’eau qui vient continuellement, doit s’élever toujours
de plûs en plus, de maniéré qu’à la fin elle débonde,
Ou au-deffus de l’obftacle, ou au-deffus de fes
bords. Si on élévoit les bords auffi-bien que l’obftacle
, l’eau s’élèverait à une hauteur au deffus de i t;
jufqu’à ce que cela arrive, la vîteffe de l’eau ne peut
augmenter : mais quand une fois l’eau fe fera élevée
au-deffus de i t , la hauteur de l’eau dans le réfervoir
fera augmentée. Car comme on fuppofe que la riviere
eft dans un état permanent-,'il faut néceffairément
qu’il entre continuellement autant de nouvelle eau
dans le réfervoir, qu’il s’en échappe pour couler
dans le lit : fi donc il coule moins d’eau dans le lit,
la hauteur de l’eau doit augmenter dans le réfervoir,
jufqu’a ce que la vîteffe de l’eau qui coule au-deffous
de l’obftacle foit tellement augmentée, qu’il coule
par-deffous l’obftacle autant d’éau qu’il en couloit
auparavant dans le lit, lorfqü’il étoit libre. Voye{
O n d e .
Voilà la théorie de Guglielmini', fur la vîteffe des
rivières, théorie purement mathématique , & que
les circonftances phyfiques doivent altérer beaucoup.
Avant que d’entrer là-deffus dans quelque
détail, je remarquerai i°. que dans mes reflexions
fu r la caufe générale des vents, Paris 1747 > J*3* démontré
p . iy c ) , qu’un fluide qui par une caufe quelconque
fe mouvrait horifontalement & uniformément
eqtre deux bords verticaux, ne devrait pas toujours
s’accélérer dans les endroits oii fon lit viendrait
à fe rétrécir, mais que fuivant le rapport dèfa
profondeur avec l’efpace qu’il parcourrait dans une
îeconde, il devoit tantôt s’abaiffer dans ces endroits,
tantôt s’y élever ; que dans ce dernier cas, il’ aug-
F L E 871
menteroit plus en hautèürèn^élevant, qu’il ne perdrait
en largeur, & que par conféquent au lieu cl’ac-
; célèrer faSît'effe, il devrait au contraire la ralentir,
puifque Fefpace par lequel il devrait paffer, ferait
! augmenté réellement au lien d’être^ diminû.é!
Je remarquerai z ° . que dans1 mon eflai dè là réflfl
tancedes f l u i d e s Paris 1751, j’ai donné le premier
une méthode générale pour déterminer mathématiquement
la-vîteffe d’u n fleu ve en u n endroit quelconque;
méthode qui demande une analyfe très-côm-
, pliquée, quand on veut faire entrer dans le problème
toutes fes circonftances, quoiqu’on faffe même
abftra&ion du phyfique. F o yer l’ouvrage cité art,
i i 56 & Jitiy.
, Le mouvement des eaux dans.le cours des fleuves j'
; s’écarte confidérablement de la théorie géométrique^
i°. Non-feulement la furface d’un fleu ve n’eft pas de
• niveau d’un bord à l’autre, mais même le milieu eft
fouvent plus élevé que les deux bords ; ce qui vient
; de la différence de vîteffe entre l’eau du milieu du
i fleu ve , & les bords. z ° . Lorfque les fleu ves appro-
; chent de leur embouchure", l’eau du milieli eft au
. contraire fouvent plus baffe que celle des bords,
parce que l’eau des bords ayant moins de vîteffe,
eft plus refoulée par la marée. F o ye^ F l u x . 30. La
vîteffe des eaux ne fuit pas à-beaucoup-près la pro-
; portion dé la pente; un fle u v e qui a plus de pente
qu’un autre, coule plus vîte dans une plus grande
raifon qiie celle de la pente : cela vient de ce'que la
vîteffe d’un fleu ve dépend encore plus de la quantité
de l ’eau 6c du poids des eaux fupérieures, que de la
pente. M. Kuhn., dans la differtation f u r C origine des
fo n ta in e s, s’eft donc trompé en jugeant de la pente
des fleuves par leur vîteffe, & en croyant, par exemple
fur ce principe, que la fôurce du Danube eft de
deux milles d’Allemagne plus élévée que fôn 'embou-
chure, &c. 40. Les ponts, les levées & les autres ob-
ftacles'qü’oh établit fur les rivières, ne diminuent
pas confidérablement la vîteffe totale du cours de
l’eau, parce que l’eau s’eîeve à la rencontre de l’avant
bec d’un pont, ce qui fait qu’elle agit davantage
par fon poids pour augmenter la vîteffe du courant
entre les, piles. 50. Le moyen le plus sûr de contenir
un fle u v e , eft en général de rétrécir fon canal,
parce que fa vîteffe par ce moyen eft augmentée ,
& qu’il fe creufe un lit plus profond ; par la même
raifon on peut diminuer ou arrêter quelquefois les
inondations d’une riviere, rton en y raifant des fai-
gnées, mais en y faifant entrer une autre riviere,
parce que l’union des deux rivières les fait couler
l’une & l’autre plus vîte, comme on l’a dit ci-deffus.
6°. Lorfqu’une riviere g ro ffit, la vîteffe augmente
jufqu’à c e que la riviere déborde : alors la vîteffe
diminue, fans doute parce que le lit eft augmenté en
plus grande proportion que la quantité d’eau. C ’efl:
par cette raifon que l’inondation diminue proche
l’embouchure, parce que c’eft l’endroit oit les eaux
ont le plus de vîteffe.
D e là mefure d elà vîteffe des fleu ves. Les Phyficiens
& les Géomètres ont imaginé pour cela différens
moyens. Guglielmini en propofe un dans fes ouvragés
, qui nous paraît trop compofé & trop peu certain.
Foye{ fon traité délia hatura de’ fiu m i, & fon
aquarum fluentium m enfura. Parmi les autres moyens,
un des plus Amples eft celui du pendule. On plonge
un pendule dans l’eau courante, & on juge de la vî-
teffe de l’eau par la quantité à laquelle le poids s’élève,
c’eft-à-dire par l’angle que lè fil fait avec la verticale,
Mais cette méthode paraît meilleure pour comparer
enfémble les vîteffes de deux fle u v e s, que pour
avoir la vîteffe abfolue de chacun. Les tangentes des
angles font à la vérité entr’eUes, comme les quarrés
des vîteffes, & cette réglé eftaffez sûre : mais il n’eft
pas auffi facile de déterminer directement la vîteffe