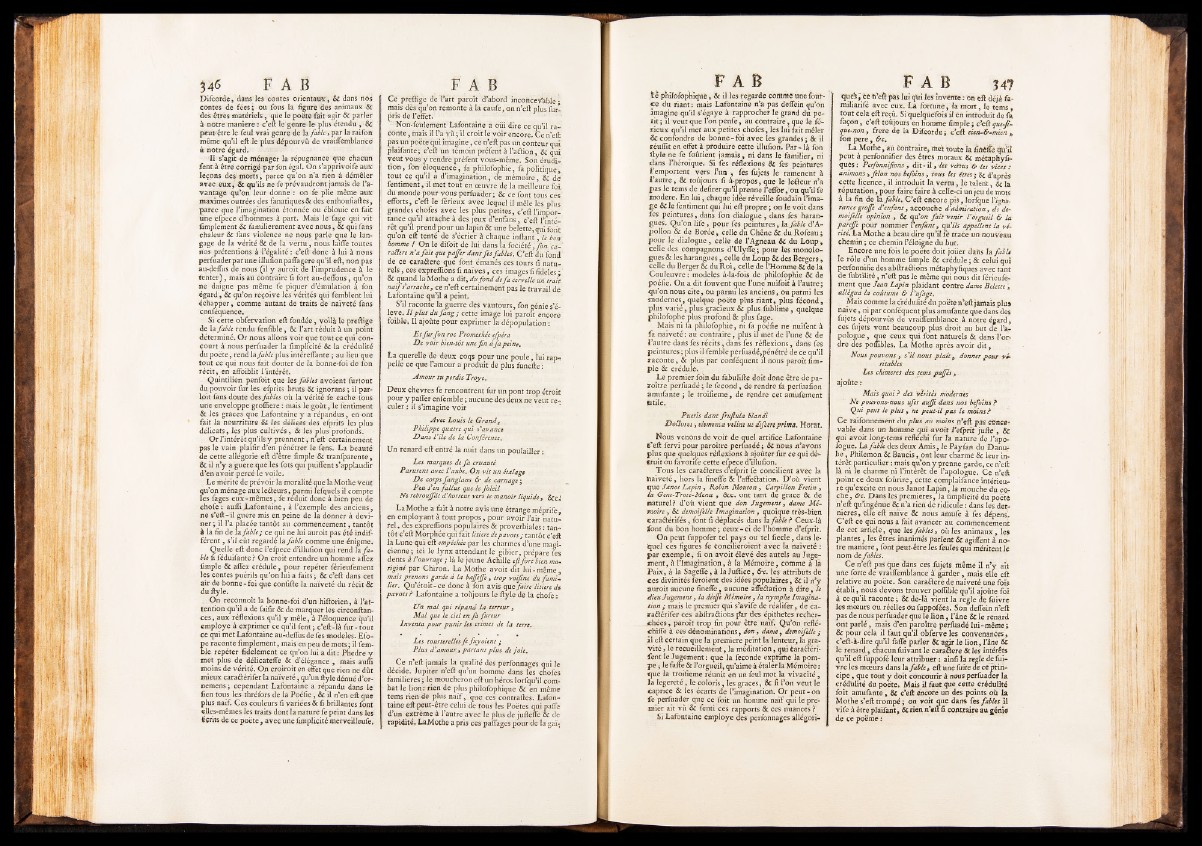
Difoprde, dans les contés orientaux , ôc clans nôS
ccmtes de fées ; ou fous la figure 'dés animaux &
des êtres matériels, que le poëte fait agir & parler
à notre maniéré : c’eft le genre le plus étendu , &
peut-être le feul vrai genre de la fable , par la raifon
même qu’il eft Je plus dépourvu de vraiffemblancé
à notre égard.
II s’agit de ménager la répugnance que chacun
fent.à être corrigé par Ion égal. On s’apprivoife aux-
leçons des morts, parce qu’on n’a rien à démêler
avec eux, & qu’ils ne feprévaudront jamais de l’avantage
qu’on leur donne : on fe plie.même aux
maximes outrées des fanatiques & des enthoufiaftes,
parce que l’imàgmatiôn étonnée où éblouie en fait
une efpece d’-hommes à part. Mais le fage qui vit-
Amplement ôc familièrement avec nous, ôc qui fans
chaleur & fans violence ne nous parle que le langage
de la vérité ôc de la vertu, nous laiffe toutes
nos prétentions à l’égalité : c’eft donc à lui à nous
perfuader par une illufionpaffagere qu’il eft, non pas
au-deffus de nous (il y auroit de l’imprudence à le
tenter), mais au contraire li fort au-deffous, qu’on
ne daigne pas même fe piquer d’émiilation à fon
égard, & qu’on reçoive les vérités qui femblent lui
échapper, comme autant de traits de naïveté fans
conféquence.
: Si cette obfervation eft fondée, voilà le preftige
de la fable rendu fenfible, ôc l’art réduit à un point
déterminé. Or nous allons voir que tout ce qui concourt
à nous perfuader la' fimplicité ÔC la crédulité
du poëte, rend la fable plus intereffante ; au lieu que
tout ce qui nous fait douter de la bonne-foi de fon
récit, en affoiblit l ’intérêt.
Quintilien penfoit que les fables avoient furtout
du pouvoir fur les efprits bruts ôc ignorans ; il parloir
fans doute des fables où la vérité fe cache fous
une enveloppe grofiiere : mais le goût, le fentiment
& les grâces que Lafontaine y a répandus, en ont
fait la nourriture ôc les délices des efprits les plus
délicats, les plus cultivés, & les plus profonds.
Or l’intérêt qu’ils y prennent, n’eft certainement
pas le vain plaifir d’en pénétrer le fens. La beauté
de cette allégorie eft d’être fimple ôc tranfparente,
ôc il n’y a guere que les fois qui puiffent s’applaudir
d’en avoir percé le voile.
Le mérite de prévoir la moralité que la Mothe Veut
qu’on ménage aux le&eurs, parmi lefquels il compte
les fages eux-mêmes, fe réduit donc à bien peu de
chofe: aufli JLafontaine, à l’exemple des anciens ,
né s*eft-il guere mis en peine de la donner à deviner
; il l’a placée tantôt au commencement, tantôt
à la fin de la fable; ce qui ne lui auroit pas été indifférent
, s’il eût regarde la fable comme une énigme.
Quelle eft donc l’efpece d’illufion qui rend la fa ble
fi féduifante ? On croit entendre un homme allez
fimple ôc aftez crédule, pour repéter férieufement
les contes puérils qu’on lui a faits ; & c’eft dans cet
air de bonne-foi que confifte la naïveté du récit ôc
du ftyle.
On reconnoît la bonne-foi d’un hiftorien, à l’attention
qu’il a de faifir ôc de marquer les circonftan-
ce s, aux réflexions qu’il y mêle, à l’éloquence qu’il
employé à exprimer ce qu’il fent ; c’eft-là fur - tout
ce qui met Lafontaine au-deffus de fes modèles. Efo-
pe raconte Amplement, mais en peu de mots; il fem-
ble repéter fidèlement ce qu’on lui a dit: Phedre y
met plus de délicateffe & d’élégance , mais auffi
moins de vérité. On croiroit en effet que rien ne dût
mieux caraftérifer la naïveté, qu’un ftyle dénué d’or-
nemens ; cependant Lafontaine a répandu dans le
fien tous les thréfors de la Poéfie, & il n’en eft que
plus naïf. Ces couleurs fi variées & fi brillantes font
elles-mêmes les traits dont la nature fe peint dans les
écrits de ce poëte, avec une fimplicité merveilleufe.
Ce preftige de Tàrt paroît d’abord inconcevable •
mais dès qu’on remonte à la caufe, on n’eft plus fur-
pris de l’effet.
Non-feulement Lafontaine a oui dire ce qu’il raconte,
mais il l’a y û ; il croitle voir encore. Ce n’eft
pas un poëte qui imagine, ce n’eft pas Un conteur qui
plaifante; c’eft un témoin préfent à l’a&ion, ôc qui
veut vous y rendre préfent vous-même. Son érudition,
fon éloquence, fa philofophie, fa politique,
tout ce qu’il a d’imagination ; de mémoire, & de
fentiment, il met tout en oeuvre de la meilleure foi
du monde pour vous perfuader; & ce font tous ces
efforts, c’ëft le férieux avec lequel il mêle les plus
grandes chofes avec les plus petites, c’eft l’importance
qu’il attache à des jeux d’enfans, c’eft ^intérêt
qu’il prendpour un lapin ôc une belette, qui font
qu’on eft tenté de s’écrier à chaque inftant , le bon
homme ! On le difoit de lui dans la foCiété ,fô n caractère
n'a fait que paffer dans fes fables. C ’eft du fond
de ce cara&ere que font émanés ces tours fi naturels
, ces expreflions fi naïves, ces images fi fîdeles ;
& quand la Mothe a dit, du fond de fa cervelle un trait
naïf s'arrache, ce n’eft certainement pas le travail de
Lafontaine qu’il a peint.
S’il raconte la guerre des vautours, fon génie s’élève.
I l plut dufang ; cette image lui paroît encore
foible. Il ajoûte pour exprimer la dépopulation:
Ê t fur fon roc Promethée efpérd
De voir bientôt une fin à fa peine.
La querelle de deux coqs pour une poule, lui rappelle
ce que l’amour a produit de plus funefte :
Amour tu perdis Troye.
Deux chevres fe rencontrent fur lin pont trop étroit
pour y paffer enfemble ; aucune des deux ne vêtit reculer
: il s’imagine voir
Avec Louis U Grand,
Philippe quatre qui s'avance
Dans l'île de la Conférence.
Un renard eft entré la nuit dans un poulailler:
Les marques de fa cruauté
Parurent avec Vaube. On vit un étalage
De corps fanglans & de carnage ;
Peu Ven fallut que le foleil
Ne rebrouffât d'horreur, vers le manoir liquide , ÔCC l
La Mothe a fait à notre avis une étrange méprife ’
en employant à tout p ropos, pour avoir l’air naturel
, des expreflions populaires & proverbiales : tantôt
c’eft Morphée qui fait litiere de pavots ; tantôt c’eft
la Lune qui eft empêchée par les charmes d’une magicienne;
ici le lynx attendant le gibier, prépare lès»
dents à l'ouvrage ; là le jeune Achille eft fort bien mo-
riginé par Chiron. La Mothe avoit dit lui-même,
mais prenons garde à la baffeffe , trop voifine du familier.
Qu’étoit-ce donc à fon avis que faire litiere de
pavots ? Lafontaine a toujours le ftyle de la chofe :
Un mal qui répand la terreur ,
Mal que le ciel en. fa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre.
Les tourterelles fe fuy oient ;
Plus d'amour., partant plus de joie.
Ce n’eft jamais la qualité des perfonnages qui le
décide. Jupiter n’eft qu’un homme dans les chofes
familières ; le moucheron eft un héros lorfqu’il combat
le lion : rien de plus philofophique ôc en même
tems rien de plus naïf, que ces contraftes. Lafontaine
eft peut-etre celui de tous les Poëtes qui paffe
d’un extrême à l’autre avec le plus de jufteffe ôc de
rapidité. La Mothe a pris ces paffages pour de la gaïm
"
te pniïofophïqùè, & il les regarde comme une four-
c e du riant : mais Lafontaine n’a pas deffein qu’on
imagine qu’il s’égaye à rapprocher le grand du petit
; il veut que l’on penfe, au contraire, que le fé-
srieux qu’il met aux petites chofes, les lui fait mêler
& confondre de bonne-foi avec les grandes; & il
réuffit en effet à produire cette illufion. Par - là fon
ftyle ne fe foûtient jamais, ni dans le familier, ni
dans l’héroïque. Si fes réflexions Ôc fes peintures
l ’emportent vers l’un -, fes fujets le rameneht à
l ’autre, & toujours fi à-propos, que le letteur n’a
pas le tems de defirer qu’il prenne l’effor, ou qu’il fe
modéré. En lu i, chaque idée réveille foudain l’image
& le fentiment qui lui eft propre ; on le voit dans
tes peintures, dans fon dialogue , dans fes harangues.
Qu’on life, pour fes peintures, la fable d’Apollon
& de Borée; celle du Chêne & du Rofeati ;
pour le dialogue, celle de l’Agneau & du Loup,
celle des compagnons d’UIyffe.; pour les monologues
& les harangues, celle au Loup ôc des Bergers,
celle du Befger ôc du Roi, celle de l’Homme ôc de la
Couleuvre : modèles à-lâ-fois de philofophie & de
poéfie. On a dit fouvent que l’une nuiioit à l’autre;
qu’on nous cite, ou parmi les anciens, ou parmi les
modernes, quelque poëte plus riant, plus fécond,
plus va r ié , plus gracieux ôc plus fublime, quelque
philofophe plus profond & plus fage.
Mais ni fa philofophie, ni fa poéfie ne nuifent à
fa naïveté : au contraire, plus il met de l’une ôc de
l ’autre dans fes récits, dans fes réflexions, dans fes
peintures ; plus il femble perfuadé,pénétré de ce qu’il
raconte, & plus par conféquent il nous paroît fimple
& crédule.
Le premier foin du fabulifte doit donc être de pa-
ïoître perfuadé ; le fécond, de rendre fa perfuafion
amufante ; le troifieme, dê rendre cet amufement
fitile.
Pueris dant fruflüla blandï
Doüores -, elementa velint ut difeerèprima. Horàt.
Nous vêtions de voir de quel artifice Lafontaine
B’eft fervi pour paroître perfuadé ; ôc ft'Ous ri’avons
plus que quelques réflexions à ajouter fur ce qui détruit
ou favo'rife cette efpece d’illufion.
Tous les caraâeres d’efprit fe concilient avec la
naïveté, hors la fineffe & l’affe&ation. D’où vient
que Janot Lapin , Robin Mouton , Carpillon Fretin ,
la Gent-Trote-Menu , ÔCC. ont tant de grâce ôc de
naturel? d’où vient que don Jugement, dame Mémoire
, ÔC demoifelle Imagination , quoique très-bien
cara&érifés, font fi déplacés dans la fable ? Cêux-là
font du bon homme; ceu x -c i de l’homme d’efprit.
On peut fuppofer tel pays ou tel fiecle, dans lequel
ces figures fe tonciüeroient avec la naïveté :
par exemple, fi on avoit élevé des autels au Jugement,
à l’Imagination, à la Mémoire, comme à la
Paix, à la Sageffe, à la Juftice, &c. les attributs de
ces divinités îëroient des idées populaires, & il n’y
auroit aucune fineffe, aucune afle&ation à dire, le
dieu Jugement, la déejfe Mémoire , la nymphe Imagination
; mais le premier qui s’avife de réalifer, de ca-
raôérifer ces abftraâiotis [fer des épithetes reçher-
.chées, paroît trop fin pour être naïf. Qu’on reflé-
chiffe à ces dénominations, don, dame, demoifelle ;
i l eft certain que la première peint la lenteur, la gravité
, le recueillement, la méditation, qui éaraftéri-
fent le Jugement : que la fécondé exphrtie la pompe
; le fafte & l’orgueil, qu’aime à étaler la Mémoire :
que la troifieme réunit en un feul mot la v ivacité,
la legereté, le coloris, les grâces, & fi l’on veut le
caprice & les écarts de l’imaginatioft. Or peut - on
fe perfuader que ce foit un homme naïf qui le premier
ait vu & fenti ces rapports & ces nuances ?
Si Lafontaine employé des perfonnages allégori-
» ce ft’eft pas lui qùi les invente : on eft déjà fa-
miliarifé avec eux. La fortune, la mort, le tems ,
tout cela^eft reçu. Si quelquefois il én introduit de fa
façon, c’eft toujours en homme fimple ; c’-eft qut-ji-
que-non, frere de la Difcorde; c ’eft tien-O-mien ,
fon pere, &c.
La Mothe, âù êontrairè, îhét toute la fiùèfîe qü’iî
peut à perfonnifier des êtres moraux & métaphyfi-
ques : Perfonnifions , dit - i l , les vetous & les vices :
animons > filon nos btfoins, tous les éirés > 8c d’après
cette licence, il introduit la v ertu , le talent, 8c la
réputation, pour faire faire à celle-ci un jeu de mots
à la fin de la fable. C ’eft encore pis, lorfque l’ignorance
grôfie d'enfant, accouche d'admiration, de demoifelle
opinion , & qu.'on fait-venir l'orgueil & la
pareffe pour nommer Yenfant, qiY ils appellent la vérité.
La Mothe a beau dire qu’il fé trace un nouveau
chemin ; ce chemin l’éloigne du but.
Encore une fois le poëte doit jouer dafis la fable
le rôle d’un homme fimple & crédule ; & celui qui
perfonnifie des abftraêfions métaphyfiques avec tant
de fubtüité, n’ eft pas le même qui nous dit férieufement
que Jean Lapin plaidant contre dame Belette ,
allégua la coutume & l'ufagè»
Mais comme la crédulité du poëté n*eft jamais plu»
naïve, ni par conféquent plus amufante que dans des
fujets dépourvûs de vraiffemblance à notre égard,
ces fujets vont beaucoup plus droit au but de l’apologue
, que ceux qui font naturels & dans l’ordre
des poflibles. La Mothe après avoir d it ,
Nous pouvons , s 'il nous plait ^ donner pour V*
ritables
■ Les chimères des tems paffés ,
a jo û te :
Mais quoi ? dtS Vérités modernes
Ne pouvons-nous ufer auffi dans nos bèfoihs ?
Qui peut le plus , ne peut-il pas le moins ?
Ce raifonnement du plus au moins n’eft pas concevable
dans un homme qui -avoit Petprit Julie , &
qui avoit Iong-tems réfléchi fur la nature de l’apologue.
La fable des deux Amis, le Payfart du Danu*
b e , Philemon ôc Baucis, ont leur charmé ôc leur intérêt
particulier : mais qu’on y prenne garde, ce n’eft
là ni le charme ni l’intérêt de l’apologue. Ce n’ eft
point ce doux foûrire, cette complaifance intérieure
qu’excite en nous Janot Lapin, la mouche du coch
e, &c. Dans les premières, la fimplicité du poëte
n’eft qu’ingénue & n’a rien de ridicule : dans lés det-
nieres, elle eft naïve ôc nous amufe à fes dépens.
C ’eft ce qui nous a foit avancer au commeticement
de cet article, que les fables, où les animaux, les
plantes, les êtres inanimés parlent ôc agiffent à notre
maniéré, font peut-être les feules qui méritent lé
nom de fables.
Ce n’eft pas que dâns ces fujets même il n’y ait
une forte de vraiffemblance à garder, mais elle eft
relative au poëte. Son caraftere de naïveté une fois
établi, nous devons trouver poffible qu’il ajoûte foi
à ce qu’il raconte ; Ôc dé-là vient la réglé de foivre
les moeurs ou réelles Ou fuppoféés. Son deffein ri’eft
pas de nous perfuader que le lion , l’âne & le renard
Ont parlé, mais d’en paroître perfuadé lui-même;
ôc pour cela il faut qu’il obferve les convenances ,
c’eft-à-dire qu’il foffe parler & agir le lion, l’âne &
le renard, chacun fuivant le cara&ere & les intérêts
qu’il eft fuppofé leur attribiier : ainfi la réglé defui-
vreles moeurs dans la fable, eft une fuite de ce principe
, que tout y doit concourir à nous perfuader la
crédulité du poëte. Mais il fout que cette crédulité
foit amufante, ôc c’eft encore un des points où la
Mothe s’eft trompé ; o n v o i t que dans fes fables il
vife à être plaifant, Ôc rien n’eft fi contraire au génie
de ce poëme :