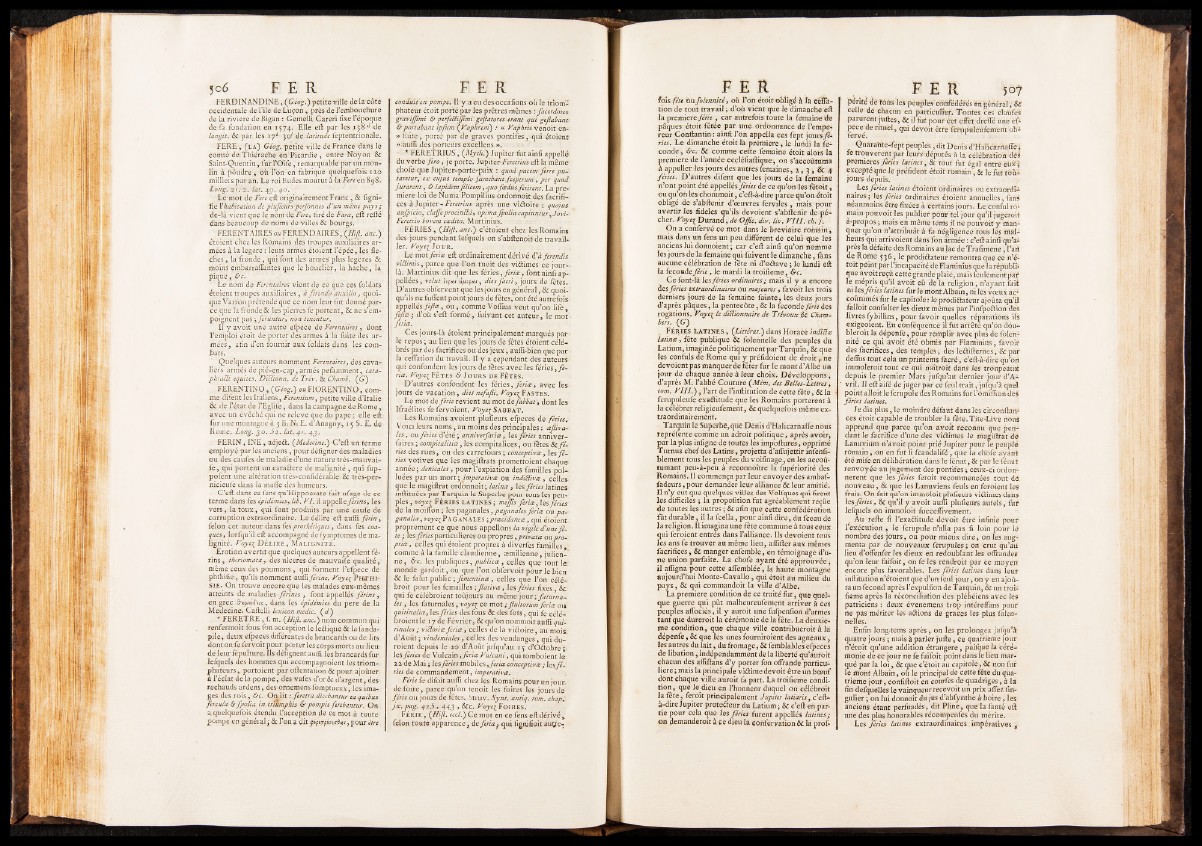
FERDINANDINE, (Géog.) petite ville de la côte
occidentale de l’île de Luçon , près de l'embouchure
de la riviere de Bigan : Gemelli Careri fixe l’époque
de fa fondation en 1574. Elle eft par les ,138 d de
longit. &c par, les I7d ^ddelatitude feptetttrionale.
FERE*, ( la) Géôg. petite ville de France dans le
comté -de: Thiéraéhe en Picardie , entre Noyon &
Saint-Quentin, fur l’O'ife, remarquable par un moulin
à poudre , 011 Fon -en fabrique quelquefois 120
milliers par an. Le roi Eudes mourut àlâ'FVrê en 898.
Long. z i . 2. lut. 4c). 40.' ?'
Lé'mot de Fere eft originairement Franc, & lignifie
l’habitation de plujieurs-perfonnes d’un même pays7
de-là vient que le nom de Fere, tiré de Fara, eft refté
dans beaucoup de noms de villes & bourgs; :
FERENTAIRES ou FERENDAIRES, (Hifl. anc.)
étoient chez les Romains des troupes auxiliaires armées
à la legere: leurs armes étoient l’épée , les fle-
clies, la“ frondé, qui font des armes plus légères &
moins embarraffarttes que le 'bouclier, la hache, la
pique y&c.
Le riôrii de Ferentaires vient de ce que ces foldats
étoient troupes auxiliaires, à fercndàauxilïo, quoique
Varron prétende que ce nom leur fut donné parce
que là fronde & les pierres fe portent, & ne s’empoignent
pas ; feruntur, non tenentur. / ,
Il y avoitune autre efpéce de Ferentaires, dont,
l ’emploi étoit de porter des armes à la fuite des armées
, afin d’en fournir aux foldats dans les combats.
Quelques auteurs nomment Ferentaires, des cavaliers
armés de pié-en-cap, armés pefamment, cata-
phracti équités. Diaionn. de Trév. & Chamb, ■ (G)
FERENTINO, (Géog,) ou FIORENTINO, comme
dil'ent les Italiens, Ferentium, petite ville d’Italie
& de l’état de l’Eglife, dans la campagne de Rome,
avec un évêché qui ne releve que. du pape : elle eft
fur une montagne à 3 li. N. E. d’Anagny, 15'S. E. de
Rome. Long. 3 0. 62. Lat. 41. 43.
FERIN, INE, adjeft. (Medecine.) C’eft un terme
employé par les anciens, pour défigner des maladies
ou des caufes de maladie d’une nature très-mauvai-
f e , qui portent un caradere de malignité , qui fup-
pofent une altération très-confidérable & très-per-
nicieufe dans la maffe des humeurs.
C ’eft dans ce fens qu’Hippocrate fait ufage de ce
terme dans fes épidémies, lib. VI. il appelle férins, les
v ers, la toux, qui font produits par une caufe de
corruption extraordinaire. Le délire eft aufli férin,
félon cet auteur dans fes prorhétiques, dans fes conques
, lorfqu’il eft accompagné de lÿmptomes de malignité.
Voye^ D é l ir e , Ma l ig n it é .
Erotion avertit que quelques auteurs appellent férins
, theriomata, des ulcérés de mauvaife qualité,'
même ceux des poumons , qui forment l’efpece de
phthifie, qu’ils nomment aufli férine. Voyez Ph jh i-
s ie. On trouve encore que les malades eux-mêmes
atteints de maladies férines , font appellés férins ,
en grec 5npiûS'uç, dans les épidémies du pere de la
Meaecine. Caftelli Lexiconmedic. (d )
* FERETRE, f. m. (Hifl. anc.) nom commun qui
renfermoit fous fon acception le le&ique & la fanda-
pile, deux efpeces différentes de brancardsou de lits
dont on fe fer voit pour porter les corps morts au lieu
dé leur fépulture. Ils défignent aufli les brancards fur
lefquels des hommes qui accompagnoient les triomphateurs,
portoient par oftentation & pour ajouter
à l’éclat de la pompe, des va fes d’or & d’argent, des
rechauds ardens, des ornemens fomptueux, les images
des rois, &c. On lit : feretra dicebantur ta quibus
fercula 6/ fpolia in triumphis & pompis fertbantur. On
a. quelquefois, étendu l’acception de ce mot à toute
pompe en général; & l’on a dit ftptjpmrücu, pour être
conduit en pompe.phateur étoit por tIél pya ra leeus dperês torcecsâ mfiêomnse so i:t le triomfacerdotes
j gravifjimi & perfecUJJîmi geJiatores erant qui gejlabdnti
& pôrtabant ipfum (Vaphrem) : « Vaphris Venoit en-
j » fuite, porté par de graves pontifes,:'qui étoient
l »;àüfli des porteurs excellens. ». . ■
- * FE R E TR IU S (Myth.) Jupiter fut ainfi appelle;
du verbe ftro, je porte. Jupiter-Feremas eft la même
; cho-feique Jupiter-pbrte^paix : quod pacem ferre pu±:
taretur,.ex cujùs ttmplo fumebant.fceptrum, per quoi
jurarent, & lapidtmjilicem, quo fendus,férir ent. La première
loi de Numa Pompilius ordonnoit des facrifî-;
: ces à J upiter - Feretrius après une viéloire : quojus.
. aufpicio, clajfe procinclâ, opima fpolia capiuntur Jovi->
Feretrio bovem ccedito. Maftinius. :•
FÉRIÉS, (Hifl. <z#£.).c’étoient chez-les Romain*
\: d1eers. jours pendant lefquels on s’abftenpit de travail-; Voyez Jour.
Le mot ferla eft ordinairement dérivé d’à ferendis
yiclimis, parce que l ’on tuoit des viftimes ce jour-.
. là. Martinius dit que les fériés ,feriæ, font ainfi ap->
pellées, relut Upta ù/Mpur, dits facri, jours de fêtes.
; D ’autres obferv.ent que les jours en général, & quoi-’
qu’ils ne fuffent point jours de fêtes, ont été autrefois-
appellés fejiæ, o u ,.’comme Voflius veut qu’on life ,
1 fejiæ; d’où s’eft formé, fuivant cet auteur, le mot-
| ferice.
Ces jours-là étoient principalement marqués par--
le repos; au lieu que les jours de fêtes étoient célébrés
par des facrifices ou-des jeu x, auffi-bien que par 1
; la ceffation du travail. Il y a cependant des auteurs -
qui confondent les-jours de fêtes avec les fériés, f t - ;
rite. Voye^ Fêtes & Jours de Fêtes.
D ’autres confondent les fériés, ferice, avec les
jours de vacation, dits nefajli, Voye^ Fastes.
Le mot de férié revient au mot de fabbaty dont les
Ifraélites fe fervoient. Voye{ Sa b b a t .
Les Romains avoient plufieurs efpeces de fériés.
Voici leurs noms, au moins des principales : cefliva-
les, Ou fériés d’été ; anniverfaria, les fériés anniver-
faires ; compitalititz, les compitalices, ou fêtes 8>cfé-
; ries des rues, ou des carrefours ; conceptivce, les fé±'
ries votives que les magiftrats promettoient chaque-
année ; denicales , pour l ’expiation des familles polluées
par un mort ; imperativce ou indiÜivoe , celles.
que le magiftrat ordonnoit; latince , lés fériés latines
inftituées parTarquin le Superbe pour tous les peuples
, voyei Fériés latines ; mefjis ferice, les fériés
de la moiffon ; les paganales, paganales ferice ou pa-
ganalia, voyer^Paganales ;proecidanece, qui étoient-
proprement ce que nous appelions la vigile d’une fê-
’ te ; les fériés particulières ou propres, privât ce ou pro-,
pria, celles qui étoient propres à diverfes familles,',
comme à la famille claudienne, æmilienne, julienne
, &c. les publiques, publicce, celles que tout lec
monde gardoit, ou que l’on obfervoit pour le bien
& le falut public ; fementinoe, celles que l’on célé-
broit pour les femailles ; Jlativce , les fériés fixes, ôç
qui fe célébroient toujours au même jour; faturna-
les, les faturnales, voye^ ce mot ; flultorum ferice ou
quirinalioe, les fériés des fous & des fots, qui fe celé—-
broientle 17 de Février, & qu’on nommoit aufli qui-
rinales ; viclorice ferice , celles de la vi&oire, au moisi
d’Aoüt ; vindemiales, celles des vendanges, qui du-
roient depuis le 20 d’Août jufqu’au 15 d’Oriobre ;>
les fériés de Vulcain, feriez Vulcani, qui tomboient le
22 de Mai ; les fériés mobiles, ferice conceptivce ; les fé riés
de commandement, imperativce.
Férié fe difoit aufli chez les Romains pour un jour,
de foire, parce qu’on tenoit les foires les jours de
férié ou jours de fêtes, itruv. Synt. antiq. rom. chapl
j x . pag. 4 zâ , f 4 4 g , &c. Voyei Foires. Férié , (Hifl. eccl.) Ce mot en ce fens eft dérivé,
félon toute apparence, de feria ^ qui fignjfioit autfefois
fête bù folennité, où l’on étoit obligé à la céfla-
tion de tout travail ; d’où vient que le dimanche eft
îa première j/er/e , car autrefois toute la femaine- de
pâques étoit fêtée par une. ordonnance de l’empe*
reur Conftantin: ainfi l’on appella ces fept jours,/#-.
ries. Le dimanche étoit la prémiere, le lundi la fécondé
, &c. & comme cette femaine étoit-alors-la
première de Fannée ecçléfiaftique^ on s’accoùîttaiia
à appeller les jours des autres femaines, 2 , 3 , & 4
fériés. D ’autres difent que les jours de la femaine
n’ont point été appellés fériés de ce qu’on les Fêtoit 9
ou qu’on les chommoit, c’eft-à-dire parce qu’on étoit
obligé de s’abftenir d’oeuvres ferviles, mais pour
avertir les fideles qu’ils dévoient s’abfteflir de-pécher.
Voyez-'Durand, dé Offic. div. AV. V I I I : ch, j .
On a confervé ce mot dahs le bréviaire rofiiain^
mais dans un fens un peu différent de celui que les
anciens lui donnoient ; car c’eft ainfi qu’orî îïo'fiimé
les jours de la femaine qui fuivent le dimanche, fkns
aucune célébration de fête ni d’oâa ve ; le lundi éft
la fécondé férié, le mardi la troifieme, &c.
Ce font-là les fériés ordinaires; mais il y a encore
des fériés extraordinaires ou majeures , favoir les trois
derniers jours de la femaine fainte, les deux jours
d’après pâques, la pentecôte, & la fécondé férié des
rogâtions. Voye^ le duiiànnaire de Trévoux Charniers.
(G') , Fériés Latines , (Littéral.) dans Horaèé indictoe.
latince, fête publique & folennelle des peuples dit
Latium, imaginée politiquement parTarquin, & que
les cqnfuls de Rome qui y préfidoient de droit , ne
dévoient pas manquer de fêter fur le môntd’Albê tin
jour de chaque année à leur choix. Développons ,
d’après M. l’abbé Couture (Mém. des Belles-Lettres,
tom. V I I I . ) , l’art de l’inftitution de cette fête, & là
fcrupuleufe exa&itude que les Romains portèrent à
la célébrer religieufement, & quelquefois même extraordinairement.
Tarquin le Superbe, que Denis d’Halicarnafte nous
reprélente comme un adroit politique, après avoir,
par la plus infigne de toutes les impoftures, opprimé
Turnus chef des Latins, projette d’afliijettir infenfi-
blement tous les peuples du voifinage, en les accoutumant
peu-à-peu à reconnoître la fupériorité des
Romains. Il commença par leur envoyer des ambaf-
fadeurs, pour demander leur alliance & leur amitié.
Il n’y eut que quelques villes des Volfques qui firent
les difficiles ; la propofition fut agréablement reçue
de toutes les autres ; & afin que. cette confédération
fût durable, il la fcella, pour ainfi dire, du fceau de
la religion. Il imagina une fête commune à tous ceux
qui feroient entres dans l’alliance. Ils dévoient tous
les ans fe trouver au même lieu, aflifter aux mêmes
facrifices, & manger enfemble, en témoignage d’ü-
ne union parfaite. La chofe ayant été approuvée,
il affigna pour cette affemblée, la haute montagne
aujourd’hui Monte-Cavallo, qui étoit au milieu du
p a y s , & qui commandoit la ville d’Albê.
La première condition de ce traité fu t, que quel-
que guerre qui pût malheureufêment arriver à ce$
peuples affociés, il y auroit une fufpenfion d’armes
tant que dureroit la cérémonie de la fête. La deuxième
condition, que chaque ville contribueroit à la
dépenfe, & que les unes fourniroient des agneaux,
les autres du la it , du fromage, & feffiblables efpeces
de libation, indépendamment de la liberté qu’aüfôit
chacun des afliftans d’y porter fon offrande particulière
; mais la principale viftime devoit être un boeuf
dont chaque ville auroit la part. La troifieme condition,
que le dieu en l’honnenr duquel on célébroit
la fête, fêroit principalement Jupiter lettiaris, c’eft*
à-dire Jupiter protecteur du Latium ; & c’eft en par-
tie pour cela que les fériés furent appellés latines ;
on demanderait à ce dieu la eonfervation Ôc là prof-
'perîte dêtôfiS les peuples càrifédéfés èn général ; Sd
celle dê chacun en particulier. Toutes cès claùfcs
parurent jûftes, & il fut pour cet effet d’refie une ef'
pece de rituel, qui dévoit être leriipuleufenten't ob-
ferve.
I Quafàtite-fépt peuples S dit Dénis d’Haliéarhaffé \
fe trouvèrent par leursidéputës a là célébfatibn dès
premières fèties latinet ,• & fout fut égal entre1
excepté que le préfident étoit romain, & lé fut tbu-
jourS depuis.
Les fériés latines étôiéht 'Ordinaires ou èxtraordi^
haires; leîj'èrAï Ordinaires étoient annuelles, fans
néanmoins être fixées à certains jours. Le.conful roi
main poüvoit les publier pour tel jour qu’il jugeroit
à-propos ; mais en mênie téms il ne pouvoit y manquer
qu’on n’àttribuât à fa- hégligèhce tous lés malheurs
qui arrivoient dans fon ârméè .* c’eft ainfi qu’à*
près la défaite dés Romains aü lac de Trafimene, l’àii
de Rome 536, le prodidateur remontra que ce n’é-
toit p<5int par l’incapacité de Flàminïu’s que la république
âvoitreçu cette grande plaié, mais feulement paF
le mépris qu’il avoit eû de la religion, n’ayant fait
ni les ferie's latines fur le mont Albain, ni les voeux ac^
coutumes fur lé capitôle :!e prodiftateiir ajbûta qu’il
falloit confulter les dieux mentes par l’infpeftion des
livres fybillins, pour favoir quelles réparations ils
exigeoient. En conféquence il fut arrêté qu’pn dôu-
bleroit la dépenfe, pour remplir avec plus de folén-
nité ce qui avoit été obfnis pâr Flamitfiiis, fâvôir
des facrifices, des temples, des léCtifternés, & par
deffus tout cela un printems fâcré, c’eft-à-dire qu’on
immoleront tout ce qui nâîtroit dans les troupeaux
depuis le premier Mars jüfqu-aü dernier jour d’A-*
vril. Il eft aifé de juger par ce feul trait, jufqu’à quel
point alloit le ferupule des Romains fur l’ôriiiffion dés
fériés latines.
Je dis plus, le moindre défaut dans les Cifconftan1
ces étoit capable de troubler la fête.Tite-Live rioùà
apprend que parce qu’on avoit reconnu que pendant
le facrifice d’une des virtimès le magiftrat dé
Laniivium n’avoit point prié Jupiter pour le peuple
romain, ,on en fut fi feandalifé, que la chofe ayant
été niife en délibération dans le fénât, & par le fénat
renvoyée an jugement des pontifes ; ceux-ci Ordonnèrent
que les fériés feroit recommencées tout dô
nouveau, & que les Lanuviens feüls en feroient les
frais. On fait qu’on immoloit plufieurs viôimes dans
les fériés, & qu’il y avoit aufli plufieurs autels, fur
lefquels OU immoloit fucceflîvement. Au refte fi l’exaftitude devoit être infinie pouf
nl’oexmébcruet idoens j, oluer sf,e rouup uploeu nr ’amlliae upxa sd ifrie ,l ooinn lpeos uaru glé
lmieeun dta’o pffaern fdeer lenso duiveeuaxu xen f crérudpoüulbelsa ;n Ot lne sc roufft raqnud’àetsi qu’on leur faifbit, on fe les rendroit par cè moyen
einnfctoitruet iopnlu ns’ éftaovioernatb qluese, dL’uèns ffeéuHle jso luarti,n Oens yd aenns aljeouur
ta un fécond après l’expulfion de Tarquin, & un tfoi-
pfiaetmriec iaepnrsè s: ldae ruéxc oénvceinlièamtioenn sd terso ppl éinbtééireenfsfa anvse pco luers nneel lpeâs.s mériter les avions de grâces les plus folen-
Enfin long-tems après, on lés prolongea jufqu’à
quatre jours ; mais à parler jufte, ce quatrième jour
n’étoit qu’une addition étrangère, puifqué la eéré-*
manie de ce jour ne fe faifoit point dans le lieu marqué
par la lo i , & que c’étoit au capitôle, & non fur
le mont Albain, où le principal de cette fête du quatrième
jour, confiftoit en coürfeS de quadriges, à la
fin defquelles le vainqueur recevoit un prix affez fin-*
gulier ; on lui donnoit du jus d’àbfynthe à boire, les
anciens étant perfuadés, dit Pline, que la fanté eft
une des plus honorables récompenfes du mérité.
Les fériés latines extraordinaires impératives $