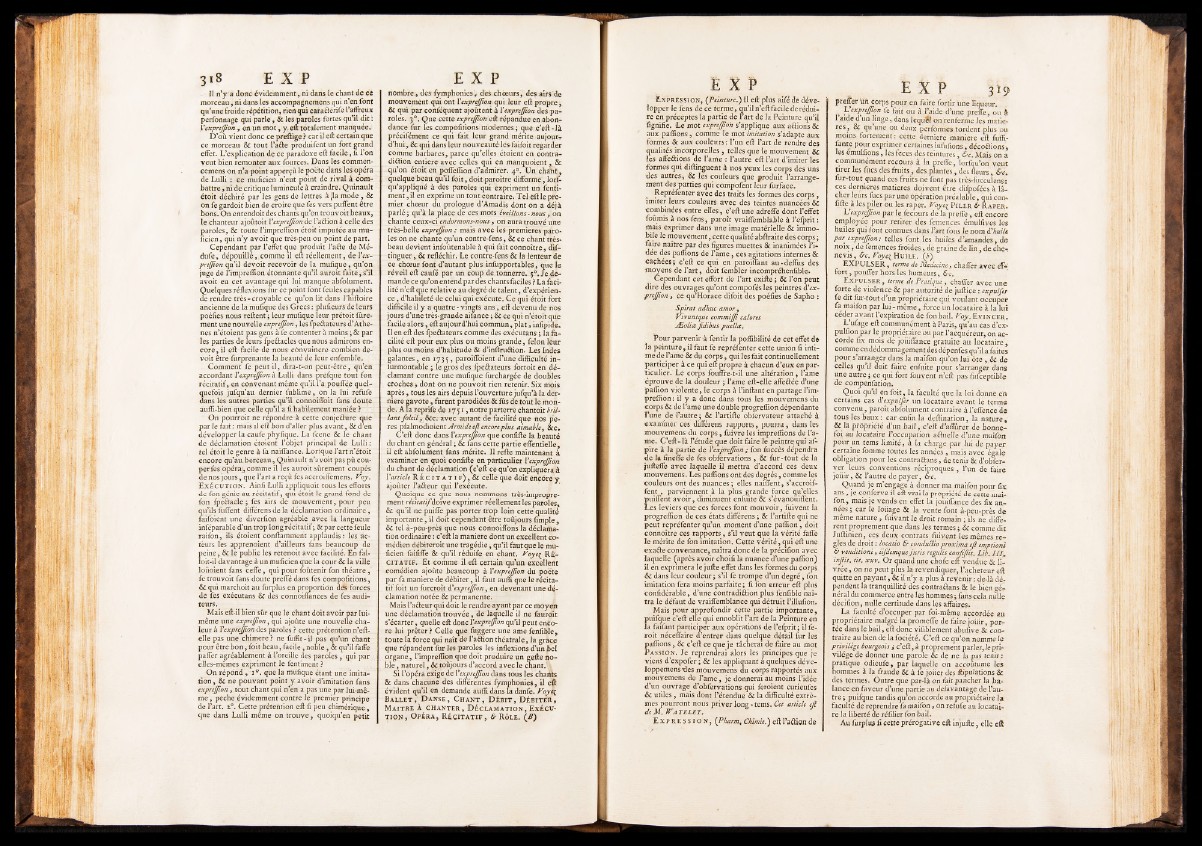
Il n’y a donc évidemment r ni dans le chant de ce
morceau, ni dans les accompagnemens qui n’en font
qu’une froide répétition, rien qui caraélérife l’affreux
perfonnage qui parle, & les paroles fortes qu’il dit :
yexprejjîon , en un m ot, y. eft totalement manquée.
D ’où vient donc ce preftige? car il eft certain que
ce morceau & tout l’afte produifent un fort grand
effet. L’explication de ce paradoxe eft facile, fi l’on
veut bien remonter aux fources. Dans les commen-
cemens on n’ a point apperçû le poëte dans les opéra
de Lulli : ce muficien n’eut point de rival à combattre
, ni de critique Iumineufe à craindre. Quinault
étoit déchiré par les gens de lettres à [la m ode, &
on fe gardoit bien de croire que fes vers puffent être
bons. On entendoit des chants qu’on trouvoit beaux,
le chanteur ajoûtoit Yexprejjîon de l’aélion à celle des
paroles, & toute l’impreffion étoit imputée au muficien
, qui n’y avoit que très-peu ou point de part.
Cependant par l’effet que produit l'aâe de Mé-
dufe, dépouillé,, comme il eft réellement, de 1’«?-
prejjion qu’il devoit recevoir de la mufique, qu’on
juge de l’impreflion étonnante qu’il auroit faite, s’il
avoit eu cet avantage qui lui manque abfolument.
Quelques réflexions lur ce point font feules capables
de rendre très-croyable ce qu’on lit dans l ’hiftoire
ancienne de la mulique des Grecs : plufieurs de leurs
poéfies nous reftent ; leur mufique leur prétoit fûre-
ment une nouvelle exprejjîon, les fpettateurs d’Athènes
n’étoient pas gens à fe contenter à moins ; & par
les parties de leurs fpeétacles que nous admirons encore
, il eft facile de nous convaincre combien devoit
être furprenante la beauté de leur enfemble.
Comment fe peut il, dira-t-on peut-être, qu’en
accordant Vexprejjîon à Lulli dans prefque tout fon
récitatif, en convenant même qu’il l’a.pouffée quelquefois
jufqu’au dernier fublime, on la lui refufe
dans lés autres parties qu’il connoiffoit fans doute
aufli-bien que celle qu’il a fi habilement maniée ?
On pourroit ne répondre k cette conjecture que
parle fait: mais il eft bon d’aller plus avant, & d’en
développer la caufe phyfique. La fcene & le chant
de déclamation étoient l’objet principal de Lulli :
tel étoit le genre à fa naiffance. Lorlque l’art n’étoit
encore qu’au berceau, Quinault n’a voit pas pû couper
fes opéra;, comme il les auroit sûrement coupés
de nos jours, que l’art a reçu fes accroiffemens. Foy.
E x é c u t io n . Ainfi Lulli appliquoit tous les efforts
de fon génie au récitatif, qui étoit le grand fond de
fon fpe&acle ; fes airs de mouvement, pour peu
qu’ils fuffent différens de la déclamation ordinaire,
faifoient une diverfion agréable avec la langueur
inféparable d’un trop long récitatif; & par cette, feule
raifon, ils étoient conftammerit applaudis: les acteurs
les apprenoient d’ailleurs fans beaucoup de
peine, & le public les retenoit avec facilité. En fal-
îoit-il davantage à un muficien que la cour & la ville
loiioient fans ceffe, qui pour loûtenir fon théâtre,
fe trouvoit fans doute preffé dans fes compofitions,
& qui marchoit au furplus en proportion dé*5 forces
de fes exécutans & des connoiffances de fes auditeurs.
Mais eft-il bien sûr que le chant doit avoir par lui-
même une exprejjîon, qui ajoûte une nouvelle chaleur
à Yexprejjîon des paroles ? cette prétention n’eft-
elle pas une chimere ? ne fuffit - il pas qu’un chant
pour être bon, foit beau, facile, noble, & qu’il faffe
paffer agréablement à l’oreille des paroles, qui par
elles-mêmes expriment le fentiment ?
On répond, i ° . que la mufique étant une imitation
, & ne pouvant point y avoir d’imitation fans
exprejjîon , tout chant qui n’en a pas une par lui-même
, peche évidemment contre le premier principe
de l’art. z°. Cette prétention eft fi peu chimérique,
que dans Lulli même on trouve, quoiqu’en petit
nombre., des Symphonies * dèS ,choeurs , des airs de
mouvement qui ont Y exprejjîon qui leur eft propre,
& qui par cohféquent ajoutent à Y exprejjîon des paroles.
30. Que cette exprejjîon eft répandue en abondance
fur les compofitions modernes ; que .c’e ft-là
précifément ce qui fait leur grand mérite aujourd’hui,
& qui dans leur nouveauté les faifoit regarder
comme barbares, parce qu’elles étoient en contradiction
entière avec celles qui en manquoient, &
qu’on étoit en poffeflion d’admirer. 40. Un chaht.,
quelque beau qu’il foit, doit paroître difforme, Iorf-
qu’appliqué à des paroles qui expriment un fentiment
, il en exprime un tout contraire. T el èift le premier
choeur du prologue d’Amadis dont on a déjà
parlé; qu’à la place de ces; mots éveillons - nous , on
chante ceux-ci endormons-nous , on aura trouvé une
très-belle exprejjîon: mais avec les premières paroles
on ne chante qu’un contre-fens, & ce chant très-
beau devient infoutenable à qui fait connoître, distinguer
, & réfléchir. Le contre-fens & la lenteur de
ce choeur font d’autant plus infupportables, que le
réveil eft caufé par un coup de. tonnerre. $°.Je demande
ce qu’on entend par des chants faciles ? La facilité
n’eft que relative au degré de talent, d’expérience
, d’habileté de celui qui exécute. Ce qui étoit fort
difficile il y a quatre - vmgts ans, eft devenu de nos
jours d’une très-grande ailance ; & ce qui n’étoit que
facile alors, eft aujourd’hui commun, plat, infipide.
11 en eft des fpeftateurs comme des exécutans ; la facilité
eft pour eux plus ou moins grande, félon leur
plus ou moins d’habitude & d’inftruCtion. Les Indes
galantes, en 1735, paroiffoient d’une difficulté in-
l'urmontable ; le gros des fpe&ateurs fortoit en déclamant
contre une mufique furchargée de doubles
croches > dont on ne pouvoit rien retenir. Six mois
après, tous les airs depuis l’ouverture jufqu’à la dernière
gavote, furent parodiées & fus de tout le monde.
A la feprife de 17 5 1 , notre parterre chantoit brillant
fohily & c ; avec autant de facilité que nos pe-
res pfalmodioient Armide eft encore plus aimable, &c.
C ’eft donc dans Yexprejjîon que confifte la beauté
du chant en général ; & fans cette partie effentielle,
il eft abfolument fans mérite. Il refte maintenant à
examiner en quoi confifte en particulier Yexprejjîon
du chant de déclamation (c’eft ce qu’on expliquera à
Y article Ré c it a t if ) , & celle que doit encore y
ajoûter l’a&eur qui l’exécute.
Quoique ce que nous nommons très-improprement
récitatif doive exprimer réellement les paroles,
& qu’il ne puiffe pas porter trop loin cette qualité
importante, il doit cependant être toûjours fimple ,
& tel à-peu-près que nous connoiffons la déclamation
ordinaire : c’eft la maniéré dont un excellent comédien
débiteroit une tragédie, qu’il faut que le muficien
faififfe & qu’il réduife en chant. Foyer Réc
i t a t i f . Et comme il eft certain qu’un excellent
comédien ajoûte beaucoup à Yexprejjîon du poëte
par fa maniéré de débiter, il faut auffi que le récitatif
foit un furcroît dû exprejjîon, en devenant une déclamation
notée & permanente.
Mais l’aûeur qui doit le rendre ayant par ce moyen
une déclamation trouvée, de laquelle il ne fauroit
s’écarter, quelle eft donc Yexprejjîon qu’il peut encore
lui prêter ? Celle que fuggere une ame fenfible,
toute la force qui naît de l’aCtion théâtrale, la grâce
que répandent fur les paroles les inflexions d’un bel
organe, l’impreflion que doit produire un gefte noble
, naturel, & toûjours d’accord avec le chant.' i
Si l’opéra exige de l’exprejjîon dans tous les charits
& dans chacune des différentes fymphonies, il eft
évident qu’il en demande auffi dans la danfe. Foyt^ Ballet, Danse, Chant,M Débit, Débiter, aître à chanter, Déclamation,E xécution,
Opéra, Récitatif, & Rôle. (Æ)
E x p r e s s io n , ( P e in tu r e .) II eft plus aifé de développer
le fens de ce terme, qu’il n’eft facile de réduire
en préceptes la partie de l’art de la Peinture qu’il
fignifie. Le mot e x p r e j j îo n s’applique aux aftions &
aux paffions, comme le mot im i ta t io n s’adapte aux
formes & aux couleurs : l’un eft l’art de rendre des
qualités incorporelles, telles que le mouvement &
les affections de l’ame •: l’autre eft l ’art d’imiter les
formes qui diftinguent à nos yeux les corps des uns
des autres-, & lés couleurs que produit l’arrangement
des 'parties qui compofent leur furface»
Repréfenter avec des traits les formes des corps,
imiter leurs couleurs avec des teintes nuancées &
combinées entre elles, c’eft une adreffe dont l’effet
fournis à nos fens, paroît vraiffemblable à l’efprit :
mais exprimer dans une image matérielle & immobile
le mouvement, cette qualité abftraite des corps ;
faire naître par des figures muettes & inanimées l’i-
dee des pallions de l’ame, ces agitations internes &
càçhées ; c’eft ce qui en paroiffant au-deflùs des
moyens de l’art, doit fembler incompréhenfible.
| Cependant cet effort de l’art exifte; & l’on peut
dire dès ouvrages qu’ont compofés les peintres e x p
r e j j îo n , ce qu’Horace difoit des poéfies de Sapho :
S p i r a t a d k u c am o r ,
Vivuntque commijji calons
Æolice jîdibus paella.
iPour parvenir à fentir la poffibilité de cet effet de
la peinture, il faiit fe repréfenter cette union fi intime
de l’ame & du corps, qui les fait continuellement
participer à ce qui eft propre à chacun d’eux en particulier.
Le corps fouffre-t-il une altération, l’ame
éprouve de la douleur ; l’ame eft-elle affeCtée d’une
’paffion violente, le corps à l’inftant en partage l’impreffion
: il y a donc dans tous les mouvemens du
corps & de l’ame une double progreffion dépendante
l ’une de l’autre ; & l’artifte obfervateur attaché à
examiner ces différens rapports, pourra, dans les
mouvemens du corps, fuivre les impreffions de l’ame.
C ’eft-là l’étùdê que doit faire le peintre qui af-
pire à la partie de Yexprejjîon ; fon fuccès dépendra
de la fineffe de fes obfèrvations , & fur-tout de la
jufteffe avec laquelle il mettra d’accord ces deux
mouvemens. Les paffions ont des degrés, comme les
couleurs ont des nuances; elles naiffent, s’accroif-
fent , parviennent à la plus grande force qu’elles
puiffent avoir, diminuent enfuite & s’évanoiiiffent.
Les leviers que ces forces font mouvoir, fuivent la
progreffion de ces états différens ; & l’artifte qui ne
peut repréfenter qu’un moment d’une paffion, doit
connoître ces rapports, s’il veut que la vérité faffe
le mérite de fon imitation. Cette v érité, qui eft une
exaCte convenance, naîtra donc de la précifion avec
laquelle (après avoir choifi la nuance d’une paffion)
il en exprimera le jufte effet dans les formes du corps
& dans leur couleur ; s’il fe trompe d’un degré, fon
imitation fera moins parfaite ; fi fon erreur eft plus
confidérable, d’une contradiction plus fenfible naîtra
le défaut de vraiffemblance qui détruit l’illufion.
Mais pour approfondir cette partie importante,
puifque c’eft elle qui ennoblit l’art de la Peinture en
la faifant participer aux opérations de l’efprit; il fe-
roit néceffaire d’entrer dans quelque détail fur les
paffions, & c’eft ce que je tâcherai de faire au mot
P a s s io n . Je reprendrai alors les principes que je
viens d’expofer ; & les appliquant à quelques déve-
loppemens*des mouvemens du corps rapportés aux
mouvemens de l’ame, je donnerai au moins l ’idée
d’un ouvrage d’obfervations qui feroient curieufes
& utiles, mais dont l’étendue & la difficulté extrêmes
pourront nous priver long - tems. C e t a r t ic le eft
d e M . JF a t e l e t .
E x p r e s s i o n , (Pharm, Chimie.')eftl’aClionde
preffer ton corps pour en faire fortir fine liqueur.
£. L exprejjîon fe fait ou à l’aide d’une preffe, ou â
l’aide d’un linge , dans lequel on renferme les matières,
& qu’une ou deux perfon nés tordent plus ou
moins fortement: cette derniere maniéré eft fuffi-
fante pour exprimer certaines infivfions, décodions *
les emulfions, les feces des teintures, &c. Mais on a
communément récours à la preffe, lorfqu’on veut
tirer les fucs des fruits m des plantes, des fleurs, &c.
fur-tout quand ces fruits ne font pas très-firccuîenst
ces dernieres matières doivent être difpofées à lâcher
leurs fucs par une opération préalable, qui confifte
à les piler ou les râper. V o y e ^ Pi l e r & R â p e r .
Vexprejjîon par le fecours de la preffe, eft encore
employée pour retirer des femences émulfivés les
huiles qui font connues dans l’art fous le nom & huile
paT' exprejjîon: telles font les huiler d’amandes, de
noix, de femences froides, dé graine de lin, de che-
nevis, &c. Foye1 Hu î l e . (b)
EXPULSER, terme de lÆed&dnt, chaffer avec eî^'
fo r t , pouffer horsies humeurs, &c.
Ex p u l s e r , terme de Pratique , chaffer avec une
forte de violence & par autorité de juftice : expulfer
fe dit fur-tout d’un propriétaire qui voulant occuper
fa maifon par lui - même, force un locataire à la lui
ceder avant l’expiration de fon bail. Foy, E v in c e r .
- L’ufage eft communément à Paris, qu’au cas d’ex*
pulfion par le propriétaire ou par l’acquéreur, on accorde
fix mois de joiiiffance gratuite au locataire ,
comme endédommagement desdépenfes qu’il a faites
pour s’arranger dans la maifon qu’on lui ôte , & de
celles qu’il doit faire enfuite pour s’arranger d an s
une autre ; ce qui fort fouvent n’eft pas fufceptible
de compénfation.
Quoi qu’il en foit, la faculté que la loi donne en
certains cas (Yexpulfer un locataire avant le terme
convenu, paroît abfolument contraire à l’effence de
tous les baux : car enfin la deftination, la nature ,
& la propriété d’un bail, c’eft d’affûrer de bonnes
foi au locataire l’occupation aôuelle d’une maifon
pour un tems limité, à la charge par lui de payer
certaine fomme toutes les années , mais avec égaie
obligation pour les contraûans, de tenir & d’obfer-
ver leurs conventions réciproques , l’un de faire
jouir, & l’autre de p ayer, &c.
Quand je m’engage à donner ma maifon pour fix
ans, je conferve il eft vrai la propriété de cette maifon,
mais je vends en effet la joiiiffance des fix années;
car le Ioiiage & la vente font à-peu-près de
même nature, fuivant le droit romain ; ils ne different
proprement que dans les termes ; & comme dit
Juftinien, ces deux contrats fuivent les mêmes règles
de droit : locatio & conduclio proxima ejl emptioni
& venditioni, iifdemquejuris regulis conjîftit. Lib. I I I .
injlit. tit. xxv. Or quand une chofe eft vendue & livrée
, on ne peut plus la revendiquer, l’acheteur eft
quitte en payant, & il n’y a plus à revenir : de-là dé?
pendent la tranquillité des contraftans & le bien gé?
néral du commerce entre les hommes ; fans cela nulle
décifion, nulle certitude dans les affaires.
La faculté d’occuper par foi-même accordée au
propriétaire malgré la promeffe de faire jouir, portée
dans le bail, eft donc vifiblement abufive & contraire
au bien de la fociété. C ’eft ce qu’on nomme le
privilège bourgeois ; c’eft, à proprement parler, le privilège
de donner une parole & de ne la pas tenir :
pratique odieufe, par laquelle on accoutume les
hommes à la fraude & à fe jouet des ftipulations &
des termes. Outre que par-là on fait pancher la balance
en faveur d’une partie au defavantage de l’autre
; puifque tandis qu’on accorde au propriétaire la
faculté de reprendre fa maifon, on refufe au locataire
la liberté de réfilier fon bail.
Au furplus fi cette prérogative eft injufte, elle eft