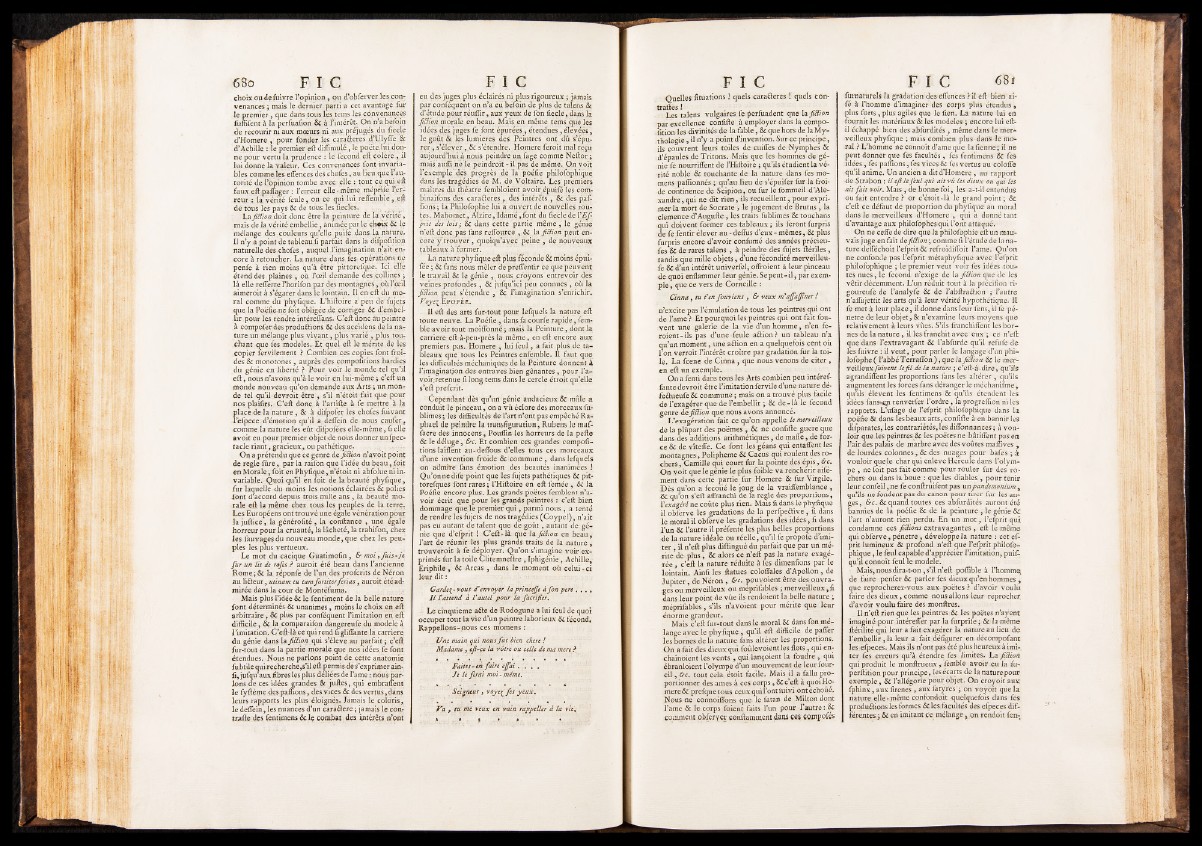
choix ou de fuivre l’opinion, qu d’obferver les conr
venances ; mais le dernier parti a cet avantage lur
le premier , que dans tous les teins les convenances
fuffifent à la perfuafion 8c à .l’intérêt. On n’a befoin
de recourir ni aux moeurs, ni aux préjuges du fiecle
d’Homere , pour fonder, les caçaûeres ,d’Ulyffe.,8ç
d’Achille : le premier eft diflimulé, le poëte.lui don-
ne pour vertu la prudence : îe^feçqnd eft ç io lè ç e il
lui donne la valeur. Ces convenances font invariables
comme les effences des chofes, au lieu que l'autorité
de l’opinion tombe avec elle : tout ce .qui eû
faux eft paffager : l’erreur elle L même, méprife l’erreur
: la vérité feule,.ou ce qui lui reffembie, eft
de tous les pays 8c de tdus les fiecles_.; f
La fiction doit donc être la peinture de la' v érité,
mais de la vérité embellie, animée par le choix 8c le
mélange des couleurs qu’elle puife dans la nature.
Il n’y a point de tableau fi parfait dans la difpofition
naturelle des chofes , auquel ,fimagination.n’ait encore
à retoucher. La nature dans les opérations ,nç
penfe à rien moins qu’à être pittorefque. Ici elle
étend des plaines , où l’oeil demaxide des collines ;
là elle refferre l’horifon par des montagnes , ou l’oeil
aimeroit à s’égarer dans le lointain. II. en eft du moral
comme du phyfique. L’hifioire a1 peu de‘ fujçts
que la Poèfiene foit obligée ,de, corriger 8c d’embellir
pour les rendre intéreflans. C’eft donc au peintre
à çompofer des productions 8c des accidens de la nature
un mélange plus v ivant, plus varie , plus tou-
chant que fes modèles. Et quel eft le mérité de les
Copier lervilement ? Combien ces copies font froides
& monotones, auprès des,,comportions hardies
du génie en liberté ? Pour voir le monde tel qu’il
e ft , nous n’avons qu’à le voir en lui-même ; c’eft un
monde nouveau qu’on demande aux Arts.; immonde
tel qu’il'devroit être* s’il rnétoit fait que pour
nos plaifirs. C ’ell donc à l’ artiftc à fe mettre à la
place de la nature, & à difppfer les chofes fuivant
l ’efpece d’émotion qu’il a, deffein de nous caufer,
comme la nature les eût difpofées elle-même, fi elle
«voit eu pour premier objet de nous donner unfpec-
tacle riant, gracieux,, ou pathétique.
On a prétendu que ce genre de fiction n’ayoit point
de réglé fûre, par la raifon que l’idée du beau, foit
en Morale, foit en Phyfique, n’étoit ni abfolue ni in,
variable. Quoi qu’il en foit de la beauté phyfique,
fur laquelle du moins les notions éclairées & polies
font d’accord depuis trois mille,ans , la beaute morale
eft la même chez tous les peuples de la terre.
Les Européens ont trouvé une égale vénération pour
la jufticë, ‘la générofité , la confiance , une égalé
horreur pour, la cruauté, la lâcheté, la trahifon, chez
les fauvagesdu nouveau monde , que chez les peuples
les plus vertueux.
Le mot du cacique Guatimofin, & moi, fuis-je
fur un lit de rofes ? auroit été beau dans l’ancienne
Rome; & la réponfe de l’un des proferits de Néron
au liûeur, utinarn tu tam fortiterferias, auroit été admirée
dans la cour de Montéfuma,
Mais plus l’idée 8c le fentiment de la belle nature
font déterminés 8c unanimes, moins le choix en,eft
arbitraire, & plus par conféquent l’imitation en eft
difficile, 8c la comparaifon dangereufe du modèle à
l ’imitation. C ’eft-là ce qui rend fi griffante la carrière
du génie dans la fiction qui s’élève au parfait ; c’eft
fur-tout dans la partie morale que nos idées, fe font
étendues. Nous ne parions point de cette anatomie,
fubtile qui recherche,s’il eft permis de s’exprimer ain-
fi, jufqu’aux fibres les plus déliées de l’ame : nous parlons
de ces idées grandes 8ç juftes, qui embraffent
le fyftème des pâmons, des vices 8c des vertus, dans
leurs rapports les plus éloignés,, Jamais ie coloris,
le deffein, les nuances d’un caraâere ; jamais le eon?
trafte des fentimens 8c le combat des intérêts n’ont
eu des juges, plus éclairés, ni. plus; rigoureux ; jamais
par confequent on n’a eu befoin de phis de talens &
d’étude,pour réuflir, aux yeux de fon fiecle , dans la
fiction morale en beau. Mais en même tems que les
idées des juges fe font épurées, étendues, élevées,
le gofit & les lumières des Peintres ont. dû s’épurer
» s’ëféyer ,’ 8c s’étendre. Homere feroit mal reçu
aujourd’hui.à nous peindre un, fage comme Neftor, ;
mais aixrn ne le peindrait - il p.as de même,. On voit
l’exemple dés progrès de la poéfie philofophique
dans les tragédies de M. de Vqltairé. Les .premiers
maîtres du théâtre fembloiént avoir, épuifë les com:
binaifons des çara&eres , des intérêts , 8c des paf-
lions; la Philofophie lui a ouvert de nouvelles routes.
Mahomet , Alzirë, Idâmë, font du fiecle de \'Ef-
prit des lois; 8c dans cette partie même ,' le génie
n’eft donc, pas fans re.ftburce , ;8c la fiction peut encore
y’ trouver, quoiqu’ayec .peine , de noix veaux
tableaux à’former.
La nature phyfique eft plus féconde 8c moins épui-
fée ; 8c faiis nous mêler déprëflentir ce que peuvent
le trayail 8c le génie ,- nous, .croyons entrevoir des
veines profondes , 8c jufqu’ici peu connues , où la
fiction, peut s’étendre , 8c l’imagination s’enrichir.
Voyez- E p o p é e .
Il eft des arts fur-tout pour lefquels la nature eft
toute neuve. La Poéfie;, dans faoourfe rapide, fem-
ble avoir.tout moiffonné ; mais la Peinture, dont la
carrière eft'à-peu-près la même, en eft encore aux
premiers pas. Homere , lui feu l, a fait plus.de tableaux
que tous les Peintres enfemble. Il faut que
les difficultés méchaniqites de la Peinture donnent à
l'imagination, des entraves bien gênantes , pour .l’a-
vpir.-retenqe fi long tems dans le cercle étroit qu’elle
s’eft preferit.
: Cependant dès qu’un génie audacieux & mâle a
conduit lé pinceau, on a-vû éclore des morceaux fu-
blimes; les difficultés de l’art n’ont pas empêché Raphaël
de peindre la transfiguration, Rubens le maf-
facrè des innocens , Poulïin les horreurs de la pefte
8c le déluge, &c. Et combien ces grandes compofi-
tioris lâiflent au-deffous d’elles tous ces morceaux
d’une invention froide 8c commune, dans lefquels
on admire fans émotion des beautés inanimées !
Qu’on ne dife point que les fujets pathétiques 8c pit-
torefques font rares ; l’Hiftoire en eft femée , 8c la
Poéfie encore plus. Les grands poètes femblent n’avoir
écrit que pour les grands peintres : c’eft bien
dommage que le premier q u i, parmi nous , a tenté
de rendre les fujets de nos tragédies (Coypel), n’ait
pas eu autant de talent que de g o û t, autant de génie
que d’efprit !..C ’eft-là que la fiction en beau,
l’art de réunir les plus grands traits de la nature ,
trouveïoit- à fe déployer. Qu’on s’imagine voir exprimés
fur la toile Clitemneftre , Iphigénie, Achille,
Eriphile, & Areas , dans le moment où celui - ci
leur dit :
Gardez-vous d'envoyer la princefjc à fon pere . . . .
I l T attend â l'autel pour la fàcrifier.
Le cinquième afte de Rodogune à lui feul de quoi
occuper tout la vie d’un peintre laborieux & fécond.
Rappelions-uous ces momëns :
Une main aui nous fu t bien chere !
Madame , ejl-ce là vôtre ou celle de ma mere ?,
Faites -en faire éffaï. . . . .
Je le ferai moi -même.
Seigneur, voyez fes yeux.
Va , tu me veux en vain rappeller à la vie;
v . v • a 8 * * » -,
Quelles fituations ! quels caraûeres ! quels con-
traftes !
Les talens vulgaires fe perfuadent que la fittion
par excellence confifte à employer dans la compo-
ütion les divinités de la fable, & que hors de la Mythologie
, il n’y a point d’invention. Sur ce principe,
ils couvrent leurs toiles de cuiffes de Nymphes &
d’épaules de Tritons. Mais que les hommes de génie
fe nourriffent de l’Hiftoire ; qu’ils étudient la vérité
noble & toixehante de la nature dans fes mo-
nxens paffionnés ; qu’au lieu de s’épuifer fur la froide
continence de Scipion, ou fur le fommeil d’Alexandre
, qui ne dit rien, ils recueillent ; pour exprimer
la mort de Socrate * lè jugement. de Brutus, la
clemence d’Augufte, les traits fublimes & tôuchans
qui doivent former ces tableaux ; ils feront furpris
de fe fentir élever.au - deflixs d’eux - mêmes, & plus
furpris encore d’avoir confumé des années précieu-
fes & de rares talens , à peindre des fujets ftériles,
tandis que mille objets, d’une fécondité merveilleii-
fe & d’un intérêt univerfel, offroient à leur pinceau
de quoi enflammer leur génie. Se peu t-il, par exemple
, que ce vers de Corneille :
Cinna, tu t'en fouviens , & veux m'affaffiner l
furnàturels la gradation des effences ? il eft bien ai-
fé à l’homme d’imaginer des corps plus étendus ÿ
plus ÛDrts , plus agiles que le fien. La nature lui eù
fournit les matériaux & les modèles ; encore lui eft-
il échappé bien des abfurdités , même dans le merveilleux
phyfique ; mais combien plus dariS-le moral
.? L ’homme ne connoît d’ame que la fienne; il ne
peut donner que fes facultés , fes fentimens & feè
idées, fes pâmons, fes vices &c fes vertus au coloffe
qu’il anime. Un ancien a dit d’Homere , au rapport
•de Strabon : i l eft U feul qui ait vît les dieux ou qui les
ait fait voir. Mais , de bonne foi, les a-t-il entendus
ou fait entendre ? or c’étoit-là le grand point ; 8c
c’eft ce défaut dé proportion dü phyfique au moral
dans, le merveilleux d’Homere , qixi a donné tant
d’avantage aux philofophes qui l’ont attaqué.
On ne ceffe de dire que la philofophie eft un mauvais
juge en fait dq fiction ; comme fi l’étude dé lana-
ture defféchoit l’efprit 8c refroidiffoit l’ame. Qu’ori
ne confonde pas l’efprit métaphyfique avec l’efprit
philofophique ; le premier veut voir fes idées -tourtes
nues, le fécond n’exige de la fiction qtxe de les
vêtir décemment. L’un réduit tout à la précifion ri-
goureufe de l’analyfe 8c de l’abftra&ion ; l’autre
n’affujettit les arts qu’à leur vérité hypothétique. Il
fe met à leur place, il donne dans leur fens, il le pénétré
de leur objet, 8t n’examine leurs moyens que
relativement à leurs vues. S’ils franchiffent les bornes
de la nature, il les franchit avec eux ; ce n’eft:
que dans l’extravagant 8c l’abfurde qu’il refufe de
les fuivre : il v eut, pour parler le langage d’un phi—
lofophe ( l’abbé T erraffon ) , que la fiction 8c le merveilleuxfuivent
le f il de la nature ; c’eft-â-dire, qix’ils
agrandirent les proportions fans les altérer, qu’ils
augmentent les forces fans déranger le méchanilrne ,
qu’ils élevent les fentimens & qu’ils étendent les
idées fans*^fi renverfer l’ordre, la progreffion ni les
rapports. L’ufage de l’efprit philofophique dans la
poéfie & dans lesbèaux arts, confifte à en bannir les
dilparates, les contrariétés, les diffonnances ; à vouloir
que les peintres 8c les poètes ne bâtiffent pas en
l’air des palais de marbre avec des voûtes mafîxves ,
de lourdes colonnes, 8c des nuages pour baies ; à
vouloir que le char qui enleve Hercule dans l’olympe
, ne foit pas fait comme pour rouler fur des rochers
ou dans la boue : que les diables , pour tenir
leur confeil, ne fe conftruifent pas un pandémonium ,
qu’ils ne fondent pas du canon pour tirer fur les anges
, &c. 8c quand toutes ces abfurdités auront été
bannies de la poéfie 8c de la peinture , le génie &C
l’art n’auront rien perdu. En un m o t, l’eîprit qui
condamne ces fictions extravagantes , eft le même
qui obferve, pénétré , développe la nature : cet ef-
prit lumineux & profond n’eft que l’efprit philofophique
, le feul capable d’apprécier l’imitation, puif-
qu’il connoît feul le modèle.
Mais, nous dira-t-on, s’il n’eft poflible à l’homme^
de faire penfer 8c parler fes dieux qu’en hommes ,
que reprocherez-vous aux poètes ? d’avoir voulu
faire des dieux, comme nous allons leur reprocher
d’àvôir voulu faire des monftres.
Il: n’eft rien que les peintres 8c les poètes n’ayent
imaginé pour intérefler par la furprife ; 8c la même
ftérilité qui leur a fait exagérer la nature au lieu de
l’embellir, la leur a ; fait défigurer • en décompofant
les:efpeces. Mais ils n’ont pas été plus heureux à imt-,
| ter fes .erreurs qu’à étendre fes limites. La fiction
\ qui produit le monftrueux ,• fèmble avoir ,eu la îfu-
perftition pour, principe, les écarts de la nature pour
exemple, 8c l’allégorie pour objet. On croyoit aux
fphinx, aux firenes , aux fatyrës ; on voyôit que la
nature elle- même confondoit quelquefois dans fes
produirions les formes 8c les.facultés des efpeces différentes
5 8c en imitant se- mélange, on rendoit fenn’excite
pas l’émulation de tous les peintres qui ont
de l’ame ? Et pourquoi les peintres qui ont fait fou-
vent une galerie de la vie d’un homme, n’en feraient
ils pas d’une feule airion? un tableau n’a
qu’un moment, une airion en a quelquefois cent où
l ’on verrait l’intérêt croître par gradation fur la toile.
La feene de Cinna, que nous venons de cite r,
en eft un exemple. . ; .
On a fenti dans tous les Arts combien peu xntéref-
fante devroit être l’imitation fervile d’une nature dé-
fe&ueufe 8c commune ; mais on a trouvé plus facile
de l’exagérer que de l’embellir ; 8c de - là le fécond
.genre de fiction que nous avons annoncé.
L ’exagération fait ce qu’on appelle le merveilleux
de la plûpart des poèmes , 8c ne confifte guère que
dans des additions arithmétiques, de ipaffe, de force
8c de vîtefle. Ce font les géans qui entaffent les
montagnes, Polipheme 8c Cacus qui roulent des rochers
, Camille qui court fur la pointe des éjpis ,&c.
On voit que le génie le plus foible va renchérir àifé-
ment dans cette partie fur Homere 8c fur Virgile.
-Dès qu’on a fecoiié le joug de la vraisemblance ,
8c qu’on s’eft affranchi de. la réglé des proportions,
l’exagéré ne coûte plus rien. Mais fx dans le phyfique
il obferve les gradations de la perfpeûiv.e, fi dans
lè moral il obferve les gradations des idées, fx dans
l’un 8c l’autre il préfente les plus belles proportions
de la nature idéale ou réelle, qu’il fe propofe d’imiter
, il n’eft plus diftingué du parfait que par un mérite
de plus, 8c alors ce n’eft pas la nature exagérée
, c’eft la nature réduite à fes dimenfions par le
lointain. Ainfi les ftatues coloffales d’Apollon, de
Jupiter, de Néron , &c. pouvoient être des ouvrages
ou merveilleux ou meprifables ; merveilleux, fi
dans leur point de vûe ils rendoient la belle nature ;
meprifables, s’ils n’avoient pour mérite que leur
énorme grandeur. . . . . ■ t
Mais c’eft fur-tout dans le moral 8c dans fon mélangé
avec le phyfique , qu’il eft difficile de pafler
les bornes de la nature fans altérer les proportions.
On a fait des dieux qui, foûlevoient les flots, qui en-
chaînoient les vents , qtii lançoient la foudre , qui
ébranloient l’olympe d’un mouvement de leur four-
cil , &c. tout cela étoit facile. Mais il a fallu proportionner
des âmes à ces; corps, 8c c’eft à quoi Homere
8c prefque tous ceux qui l’ont luivi ont échoüe.
Nous ne connoiffons que le fatan de Milton dont
Famé 8c le corps foient faits l’un pour l’autre: 8c
comment qbferyer conftanjment dans ces compofés