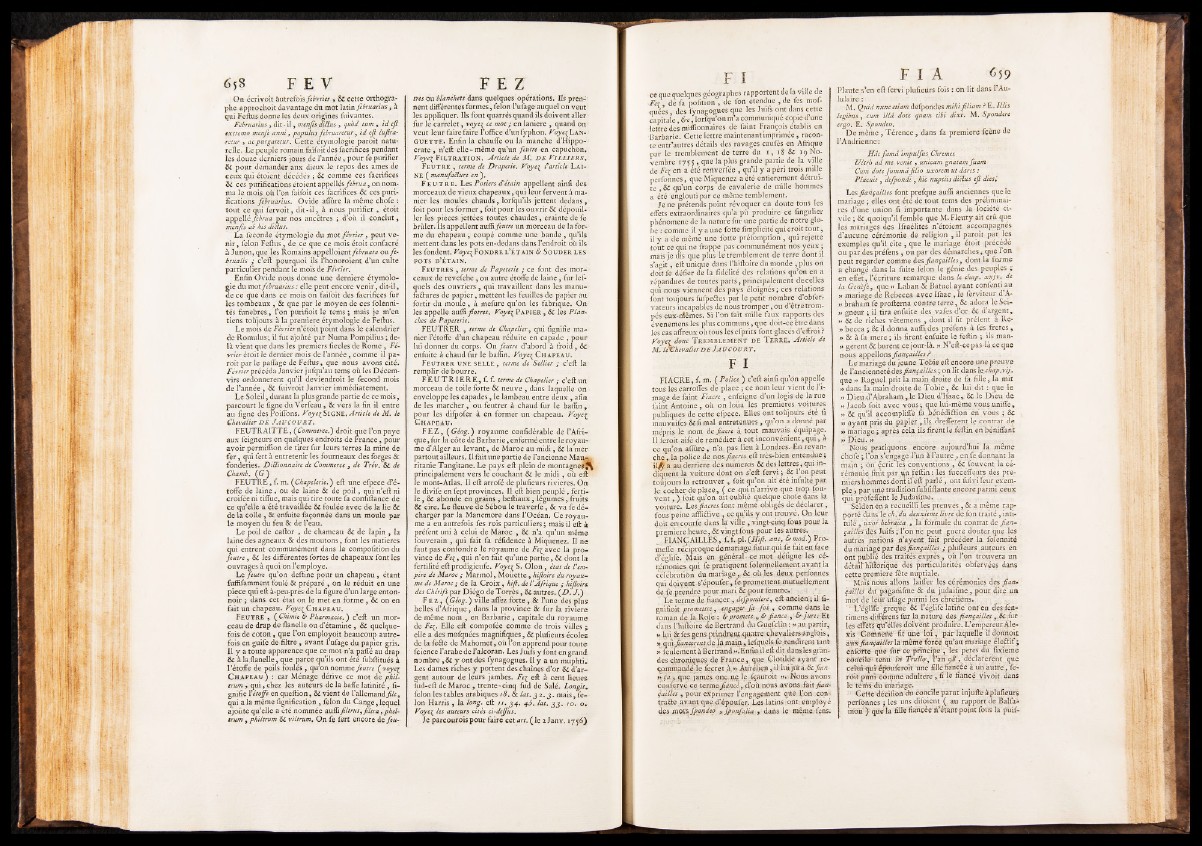
; On écrivoît Autrefois febvrier, & cette orthographe
approchoit davantage du mot latin februarius , à
qui Feftus; donne les deux origines fuivantes.
Februarius , dit - i l , menjis dictas > qubd tum , id ejl
txtremo mer je an ni, populus febnuiretur, id efl lufira-
■ retur, acpurgaretur, Cette étymologie paroît natu*
relie. Le peuple romain faifoit des facrifîces pendant
les douze, derniers jours de l’année, pour fe purifier
& pour demander aux dieux le repos des âmes de
ceux qui étoient décédés ; & comme ces facrifîces
& ces purifications étoient appellés februa, on nomma
le mois où l’on faifoit ces facrifîces & ces purifications
februarius. Ovide affûre la même chofe :
tout ce qui fervoit, d it- il, à nous purifier , étoit
appellé februa par nos ancêtres ; d’où il conclut,
menjis ab bis diclus.
La fécondé étymologie du mot février, peut ven
ir, félon Feflus, de ce que ce mois étoit confacré
à Junon,que les Romains appelloient februata ou fie-
brualis ; c’efl pourquoi ils l’honoroient d’un culte
particulier pendant le mois de Février.
Enfin Ovide nous donne une derniere étymologie
du taotfebraarius elle peut encore venir, dit-il,
de ce que dans ce mois on faifoit des facrifîces fur
les tombeaux , & que par le moyen de ces folenni-
tés funèbres, l’on purifioit le tems ; mais je m’en
tiens toujours à la première étymologie de Feflus.
Le mois de Février n’étoitpoint dans le calendrier
de Romulus; il fut ajoîtté par Numa Pompilius ; delà
vient que dans les premiers fiecles de Rome , Février
étoit le dernier mois de l ’année, comme il paroît
par le paffage de Feflus, que nous avons cité.
Février précéda Janvier jufqu’au tems où les Décemvirs
ordonnèrent qu’il deviendroit le fécond mois
de l’année , & fuivroit Janvier immédiatement.
Le Soleil, durant la plus grande partie de ce mois,
parcourt le ligne du Verfeau, & vers la fin il entre
au ligne des Poiffons. Voye^S i g n e . Article de M. le
Chevalier DÉ Ja u c o u r t .
FEUTRAITTE, (Commerce.) droit que l’on paye
aux feigneurs en quelques endroits de France, pour
avoir permiflion de tirer fur leurs terres la mine de
f e r , qui fert à entretenir les fourneaux des forges &
fonderies. Dictionnaire de Commerce , de Trév. & de
Chamb. {G )
FEUTRE, f. m. ( Ckapelerie.) efl une efpece d’étoffe
de laine, ou de laine & de p o il, qui n’efl ni
croiféeni tiffue, mais qui tire toute fa confiflance de
ce qu’elle a été travaillée & foulée avec de la lie &
de la c o lle , & enfuite façonnée dans un moule par
le moyen du feu & de l’eau.
Le poil de caflor , de chameau & de lapin , la
laine des agneaux & des moutons, font les matières
qui entrent communément dans la compofition du
feutre, & les différentes fortes de chapeaux font les
ouvrages à quoi on l’employe.
Le feutre qu’çn defline pour un chapeau, étant
fuffifamment foulé & préparé , on le réduit en une
piece qui efl à-peu-près de la figure d’un large entonnoir
; dans cet état on le met en forme, & on en
fait un chapeau. Voyei C h a p e a u .
F e u t r e , {Chimie & Pharmacie.') c’efl un .morceau
de drap de flanelle ou d’étamine , & quelquefois
de coton, que l’on employoit beaucoup autrefois
en guife de filtre , avant l’ufage du papier gris.
Il y a toute apparence que ce mot n’a paffé au drap
& à la,flanelle, que parce qu’ils ont été fubflitués à
l ’étoffe de poils Foulés , qu’on nomme feutre { voye^
C h a p e a u ) : car Ménage dérive ce mot de phil-
trum, qui, chez les auteurs de la baffe latinité, lignifie
l’étoffe en queflion, & vient de l’allemandjf/^,
qui a la même fignification , félon du Cangë, lequel
ajoute qu’elle a été nommée aufîifiltrus^ filtra, phel-
trum, philtrum & viltrum. On fe fert encore de feutrès
du bïanchets dans quelques opérations. Ils prennent
différentes formes, félon Fufage auquel on veut
les appliquer. Ils font quarrés quand ils doivent aller
fur le carrelet, voy eç ce mot ; en laniere , quand on
veut leur faire faire l’office d’unfyphon. Voye^ Lang
u e t t e . Enfin la chauffe ou la manche d’Hippo- ‘
crate , n’elt elle - même qu’un feutre en capuchon.
V o y e \ Fil t r a t io n . A r tic le de M . d e V i l l i e r s .
FEUTRE , terme de Draperie. Voye[ l'article L aine
( manufacture en ).
F e u t r e . Les Potiers d'étain appellent ainfi des
morceaux de vieux chapeaux, qui leur fervent à manier
les moules chauds, lorfqu’ils jettent dedans,
foit pour les former, foit pour les ouvrir & dépouiller
les pièces jettées toutes chaudes ', crainte de fe
brûler. Iis appellent aufîi feutre un morceau de la forme
du chapeau, coupé comme une bande, qu’ils
mettent dans les pots en-dedans dans l’endroit où ils
les fondent. Voye^Fondre l’é t a in & Souder les
pot s d’é t ain .
Feutres , terme de Papeterie ; ce font des morceaux
de rèvefche, ou autre étoffe de laine, fur lef-
quels des ouvriers , qui travaillent dans les manu-
raélures de papier, mettent les feuilles de papier au
fortir du moule , à mefure qu’on les fabrique. On
les appelle aufîi fiotres. Voyeç Papier , & les Planches
de Papeterie.
FEUTRER , terme de Chapelier, qui lignifie manier
l’étoffe d’un chapeau réduite en capade , pour
lui donner du corps. On feutre d’abord à froid, ÔC ■
enfuite à chaud fur le bafîin. Voye%_ C hapeau.
F e u t r e r u n e s e l l e , terme de Sellier ; c’efl la
remplir de bourre.
F EU T R IE R E , f. f. terme de Chapelier • c’efl un
morceau de toile forte & neuve , dans laquelle on ■
enveloppe les capades, le lambeau entre deux , afin
de les marcher, ou feutrer à chaud fur le bafîin ,
pour les difpofer à en former un chapeau. Voye^
C h a p e au .
F E Z , ( Géog. ) royaume confidérable de l’Afrique
, fur la côte de Barbarie, enfermé entre le royaume
d’Alger au levant, de Maroc au m idi, & la mer
partout ailleurs. Il fait une partie de l’ancienne Maum-,
ritanie Tangitane. Le pays efl plein de montagnes
principalement vers le couchant & le midi , où efl
le mont-Atlas. Il efl arrofé de plufieurs rivières. On
le divife en fept provinces. Il efl bien peuplé, fertile
, & abonde en grains ; befliaux, légumes, fruits
& cire. Le fleuve de Sébou le traverfe, & va fe décharger
par la Mancmore dans l’Océan. Ce royaume
a eu autrefois fes rois particuliers ; mais il efl à
préfent uni à celui de Maroc , & n’a qu’un même
Fouverain , qui fait fa réfidence à Miquenez. Il ne
faut pas confondre le royaume de Fe^ avec la province
de Ft{ , qui n’en fait qu’une partie, & dont la
fertilité efl prodigieufe. Voye^ S. O lo n , état de l'empire
de Maroc ; Marmol, Mouette, hifioire du royaume
de Maroc ; de la C ro ix , hifi. de l'Afrique ; hifioire.
des Chérifs par Diégo de Torrès, & autres. (D . J.)
F e z , {Géog. ) ville allez forte, & l’une des plus
belles d’Afrique, dans la province & fur la riviere
de même nom , en Barbarie, capitale du royaume
de Fe[. Elle efl compofée comme de trois villes ;
elle a des mofquées magnifiques, & plufieurs écoles
de la fe&e de Mahomet, où l’on apprend pour toute
fcience l’arabe de l’alcoran. Les Juifsy font en grand
nombre , & y ont des fynagogues. Il y a un muphti.
Les dames riches y portent des chaînes d’or & d’argent
autour de leurs jambes. Fe{ efl à cent lieues
liid-efl de Maroc , trente-cinq fud de Salé. Longit.
félon les tables arabiques 18. & lat. 3 2 .3 . mais, félon
Harris , la long, efl //. 34. 4S. lat. 3 3 . 10. o.
Voye[ les auteurs cités ci-deffus.
Je parcourois pour faire çQtart. ( le 2 Janv. 1756)
ce que quelques géographes rapportent de la v ille de
■ Fer, de fa pofition , de fon étendue , de fes mofquées
, des fynagogues que les Juifs ont dans cette
capitale, &c, lorfqu’on m’a communiqué copie d’une
lettre des millionnaires de faint François établis en
Barbarie. Cette lettre maintenant imprimée, raconte
entr’autres détails des ravages caufés en Afrique
par le tremblement de terre du 1 , 18 & 19 Novembre
175 ^, que la plus grande partie de la ville
de Fe{ en a été renverfée , qu’il y a péri trois mille
perfonnes, que Miquenez a été entièrement détruite
, & qu’un corps de cavalerie de mille hommes
a été englouti par ce même temblement.
Je ne prétends point révoquer en doute tous les
effets extraordinaires qu’a pu produire ce fingulier
phénomène de la nature fur une partie de notre globe
: comme il y aune fotte fimplicité qui croit tout,
il y a de même une fotte préfomption , qui rejette
tout ce qui ne frappe pas communément nos yeux ;
mais je dis que plus le tremblement de terre dont il
s’a g it , efl unique dans l’hifloire du monde , plus on
doit fe défier de la fidélité des relations qu’on en a
répandues de toutes parts, principalement de celles
qui nous viennent dés pays éloignés ; ces relations
font toujours fufpe&es par le petit nombre d’obfeiv
vateurs incapables de nous tromper, ou d’être trompés
eux-rffêmes. Si l’on fait mille faux rapports des
évenemens les plus communs, que doit-ce être dans
lés cas affreux où tous les efprits font glacés d’effroi ?
Foyer donc TREMBLEMENT DE TERRE. Article de
M. IFChtv alier de J AV cou RT.
F I
FIACRE, f. m. ( Police J c’efl: ainfi qu’ôn appelle
tous les cârroffes de place ; ce nom leur vient de l’image
de faint Fiacre , enfeigne d’un logis de la rue
faint Antoine, où on loua les premières voitures
publiques de cette efpece. Elles ont toujours été fi
mauvaifes & fi mal entretenues, qu’on a donné par
mépris l,e, nom de fiacre à tout mauvais équipage.
IL feroit aifé de remédier à cet inconvénient , qui, à
ce qu’on affûre, n’a pas lieu à Londres. En revanche,,
la police de nosfiacresçPitres-bien entendue;
a au derrière des numéros & des lettres^ qui. indiqu
e r la voiture dont on s’efl fervi ; & l’on peut
toujours la retrouver , foit qu’on ait été infulté par,
le: cocher;de place, ( ce qui n’arrive que trop fou-
ÿ e n t ,,) foit qu’on ait oublié .quelque chofe dans la
voiture. Les fiacres font même obligés de déclarer,
fous 'peine affliûive,, ce qu’ils y ont trouvé. On leur
doit eiuçpurfe dans la v ille , vingt-cinq fous pouf la
première heure, & vingt fous pour les autres.
_ FIANÇAILLES, f.!f..pl.{Hifi. âne, &mod.) Pro-,
meffe réciproque de mariage futur, qui fe faitedface
d’ èglife. 'Mais en, général-ce mot défigne* les cérémonies
qui fe pratiquent folehjiellement avant la
celehratiôn du mariage pù les deux, perfonnes
qui doivent s’époufer-, fe,promettent.mutueilement
de fe,prendre pour-mari &;pour femme. , 'i / _
Le terme de fiançer , .defponderey efl ancien:; il- fi-
gnifioit promettre, engager fa fofi ,• c'omme dans., le
romande la Rofe ; & promets,? & fiance->'&jurer Et
dans rhïflôire de Bertrand du Guefclfo au partir,:
»foi Sçfes.gens pdrufrei^quatre cjievaliersahghns,
>> a u i^ ^ f preafdq ïà mafo , lefquelsfo rendirent tant
» feuîement àBertrand ».'EnfiniLeû dit dâos.lesgràm-
des çhrçfoques; de Fpajnce,, que Cfotilde ayant se-
qpmmandé;ie feprçt à,>>,,fofréUen ^iMuftj.iürâ<&fian
$.que j aptes, one.^, lefoauroit m-Nous„avons
cpnfervé ce term&fiançé/, d’pù.nous .avons foit _/&*«-
çailles , pour exprimer l’engagpment que foÜ .con^
traéle.avant que, d’époufer,. Les,latins ont. employé
des .mots, fpvndeo »fiffionfalia , dans le mê/nefons.
Plaute s’en efl fervi plufieiirs fois : on lit dans l’Au-
lulaire :
M. Quid nunc etiam defpondes mihi filiam ? E. lllis
le gibus, cum illd dote quam tibi dixi. M. Spondcre
ergo. E. Spondeo.
De même , Térence, dans fa première fcène de
l’Andrienne:
Hâcfamâ impulfus Çhremts
Ultrb ad me, venit , unicam gnatam fuam
Cum dote fummâfilio uxorem ut dares :
Plàcuit, defpondi 9 hic nuptiis dictus efl diesi
Les fiançailles font prefque aufîi anciennes que le
mariage; elles ont été de tout tems des préliminaires
d’une union fi importante dans la foçiété civile
; & quoiqu’il femble que M. Fleury ait crû que
les mariages des Ifraélitês n’étoierrt accompagnes
d’aucune cérémonie de religion , il paroît par les
exemples qu’il cite , que le mariage étoit précédé
ou par des préfens , ou par des démarches , que l’on
peut regarder comme des fiançailles, dont la forme
a changé dans la fuite félon le génie des peuples ;
en effet, l’écriture remarque dans le chap. xxjv. de
la Genèfe, que « Laban & Batuel ayant confenti au
>> mariage de Rebeeca avec Ifaac , lé ferviteur.d’A-
» braham fe proflerna côntre terre, & adora le Sei-
» gneur ; il tira enfuite des.vafes d’or & d’argent,
» 6c de riches vêtemens , dont il fit préfent à Re-
» becca ; ÔC il donna aufli, des préfens à fes freres ,
» & à fa mere ; ils firent enfuite le feflin ; ils man-
>> gerent & burent ce jour-là. » N’efl-ce pas-làceque
nous appelions fiançailles?.
Le mariage du jeune Tobie efl encore une preuve
de l’anciennetédes fiançailles,; on lit dans leckap.vij.
que » Raguel prit la main droite dé fa fille > la mit
» dans; la main droite, dé T o b ie , & lui. dit : que le
» Dieu .d’Abraharu , fe Dieu d-’Ifaac , ôt le Dieu de
»Jacob foit avec y o u s ; que lui-même, vous .unifie ,
» & qu’il accompliffe. fa bénédi&ion en vous ; ÔC
» ayant pris du papier , ils drefferent le contrat de
» mariage; après cefe.ils firentle féfïin en béniffant
>> Dieu. ï*
Nous pratiquons encore aujourd’hui la même
chofe ; l’on s’engage .l’un à l’autre , en fe donnant la
iîiafo ; on écritTe§ conventions;, & fouvent la cérémonie
finit par un ffifon : les fuçcéffeùrs des pre-
niïérshommes dont il efl p a r lé o n t fùivi feur exemple
) par une tradition fubfiflante encore parmi ceux
r qui prpfeffeht le Judaïfme. .
Sëldên én a recueilli les preuves., & a même rap-
; porté dânsTê ch.'du deuxieme livre de, fon traité, intitulé'
• 'ùx'or.^ébhûka.,\îa"fo‘rmule du contrat de fian-
i çailtes'éÂs Juifs ; l’on ne peut guère douter que les
! autres nations n’ayent . fait précéder la folennité
: du ma'riâgé par des fiançailles ; plufieurs auteurs en
. ont publié dès trâités.éxprés , où l’on trouvera un
1 détail"hiïldriqué des particularités obleryées dans
: cette.premiere fête nuptiale.
Màis nous allons laiffer les cérémonies des fiarù
: tcàlltl dirpàgahifme & du judaifine, pour dire'un
i mot de leur üfàge parmi les chrétiêns.
' 1 ÎL^églîfe ' greque èt réglîfélatifte'ont'eu des-fen-
; timens-différens fur la nature, des fiançailles ?, & iur
! les effets1 qii’èlles doivent produire. L’empereur Àle-
! xis Ccftnrièùë fit une loi , r p a r laquelle il dôhnoit
i àti*fiançaillts\iL-TûBsit forcé qu’au mariage elèftif ;
; èÀfortd qiie fur1 ce p r in c ip e 'lès pereS du fixieme
1 Côn'éîfo' tenu ïrt Truticr^ l’an 98, déclarèrent que
! cèM-qiir e^ouferoit une fille fiancée à un autre, fe-
! rôit puni coriime adultéré , fi le fîancé vivôit dans
, le té dù mariage.
Cette décifion du concile parut injuffe àplufieurs
i perfonnes ; les uns difoient (. au rapport de Balfamon
) que la fiüë fiancée h’étantpoint foiis la puif