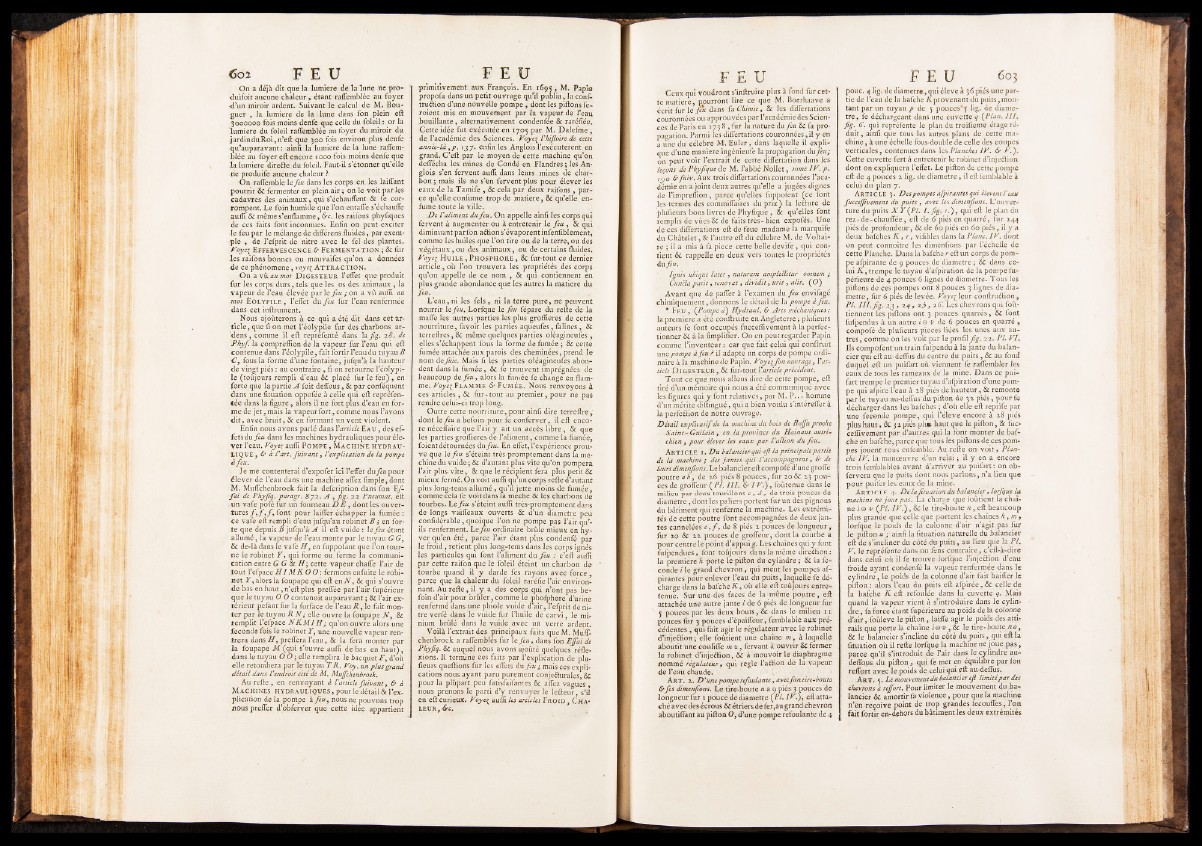
On a déjà dit que la lumière de la lune ne pro-
duifoit aucune chaleur, étant raflemblée au foyer
•d’un miroir ardent. Suivant le calcul de M. Bou-
^uer , la lumière de la • lune dans fon plein eft
3000000 fois moins denfe que celle du foleil : or la
lumière du foleil raffemblée au foyer du miroir du
jardin du Roi, n’eft que 300 fois environ plus denfe
qu’auparavant: ainfi la lumière de la lune raffemblée
au foyer eft encore 1000 fois moins denfe que
la lumière direfte du foleil. Faut-il s’étonner qu’elle
ne produife aucune chaleur ?
On raffemble lé feu dans les corps en les laiflant
pourrir & fermenter en plein air ; on le voit par les
cadavres des animaux, qui s’échauffent & fe corrompent.
Le foin humide que l’on entaffe s’échauffe
aufli & même s’enflamme, &c. les raifons phyfiques
de ces faits font inconnues. Enfin on peut exciter
le feu par le mélange de différens fluides, par exemple
, de l’efprit de nitre avec le fel des plantes.
Voye[ E f f e r v e s c e n c e & F e r m e n t a t i o n ; & fur
les raifons bonnes ou mauvaifes qu’on a données
de ce phénomène, voye^ A t t r a c t i o n .
On a vu au mot D i g e s t e u r l’ effet que produit
fur les corps durs, tels que les os des animaux , la
.vapeur de l’eau élevée par le feu ; on a vu aufli au
-mot É o l y p i l e , l’effet du feu fur l’eau renfermée
dans cet infiniment.
Nous ajouterons à ce qui a été dit dans cet article
, que fi on met l’éolypile fur des charbons ar-
dens, comme il eft repréfenté dans la fig. 28. de
Phyfi la compreflion de la vapeur fur l’eau qui eft
contenue dans l’éolypile, fait fortir l’eau du tuyau B
'Cf fous la forme d’une fontaine, jufqu’à la hauteur
de vingt piés : au contraire , fi on retourne l’éolypile
(toûjours rempli d’eau & placé fur le feu) , en
forte que la partie A foit deflous, & par conféquent
dans une fituation oppofée à celle qui eft repréfen-
tée dans la figure, alors il ne fort plus d’eau en forme
de jet, mais la vapeur fort, comme nous l’avons
d i t , avec bruit, & en formant un vent violent.
Enfin nous avons parlé dans l'article E a u , des effets
du feu dans les machines hydrauliques pour élev
er l’eau. Voyez aufli P o m p e , M a c h i n e h y d r a u l
i q u e , & à L'art, fuivant, Vexplication de la pompe
à feu.
î e me contenterai d’expofer ici l’effet du feu pour
élever de l’eau dans une machine affez fimple f dont
M. Muflchenbroek fait la defcription dans fon Ef-
fa i de Phyjîq. paragr, 8y2. A , fig. 22 Pneumat. eft
.un vafe pofé fur un fourneau D E , dont les ouvertures
ƒ , ƒ , ƒ , font pour laiffer échapper la fumée :
c e vafe eft rempli d’eau jufqu’au robinet B ; en forte
que depuis B jufqu’à A il eft vuide : le feu étant
•allumé, la vapeur de l’eau monte par le tuyau G G,
& de-là dans le vafe H , en fuppofant que l’on tourne
le robinet Y , qui forme ou ferme la communication
entre G G & H ; cette vapeur chaffe l’air de
tout l’efpace H IM K O O : fermons enfuite le robinet
Y , alors la foupape qui eft enA^, & qui s’ouvre
de bas en haut, n’eft plus preffée par l’air fupérieur
que le tuyau O O contenoit auparavant ; & l’air extérieur
pefant fur la furface de l’eau R , le fait monter
par le tuyau R N ; elle ouvre la foupape N f &
remplit l’efpace N K M IH ; qu’on ouvre alors une
fécondé fois le robinet Y, une nouvelle vapeur rentrera
dans Hf preffera l’eau, & la fera monter par
la foupape M (qui s’ouvre aufli de bas en haut),
dans le tuyau O O ; elle remplira le bacquet F , d’où
elle retombera par le tuyau T R. Voy. un plus grand
détail dans l'endroit cité de M. Muflchenbroek.
Au refte , en renvoyant à Carticle fuivant, & à
M a c h i n e s h y d r a u l i q u e s , pour le détail & l ’explication
de la pompe à feu, nous ne pouvons trop
nous preffer d’obferver que cette idee appartient
primitivement aux François. En 16 95 , M. Papîa
propofa dans un petit ouvrage qu’il publia, la conf-
truftion d’une nouvelle pompe , dont les pillons feraient
mis en mouvement par la vapeur de l’eau
bouillante, alternativement condenfée & raréfiée.
Cette idée fut exécutée en 1705 par M. Dalefme ,
de l’académie des Sciences. Voye^ Vhifioire de cette
année-là fp . 13J. enfin les Anglois l’executerent en
grand, C ’eft par le moyen de cette machine qu’on
deffécha les mines de Condé en Flandres ; les Anglois
s’en fervent aufli dans leurs mines de charbon
; mais ils ne s’en fervent plus pour élever les
eaux de la Tamife , & cela par deux raifons , parce
qu’elle confume trop de matière, & qu’elle enfume
toute la ville.
De l'aliment du feu. On appelle ainfi les corps qui
fervent à augmenter ou à entretenir le feu , & qui
diminuant par fon aâion s’évaporent infenfiblement,
comme les huiles que l’on tire ou de la terre, ou des
végétaux, ou des animaux, ou de certains fluides.
Voyei Huile , Phosphore , & fur-tout ce dernier
article, où l’on trouvera les propriétés des corps
qu’on appelle de ce nom , & qui contiennent en
plus grande abondance que les autres la matière du
f eu‘ m - ,
L’eau, ni les fels , ni la terre pure, ne peuvent
nourrir le feu. Lorfque le feu fépare du refte de la
maffe les autres parties les plus groflieres de cette
nourriture, favoir les parties aqueufes, falines, &
terreftres, & même quelques parties oléagineufes ,
elles s’échappent fous la forme de fumée ; & cette
fumée attachée aux parois des cheminées, prend le
nom de fuie. Mais fi les parties oléagineufes abondent
dans la fumée , & le trouvent imprégnées de
beaucoup de feu, alors la fumée fe change en flamme.
Voyei Flamme & Fumée. Nous renvoyons à
ces articles , & fur - tout au premier, pour ne pas
rendre celui-ci trop long.
Outre cette nourriture, pour ainfi dire terreftre,'
dont le feu a befoin pour fe conferver, il eft encore
néceffaire que l’air y ait un accès libre, & que
les parties groflieres de l’aliment,,comme la fumée,
foient détournées du feu. En effet, l’expérience prouve
que le feu s’éteint très-promptement dans la machine
du vuide ; & d’autant plus vite qu’on pompera
l’air plus-vite, & que le récipient fera plus petit &
mieux fermé. On voit aufli qu’un corps refte d’autant
plus long-tems allumé, qu’il jette moins de fumée ,
comme cela fe voit dans la meche & les charbons de
tourbes. Le feu s’éteint aufli très-promptement dans
de longs vaiffeaux ouverts & d’un diamètre peu
confidérable, quoique l’on ne pompe pas l’air qu’ils
renferment. Le feu ordinaire brûle mieux en hy-
ver qu’en é té, parce l’air étant plus condenfé par
le froid, retient plus long-tems dans les corps ignés
les particules qui font l’aliment du feu : c’eft aufli
par cette raifon que le foleil éteint un charbon de
tourbe quand il y darde fes rayons avec force,
parce que la chaleur du foleil raréfie l’air environnant.
Au refte, il y a des corps qui n’ont pas befoin
d’air pour brûler, comme le phofphore d’urine
renfermé dans une phiole vuide d’air, l’efprit de nitre
verfé dans le vuide fur l’huile de ca rvi, le minium
brûlé dans le vuide avec un verre ardent.
Voilà l’extrait des principaux faits que M. Muff-
chenbroek a raffemblés fur le feu, dans fon Effai de
Phyfiq. & auquel nous avons ajoûté quelques réflexions.
Il termine ces faits par l’explication de plu-
fieurs queftions fur les effets du feu; mais ces explications
nous ayant paru purement conjeélurales,
pour la plupart peu fatisfaifantes & affez vagues ,
nçus prenons le parti d’y renvoyer le leâeur, s’il
en eft curieux. Voye^ aufli les articles Fr o id , CHALEUR,
& c .
Ceux qui voudront s’inftruire plus à fond fur cette
matière, pourront lire ce que M. Boerhaave a
écrit fur le feu dans fa Chimie, & les differtations
couronnées ou approuvées par l’académie des Sciences
de Paris en 1738 , fur la nature du feu & fa propagation.
Parmi les differtations couronnées., il y en
a une du célébré M. Euler, dans laquelle il explique
d’une maniéré ingénieufe la propagation du feu;
on peut voir l’extrait de cette differtation dans les
leçons de Phyfique de M. l’abbé Nollet, tome IV. p.
100 & fuiv. Aux trois differtations couronnées l’académie
en a joint deux autres qu’elle a jugées dignes
de l’impreflion, parce qu’elles fuppofent (ce font
les termes des commiffaires du prix ) la lecture de
plufieurs bons livres de Phyfique , & qu’elles font
remplis de vûes & de faits très-bien expofés. Une
de ces differtations eft de feue madame la marquife
du Châtelet, & l’autre eft du célébré M. de Voltaire
; il a mis à fa piece cette belle devife , qui contient
Sc rappelle en deux vers toutes le propriétés
du feu,
Ignis ubique latet, naturam àmpleclitur omnerh ;
Cunclaparit, rénovât, dividitjurit, alit. (O)
Avant que de paffer à l’examen du feu envifagé
chimiquement, donnons le détail de la pompe à feu.
* Feu , (Pompe à) Hydraul. & Arts méchaniques:
la première a été conftruite en Angleterre ; plufieurs
auteurs fe font occupés fucceflivement à la perfectionner
& à la Amplifier. On en peut regarder Papin
comme l’inventeur : car que fait celui qui conftruit
une pompe à feu ? il adapte un corps de pompe ordinaire
à la machine de Papin. Voye^fon ouvrage, Yar-
ticle DIGESTEUR, & fur-tout 1*article précédent.
Tout ce que nous allons dire de cette pompe, eft
tiré d’un mémoire qui nous a été. communiqué avec
les figures qui y font relatives, par M. P .. . homme
d’un mérite diftingué, qui a bien voulu s’intéreffer à
la perfection de notre ouvrage.
Détail explicatif de la machine du bois de Boflu proche
Sdint - Guilain , en la province du Hainaut autrichien
y pour éleyer les eaux par l'action du feu.
A r t i CLE 1. Du balancier qui ejl la principale partie
de la machine ; des jantes qui 1'accompagnent, & de
leursdimenjions. Le balancier eft compofé d’une groffe
poutre ab y de z6 piés 8 pouces, fur z o & 13 pouces
de groffeur (P/. I I I . & I V .'}, foûtenue dans le
milieu par deux tourillons c , d , de trois pouces de
diamètre ,-dont les paliers portent fur un des pignons
du bâtiment qiii renferme la machine. Les extrémités
de cette poutre font accompagnées de deux jantes
cannelées e, f , de 8 piés 2 pouces de longueur,
fur 20 &• 22 pouces de groffeur, dont la courbe a
pour centre le point d’appui g-. Les chaînes qui y font
fufpendues, font toûjours dans la même direction :
la première h porte le pifton du cylindre ; & la fécondé
i le grand chevron, qui meut les pompes af-
pirantes pour enlever l’eau du puits, laquelle fè décharge
dans la bafehe K , où elle eft toûjours entretienne.
Sur une*des faces de la'même poutre, eft
attachée une autre jante / de 6 piés de longueur fur
5 pouces par les deux bouts, & dans le milieu 1 r
pouces fur 3 pouces d’épaiffeur, femblable aux précédentes
, qui fait agir le régulateur avec le robinet
d’injeCtion ; elle foutient une chaîne m, à laquelle
aboutit une coulifle m 2 , fervant à‘ ouvrir & fermer
le robinet d’injeCtion, $£ à mouvoir le diaphragme
nommé régulateur, qui réglé l’a&ion de la vapeur
de l’eau chaude.
A r t . 2. D'une pompe refoulante, avecfontire-boute
6 fes dime/flîons. Le tire-boute n a 9 piés 3 pouces de
longueur (ur i pouce de diamètre (F/. IV .), eft attaché
avec des écrous & étriers de fer,au grand chevron
aboutiffant au pifton O, d’une pompe refoulante de 4
potic. 4 lig. de diamètre, qui éleve à 36 piés une partie
de l’eau de la bafehe K provenant dû puits, montant
par un tuyau p de. 5 pouces*5 lig. de diamètre,
fe déchargeant dans une cuvette q {Plan. I II.
fig. G. qui repréfente le plan du troifieme étage ré*
duit, ainfi que tous les autres plans de cette machine
, à une échelle fous-double de celle des coupes
verticales, contenues dans lés Planches IV. & V.}.
Cette cuvette fert à entretenir le robinet d’injeélion
dont on expliquera l’effet. Le pifton de cétte pompe
eft de 4 pouces 2 lig. de diamètre ; il eft femblable à
celui du plan 7. .
ARTICLE 3. Despompes àfpirantes qui élevent L'eau
fucceflivement du puits, avec les dimenjions. L’ouverture
du puits X Y {PI. 1. fig. 1. ) , qui eft le plan du
rez-de-chauffée, eft de 6 piés en quarré, fur 244
piés de profondeur, & de 60 piés en 60 piés, il y a
deux bafehes K , r , vifibles dans la Plane. IV. dont
on peut connoître les dimenfions par l’échelle de
cette Planche. Dans la bafehe r eft un corps de pompe
afpirante de 9 pouces de diamètre ; & dans ce*
lui K , trempe le tuyau d’afpiration de la pompe fu-
périeure de 4 pouces 6 lignes de diamètre. Tous les
piftons de ces pompes ont 8 pouces 3 lignes de diamètre
, fur 6 piés de levée. Voye^ leur conftruétion ,
PI. I II. fig. 2 3 ,2 4 , 2 6 ,2 6 . Les chevrons qui foû-
tiennent les piftons ont 3 pouces quarrês, & font
fufpendus à un autre i © *• de 6 pouces en quarré ,
compofé de plufieurs pièces liées les unes aux autres,
comme on les voit par le profil fig. 22. PI. V h
.Ils compofent un train fufpendu à la jante du balancier
qui eft au-deffus du centre du puits, & au fond
duquel eft un puifart où viennent fe raffembler les
eaux de tous les rameaux dé la mine. Dans ce puifart
trempe le premier tuyau d’afpiration d’une pompe
qui afpire l’eau à 28 piés de hauteur, & remont«
par le tuyau au-deffus du pifton de 32 piés, pourfe
décharger dans les bafehes ; d’où elle eft reprife par
une fécondé pompe, qui l’éleve encore à 28 piés
plus haut, & 3 2 piés pli* haut que le pifton, & fucceflivement
par d’autres qui la font monter de bafehe
en bafehe, parce que tous les piftons de ces pom*
pes jouent tous enfemble. Au refte on v o it , Planche
IV. la manoeuvre d’un relai ; il y en a encore
trois femblables avant d’arriver au puifart : on ob-
fervera que le puits dont nous parlons, n’a lieu que
pour puifer les eaux de la mine.
A r t i c l e 4. De lafituation du balancier , lorfque la
machine ne joue pas. La charge que foûtient la chaîne
i © v ( P I IV . ) , àc le tire-boute n , eft beaucoup
plus grande que celle que portent les chaînes h f m *
lorfque le poids de la colonne d’air n’agit pas fur
le pifton u ; ainfi la fituation naturelle du balancier
eft de s’incliner du côté du puits, au lieu que la P l.
V. le repréfente dans un fens contraire, c’eft-à-dire
dans celui où il fe trouve lorfque Pinje&ion d’eau
froide ayant condenfé la vapeur renfermée dans le
cylindre, le poids de la colonne d’air fait baiffer le
pifton : alors l’eau du puits eft afpirée, & celle de
la bafehe K eft refoulée dans la cuvette q. Mais
quand la vapeur vient à s’introduire dans le cylindre,
fa force étant fupérieure au poids dé la colonne
d’air , foûleve le pifton, laiffe agir le poids des attirails
que porte la chaîne i©-^ , & le tire-boute n o ,
& le balancier s’incline du côté du puits, qui eft la
fituation où il refte lorfque la machine ne joue pas ,
parce qu’il s’introduit de l’air dans Je cylindre au-
deflous du pifton, qui fe met en équilibre par fon
reffort avec le poids de celui qui eft au-deffus.
 r t . <. Le mouvement du balancier ejl limite par des
chevrons à reffort. Pour limiter le mouvement du balancier
& amortir fa violence, pour que la machine
n’en reçoive point de trop grandes lecouffes, l’on
fait fortir en-dehors du bâtiment les deux extrémités