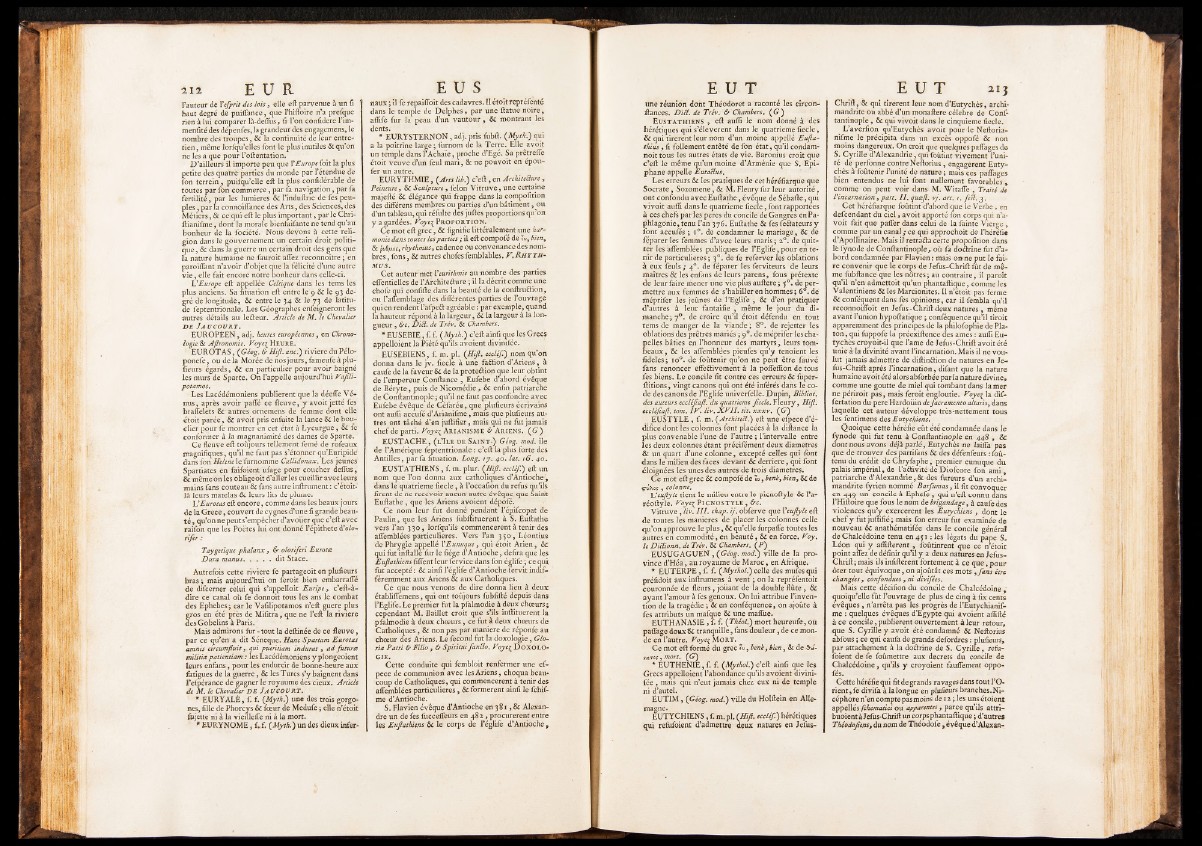
l ’auteur de Yefprit des lois, «lie eft parvenue â u n f i
haut degré de puiffance, que l’hiftoire n’a prefque
rien à lui comparer là-deffus, fi l’on confidere l’im-
menfité des dépenfes,la grandeur des engagemens, le
nombre des troupes, & la continuité de leur entretien,
même lorfqu’elles font le plus inutiles & qu’on
ne les a que pour l’oftentation.
D ’ailleurs il importe peu que Y Europe foit la plus
petite des qua’tre parties du monde par l’étendue de
fon terrein, puisqu’elle eft là plus confidérable de
toutes par fon commerce, par fa navigation, par fa
fertilité, par les lumières & l’induftrie de fes peuples
, par la connoiffance des Arts, des Sciences, des
Métiers, & ce qui eft le plus important, par le Chri-
fitianifme, dont la morale bienfaifante ne tend qu’au
bonheur de la fociété. Nous devons à cette religion
dans le gouvernement un certain droit politique,
& dans la guerre un certain droit des gens que
la nature humaine ne fauroit affez reconnoître ; en
paroiffant n’avoir d’objet que la félicité d’une autre
v ie , elle fait encore notre bonheur dans celle-ci.
L'Europe eft appellée Celtique dans les tems les
plus anciens. Sa fituation eft entre le 9 & le 93 degré
delongitudè, & entre le 34 & lé 73 de latitude
feptentrionale. Les Géographes enfeigneront les
autres détails au lefteur. Article de M. le Chevalier
D E J A V C O V R T .
EUROPÉEN, adj. heures européennes, en Chronologie
& Aßronomie. Voye^ HEURE.
EUROTA S, (Géog. 6* Hiß. anc.) riviere du Pélo-
ponefe, ou de la Morée de nos jours, fameufe à plufieurs
égards, & en particulier pour avoir baigné
les murs de Sparte. On l’appelle aujourd’hui V fili-
potamos.
Les Lacédémoniens publièrent que la déeffe Vénus
, après avoir paffé ce fleuve, y avoit jetté fes
braffelets & autres ornemens de femme dont elle
étoit parée, & avoit pris enfuite la lance & le bouclier
pourfe montrer en cet état à Lycurgue, & fe
conformer à la magnanimité des dames de Sparte.
Ce fleuve eft toujours tellement ferne de rofeaux
magnifiques, qu’il ne faut pas s’étonner qu’Euripidé
dans fon Helene le furnomme Callidonax. Les jeunes
Spartiates en faifoient üfage pour coucher deffus,
& même on les obligeoit d’aller les cueillir avec leurs
mains fans couteau & fans autre infiniment : c’étoit-
là leurs matelas & leurs lits de plume.
VEurotas eft encore, comme dans les beaux jours
de la Grece, couvert de cygnes d’une fi grande beauté
, qu’on ne peut s’empêcher d’avoiier que c’eft avec
raifon que les Poètes lui ont donné l’épithete d’0/0-
rifer :
Taygetique phalanx , & oloriferi Eurotce
Dura manus...............dit Stace.
Autrefois cette riviere fe partageoit en plufieurs
bras ; mais aujourd’hui on leroit bien embarrafïe
de difcemer celui qui s’appelloit Euripe, c’eft-à-
dire ce canal oii fe donnoit tous les ans le combat
des Ephebes ; car le Vafilipotamos n’eft guere plus
gros en été près de Mifitra, que ne l’eft la riviere
des Gobelins à Paris.
Mais admirons fur - tout la deftinée de ce fleuve,
par ce qu’en a dit Séneque. Hanc Spartam Eurotas
amnis circumfiuitqui pueritiam indurat, ad futura
militiez padentiam : les Lacédémoniens y plongeoient
leurs enfans, pour les endurcir de bonne-heure aux
fatigues de la guerre, & les Turcs s’y baignent dans
l ’efpérance de gagner le royaume des cieux. Article
de M. le Chevalier D E J a u c o V R T .
* EURYALÉ, f. f. (Myth.) une des trois gorgones,
fille de Phorcys & foeur de Medufe ; elle n’étoit
fujette ni à la vieilleffe ni à la mort.
* EURYNOME, fi. f. (Myth.) un des dieux infer-
E U S
naux ; il fe repaiffoit des cadavres. Il étoit repréfenté
dans le temple de Delphes, par une ftatue noire,
aflife fur la peau d’un vautour, & montrant les
dents.
* EURYSTERNON, adj. pris fubft. (Myth.) qui
a la poitrine large; furnom de la Terre. Elle avoit
un temple dans l’Achaïe, proche d’Egé. Sa prêtreffe
étoit veuve d’un feul mari, & ne pouvoit en épou-
fer un autre.
EURYTHMIE, (Arts lib.) c’e f t , en Architecture ,
Peinture, & Sculpture , félon Vitruve, une certaine
majefté & élégance qui frappe dans la compofition
des différens membres ou parties d’un bâtiment, ou
d’un tableau, qui réfulte des juftes proportions qu’on y a gardées, Voye^ Proportion.
Ce mot eft grec, & lignifie littéralement une harmonie
dans toutes les parties ; il eft compofé de lu, bien,
& pvdpoç, rhythmus, cadence ou convenance des nombres,
fons, & autres chofesfemblables. V .R h y t h -
mus.
Cet auteur met Yeuritkmie au nombre des parties
effentielles de l’Archite&ure ; il la décrit comme une
chofe qui confifte dans la beauté de la conftruélion,
ou l’affemblage des différentes parties de l’ouvrage
qui en rendent l’afpett agréable : par exemple, quand
la hauteur répond à la largeur, & la largeur à la longueur
, &c. JDici. de Trév. & Chambers.
* EUSEBIE, fi f. (Myth.) c’eft ainfi que les Grecs
appelloient la Piété qu’ils avoient divinifée.
EUSEBIENS, fi m. pl. (Hift. eccléf.) nom qu’on
donna dans le jv. fiecle à une fa&ion d’Ariens, à
caufe de la faveur & de la proteélion que leur obtint
de l’empereur Confiance , Eufebe d’abord évêque
de Béryte, puis de Nicomédie, & enfin patriarche
de Confiantinople; qu’il ne faut pas confondre avec
Eufebe évêque de Céfarée, que plufieurs écrivains
ont aufîi accufé d’Arianifme, mais que plufieurs autres
ont tâché d’en juftifier, mais qui ne fut jamais
chef de parti. V o y eArianisme & Ariens. (G )
EUSTACHE, (l’Ile de Saint-) Géog. mod. île
de l’Amérique feptentrionale : c’eft la plus forte des
Antilles, par fa fituation. Long. ty. 40. lut. 16. 40.
EUSTATHIENS, f. m. plur. (Hift. eccléf.) eft un
nom que l’on donna aux catholiques d’Antioche ,
dans le quatrième fiecle, à l’occafion du refus qu’ils
firent de ne recevoir aucun autre évêque que Saint
Euftathe, que les Ariens avoient dépofé.
Ce nom leur fut donné pendant l’épifcopat de
Paulin, que les Ariens fubftituerent à S. Euftathe
vers l’an 330, lorfqu’ils commencèrent à tenir des
affemblées particulières. Vers l’an 350 , Léontius
de Phrygîe appellé Y Eunuque , qui étoit Arien, &
qui fut inftallé fur le fiége d’Antioche, délira que les
Eufiathiens fiffent leur fervice dans fon éelife ; ce qui
fut accepté : & ainfi l’églife d’Antioche fer vit indifféremment
aux Ariens & aux Catholiques.
Cé que nous venons de dire donna lieu à deux
établilfemens, qui ont toujours fubfifté depuis dans
l’Eglife.Le premier fut la pfalmodie à deux choeurs;
cependant M. Baillet croit que s’ils inftituerent la
pfalmodie à deux choeurs, ce fut à deux choeurs de
Catholiques, & non pas par maniéré de réponfe au
choeur des Ariens. Le fécond fut la doxologie, Gloria
Patri & Filio , & Spiritui fanclo. Voye{ Doxolo-
G IE.C
ette conduite qui fembloit renfermer une ef-
pece de communion avec les Ariens, choqua beaucoup
de Catholiques, qui commencèrent à tenir des
alfemblées particulières, & formèrent ainfi le fchif-
me d’Antioche.
S. Flavien évêque d’Antioche en 3 8 1 ,& Alexandre
un de fes fucceffeurs en 482, procurèrent entre
les Eufiathiens & le corps de l’églife d’Antioche,
une réunion dont Théodoret a raconté les circon-
llances. Dict. de Trév. & Chambers. (G ) Eustathiens , eft aufîi le nom donné à des
hérétiques qui s’élevèrent dans le quatrième fiecle,
& qui tirèrent leur nom d’un moine appellé Eußa-
thius y fi follement entêté de fon état, qu’il condam-
noit tous les autres états de vie. Baronius' croit que
c ’eft le même qu’un moine d’Arménie que S. Epi-
phane appelle Eutacius.
Les erreurs & les pratiques de cet héréfiarque que
Socrate, Sozomene, & M. Fleury fur leur autorité,
ont confondu avec Euftathe, évêque de Sébafte, qui
vivo it aulfi dans le quatrième fiecle, font rapportées
à ces chefs parles peres du concile de Gangres en Paphlagonie,
tenu l’an 376. Euftathe & fes fe&ateurs y
font accules ; i° . de condamner le mariage, & de
féparer les femmes d’avec leurs maris ; 20. de quitter
les affemblées publiques de l’Eglife, pour en tenir
de particulières; 30. de fe referver les oblations
à eux feuls ,* 40. de féparer les ferviteurs de leurs
maîtres & les enfans de leurs parens, fous prétexte
de leur faire mener une v ie plus auftere ; 50. de permettre
aux femmes de s’habiller en hommes ; 6 . de
méprifer les jeûnes de l ’Eglife , & d’en pratiquer
d’autres à leur fantaifie , même le jour du dimanche
; 70. de croire qu’il étoit défendu en tout
tems de manger de la viande ; 8°. de rejetter les
oblations des prêtres mariés ; 90, de méprifer les chapelles
bâties en l’honneur des martyrs, leurs tombeaux
, & les affemblées pieufes qu’y tenoient les
fideles; io ° . de foûtenir qu’on ne peut être fauvé
fans renoncer effeôivement à la poffeflxon de tous
fes biens. Le concile fit contre ces erreurs & fuper-
ilitions, vingt canons qui ont été inférés dans le code
des canons de l’Eglife univérfelle. Dupin, Bibliot.
des auteurs eccléfiafi. du quatrième fiecle. F leury, Hiß.
tccléfiaft. tom. IV . liv. X V I I . tit. x xxv. (G )
EUSTYLE , f. m. (Architect.) eft une efpece d’édifice
dont les colonnes font placées à la diftance la
plus convenable l’une de l’autre ; l’intervalle entre
les deux colonnes étant précifément deux diamètres
& un quart d’une colonne, excepté celles qui font
dans le milieu des faces devant & derrière, qui font
éloignées les unes des autres de trois diamètres.
C e mot eft grec & compofé de lu, benè, bien, & de
çvXof , colonne.
Ueuftyle tient le milieu entre le picnoftyle & l’a-
réoftyle. l^oyeçPiCNOSTYLE, &c. Vitruve, liv. I II. chap. ij. obferve que Yeuflyle eft
de qu’otonu atepsp rleosu vmea nlei éprléuss ,d &e pqlua’ceellre lfeusr pcaoflfoen tnoeust ecse lleles
autres en commodité, en beauté, & en force. Voy.
le Dictionn. de Trév. & Chambers. (P)
EUSUGAGUEN , (Géog. mod/) ville de la province
d’Héa, au royaume de Maroc, en Afrique.
* EUTERPE, f. f. (Mythol.) celle des mutes qui
préfidoit aux inftrumens à vent ; on la repréfentoit
couronnée de fleurs, jouant de la double flûte, &
ayant l’amour à fes genoux. On lui attribue l’invention
de la tragédie ; & en conféquence, on ajoûte à
fes attributs un mafque & une maffue.
EUTHANASIE, f. f. (Théol.) mort heureufe, ou
paffage douxtk tranquille, fans douleur, de ce monde
en l’autre. Voyeç Mort.
Ce mot eft formé du grec tu, benè, bien, & de Aa-
varroç , mort. (G)
* EUTHENIE, f. f. (Mythol.) c’eft ainfi que les
Grecs appelloient l’abondance qu’ils avoient divinifée
, mais qui n’eut jamais chez eux ni de temple
ni d’autel.
ËUTIM, (Géog. mod.) ville du Holftein en Allemagne.
EUTYCHIENS, f. m. pl. (Hiß. eccléf.) hérétiques
qui refufoient d’admettre deux natures en Jefus-
Chrift , & qui tirèrent leur nom d’Eutychès, archimandrite
ou abbé d’un monaftere célébré de Conf-
tantinople, & qui v ivoit dans le cinquième fiecle.
L’averfion qu’Eutychès avoit pour le Neftoria-
nifme le précipita dans un excès oppofé & non
moins dangereux. On croit que quelques paffages de
S. Cyrille d’Alexandrie, qui foûtint vivement l’unité
de perfonne contre Neftorius, engagèrent Euty-
chès à foûtenir l’unité de nature ; mais ces paffages
bien entendus ne lui font nullement favorables ,
comme on peut voir dans M. Witaffe , Traité de
P incarnation , part. I I . qucefi. vj. art. 1. feH. 3.
Cet héréfiarque foûtint d’abord que le V erbe, en
defcendant du c ie l, avoit apporté fon corps qui n’a-
voit fait que paffer dans celui de la fainte Vierge ,
comme par un canal,* ce qui approchoit de l’héréfic
d’Apollinaire. Mais il retraâa cette propofition dans
lè fynode de Conftantinople , où fa doélrine fut d’abord
condamnée par Flavien : mais on ne put le faire
convenir que le corps de Jefus-Chrift fut de même
fubftance que les nôtres ; au contraire, il pàroît
qu’il n’en admettoit qu’un phantaftique, comme les
Valentiniens & les Marcionites. Il n’étoit pas ferme
& conféquent dans fes opinions, car il fembla qu’il
recOnnoiffoit en Jefus-Chrift deux natures , même
avant l’union hypoftatique ; conféquence qu’il tiroit
apparemment des principes de la philofopnie de Platon
, qui fuppofe la préexiftence des âmes : aufîi Eu-
tychès croyoit-il que l’ame de Jefus-Chrift avoit été
Unie à la divinité avant l’incarnation. Mais il ne voulut
jamais admettre de diftinétion de natures en Jefus
Chrift après l’incarnation, difant que la nature
humaine avoit été alors abforbée parla nature divine,
comme une goutte de miel qui tombant dans la mer
ne périroit pas, mais feroit engloutie. Voyeç la dif-
fertation du pere Hardoüin de Jacramento ahuris, dans
laquelle cet auteur développe très-nettement tous
les fentimens des Eutychiens.
Quoique cette héréfie eût été condamnée dans le
fynode qui fut tenu à Conftantinople en 448 , &c
dont nous avons déjà parlé, Eutychès ne laiffa pas
que de trouver des partifans & des défenfeurs : foû-
tenu du crédit de Chryfaphe ; premier eunuque du
palais impérial, de l ’a&ivité de Diofcore fon ami ,
patriarche d’Alexandrie,& des fureurs d’un archimandrite
fyrien nommé Barfumas , il fit convoquer
en 449 un concile à Ephefe, qui n’eft connu dans
l’Hiftoire que fous le nom de brigandage, à caufe des
violences qu’y exercèrent les Euty chiens , dont le
chef y fut juftifié ; mais fon erreur fut examinée de
nouveau & anathématifée dans le concile général
de Chalcédoine tenu en 451 : les légats du pape S.
Léon qui y afiillerent, loûtinrent que ce n’étoit
point affez de définir qu’il y a deux natures en Jefus-
Chrift; mais ils infifterent fortement à ce que, pour
ôter tout équivoque, on ajoûtât ces mots ,fans être
changées , confondues , ni divifées.
Mais cette décifion du concile de Chalcédoine Z
quoiqu’elle fût l’ouvrage de plus de cinq à fix cents
evêques, n’arrêta pas les progrès de l’Eutychianif-
me : quelques évêques d’Egypte qui avoient .aflifté
à ce concile, publièrent ouvertement à leur retour,
que S. Cyrille y avoit été condamné & Neftorius
abfous ; ce qui caufa de grands defordres : plufieurs,
par attachement à la doctrine de S. Cy r ille , refufoient
de fe foûmettre aux decrets du concile de
Chalcédoine, qu’ils y croyoient fauffement oppo-
fés.
Cette héréfie qui fit de grands ravages dans tout l’Orient,
fe divifa à la longue en plufieurs branches. Ni-
céphore n’en compte pas moins de 12 ; les uns étoient
appellé s fchemaàci ou apparentes , parce qu’ils attri-
buoient à Jefus-Chrift un corps phantaftique ; d’autres
Théodofiens, du nom de Théodofe, évêque d’Alexan