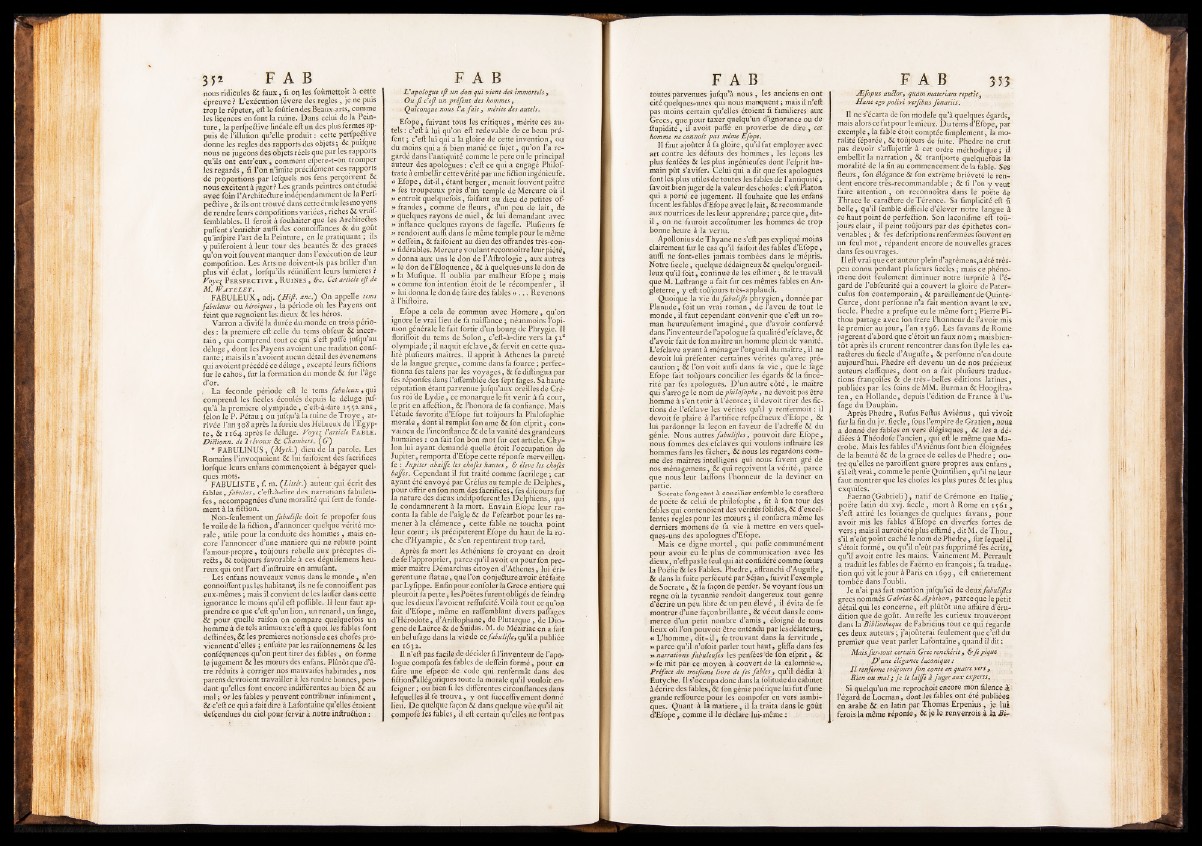
nous ridicules & faux, fi oq les foûmettoit à cette
épreuve ? L’execution févere des réglés, je ne puis
trop le répéter, eft le foûtien des Beaux-arts, comme
les licences en font la ruine. Dans celui de la Peinture
, la perfpeûive linéale eft un des plus fermes appuis
de l’illulion qu’elle produit : cette perfpeâive
donne les réglés des rapports des objets ; 6c puifque
nous ne jugeons des objets réels que par les rapports
qu’ils ont entr’e u x , comment elpere-t-on tromper
les regards, fi l’on n’imite précifément ces rapports
de proportions par lefquels nos fens perçoivent 6c
nous excitent à juger ? Les grands peintres ont étudié
avec foin l’Architefture indépendamment de la Perl-
peftive, & ils ont trouvé dans cette étude les moyens
de rendre leurs cOmpofitions variées , riches & vraif-
femblables. Il feroit à fouhaiter que les Architectes
puffent s’enrichir aufli des çonnoiffances & du goût
qu’infpire'l’art de la Peintiu-e, en le pratiquant ; ils
y puiferoient à leur tour des beautés & des grâces
qu’on voit fouvent manquer dans l’exécution de leur
compofition. Les Arts ne doivent-ils pas briller d’un
plus v if éclat, lorfqu’ils réunifient leurs lumières ?
Foyt^ Perspective , Ruines , &c. Cet article e f de
M. Wa t e l e t .
FABULEUX, adj. (Hifl. anc.) On appelle tems
fabuleux ou héroïques, la période oîi les Payens ont
feint que regnoient les dieux 6c les héros.
Varron a divifé la durée du monde en trois périodes
: la première eft celle du tems obfcur & incertain
, qui comprend tout ce qui s’eft pafle jufqu’au
déluge, dont les Payens avoient une tradition conf-
tante ; mais ils n’a voient aucun détail des évenemens
qui avoient précédé ce déluge, excepté leurs fictions
lur le cahos, fur la formation du monde 6c fur l’âge
d’or.
La fécondé période eft le tems fabuleux, qui
comprend les fiecles écoulés depuis le déluge jufqu’à
la première olympiade, c’elt-à-dire 1 5 5 2. ans,
lelon le P . Pétau ; ou jufqu’à la ruine de T ro y e , arrivée
l’an 308 après la fortie. des Hébreux de l’Egypte,
& 1164 après le déluge. Voye^ Varticle Fable.
Diclionn. de 1 révoux 6c Chambers. (G)
* FABULINUS, (Myth.) dieu de la parole. Les
Romains l’invoquoient 6c lui faifoient des facrifices
lorfque leurs entans commençoient à bégayer quelques
mots.
FABULISTE, f. m. ( Littér.) auteur qui écrit des
fables, fabulas, c’eft-à-dire des narrations fabuleu-
fe s , accompagnées d’une moralité qui. fert de fondement
à la fiction.
Non-feulement un fabulijle doit fe propofer fous
le voile de la fiction, d’annoncer quelque vérité morale
, utile pour la conduite des hommes , mais encore
l’annoncer d’une maniéré qui ne rebute point
l’amour-propre, toujours rebelle aux préceptes directs
, & toujours favorable à ces déguifemens heureux
qui ont l’art d’inftruire en amufant.
- Les enfans nouveaux venus dans le monde, n’en
connoiflent pas les habitans*, ils ne fe connoiffent pas
eux-mêmes ; mais il convient de les laifler dans cette
ignorance le moins qu’il eft poflible. Il leur faut apprendre
ce que c’eft qu’un lion, un renard, un finge,
& pour quelle raifon on compare quelquefois un
homme à de tels animaux : c’eft à quoi les fables font
deftinées, 6c les premières notions de ces chofes proviennent
d’elles ; enfuite par les raifonneniens 6c les
conféquences qu’on peut tirer des fables , on forme
le jugement 6c les moeurs des enfans. Plûtôt que d’être
réduits à corriger nos mauvaifes habitudes, nos
parens devroient travailler à les rendre bonnes, pendant
qu’elles font encore indifférentes au bien 6c au
mal ; or les fables y peuvent contribuer infiniment,
& c’eft ce qui a fait dire à Lafontaine qu’elles étoient
defçendues du ciel pour fervir à notre inftruCtion :
L'apologue efl un don qui vient des immortels ,
Ou J i c’efl un préfent des hommes ,
■ Quiconque nous l'a fa it, mérite des autels.
Efope, fuivant tous les critiques, mérite ces autels
: c’eft à lui qu’on eft redevable de ce beau préfent
; c’eft lui qui a la gloire de cette invention, ou
du moins qui a fi bien manié ce fujet, qu’on l’a regardé
dans l’antiquité comme le pere ou le principal
auteur des apologues : c’eft ce qui a engagé Philof-
trate à embellir cette vérité par une fiftion ingénieufe.
« Efope, dit-il, étant berger, menoit fouvent paître
» fes troupeaux près d’un temple de Mercure oh il
» entroit quelquefois, faifant au dieu de petites of-
» frandes, comme de fleurs, d’un peu de la it , de
» quelques rayons de miel, 6c lui demandant avec
» inftance quelques rayons de fageffe. Plufieurs fe
» rendoient aufli dans le même temple pour le même
» deffein, & faifoient au dieu des offrandes très-con-
» fidérables. Mercure voulant reconnoître leur piété,
» donna aux uns le don de l’Aftrologie , aux autres
» le don de l’Éloquence, & à quelques-uns le don de
» la Mufique. Il oublia par malheur Efope ; mais
» comme fon intention étoit de le récompenser, il
» lui donna le don de faire des fables » . . . Revenons
à l’hiftoire.
Efope a cela de commun avec Homere, qu’on
ignore le vrai lieu de fa naiflance ; néanmoins l’opinion
générale le fait fortir d’un bourg de Phrygie. Il
florifloit du tems de Solon, c’eft-à-dire vers la < z®
olympiade ; il naquit efclave, & fervit en cette qualité
plufieurs maîtres. Il apprit à Athènes la pureté
de la langue greque, comme dans fa fource ; perfectionna
fes talens par les voyages, & fe diftingua par
fes réponfes dans l’affemblée des Sept fages. Sa haute
réputation étant parvenue jufqu’aux oreilles de Cré-
fus roi ‘de Lydie, ce monarque le fit venir à fa cour,
le prit en affeâion, 6c l’hônora de fa confiançe. Mais
l’étude favorite d’Efope fut toujours la Philofophie
morale, dont il remplit fon ame 6c fon efprit, convaincu
de l’inconftance 6c de la vanité des grandeurs
humaines : on fait fon bon mot fur cet article. C hy-
lon lui ayant demandé quelle étoit l’occupation de
Jupiter, remporta d’Efope cette réponfe merveilleu-
fe : Jupiter abaijfe les chofes hautes, & élevé les chofes
baffes. Cependant il fut traité comme facrilege ; car
ayant été envoyé par Créfus au temple de Delphes,
pour offrir en fon nom des facrifices, fes difeours fur
la nature des dieux indifpoferentles Delphiens, qui
le condamnèrent à la mort. Envain Efope leur raconta
la fable de l’aigle 6c de l’efcarbot pour les ramener
à la clémence, cette fable ne toucha point
leur coeur ; ils précipitèrent Efope du haut de la roche
d’Hyampie, 6c s’en repentirent trop tard.
Après fa mort les Athéniens fe croyant en droit
de fe l’approprier, parce qu’il avoit eu pour fon premier
maître Démarchus citoyen d’Athènes., lui é r i gèrent
une ftatue, que l’on conje&ure avoir été faite
par Lyfippe. Enfin pour confoler la Grece entière qui
pleuroit la perte, les Poètes furent obligés de feindre
que les dieux l’a voient reflufeité. Voilà tout ce qu’on
lait d’Efope, même en raffemblant divers paflages
d’Hérodote, d’Ariftophane, de Plutarque , de Dio-
gene de Laërce & de Suidas. M. de Méziriac en a fait
unbelufage dans la vie de ce fabulijle, qu’il a publiée
en 1631.
Il n’eft pas facile de décider fi l’inventeur de l’apor
logue compofa fes fables de deffein formé, pour en
faire une efpece de code qui renfermât dans des
fiftion^allégoriques toute la morale qu’il vouloit en-
feigner ; ou bien fi les différentes circonftances dan?
lefquelles il fe trouva, y ont fucceflivement donné
lieu. De quelque façon 6c dans quelque vue qu’il ait
çompofe fes fables, il eft certain qu’elles ne font pas
toutes parvenues jufqu’à nous, les anciens eh ont
cité quelques-unes qui nous manquent ; mais il n’eft
pas moins certain qu’elles étoient fi familières aux
Grecs, que pour taxer quelqu’un d’ignorance ou de
ftupidité, il avoit paffé en proverbe de dire, cet
homme ne connoît pas même Efope.
Il faut ajoûter à fa gloire, qu’il fut employer avec
art contre les défauts des hommes, les leçons les
plus fenfées & les plus ingénieufes dont l’efprit humain
pût s’avifer. Celui qui a dit que fes apologues
font les plus utiles de toutes les fables de l’antiquité,
favoit bien juger de la valeur des chofes : c’eft Platon
qui a porté ce jugement. Il fouhaite que les enfans
lucent les fables d’Efope avec le lait, 6c recommande
aux nourrices de les leur apprendre ; parce qùe, dit-
il , on ne’fauroit accoutumer les hommes de trop
bonne heure à la vertu.
Apollonius de Thyane ne s’eft pas expliqué moins
clairement fur le cas qu’il faifoit des fables d’Efope,
aufli ne font-elles jamais tombées dans le mépris.
Notre fiecle, quelque dédaigneux & quelqu’orgueil-
leux qu’il foit, continue de les eftimer ; 6c le travail
que M. Leftrange a fait fur ces mêmes fables en Angleterre
, y eft toûjours très-applaudi.
Quoique la v ie du fabulijle phrygien, donnée par
Planude, foit un vrai roman, de l’aveu de tout le
monde, il faut cependant convenir que c’eft un roman
heureufement imaginé, que d’avoir confervé
dans l’inventeur de l’apologue fa qualité d’efclave, 6c
d’avoir fait de fon maître un homme plein de vanité.
L ’efclave ayant à ménager l’orgueil du maître, il ne
de voit lui préfenter certaines vérités qu’avec précaution
; & l’on voit aufli dans fa vie , que le iage.
Efope fait toûjours concilier les égards 6c la fincé-
rité par fes apologues. D ’un autre cô té , le maître
qui s’arroge le nom de philofophe, ne devoit pas être
homme à s’en tenir à l’écorce ; il devoit tirer des fie-,
tions de l’efclave les vérités qu’il y renfermoit : il
devoit fe plaire à l’artifice refpeâueux d’Efope, 6c
lui pardonner la leçon en faveur de l’adreffe 6c du
génie. Nous autres fabuliftes, pouvoit dire Efope,
nous fommes des efclaves qui voulons inftruire les
hommes fans les fâcher, '6c nous les regardons comme
des maîtres intelligens qui nous favent gré de
nos ménagemens, 6c qui reçoivent la v érité, parce
que nous leur laiffons l’honneur de la deviner en
partie. -
Socrate fongeant à concilier enfemble le cara&ere
de poète & celui de philofophe , fit à fon tour des
fables qui contenoient des vérités folides, 6c d’excellentes
réglés pour les moeurs ; il confacra même les
derniers momens de fa vie à mettre en vers quelques
uns des apologues d’Efope.
Mais ce digne mortel, qui paffe communément
pour avoir eu le plus de communication avec les
dieux, n’eft pas le feul qui ait confidéré comme foetus
la Poëfie & les Fables. Phedre, affranchi d’Augufte,
.& dans la fuite perfécuté par Séjan, fuivit l’exemple
de Socrate, & la façon de penfer. Se voyant fous un
régné où la tyrannie rendoit dangereux tout genre
d’écrire un peu libre & un peu é lev é, il évita de fe
montrer d’une façon brillante, & vécut dans le commerce
d’un petit nombre d’amis, éloigné de tous
lieux où l’on pouvoit être entendu par les délateurs.
« L’homme, dit- i l , fe trouvant dans la fervitude,
m parce qu’il n’ofoit parler tout haut, gliffa dans fes
h narrations fabuleufes les penfées ‘de Ion efprit, &
» fe mit par ce moyen à couvert de la calomnie ».
Préface du troifieme livre de fes fables, qu’il dédia à
Eutyche. Il s’occupa donc dans la folitudedu cabinet
à écrire des fables, 6c fon génie poétique lui fut d’urie
grande reffource pour les compofer en vers ïambi-
ques. Quant à la matière, il la traita dans le goût
d’Efope, comme il le déclare lui- même : §f
Æfopus auclor, quammateriam repefit,
Hanc ego polivi verjibus fenariis.
Il ne s’écarta de fon modèle qu’à quelques égards,
mais alors ce fut pourle mieux. Du tems d’Efope, par
exemple, la fable étoit comptée Amplement, la moralité
féparée, & toujours de fuite. Phedre ne crut
pas devoir s’affujettir à cet ordre méthodique ; il
embellit la narration, 6c tranfporte quelquefois la
moralité de la fin au commencement de la fable. Ses
fleurs, fon élégance & fon extrême brièveté le rendent
encore très-recommandable ; 6c fi l’on y veut
faire attention, on reconnoîtra dans le poète de
Thrace le cara&ere deTérence. Sa fimplicité eft fi
belle, qu’il femble difficile d’élever notre langue à
ce haut point de perfeélion. Son laconifme eft toûjours
c lair, il peint toûjours par des épithètes convenables
; & les deferiptions renfermées fouvent en
un feul mot, répandent encore de nouvelles grâces
dans fes ouvrages.
Il eft vrai que cet auteur plein d’agrémens,a été très-
peu connu pendant plufieurs fiecles ; mais ce phénomène
doit feulement diminuer notre furprife à l’égard
de l’obfcurité qui a couvert la gloire de Pater-
culus fon contemporain, & pareillement de Quinte-
Gurce, dont perfonne n’a fait mention avant le x v .
fiecle. Phedre a prefque eu le même fort ; Pierre Pi-
thou partage avec fon frere l’honneur de l’avoir mis
le premier au jour, l’an 1596. Les favans de Rome
jugèrent d’abord que c’étoit un faux nom ; mais bientôt
après ils crurent rencontrer dans fon ftyle les ca-
rafteres du fiecle d’Augufte, & perfonne n’en doute
aujourd’hui. Phedre eft devenu un de nos précieux
auteurs clafliques, dont on a fait plufieurs traductions
françoiles & de très - belles éditions latines,
publiées par les foins de MM. Burman 6c Hoogftra-
ten, en Hollande, depuis l’édition de France à l’u-
fage du Dauphin.
Après Phedre, Rufus Feftus Aviénus, qui vivoit
fur la fin du jv. fiecle, fous l’empire de Gratien, nous
a donné des fables en vers élégiaques, 6c les a dédiées
à Théodofe l’ancien, qui eft le même que Ma-
crobe. Mais les fables d’Avienüs font bien éloignées
de Ia.beauté 6c de la grâce de celles de Phedre ; outre
qu’elles ne paroiffent guere propres aux enfans ,
s’il eft v ra i, comme le penfe Quintilien, qu’il ne leur
faut montrer que les chofes les plus pures 6c les plus
exquifes. .
Faërno(Gabrieli), natif de Crémone en Italie,'
poète latin du xvj. fiecle, mort à Rome en 15 6 1 ,
s’eft attiré les louanges de quelques favans, pour
avoir mis les fables d’Efope en diverfes fortes de
vers ; mais il auroit été plus eftimé, dit M. de Thou,
s’il n’eût point caché le nom de Phedre, fur lequel il
s’étoit formé, ou qu’il n’eût pas fupprimé fes écrits,
qu’il avoit entre, les mains. Vainement M. Perrault
a traduit les fables de Faërno en françois ;Ta traduction
qui vit le jour à Paris en 1699, eft entièrement
tombée dans l’oubli.
Je n’ai pas fait mention jufqu’ici de deux fabuljles
grecs nommés Gabrias 6c Aphthon, parce que le petit
détail qui les concerne, eft plûtôt une affaire.d’érudition
que de goût. Au refte les curieux trouveront
dans la Bibliothèque de Fabricius tout ce qui regarde
ces deux auteurs ; j’ajoûterai feulement que c’eft du
premier que veut parler Lafontaine, quand il dit :
Mais, furrtout certain Grec renchérit, &fe pique
D'une élégance laconique :
11. renferme toujours fçn conte en quatre vers ,
Bien ou mal ; je lé Laiffe à juger, aux experts. ,
. Si quelqu’un me reprochoit encore mon filence à
l’égard de Locman, dont les fables ont été publiées
en arabe 6c en latin par Thomas Erpenius, je lui
ferois. la même réponlè, 6c je le renverrois à la Bi