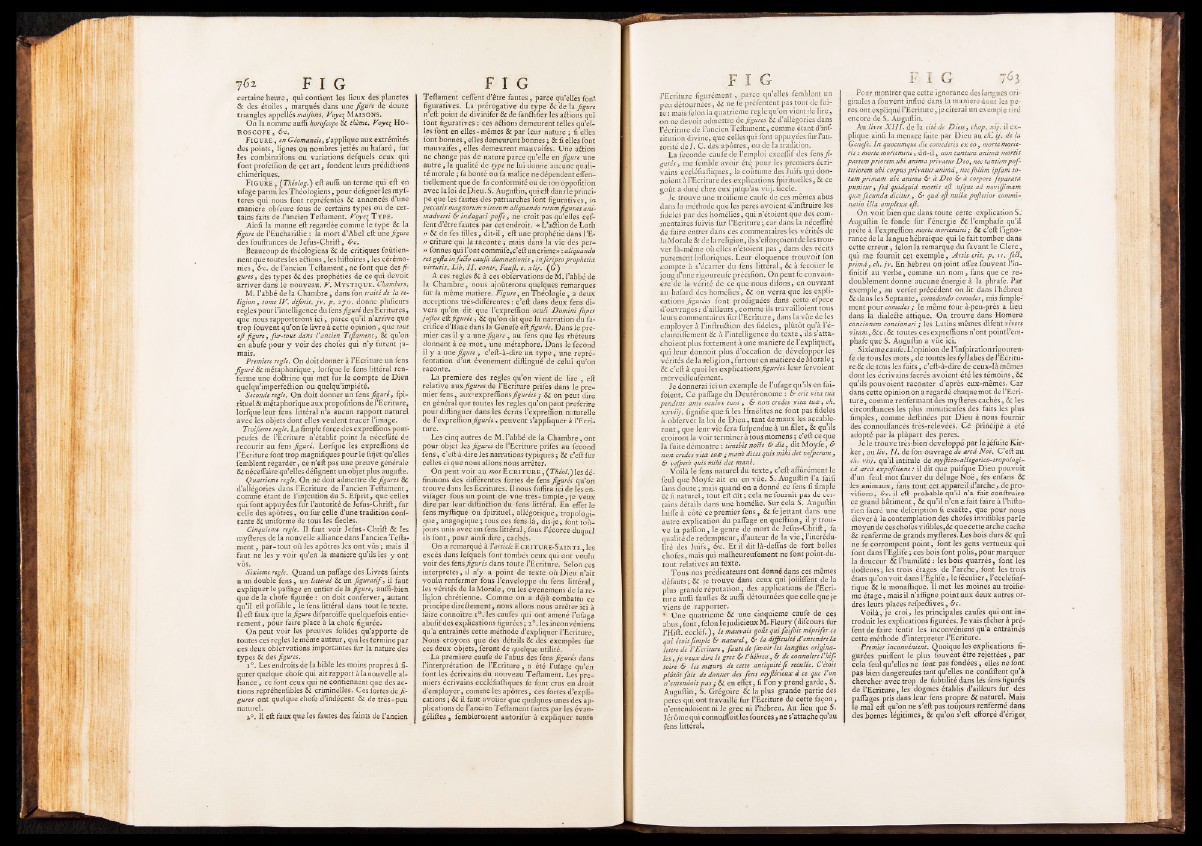
c e r ta in e h e u r e , q u i c o n t ie n t le s l ie u x d e s p lan è te s
& d e s é t o i l e s , m a rq u é s d an s u n e figure d e d o u z e
t r ia n g le s ap p e lle s maifons. Voye[ M a i s o n s .
On la nomme aufli horofcope 6c thème. V Ho-
& O S C Q P E , & c.
F i g u r e , en Géomancie, s’applique aux extrémités
des points, lignes ou nombres jettés au hafard, fur
les combinail’ons ou variations defquels ceux qui
font profeflion de cet art, fondent leurs prédirions
chimériques.
F i g u r e , (Théolog.) eft aufli un terme qui eft en
ufage parmi les Théologiens, pour défigner les myfteres
qui nous font repréfentés &: annoncés d’une
maniéré obfcure fous de certains types ou de certains
faits de l’ancien Teftament. Voye^ T y p e .
Ainli la manne eft regardée comme le type 6c la
figure de l’Euchariftie : la mort d’Abel eft une figure
des fouffrances de Jefus-Chrift, Oc.
Beaucoup de théologiens 6c de critiques foûtien-
nent que toutes les aérions, les hiftoires, les cérémonies
, &c. de l’ancien Teftament, ne font que des f igures
, des types 6c des prophéties de ce qui devoit
arriver dans le nouveau. V . M y s t i q u e . Chambers.
M. l’abbé de la Chambre, dans fon traité de la religion
y tome IV. définit, j v . p . x y o , donne plulieurs
réglés pour l’intelligence du fens figuré des Ecritures,
que nous rapporterons ici, parce qu’il n’arrive que
trop fouvent qu’on fe livre à cette opinion, que tout
ejl figure y fur-tout dans l'ancien Tefiament, 6c qu’on
en abufe pour y voir des chofes qui n’y furent jamais.
Première réglé. On doit donner à l’Ecriture un fens
figuré & métaphorique, lorfque le fens littéral renferme
une doârine qui met fur le compte de Dieu
quelqu’imperfeftion ou quelqu’impiété.
Seconde réglé. On doit donner un fens figuré, fpi-
rituel & métaphorique aux propofitions de l’Ecriture,
lorfque leur fens littéral n’a aucun rapport naturel
avec les objets dont elles veulent tracer l’image.
Troijieme réglé. La fimple force des expreflions pom-
peufes de l’Ecriture n’établit point la néceflité de
recourir au fens figuré. Lorfque les expreflions de
l’Ecriture font trop magnifiques pour le fujet qu’elles
femblent regarder, ce n’eft pas une preuve générale
6c néceflaire qu’elles défignent un objet plus augufte.
Qjiatrieme réglé. On ne doit admettre de figures &
d’allégories dans l’Ecriture de l’ancien Teftament,
comme étant de l’intention du S. Efprit, que celles
qui font appuyées fur l’autorité de Jefus-Cnrift, fur
celle des apôtres, ou fur celle d’une tradition confiante
& uniforme de tous les ftecles.
Cinquième réglé. Il faut voir Jefus-Chrift & les
myfteres de la nouvelle alliance dans l’ancien Teftament
, par-tout ou les apôtres les ont vûs ; mais il
faut ne les y voir qu’en la maniéré qu’ils les y ont
vus.
Sixième réglé. Quand un paflage des Livres faints
a un double fens, un littéral 6c un figuratif, il faut
expliquer le paflage en entier de la figure, aufli-bien
que de la chofe figurée : on doit conferver, autant
qu’il eft poflible, le fens littéral dans tout le texte.
Il eft faux que la figure difparoifle quelquefois entièrement
, pour faire place à la choie figurée.
On peut voir les preuves folides qu’apporte de
toutes ces réglés le même auteur, qui les termine par
ces deux oblêrvations importantes fur la nature des
types & des figures.
i°. Les endroits de la bible les moins propres à figurer
quelque chofe qui ait rapport à la nouvelle alliance
, ce font ceux qui ne contiennent que des actions
repréhenfibles 6c criminelles. Ces fortes de f igures
ont quelque chofe d’indécent & de très-peu
naturel.
2°. Il eft faux que les fautes des faints de l’ancien
Teftament ceflènt d’être fautes, parce qu’elles font
figuratives. La prérogative du type &: de la figure
n’eft point de divinifer & de fanftifier les aérions qui
font figuratives : ces aérions demeurent telles qu’elles
font en elles-mêmes & par leur nature ; fi elles
font bonnes, elles demeurent bonnes ; & fi elles font
mauvaifes, elles demeurent mauvaifes. Une aérion
ne change pas de nature parce qu’elle en figure une
autre, la qualité de type ne lui donne aucune qualité
morale ; fa bonté ou fa malice ne dépendent eflen-
tiellement que de fa conformité ou de ion oppofition
avec la loi de Dieu. S. Auguftin, qui eft dan* le principe
que les fautes des patriarches font figuratives, in
peccatis magnorum virorum aliquando rerum figuras ani-
madverti & indagari pojfe, ne -croit pas qu’elles cef-
fent d’être fautes par cet endroit. « L’aérion de Loth
» 6c de fes filles, dit-il, eft une prophétie dans l’E-
» criture qui la raconte ; mais dans la vie des per-
» fonnes qui l’ont commife,c’eft un crime» : aliquando
res gefia in facto caufa damnationis, in fcripto prophetia
virtutis. Lib, I I . contr. Faufi. c. x lij. (G)
A ces réglés 6c à ces obl'ervations de M. l’abbé de
la Chambre, nous ajouterons quelques remarques
fur la même matière. Figure, en Théologie, a deux
acceptions très-différentes : c’eft dans deux fens divers
qu’on dit que l’expreflion oculi Domini fuper
jufios eft figurée, 6c qu’on dit que la narration du fa-
crifice d’Ifaac dans la Genefe eft figurée. Dans le premier
cas il y a une figure , au fens que les rhéteurs
donnent à ce mot, une métaphore. Dans le fécond
il y a une figure , c’eft-à-dire un type, une repré-
fentation d’un événement diftingué de celui qu’on
raconte.
La première des réglés qu’on vient de lire , eft
relative aux figures de l’Ecriture prifes dans le premier
fens, aux-expreflions figurées ; 6c on peut dire
en général que toutes les réglés qu’on peut prefcrire
pour diftinguer dans les écrits l’expreflion naturelle
de l’expreflion figurée , peuvent s’appliquer à l’Ecriture.
.
Les cinq autres de M. l’abbé de la Chambre, ont
pour objet les figures de l’Ecriture prifes au fécond
fens, c’eft-à-dire les narrations typiques ; & c’eft fur
celles-ci que nous allons nous arrêter.
On peut voir au mot E c r i t u r e , (T h é o l.jle sdéfinitions
des différentes fortes de fens figurés qu’on
trouve dans les Ecritures. Il nous fuffira ici de les en-
vifager fous un point de vue très-fimple, je veux
dire par leur diftinérion du fens littéral. En effet le
fensmyftique ou fpirituel, allégorique, tropologi-
que, anagogique ; tous ces fens-là, dis-je, font toujours
unis avec un fens littéral, fous l’écorce duquel
ils font, pour ainfi dire, cachés.
On a remarqué à Varticle E c r i t u r e -S a i n t e , les
excès dans lefquels font tombés ceux qui ont voulu
voir des fens figurés dans toute l’Ecriture. Selon ces
interprètes, il n’y a point de texte où Dieu n’ait
voulu renfermer fous l’enveloppe du fens littéral,
les vérités de la Morale, ou les évenemens de la reT
ligion chrétienne. Comme on a déjà combattu ce
principe directement, nous allons nous arrêter ici à
faire connoître i°. les caufes qui ont amené l’ufage
abufif des explications figurées ; 20. les inconvéniens
qu’a entraînés cette méthode d’expliquer l’Ecriture.
Nous croyons que des détails 6c des exemples fur
ces deux objets, feront de quelque utilité.
La première caufe de l’abus des fens figurés dans
l’interprétation de l’Ecriture, a été l’ufàge qu’en
font les écrivains du nouveau Teftament. Les premiers
écrivains eccléfiaftiques fe font crus en droit
d’employer , comme les apôtres, ces fortes d’explications
; 6c il faut avoüer que quelques-unes des applications
de l’ancien Teftament faites par les évan-
géiiftes , fembleroient autorifer à expliquer toute
l’Ecriture figurément, parce qu elles femblent un
peu détournées, 6c ne fe préfentent pas tout de fuite
: mais félon la quatrième réglé qu’on vient de lire,
on ne devoit admettre de figures 6c d’allégories dans
l ’écriture de l’ancien Teftament, comme étant d’inf-
titution divine, que celles qui font appuyées fur l’autorité
de J. C. des apôtres, ou de la tradition.
La fécondé caufe de l’emploi exceflif des fens f igurés
y me fémble avoir été pour les premiers écri-
vains eccléfiaftiques, la coutume des Juifs qui don-
noient à l’Ecriture des explications fpirituelles, & ce
goût a duré chez eux jufqu’au viij. fiecle.
Je. trouve une troifieme caufe dq ces. mêmes abus
dans, la méthode que les peres avoient d’inftruire les
fideles par des homélies, qui n’étoient que des commentaires
fuivis fur l’Ecriture; car dans la néceflité
de faire entrer dans ces commentaires les vérités de
la Morale & de la religion, ils s’efforçoientde les trouver
là-même où elles n’étoient pas , dans des récits
purement hiftoriques. Leur éloquence trouvoit fon
compte à s’écarter du fens littéral, 6c à fecoiier le
joug d’une rigoureufe précifion. On peut fe convaincre
de la vérité de ce que nous difons, en ouvrant
au hafard des homélies, 6c on verra que les explications
figurées font prodiguées dans cette efpece
d’ouvrages : d’ailleurs, comme ils travailloient tous
leurs commentaires fur l’Ecriture, dans la vûe de les
employer à l’inftruérion des fideles, plûtôt qu’à l’ér
clairciflement 6c à l’intelligence du texte, ils s’atta-
choient plus fortement à une maniéré de l’expliquer,
qui leur donnoit plus d’occafion de développer les
vérités de la religion, furtout en matière de Morale ;
6c c’eft à quoi les explications figurées leur fervoient
merveilleufement.
Je donnerai ici un exemple de l’ufage qu’ils en fai-
foient. Ce paflage du Deutéronome : 6* eût vita tua
pendens ante oculos tuos , 6* non credes vita tua, ch.
x x v iij. fignifie que fi les Ifraëlitesne font pas fideles
à obferver la loi de Dieu, tant de maux les accableront
, que leur vie fera fufpendue à un filet, & qu’ils
croiront la voir terminer à tous momens ; c’eft ce que
la fuite démontre : timebis nocte O die y dit Moyfe, O
non credes vitoe tua j marié dices quis mihi det vefperum ,
& vefperè quis mihi det mane.
Voilà le fens naturel du texte, c’eft aflurément le
feul que Moyfe ait eu en vûe. S. Auguftin l’a faifi
fans doute ; mais quand on a donné ce fens fi fimple
& fi naturel, tout eft dit ; cela ne fournit pas de certains
détails dans une homélie. Sur cela S. Auguftin
laiffeà côté ce premier fens, 6c fe jettant dans une
autre explication du paflage en queftion, il y trouve
la paflion, le genre de mort de Jefus-Chrift, fa
qualité de rédempteur, d’auteur de la vie ; l’incrédulité
des Juifs, Oc. Et il dit là-deflus de fort belles
chofes,mais qui malheureufement ne font point-du-
tout relatives au texte.
Tous nos prédicateurs ont donné dans ces mêmes
défauts ; 6c je trouve dans ceux qui joiiiflent de la
plus grande réputation, des applications de l’Ecriture
aufli faufles 6c aufli détournées que celle que je
viens de rapporter.
* Une quatrième 6c une cinquième caufe de ces
abus, font, félon le judicieux M. Fleury (difcours fur
l’Hift. eccléf. ) , le mauvais goût qui faifoit méprifer ce
qui étoitfimple & naturel, & la difficulté d'entendre la
lettre de l'Ecriture, faute de favoir les langûes originales
, je veux dire le grec & l'hébreu, O de connoître l 'h i f
toire & les moeurs de cette antiquitéfi reculée. C'étoit
plûtôt fa it de donner des fens myfiérieux à ce que Von
n'entendoitpas} 6c en effet, fi l’on y prend garde, S.
Auguftin, S. Grégoire 6c la plus grande partie des
peres qui ont travaillé fur l’Ecriture de cette façon ,
n’entendoient ni le grec ni l’hébreu. Au lieu que S.
Jérôme cpi connojiToit les four ces f ne s’attache qu’au
fens littéral.
Pour montrer que cette ignorance des langues originales
a fouvent influé dans la maniéré dont les peres
ont expliqué l’Écriture, je citerai un exemple tiré
encore de S. Auguftin.
Au livre X I I I . de la cité de D ie u , ùhap. x i j . il explique
ainli la menace faite par Dieu au cli. ij. de la
Genefe. In quocumque die comederis e x eo, morte morie-
ris : morte moriemini y dit-il, non tantum anima mortis
partem priorem ubi anima privatur Dco, nec tantiimpof-
teriorem ubi corpus privatur aninlâ, nec folum ipfam to-
tam primam ubi anima 6* à Deo & à corpore fepârata
punitur y fe d quidquid mortis ejl ufque ad noviffimam
quoi fecunda diçitur.y G qud ejl nulla pofierior commi-
naiio ilia amplexa ejl.
On voit bien que dans toute cette explication S.'
Auguftin fe fonde fur l’énergie 6c l’emphafe qu’il
prête à l’expreflion morte moriemini; 6c c’eft l’ignorance
de la langue hébraïque qui le fait tomber dans
cette erreur, félon la remarque du favant le Clerc ,
qui me fournit cet exemple, A rds crit. p . 11. fect.
prima y ch. jv . En hebreu on joint allez fouvent l’infinitif
au verbe, comme un nom, fans que ce redoublement
donne aucune énergie à la phrafe. Par
exemple, au verfet précédent on lit dans l’hébreu
&dans les Septante, comedendo comedes, mis finalement
pour comedes ; le même tour à-peu-près a lieu
dans la diale&e àttique. On trouve dans Hortiere
concionem concionari ; les Latins mêmes difentvivere
vitam,6cç. 6c toutes.ces expreflions n’ont pointl’em-
phafe que S. Auguftin a vue ici.
Sixieme-caufe. L’opinion de l ’infpiration rigoureufe
de tousles mots, de toutes les Cyllabes de l’Ecriture
6c de. tous les faits, c’eft-à-dire de ceux-là mêmes
dont les écrivains facrés avoient été les témoins , -6c
qu’ils pouvoient raconter d’après eux-mêmes. Car
dans cette opinion on a regardé chaque mot de l’Ecriture,
comme renfermant des myfteres cachés, & les
circonftanoes les plus minutieufes des faits les plus
limples, comme deftinées par Dieu à nous fournir
des connoilfances très-relevées. Ce principe a été
adopté par la plûpart des peres.
Je le trouve très-bien développé par le jéfuite Kir-
ker, au liv. I I . de fon ouvrage de area Noè. C’eft au
ch. viij. qu’il intitule de myjjico-allegorico-tropologi-
cd area expofitione: il dit que puifque Dieu pouvoit
d’un feul mot fauver du déluge Noë, fes enfans 6c
les animaux 7 fans tout cet appareil d’arche , de pro-
vifions, &c. il eft probable qu’il n’a fait conftruire
ce grand bâtiment, 6c qu’il n’en a fait faire à l’hifto-
rien facré une defeription fi exafte, que pour nous
élever à la contemplation des chofes invifibles parle
moyen de ces chofes vifibles,& que cette arche cache
6c renferme de grands myfteres. Les bois durs & qui
ne fe corrompent point, font les gens vertueux qui
font dans l’Eglife ; ces bois font polis, pour marquer
la douceur 6c l’humilité : les bois quarrés, font les
do&eurs; les trois étages de l’arcne,,font les trois
états qu’on voit dans l’Eglife, leféculier, l’eccléfiaf-
tique 6c le monaftique. Il met les moines au troifieme
étage, mais il n’aflïgne point aux deux autres ordres
leurs places refpeûives, Oc.
Voilà, je croi, les principales caufes qui ont introduit
les explications figurées. Je vais tâcher à pré-
fent de faire fentir les inconvéniens qu’a entraînés
cette méthode d’interpreter l’Ecriture.
• Premier inconvénient. Quoique les explications figurées
puiflent le plus fouvent être rejettées, par
cela feul qu’elles ne font pas fondées, elles ne font
pas bien dangereufes tant qu’elles ne confiftent qu’à
chercher avec trop de fubtilité dans lés fens figurés
de l’Ecriture, les dogmes établis d’ailleurs fur des
paflages pris dans leur fens propre & naturel. Mais
le mal eft qu’on ne s’eft pas toûjours renfermé dans
des bornes légitimes, & qu’on s’eft efforcé d*ériger(