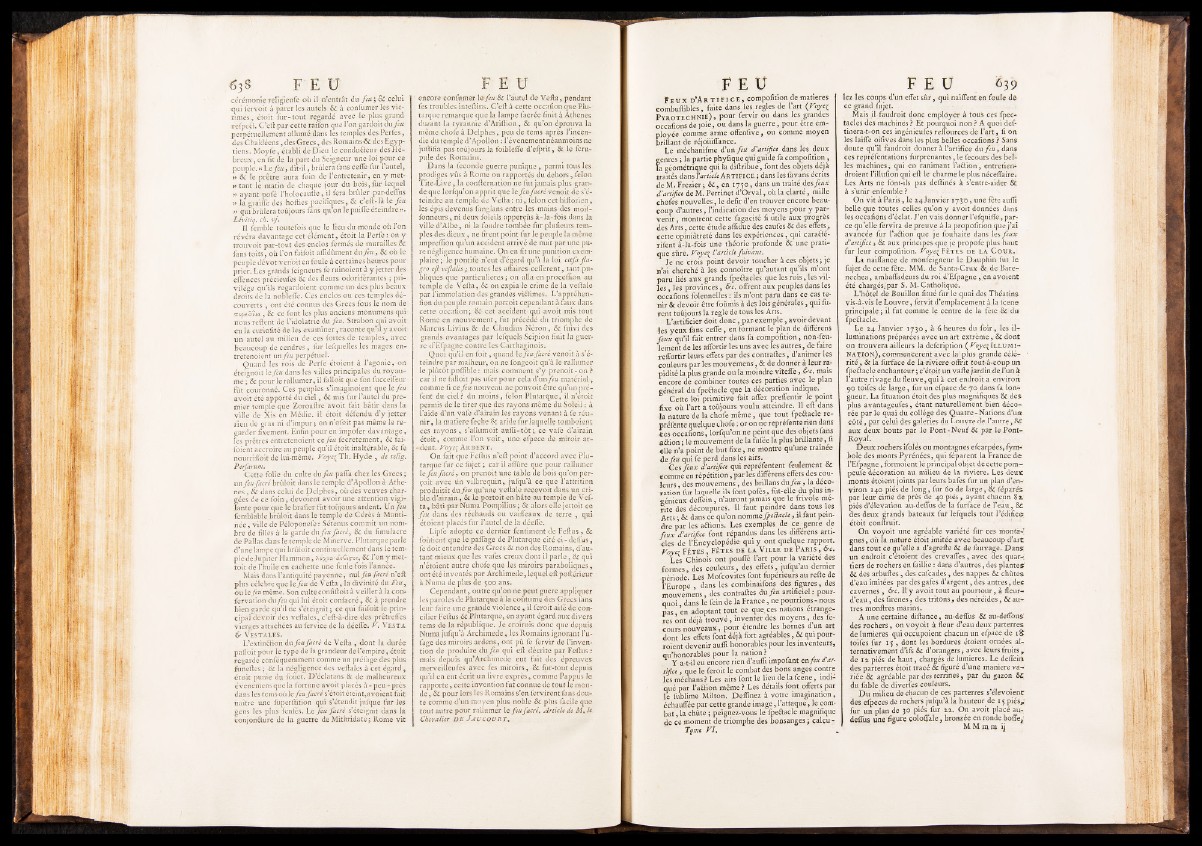
cérémonie religieufe où il n’entrât du feu ; Sc celui
■ qui fervoit à parer les autels 8c à confumer les victimes,
étoit fur-tout regardé avec le plus grand
Tefpeél, C’eft par cette raifon que l’on gardoit du feu
perpétuellement allumé dans les temples des Perles,
des Chaldéens, des Grecs, des Romains ■ & des Egyptiens.
Moyfe, établi de Dieu le condu&eur des Hébreux,
en fit de la part du Seigneur une loi pour ce
peuple.« Le f e u , dit-il, brûlera fans ceffe fur 1 autel,
» 8c le prêtre aura foin de l’entretenir, en y met-
v tant le matin de chaque jour du bois, fur lequel
» ayant pofé l’holocaulle, il fera brûler par-deffus
» la graiffe des hofties pacifiques, & c’eft-là le feu
» qui brûlera toûjours fans qu’on le puiffe éteindre ».
hèvitiq. ch. vj.
Il femble toutefois que le lieu du monde où l’on
révéra davantage cet élément, étoit la Perfe : on y
trouvoit par-tout des enclos fermés de murailles 6c
fans toîts, où l’on faifoit aflidûment du^«, 8c où le
peuple dévot venoit en foule à certaines heures pour
prier. Les grands feigneurs fe ruinoient à y jetter des
effences précieufes 8c des fleurs odoriférantes ; privilège
qu’ils regardoient comme un des plus beaux
droits de la nobleffe. Ces enclos ou ces temples découverts
j ont été connus des Grecs fous le nom de
vrvpa.dïict, 8c ce font les plus anciens monumens qui
nous reftent de l’idolâtrie du feu. Strabon qui avoit
eu la curiofité de les examiner, raconte qu’il y avoit
un autel au milieu de ces fortes de temples , avec
beaucoup de cendres-, fur lefquelles les mages en-
tretenoient un feu perpétuel.
Quand les rois de Perfe étoient à l’agonie, on
éteignoit le feu dans les villes principales du royaume
; 8c pour le rallumer, il falloir que fon fucceffeur
fût couronné. Ces peuples s’imaginoient que 1 efeu
avoit été apporté du ciel, 8c mis fur l’autel du premier
temple que Zoroaftre avoit fait bâtir dans la
ville de Xis en Médie. il étoit défendu d’y jetter
rien de gras ni d’impur ; on n’ofoit pas même le regarder
fixement. Enfin pour en impofer davantage,
les prêtres entretenoient ce feu fecretement, 8c fai-
foient accroire au peuple qu’il étoit inaltérable, 8c fe
nourriffoit de lui-même. Voye^ Th. Hyde , de relig.
Perfarum.
Cette folie du culte du feu paffa chez les Grecs ;
un feu facré brûloit dans le temple d’Apollon à Athènes
, 8c dans celui de Delphes, où des veuves chargées
de ce foin, dévoient avoir une attention vigi-:
lante pour que le brafier fût toûjours ardent. Un feu
femblable brûloit dans le temple de Cérès à Manti-
née, ville de Péloponefe : Sétenus commit un nombre
de filles à la garde du feu facré, 8c du fimulacre
de Pallas dans le temple de Minerve. Plutarque parle
d’une lampe qui brûloit continuellement dans le temple
de Jupiter Hammon, a<r&ç-oi', 8c l’on y mettoit
de l’huile en cachette une feule fois l’année.
Mais dans l’antiquité payenne, nul feu facré n’eft
plus célébré que 1 efeu de Vefta, la divinité du Feu,
ou lefieumème. Son culte confiftoit à veiller à la con-
fervation du feu qui lui étoit confacré, & à prendre
bien garde qu’il ne s’éteignît ; ce qui faifoit le principal
devoir des veftales, c’eft-à-dire des prêtreffes
vierges attachées au fervice de la déeffe. V. V esta
6* V estales.
L’extinftion du feu facré de Vefta , dont la durée
pafloit pour le type de la grandeur de l’empire, étoit
regardé conféquemment comme un préfage des plus
funeftes ; 8c la négligence des veftales à cet égard,
étoit punie du foiiet. D’éclatans & de malheureux
évenemensquela fortune avoit placés à-peu-près
dans les temsoùle feu facré s’étoit éteint, avoient fait
naître une fuperftition qui s’étendit jufque fur les
gens les plus fenfés. Le feu facré s’éteignit dans la
conjoncture de la guerre de Mithridatc ; Rome vit
’ encore confumer 1 e feu 6c l’autel de Vefta, pendant
fes troubles inteftins. C’eft à cette occafion que Plutarque
remarque que la lampe facrée finit à Athènes
durant la tyrannie d’Ariftion, & qu’on éprouva la
même chofe à Delphes, peu de tems après l’incendie
du temple d’Apollon : l’évenement néanmoins ne
juftifia pas toûjours la foibleffe d’efprit, & le fcru-
pule des Romains.
Dans la fécondé guerre punique , parmi tous les
prodiges vûs à Rome ou- rapportés du dehors, félon
Tite-Live, la confternation ne fut jamais plus grande
que lorfqu’on apprit que le feufacré v e noit de s’éteindre
au temple de Vefta: ni, félon cet hiftorien,
les épis devenus fanglans entre les mains des moif-
fonneurs, ni deux foleils apperçûs à-la-fois dans la
ville d’Albe, ni la foudre tombée fur plufieurs temples
des dieux, ne firent point fur le peuple la même
impreïïion qu’un accident arrivé de nuit par une pure
négligence humaine. On en fit une punition exemplaire
; le pontife n’eut d’égard qu’à la loi ccefa fla -
gro efiveflalis ; toutes les affaires cefferent, tant publiques
que particulières ; on alla en procefllon au
temple de Vefta,8c on expia<Ie crime de la veftale
par l’immolation des grandes viftimes. L’appréhen-
fion du peuple romain portoit cependant à faux dans
cette occafion ; Sc- cet accident qui avoit mis tout
Rome en mouvement, fut précédé du triomphe de
Marcus Livius & de Claudius Néron, 8c fuivi des
grands avantages par lefquels Scipion finit la guerre
d’Efpagne contre les Carthaginois'.
Quoi qu’il en foit, quand 1 efeu facré venoit à s’éteindre
par malheur, on ne fongeoit qu’à le rallumer
le plûtôt poflible: mais comment s’y prenoit-on ?
car il ne falloit pas ufer pour cela d’un feu matériel-,
comme fi ce feu nouvéau ne pouvoit être qu’un pré-
fent du ciel? du moins, félon Plutarque, il n’etoit
permis de le tirer que des rayons même du Soleil-: à
l’aide d’un vafe d’airain les rayons venant à fe réunir,
la matière feche 8c aride fur laquelle tomboient
ces rayons, s’allumoit aufîi-tôt ; ce vafe d’airain
étoit, comme l’on voit, une efpece de miroir ar-
*kdent. F o y e{ A rdent.
On fait que Feftus n’eft point d’accord avec Plutarque
fur ce fujet ; car il affûre que pour rallumer
1 efeu facré, on prenoit une table de bois qu’on perçoit
avec lin vilbrequin, jufqu’à ce que l’attrition
produisît du feu qu’une veftale recevoit dans un crible
d’airain, & le portoit en hâte au temple de Vefta,
bâti par Numa Pompilius; & alors elle jettoit ce
feu dans des réchauds ou vaiffeaux de terre , qui
étoient placés fur l’autel de la déeffe.
Lipfe adopte ce dernier fentiment de Feftus , &
foûtient que le paffage de Plutarque cité ci - deffus,
fe doit entendre des Grecs & non des Romains, d’autant
mieux que les vafes creux dont il parle, 8c qui
n’étoient autre chofe que les miroirs paraboliques ,
ont été inventés par Archimede, lequel eft poftérieur
à Numa de plus de 500 ans.
Cependant, outre qu’on ne peut guere appliquer
les paroles de Plutarque à la coûtume des Grecs fans
leur faire une grande violence, il feroit aifé de concilier
Feftus 8c Plutarque, en ayant égard aux divers
tems de la république. Je croirois donc que depuis
Numa jufqu’à Archimede, les Romains ignorant l’u-
fage des miroirs ardens, ont pû fe fervir de l’invention
de produire du feu qui eft décrite par Feftus :
mais depuis qu’Archimcde eut fait des épreuves
merveilleufes avec fes miroirs, 8c fur-tout depuis
qu’il en eut écrit un livre exprès, comme Pappus le
rapporte, cette invention fut connue de tout le monde
, & pour lors les Romains s’en fcrvirent fans doute
comme d’un moyen plus noble 8c plus facile que
tout autre pour rallumer le feu facré. Article de M. le
Chevalier DE J AU c o u R T .
F e u x d’A r t Oh c e , compofition de matières
combuftibles, faite dans les réglés de l’art (Voye^
Pyro te ch n ie) , pour fervir ou dans les grandes
occafions de joie, ou dans la guerre, pour être:employée
comme arme offenfive, qu comme moyen
brillant de réjoüiffance.
Le méchanifme d’un feù d'artifice dans les deux
genres ; la partie phyfique qui guide fa compofition,
la géométrique qui la diftribue, font des objets déjà
iraités dans Xarticle A r t i f i c e ; dans les fâvans écrits
de M. Frezier ; & , en 1750, dans un traité desfeux
d'artifice de M. Perrinet d’Orv al, où la clarté, mille
chofes nouvelles, le defir d’en trouver encore beaucoup
d’autres, l’indication des moyens pour y parvenir,
montrent cette fagacité fi utile aux progrès
des Arts, cette étude aflidue des caufes 8c des effets,,
cette opiniâtreté dans les expériences, qui carafté-
rifent à-la-fois une théorie profonde 8c une pratique
sürè. )Voÿe{ l'article fuivant.
Je ne crois point de voir toucher à ces objets ; je
ïi’ai cherché à les connoître qu’autant qu’ils m’ont
paru liés aux grands fpeûacles que les rois, les v illes
, les provinces, &c. offrent aux peuples dans les
occafions folennelles : ils m’ont paru dans ce cas tenir
& devoir être foûmis à des lois générales, qui furent
toûjours là f egle de tous les Arts.
L’artificier doit donc > par exemple, avoir devant
■ les yeux fans ceffe, en formant le plan de différens
feux qu’il fait entrer dans fa compofition, non-feulement
de les affortir les uns avec les autres, de faire
reffortir leurs effets par des contraftes, d’animer les
couleurs par les mouvemens, & de donner à leur rapidité
la plus grande ou la moindre yîteffe> &c. mais
encore de combiner toutes ces parties avec le plan
général du fpe&acle que la décoration indique»
Cette loi primitive fait affez preffentir le point
fixe où l’art a toûjours voulu atteindre. Il eft dans
la nature de la chofe même, que tout fpe&acle repréfente
quelque chofe : or on ne repréfente rien dans
Ces occafions, lorfqu’on ne peint que des objets fans
aétion ; le mouvement de la rufee la plus brillante, fi
elle n’a point de but fixe, ne montre qu’une traînée
de feli qui fe perd dans les airs.
Ces feux d'artifice qui repréfentent feulement 8c
comme en répétition, par les différens effets des couleurs
, des mouvemens, des brillans du feu , la décoration
fur laquelle ils font pofés, fût-elle du plus ingénieux
deffein, n’auront jamais que le frivole mérité
des découpures. 11 faut peindre dans tous les
Arts ; 8c dans ce qu’on nomme fpectacle, il faut peindre
par les aûions. Les exemples de ce genre de
feux d'artifice font répandus dans les différens articles
de l’Encyclopédie qui y ont quelque rapport.
Voyer FÊTES , FÊTES DE LA VlLLE DE PARIS , &c.
Les Chinois ont pouffé l’art pour la variété des
formes, des couleurs, des effets, jufqu’au dernier
période. Les Mofcovites font fupérieurs au refte de
l ’Europe , dans les combinaifons des figures, des
mouvemens, des contraftes du feu artificiel: pourquoi
dans le fein de la France, ne pourrions - nous
pas en adoptant tout ce que ces nations étrangères
ont déjà trouvé, inventer des moyens, des fe-
cours nouveaux, pour étendre les bornes d un art
dont les effets font déjà fort agréables, & qui pour-
roient devenir aufli honorables pour les inventeurs,
qu’honorables pour la nation ? .
Y a-t-il eu encore rien d’aufli impofant en feu a artifice
, que le feroit le combat des bons anges contre
les méchans ? Les airs font le lieu de la feene, indiqué
par l’ aftion même ? Les détails font offerts par
le fublime Milton. Deflinez à votre imagination,
échauffée par cette grande image, l’attaque, le combat
, la chûte ; peignez-vous le fpettacle magnifique
de ce moment de triomphe des bonsanges j calcu -
Tome VI» ,
lez les coups d’un effet sur, qui naiffent en foule dé
ce grand fujet.
Mais ii faudroit donc employer à tous ceS fpec-
tacles des machines ? Et pourquoi non ? A quoi def-
tinera-t-on ces ingénieufes reiTources de l’art, fi on
les laiffe oifivés dans les plus belles occafions ? Sans
doute qii’il faudroit donner à l’artifice du f e u , dan9
ces repréfentations furprenantes, le fecours des belles
machines * qui en ranimant l’aftion, entretiert-
droient Fillufion qui eft le charme le plus néceffaire.
Les Arts ne font-ils pas deftinés à s’entre-aider- &
à s’unir enfemble ?
On vit à Paris, le 24 janvier 1730 * une fête aufli
belle que toutes celles qu’on y avoit données dans
les occafions d’éclat. J’en vais donner l’efquifle, parce
qu’elle fervira de preuve à la propofition que j’ai
avancée fur l’aâion que je fouhaite dans les feux
d'artifice-> 6c aux principes que je propofe plus haut
fur leur compofition. Voye^ Fêtes de l a C o u r .
La naiffance de monfeigneur le Dauphin fut le
fujet de cette fête. MM. de Santa-Crux & de Bare-
nechea, ambaffadeurs du roi d’Efpagne , en avoient
été chargés^par S. M. Catholique.
L’hôtel de Bouillon fitué fur le quai des Théatins
vis-à-vis le Louvre, fervit d’emplacement à la feene
principale ; il fut comme le centre de la fête & du
fpe&acie.
Le 24 Janvier 1730, à 6 heures du foir,. les illuminations
préparées avec un art extrême, & dont
on trouvera ailleurs la defeription {V o y e \ Illum in
a t ion ) , commencèrent avec la1 plus grande célér
rite, & la furface de la riviere offrit tout-à-coup un
fpeétacle enchanteur ; c’étpit un vafte jardin de l’un à
l’autre rivage du fleuve, qui à cet endroit.a environ
90 toifes de large, fur un efpace de70 dans fa longueur.
La fituation étoit des plus magnifiques & des
plus avantageufes, étant naturellement bien décorée
par le quai du college des Quatre-Nations d’un
côté, par celui des galeries du Louvre de l’autre, Ô£
aux deux bouts ptar le Pont-Neuf & par le Pont-
Royaî.
Deux rOehers ifolés ou montagnes efcarpées,fym-
boie des monts Pyrénées, qui féparent la France de
l’Efpagne, formoient lé principal objet de cette pora—
peufe décoration au milieu de la riviere. Les deux
monts étoient joints par leurs bafes fur un plan d’environ
140 piés de long, fur 60 de large, & féparés
par leur cime de près de 40 piés, ayant chacun
piés d’élévation au-deffus de la furface dé. l’eau, 8c
des deux grands bateaux fur lefquels tout l ’édifice
étoit conftruit.
On voyôit une agréable variété filf ces monta-’
gnes, ôù la nature étoit imitée avec beaucoup d’art
dans tout ce qu’elle a d’agrefte 8c de fauvage. Dans
un endroit c’étoient des crevaffes, avec des quartiers
de rochers en faillie : dans d’autres, des plantes’
8c des arbuftes, des cafcades, des nappes 8c chûtes
d’eau imitées par des gafes d’argent, des antres, des
cavernes , &c. Il y avoit tout au pourtour, à fleur-
d’eau, des firénes, des tritons , des néréides, 8c au1-
très monftres marins.
A une certaine diftance, aü-deffus 8c au-deflbus’
des rochers, on voyoit à fleur d’eau deux parterres
de lumières qui occupoient chacun un efpace de 18
toifes fur 15 , dont les bordures étoient ornées alternativement
d’ifs 8c d’orangers j avec leurs fruits ,
de 12 piés de haut, chargés de lumières. Le deffein
des parterres étoit tracé 8c figuré d’une maniéré variée
8c agréable par des terrines, par du gazon 8c,
du fable de diverfes couleurs.
Du milieu de chacun de ces parterres s’éievoient
des efpeces de rochers jufqu’à la hauteur de 15 piés,'
fur un plan de 30 piés fur 22. On avoit placé au-
deffus une figure coloffale, bronzée en ronde boffez’
M M m m ij