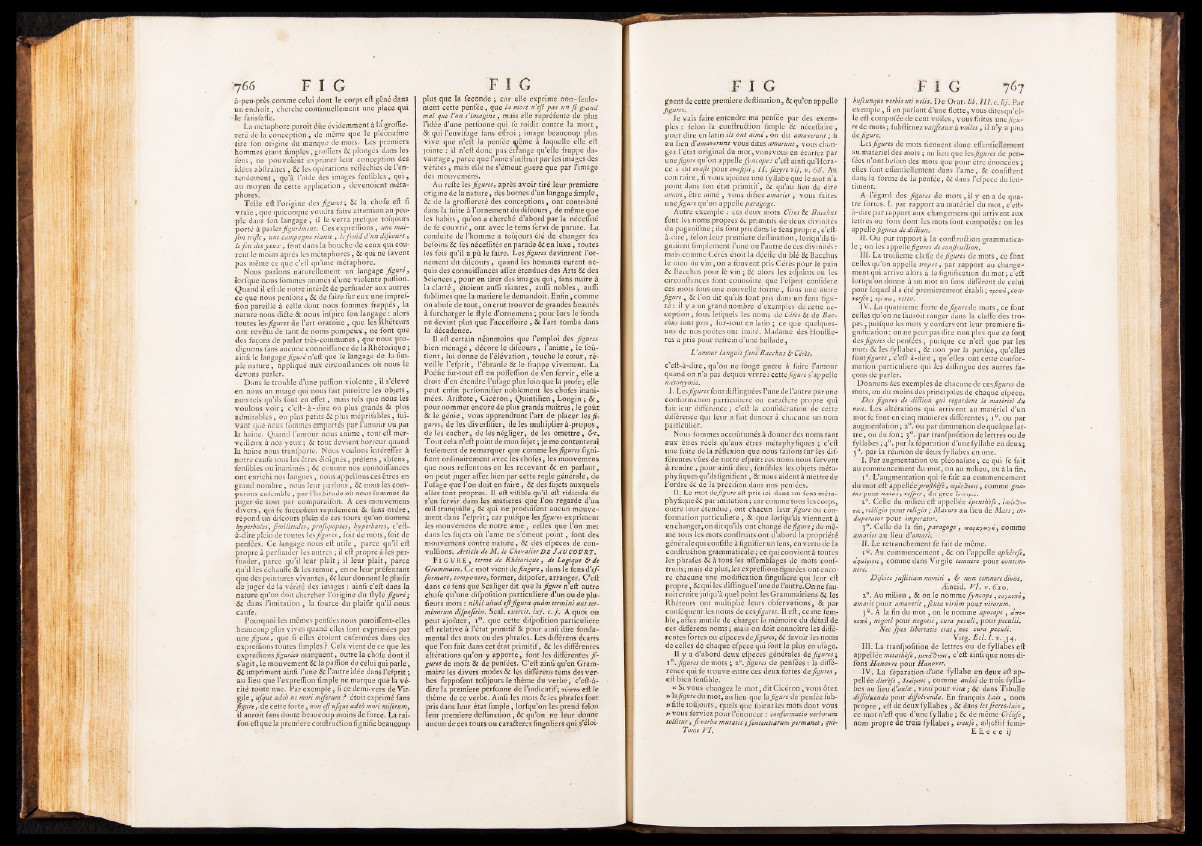
7 66 F I G à-peu-près comme celui dont le corps eft gêné dans
un endroit, cherche continuellement une place qui
-le fatisfafle. t
La métaphore paroît due évidemment à la groflie-
reté de la conception, de même que le pleonafme
tire l'on origine du manque de mots. Les premiers
• hommes étant Amples, grolîiers 8c plongés dans les
fens, ne pouvoient exprimer leur conception ^des
idées abftraites , 8c les opérations réfléchies de 1 entendement
, qu’à l’aide des images fenfibles, qui,
au moyen de cette application , devenoient métaphores.
Telle eft l’origine des figures ; 8c la choie eft fi
vraie , que quiconque voudra faire attention au peuple
dans fon langage , il le verra prelque toujours
porté à parlerfigurement. Ces exprelfions, une mai-
J'ott trifte , une campagne riante , le fro id d'un difcours ,
le feu des y e u x , font dans la bouche de ceux qui courent
le moins après les métaphores, & qui ne lavent
pas même ce que c’eft qu’une métaphore.
Nous parlons naturellement un langage figuré,
lorfque nous fommes animés d’une violente paflion.
Quand il eft de notre intérêt de perfuader aux autres
ce que nous penfons, & de faire fur eux une impref-
fion pareille à celle dont nous fommes frappes, la
nature nous difre & nous infpire fon langage alors
toutes les figures de l’art oratoire , que les Rhéteurs
ont revêtu de tant de noms pompeux, ne font que
des façons de parler très-communes , que nous prodiguons
fans aucune connoilfance de la Rhétorique ;
ainfi le langage figuré n’eft que le langage de la Ample
nature, appliqué aux circonftances oit nous le
devons parler.
Dans le trouble d’une paflion violente, il s’élève
en nous un nuage qui nous fait paroître les objets,
non tels qu’ils font en effet, mais tels que nous les
voulons voir; c’eft-à-dire ou plus grands & plus
admirables, ou plus petits 8c plus méprifables, fui-
vant que nous fommes emportés par l’amour ou par
la haine. Quand l’amour nous anime, tout eft merveilleux
à nos yeux ; & tout devient horreur quand
la haine nous tranfporte. Nous voulons intéreffer à
notre caufe tous les êtres éloignés, prélens, abfens,
fenfibles ou inanimés ; 8c comme nos connoiffances
ont enrichi nos langues, nous appelions ces êtres en
grand nombre, nous leur parlons, 8c nous les comparons
enl'emble, par l’habitude oit nous fommes de
juger de tout par comparaifon. A ces mouvemens
divers, qui fe fuccedent rapidement & fans ordre,
répond un difcours plein de ces tours qu’on nomme
hyperboles, fimilitudes, profopopées, hyperbates, c’eft-
à-.dire plein de toutes les figures, foit de mots, foit de
penfées. Ce langage nous eft utile , parce qu’il eft
propre à perfuader les autres ; il eft propre à les persuader
, parce qu’il leur plaît ; il leur plaît, parce
qu’il les échauffe & les remue, en ne leur préfentant
ue des peintures vivantes, 8c leur donnant le plaifir
e juger de la vérité des images : ainfi c’eft dans la
nature qu’on doit chercher l’origine du ftyle figuré ;
8c dans l’imitation , la fource du plaifir qu’il nous
caufe.
Pourquoi les mêmes penfées nous paroiffent-elles
beaucoup plus vives quand elles font exprimées par
une figure, que fi elles étoient enfermées dans des
exprelfions toutes fimples ? Cela vient de ce que les
expreflion s figurées marquent, outre la chofe dont il
s’agit, le mouvement 8c la paflion de celui qui parle,
& impriment ainfi l’une & l’autre idée dans l’efprit ;
au lieu que l’expreflion fimple ne marque que la vérité
toute nue. Par exemple, fi ce demi-vers de Virgile
, ufque adeb ne mori miferum ? étoit exprimé fans
figure,- de cette forte, non ejl ufque adeb mori miferum,
il anroit fans doute beaucoup moins de force. La rai-
fon eft que la première conftruftion fignifie beaucoup
plus que la fécondé ; car elle exprime non-feulement
cette penfée, que la mort n'efl pas un f i grand
mal que l'on s'imagine, mais elle repréfente de plus
l’idée d’une perfonne qui fe roidit contre la mort,
& qui l’envilage fans effroi ; image beaucoup plus
vive que n’elt la penfée même à laquelle elle eft
jointe : il n’eft donc pas étrange qu’elle frappe davantage
, parce que l’ame s’inftruit par les images des
vérités, mais elle ne s’émeut guere que par l’image
des mouvemens.
Au refte les figures, après avoir tiré leur première
origine de la nature, des bornes d’un langage fimple,
8c de la grofliereté des conceptions, ont contribué
dans la fuite à l’ornement du difcours, de même que
les habits, qu’on a cherché d’abord par la nécemté
de fe couvrir, ont avec le tems fervi de parure. La
conduite de l’homme a toujours été de changer fes
befoins 8c fes néceflîtés en parade & en luxe, toutes
les fois qu’il a pû le faire. Les figures devinrent l’ornement
du difcours, quand les hommes eurent acquis
des connoiffances allez étendues des Arts 8c des
Sciences, pour en tirer des images qui, fans nuire à
la clarté, étoient aufli riantes, auflî nobles, aufli
l'ublimes que la matière le demandoit. Enfin, comme
on abufe de tout, on crut trouver de grandes beautés
à furcharger le ftyle d’ornemens ; pour lors le fonds
ne devint plus que l’acceffoire , & l’art tomba dans
la décadence.
Il eft certain néanmoins que l’emploi des figures
bien ménagé, décore le difcours , l’anime, le foû-
tient, lui donne de l’élévation, touche le coeur, réveille
l’efprit, l’ébranle 8c le frappe vivement. La
Poéfie fur-tout eft en pofleflion de s’en fervir, elle a
droit d’en étendre l’ufage plus loin que la profe; elle
peut enfin perfonnifier noblement les chofes inanimées.
Ariftote, Cicéron, Quintilien , Longin ; & ,
pour nommer encore de plus grands maîtres, le goût
& le génie, vous apprendront l’art de placer les fi-,
gures, de les diverfifier, de les multiplier à-propos,
de les cacher, de les négliger, de les omettre, 6*c.
Tout cela n’eft point de mon fujet ; je me contenterai
feulement de remarquer que comme les figures lignifient
ordinairement avec les chofes, les mouvemens
que nous reflentons en les recevant & en parlant,
on peut juger affez bien par cette réglé générale, de
l’ufage que l’on doit en faire, 8c des fujets auxquels
elles font propres. Il eft vifible qu’il eft ridicule de
s’en fervir dans les matières que l’on regarde d’un
oeil tranquille, 8c qui ne produifent aucun mouvement
dans l’efprit ; car puifque les figures expriment
les mouvemens de notre a me , celles que l’on met
dans les fujets où l’ame ne s’émeut point, font des
mouvemens contre nature, 8c des efpeces de con-
vulfions. Article de M . le Chevalier D E J A V C O U R T .
FIGURE , terme de Rhétorique , de Logique & de
Grammaire. Ce mot vient de fingere, dans le fens d 'e f
formate, componere, former, difpofer, arranger. C’eft
dans ce fenS que Scaliger dit que la figure n’eft autre
chofe qu’une difpofition particulière d’un ou de plu-
fieurs mots : nihil aliud efi figura quam terminé aut ter-
minorum difpojitio. Seal, exercit. Ix j. c. j . A quoi on
peut ajouter, i°. que cette difpofition particulière
eft relative a l’état primitif & pour ainfi dire fondamental
des mots ou des phrafes. Les différens écarts
que l’on fait dans cet état primitif, & les différentes
altérations qu’on y apporte, font les différentes f i gures
de mots & de penfées. C’eft ainfi qu’en Grammaire
les divers modes & les différens tems des verbes
fuppofent toujours le thème du verbe, c’eft-à-
direla première perfonne de l’indicatif; tv^rru eft le
thème de ce verbe. Ainfi les mots 8c les phrafes font
pris dans leur état fimple, lorfqu’on les prend félon
leur première deftination, & qu’on ne leur donne
aucun de ces tours ou carafteres fmguliers qui s’éloi-
F I G gflent de cette première deftination, & qu'on appelle
figures. MH I
Je vais faire entendre ma penfee par dés exemples
: félon la conftruûion fimple 8c nécefîaire,
pour dire en latin ils ont aimé , on dit amaverunt ; fi
au lieu d’amaverunt vous dites amarunt, vous changez
l’état original du mot, vous vous en écartez par
une figure qu’on appelle fyncope : c’eft ainfi qu’Hora-
ce a àitevajli pour evajifii, ll. fa ty r e v ij. v, 68. Au
contraire, fi vous ajoutez une fyllabe que le mot n’a
point dans l’on état primitif, 8c qu’au lieu de dire
amari, être aimé , vous difiez amarier, vous faites
line figure qu’on appelle paragoge.
Autre exemple : ces deux mots Cères 8c Bacchus
font les noms propres 8c primitifs de deux divinités
du paganifme ; ils font pris dans le fenS propre, c’eft-
à-dire, félonJeur première deftination, lorfqu’ils fi-
gnifient Amplement l’une ou l’autre de ces divinités :
mais comme Cérès étoit la déeflè du blé & Bacchus
le dieu du vin, on a fouvent pris Cérès pour le pain
8c Bacchus pour lè vin ; & alors les adjoints ou les
circonftances font connoître que l’efprit confidere
ces mots fous une nouvelle forme , fous une autre
figure , & l’on dit qu’ils font pris dans un fens figuré
: il y a un grand nombre d’exemples de cette acception
, fous lefquels les noms de Cérès & de Bacchus
lont pris , fur-tout en latin ; ce que quelques-
uns de nos poètes ont imité. Madame des Houllie-
res a pris pour refrein d’une ballade,
L'amour languit fans Bacchus & Cérès *
c’eft-à-dire, qu’on ne fonge guere à faire l’amour
quand on n’a pas dequoi vivre : cette figure s’appelle
métonymie.
I. Les figures font diftinguées l'une de l’autre par une
conformation particulière ou caraftere propre qui
fait leur différence ; c’eft la confidération de cette
différence qui leur a fait donner à chacune un nom
particulier.
Nous fommes accoutumés à donner des noms tant
aux êtres réels qu’aux êtres métaphyfiques ; c’eft
une fuite de la réflexion que nous failons fur les différentes
vues de notre efprit : ces noms nous fervent
à rendre, pour ainfi dire, fenfibles les objets méta*
phyfiques qu’ils fignifient, & nous aident à mettre de
l ’ordre 8c de la précifion dans nos penfées.
II. Le mot défiguré eft pris ici dans un fens méta-
phyfique 8c par imitation ; car comme tous les corps,
outre leur étendue, ont chacun leur figure ou conformation
particulière , & que lorfqu’ils viennent à
en changer, on dit qu’ils ont changé aé figure ; de même
tous les mots conftruits ont d’abord la propriété
générale qui confifte à fignifier un fens, en vertu de la
eonftrufrion grammaticale ; ce qui convient à toutes
les phrafes & à tous les aflemblages de mots conf-
triuts; mais de plus,les exprelfions figurées ont encore
chacune une modification fihguliere qui leur eft
propre, &qui les diftingue l’une de l’aùtre.On ne fau-
roitcroire jufqu’àquel point les Grammairiens 8c les
Rhéteurs ont multiplié leurs obfervations, & par
conféquent les noms de ces figures. Il eft, ce me fem-
ble, allez inutile de charger la mémoire du détail de
ces différens noms ; mais on doit connoître les différentes
fortes ou efpeces de figures, 8c fa voir les noms
de celles de chaque efpece qui font le plus en ufage.
Il y a d’abord deux efpeces générales de figures ;
i ° . figures de mots ; 2°. figures de penfées : la différence
qui fe trouve entre ces deux fortes de figures,
eft bien fenfible.
« Si vous changez le mot, dit Cicéron, vous ôtez
» lafigure du mot, au lieu que la figure de penfée fub-
» fille toûjours, quels que foientles mots dont vous
» vous ferviez pour l’énoncer : conformatio verborum
tollitur , f i verba mutatis ; fententiarum permanet, qui-
Tome y i .
F I G 7 6 7
hufcuYiqüè ‘virbis uti velis. De Orat. lib. î î t . c. lij . Par
exemple, fi en pariant d’une flotte, vous dites qu’elle
eft compofée de cent voiles, vous faites une figu*
re de mots ; fubftituez vaijfeaux à voiles , il n’y a plus
de figure.
Les^figures de mots tiennent donc eflentiellement
au matériel des mots ; au lieu que les figures de pen-
fees n’ont befoin des mots que pour être énoncées ;
elles font eflentiellement dans l’ame, & confiftenC
dans la forme de la penfée, 8c dans l’efpece du fen-
timentt'
A l’égard des figures de mots, il y en a de quatre
fortes. L par rapport au matériel du mot, c’eft-
à-dire par rapport aux changemens qui arrivent aux
lettres ou fons dont les mots font compofés t on les
appelle figures de diction.
II. Ou par rapport à la cOnftrufrion grammaticale
; on les appelle figures de conjlrùction.
III. La troifieme clafle de figures de mots, ce font
celles qu’on appelle tropes, par rapport au changement
qui arrive alors à la fignification du mot ; c’eft
lorfqu’on donne à un mot un fens différent de celui
pour lequel il a été premièrement établi; TfO'a»i con-
verfio ; tpi7ra, verto.
IV. La quatrième forte de figure de mots, ce font
celles qu’on ne fauroit ranger dans la claffe des tropes
, puifque les mots y confervent leur première fignification
: on ne peut pas dire non plus que ce font
des figures de penfées, puifque ce n’eft que par les
mots & les fyllabes, 8c non par la penfee, qu’elles
fontfigures, c’eft-à-dire , qu’elles ont cette conformation
particulière qui les diftingue des autres façons
de parier.
Donnons des exemples de chacune de cesfigures de
mots, ou du moins des principales de chaque efpece.
De s figures de diction qui regardent U matériel du
mot. Les .altérations qui arrivent au matériel d’un
mot fe font en cinq maniérés différentes ; i°. ou par
augmentation ; z°. ou par diminution de quelque lettre
, ou du fon ; 30. par tranfpofition de lettres ou de
fyllabes ; 40. par la féparatiort d’une fyllabe en deux;
ç°. par la réunion de deux fyllabes en une.
I. Par augmentation'ou pleonafme ; ce qui fe fait
au commencement du mot, ou au milieu, ou à la fin. - i°. L’augmentation qui fe fait au commencement
du mot eft appellée'projihêfe , ■ npoçd-itnç, comme gna-
tus pour natus, vefper, du grec Icwtpoç.
20. Celle du milieu éft appellée épentkèfe, itslvàt-
tric, relligio pour religio ; Mavors au lieu de Mars; in•
duperator pour imperator.
■ 30. Celle de la Un,paragoge , <aa.petyuyé, comme
amarier au lieu dé amari.
II. Le retranchement fe fait de même.
i fi. Au commencement, 8c on l’appelle aphérefe,
ttçctipunç, comme dans Virgile temnere pour contenir
nere.
Difcite juftitiam moniti , & non temnere divos.
Æneid. VJ. v. 620.
20. Au milieu , & on le nomme fyncope, Guynm» ,
amarit pour amaverit ,fcuta virum pour virorum.
30. Â la fin du mot, on lé nomme apocope , «Vo-
Kové, negotî pour negotii, cura peculi, pour peculii.
N te fpes libertatis erat, nec cura peculi.
Virg. E c l. I. v. 34.
III. La tranfpofition de lettres ou de fyllabes eft
appellée metathèfe, p.trdSttriç, c’eft ainfi que nous di-
fons Hanovre pour Hanover.
IV. La féparation d’une fyllabe en deux eft appellée
dierèfe, S'iaipttru , comme auldi de trois fyllabes
au lieu d'aulce , virai’pour vitoe; 8c dans Tihulle
diffoluenda pour diffolvenda. En françois Lais , nom
propre , eft de deux fyllabes , 8c dans les freres-lais,
c e mot n’eft que d’une fyllabe ; & de même Créüfe,
nom propre de trois fyllabes, creufe, adjeftif femi-
E E e e e ij