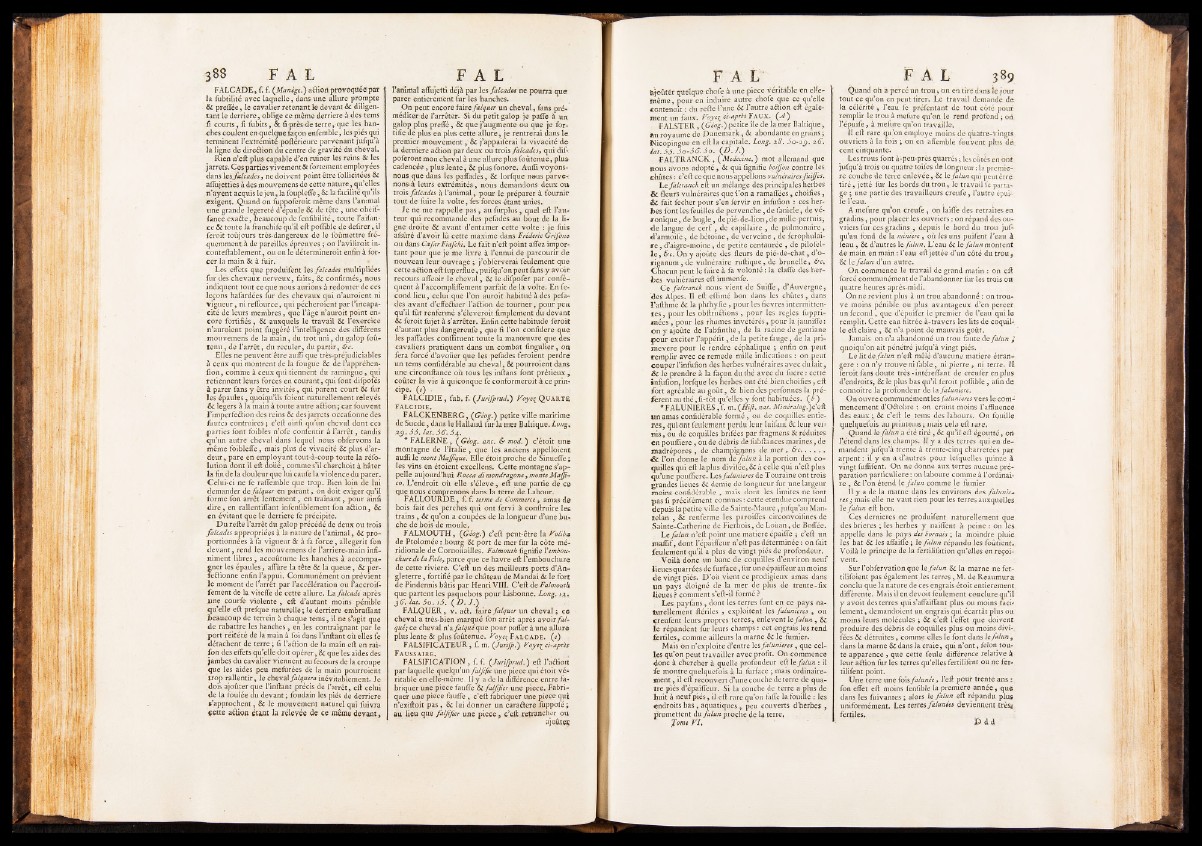
FALCADE, f. f. (Manège.) aftiort provoquée par
la fubtilité avec laquelle, dans-une allure prompte
& preffée, -le cavalier retenant le devant & diligentant
le derrière, oblige ce même derrière à des tems ;
-li courts, fi fubits, & fi près-de terre,-que les hanches
coulent emcpielque iaçon enfemble, les pies qui ;
terminent l’extremite pofterieure parvenant jufqu’à
la ligne de direction du centre de gravité du cheval.
Rien n’eft plus capable d’en ruiner les reins & les
jarrets. Ces parties vivement & fortement employées
dans les falcades, ne doivent point être follicitées &
affujetties à des mouvemens de cette nature, qu’elles
n’ayent acquis le jeu, la foupleffe, & la facilité qu’ils
exigent. Quand on fuppoferoit même dans l’animal
line grande legereté d’épaule & de tête , une obéif-
fance exaéle, beaucoup de fenfibilité, toute l’aifaii-
jcc & toute la franchife qu’il eft poffible de defirer, il
feroit toujours très-dangereux de le foûmettre fré-
quemment-à de pareilles épreuves ; on l’aviliroit in-
conteftablement, ou on le détermineroit enfin à forcer
la main & à fuir.
Les effets que produifent les falcades multipliées
fur des chevaux nerveux, faits, de confirmés, nous
indiquent tout ce que nous aurions à redouter de ces
leçons hafardées fur des chevaux qui n’auroient ni
vigueur, ni reffource, qui pécheroient par l’incapacité
de leurs membres, que l’âge n’auroit point encore
fortifiés, & auxquels le travail & l’exercice
n’auroient point fuggéré l’intelligence des différëns
mouvemens de la main, du trot uni, du galop fou-
tenu , de l’arrêt, du reculer, du partir, &c.
Elles ne peuvent être auffi que très-préjudiciables
à ceux qui montrent de la fougue & de l ’appréhen-
fion, comme à ceux qui tiennent du ramingue, qui
retiennent leurs forces en courant, qui font difpolés
à parer fans y être inyités, qui parent court & fur
les épaules, quoiqu’ils foient naturellement relevés
& légers à la main à toute autre a&ion ; car fouvent
. l ’imperfeélion des reins &c des jarrets occafionne des
fautes contraires ; c’eft ainfi qu’un cheval dont ces
/parties font foibles n’ofe conlentir à l’arrêt, tandis
qu’un autre cheval dans lequel nous obfervons la
même foibleffe, mais plus de vivacité & plus d’ardeur,
pare en employant tout-à-coup toute la iréfo-
lution dont il eft doiié, comme s’il cherchoit à hâter
la fin de la douleur que lui caufe la violence du parer.
Celui-ci ne fe raffemble que trop. Bien loin de lui
demander de falquer en parant, on doit exiger qu’il
forme fon arrêt lentement, en traînant, pour ainfi
d ire, en rallentiffant infenfiblement fon a â io n , &
en évitant que le derrière fe précipite.
Du refte l’arrêt du galop précédé de deux ou trois
falcades appropriées à la nature de l’animal, & proportionnées
à fa vigueur & à fa force, allegerit fon
devant, rend les mouvemens de l’arriere-main infiniment
libres, accoutume les hanches à accompagner
les épaules, affûre la tête & la queue, & perfectionne
enfin l’appui. Communément on prévient
le moment de Jarret par l’accélération ou l’accroif-
fement de la vîteffe de cette allure. La falcade après
line courfe violente , eft d’autant moins pénible
qu’elle eft prefque naturelle ; le derrière embraffant
beaucoup de terrein à chaque tems, il ne s’agit que
de rabattre les hanches, en les contraignant par le
port réitéré de la main à foi dans l’inftant où elles fe
détachent de terre ; fi l’aCtion de la main eft en rai-
fon des effets qu’elle doit opérer, & que les aides des
jambes du cavalier viennent au fecours de la croupe
que les aides peu mefürées dé la main pourroient
trop rallentir, le cheval falqucr a inévitablement. Je
dois ajouter que l’inftant précis de l’arrêt, eft celui
de la foulée du devant ; foudain les piés de derrière
s’approchent, & le mouvement naturel qui fuivra
$ette aâion étant la relevée de ce même devant,
l’animal affujetti déjà par les falcades ne pourra que
parer entièrement fur les hanches.
On peut encore faire falqucr un cheval, fans préméditer
de l’arrêter. Si du petit galop je paffe à un
galop plus preffé, & que j’augmente ou que je fortifie
de plus en plus cette allure, je rentrerai dans le
premier mouvement, & j’appaiferai la vivacité de
la derniere a&ion par deux ou trois falcades, qui dif-.
poferont mon cheval à une allure plus foûtenué, plus
cadencée, plus lente, & plus fonore. Auffi voyons-
nous que dans les paffades, & lorfque nous parvenons^
leurs extrémités, nous demandons deux oi»
trois falcades à l’animal, pour le préparer à fournir
tout de fuite la volte, fes forces étant unies.
Je ne me rappelle pas, au furplus, quel eft l’au-
teur qui recommande des pefades au bout de la ligne
droite & avant d’entamer cette volte : je fuis
afsûré d’avoir lû cette maxime dans Frédéric Grifone
ou dans CoefarFiafchi. Le fait n’eft point affez impor-,
tant pour que je me livre à l’ennui de parcourir de
nouveau leur ouvrage ; j’obferverai feulement que
cette aâion eft fuperflue, puifqu’on peut fans y avoir
recours affeoir le cheval, & le difpofer par confér
quent à raccompliffement parfait de la volte. En fécond
lieu, celui que l’on auroit habitué à des pefades
avant d’effeûuer l’aélion de tourner, pour peu
qu’il fût renfermé s’éleveroit fimplement du devant
& feroit fujet à s’arrêter. Enfin cette habitude feroit
d’autant plus dangereufe, que fi l’on confidere que
les paffades conftituent toute la manoeuvre que des
cavaliers pratiquent dans un combat fingulier, on
fera forcé d’avoiier que les pefades feroient perdre
un tems confidérable au cheval, & pourroient dans
une circonftance oii tous les inftans font prétieux ,
coûter la vie à quiconque fe conformeroit à,ce prin-
cipe. ( .) .
FALCIDIE, fub. f. (Jurifprud.) Voye^ Q u a r t e
FALCIDIE.
FALCKENBERG, ([Géog.) petite v ille maritime
de Suede, dans le Halland fur la mer Baltique. Long*
z$ . 55, lat. 56. 5q.
* FALERNE, ( Géog. anc. & mod. ) c’étoit une
montagne de l’Italie, que les anciens appelaient
auffi le mont MaJJiquè. Elle étoit proche de Sinueffe ;
les vins en étoient excellens. Cette montagne s’appelle
aujourd’hui Rocca dimondragone, monte MaJJi-
co. L’endroit où elle s’é lè v e , eft une partie de c©
que nous comprenons dans la t'erre de Labour.
FALLOURDE, f. f . terme de Commerce , amas de
bois fa it des perches qui ont fe rv i à conftruire les
trains , & qu’on a coupées de la longueur d’une huche
de bois de moule.
FALMOUTH, (Géog.} c’eft peut-être la Voliba
de Ptolomée : bourg & port de mer fur la côte méridionale
de Cornouailles. Falmoutk lignifie ¥ embouchure
de la Faley parce que ce havre eft l’embouchure
de cette riviere. C ’eft un des meilleurs ports d’Angleterre
, fortifié par le château de Mandai & le fort
de Pindennis bâtis par Henri VIII. C ’eft de Falmoutk
que partent les paquebots pour Lisbonne. Long, i z .
3 6 . lat. 5o. i5. ( D . J .)
FALQUER, v . a&. faire falquer un cheva l ; c e
che va l a très-bien marqué fon arrêt après a v o ir fal-
qué; ce che va l n’a falqué que pour paffer à une allure
plus lente & plus foûtenue. Voye{ Fa l c a d e . (e)
FALSIFICATEUR, f. m. (,Jurifp.) Voycç ci-après
F a u s s a ir e .
FALSIFICATION , f. f. (Jurifprud. ) eft l’aéliotl
par laquelle quelqu’un faljîfie une piece qui étoit véritable
en elle-même. ïl y a de la différence entre fabriquer
une piece fauffe & faljifier une piece. Fabriquer
une piece fauffe , c’eft fabriquer une piece qui
n’exiftoit pas , & lui donner un caraétere fuppofe ;
au lieu que faljifier une piece , c’eft retrancher ou
ajoûteç
bjoûtér quelque ehofe à une piece Véritable en elle-
tnême, pour en induire autre chofe que ce qu elle
tfontenoit : du refte l ’une 6c l’autre aftion eft également
un faux. Voyefci-après Fa u x . (A ) .
FALSTER, (Géog.) petite île de la mer Baltique,
au royaume de Danemark, & abondante en grains ;
Nicopingue en eft la capitale. Long. z8. 5o-z$. zG.
lat. 55. 5o-56. 5o. (D . J.)
F A L T R A N C K . , (Médecine.) m o t a l l e m a n d q u e
h o u s a v o n s a d o p t é , & q u i f i g n i f i e boijfon c o n t r e l e s
c h û t e s : c ’ e f t c e q u e n o u s a p p e l i o n s vulnéraires fuijfes.
Le faltranck eft un mélange des principales herbes
& fleurs vulnéraires que Ton a ramaffées, choifies,
& fait fecher pour s’en fervir en infufion : ces her-
Jbes font les feuilles de pervenche, de faniele, de véronique,
de bugle, depié-de-lion,de mille-pertuis*
rie langue de cerf , de capillaire , de pulmonaire,
d ’armoife, de bétoine, de verveine , de fcrophulai-
r e , d’aigre-moine * de petite centaurée , de pilofel-'
l e , &c. On y ajoûte des fleurs de pié-de-chat, d’o-
riganum * de vulnéraire ruftique, de brunelle, &c,
Chacun peut le faire à fa volonté : la claffe des herbes
vulnéraires eft immenfe.
Ce faltranck nous vient de Suiffe, d’AuVergne,
des Alpes. Il eft eftimé bon dans les chûtes, dans
ï ’afthme & la phthyfie, pour les fievres intermittentes
, pour les obftruûions , pour les réglés fuppri--
«nées , pour les rhumes invétérés, pour la jauniffe
on y ajoûte de l’abfinthe, de la racine de gentiane
pour exciter l’appétit, de la petite fauge, de la pri-
anevere pour le rendre céphalique ; enfin on peut
remplir avec ce remede mille indications : on peut
couper l’infufion des herbes vulnéraires avec duîait,
& le prendre à la façon du thé avec du fucre : cette
infufion, lorfque les herbes ont été bien choifies, eft
fort agréable au goût, & bien des perfonnes la préfèrent
au thé, fi-tôt qu’elles y font habituées, (b )
* FALUNIERES, f. m. (Hifi. nat. Minéralogie’eft
«m amas confidérable formé, ou de coquilles entières
, qui ont feulement perdu leur luifant & leur vernis
, ou de coquilles brifées par fragmens & réduites
en pouffiere , ou de débris de fubftances marines, de
madrépores , de champignons de mer, &c.............
& l’on donne le nom de falun à la portion des coquilles
qui eft la plus divifée, & à celle qui n’eft plus
qu’une pouffiere. Les falunieres de Touraine ont trois
grandes lieues & demie de longueur fur une largeur
moins confidérable , mais dont les limites ne font
pas fi précifément connues : cette etendue comprend
depuis la petite ville de Sainte-Maure, jufqu’au Man-
tclan , & renferme les paroiffes circonvoifines de
Sainte-Catherine de Fierbois, de Loùan, de Boffée.
Le falun n’eft point une matière épaiffe ; c’eft un
maffif, dont l’épaiffeur n’eft pas déterminée : on fait
feulement qu’il a plus de vingt piés de profondeur.
Voilà donc un banc de coquilles d’environ neuf
lieues quarrées de furface, fur une épaiffeur au moins
de vingt piés. D ’oii vient ce prodigieux amas dans
lin pays éloigné de la mer de plus de trente-fix
lieues ? comment s’eft-il formé ?
Les payfans, dont les terres font en ce pays naturellement
ftériles , exploitent les falunieres , ou
çreufent leurs propres terres, ente vent le falun, &
le répandent fur leurs champs : cet engrais les rend
fertiles , comme ailleurs la marne & le fumier.
Mais on n’exploite d’entre les falunieres , que celles
qu’on peut travailler avec profit. On commence
donc à chercher à quelle profondeur eft le falun : il
fe montre quelquefois à la furface ; mais ordinairement
, il eft recouvert d’une couche de terre de quatre
piés d’épaiffeur. Si la couche de terre a plus de
huit à neuf piés, il eft rare qu’on faffe la fouille : les
endroits b as , aquatiques, peu couverts d'herbes ,
promettent du falun proche de la terre,
fouie f l .
Quand oli à percé un trou * on ch tiré dans lé jour
tout ce qu’on en peut tirer. Le travail demandé de
la célérité , l’eau fe. préfèntant de tout côté pouf
remplir le trou à mefure qu’on, le rend profond ; oA
l’épuife, à mefure qu’on travaillei
11 eft rare qu’on employé moins de quatre-vingts
oüvriers à la fois ; on en affemblé fouVent plus dé.
cent ciri'quante.
Les trous font à-peu-près qüarrés ; les cqtés en Ont
jufqu’à trois ou quatre toifes de longueur : la première
couche de terre enlevée, & le falun qui peut être
tiré, jetté fur les bords du trou, le travail fe partage
; Une partie des travailleurs creufe, l’autre épufc
fe l’eau.
A mefure qu’on creufe, oh laiffe des retraites en
gradins, pour placer les ouvriers : on répand des ouvriers
fur ces gradins , depuis le bord du trou jufc
qu’au fond de la minière , où les uns puifent l ’eau à
feau , ôc d’autres le falun. L’eau & le falun montent
de main en main : l’eau eft jettée d’un côté du trou ,
& le falun d’un autre.
On commence le travail de grand matin : on eft
forcé communément de l’abandonner fur les trois ou
quatre heures après-midi.
On ne revient plus à un trou abandonné : on trouve
moins pénible ou plus avantageux d’en percer
un fécond , que d’épuifer le premier de l’eau qui le
remplit. Cette eau filtrée à-travers les lits de coquil-,
le eft claire , & n’a point de mauvais goût.
Jamais on n’a abandonné un trou faute de falun l
quoiqu’on ait pénétré jufqu’à vingt piés.
Le lit de falun n’eft mêlé d’aucune matière étrangère
: on n’y trouve ni fable, ni pierre , ni terre. Il
feroit fans doute très-intéreffant de creufer en plus
d’endroits, & le plus bas qu’il feroit poffible, afin de
connoître la profondeur de la faluniere.
On ouvre communément les falunieres vers le commencement
d’O&obre : on craint moins l’affluence
dés eaux & c’eft le tems des labours. On fçuille
quelquefois au printems ; mais cela eft rare.
Quand le falun a été tiré , & qu’il eft égoutté, on
l’étend dans les.champs. II y a des terres qui en demandent
jufqu’à trente à trente-cinq charretées par
arpent : il y en a d’autres pour lefquelles quinze à
vingt fuffifent. On ne donne aux terres aucune préparation
particulière : on laboure comme à l’ordinaire
, & l’on étend le falun comme le fumier
Il y a de la marne dans les environs des falunieres;
mais elle ne vaut rien pour les terres auxquelles
le falun eft bon.
Ces dernieres ne produifent naturellement que
des brieres ; les herbes y naiffent à peine : on les.
appelle dans le pays des bornais ; la moindre pluiè
les bat & les affaiffe ; le falun répandu les foutient*.
Voilà le principe de la fertilifation qu’elles en reçoivent.
Sur l’obfervation que le falun & la marne ne fer-
tilifoient pas également les terres, M. de Reaumura
conclu que la nature de ces engrais étoit entièrement
différente. Mais il en devoit feulement conclure qu’il
y avoit des terres qui s’affaiffant plus ou moins faeù
lement, demaridoient un engrais qui écartât plus ou
moins leurs molécules ; & c’eft l’effet que doivent
produire des débris de coquilles plus ou moins divi^
lées & détruites, comme elles le font dans le falun,
dans la marne & dans la craie, qui n’ont, félon tou«
te apparence , que cette feule différence relative à
leur a&ion fur les terres qu’elles fertilifent ou ne fer-
tilifent point.
Une terre une fois falunée , l’eft pour trenté ans :
fon effet eft moins fenfible la première année, que
dans les fuivantes ; alors le falun eft répandu plus
uniformément. Les terres falunées deviennent très*
fertiles.
D d d