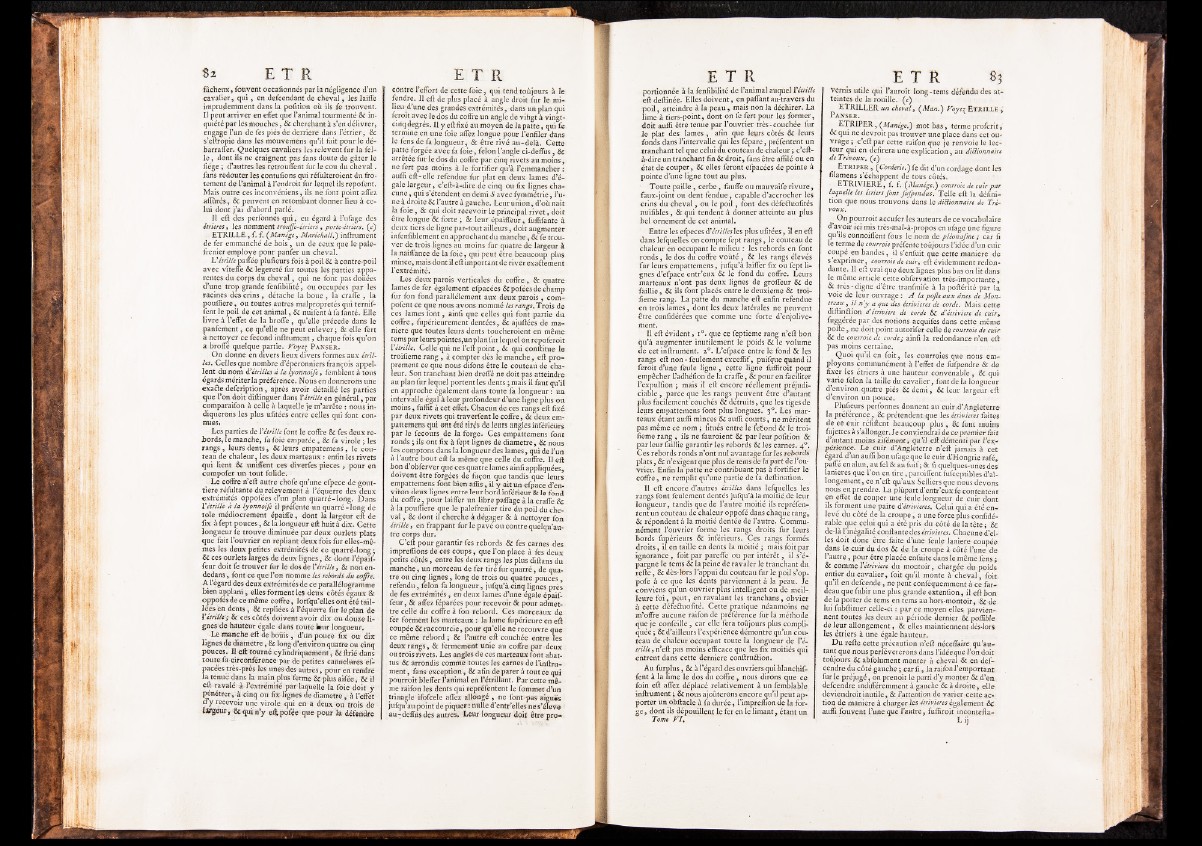
fâcheux, fotiverit occafiorinés par la négligence d’un
cavalier, qui , en defeendarit de cheval, les laiffe
imprudemment dans la pofition où ils fe trouvent.
Il peut arriver en effet que l’animal tourmenté & inquiété
par les mouches, & cherchant à s’en délivrer,
engage l’un de les pies de derrière dans l’étrier, &
s’eftro'pie dans les mouvemens qu’il fait pour le dé-
barraffer. Quelques cavaliers les relevent fur la fel-
l e , dont Ils ne craignent pas fans doute de gâter le
fiége ; d’auttes les retroüfferif fur le cou du ch eval.
fans redouter les contufions qui réfulteroient du fro-
tement de' l’animal à l’endroit fur lequel ils repofent.
Mais outre ces incoftvéniens, ils né font point affez
affûrés, & peuvent en retombant donner lieu à celui
dont j’ai d’abord parlé.
Il eft des perfonnes qui, eu égard à l’ufage des
itrieres, les nomment trouffe-étriers, porte-étriers, (e)
. ETRILLE, f. f. (Manège, Marèchall.') infiniment
de fer emmanché de bois, un de ceux que le palefrenier
employé pour panier un cheval.
L ’étrille pafleé plufieurs fois à poil Sc à contre-poil
avec rentesv dîtue fcfeo rSpcs ldeug ecrheteév faulr, tqouuit ense lefos npta rptaiess d oapupéeas
d’une trop grande fenfibilité, ou Occupées par lés
rpaocuifnfeies rdee, so cur itnosu ,te sd éatuatcrhees mlaa lbporuoep r,e tléas cqruaif ftee r,n ilfa- fent le poil de cet animal, Sc nuifent à fa fanté. Elle
livre à l’effet de la broffe , qu’elle précédé dans le
panfement, ce qu’elle ne peut enlever; & elle fert
à nettoyer ce fécond inftrunient, chaque fois qu’on
a broffé quelque partie. Voye{ Panser.
On donne en divers lieux divers formes aux étrilles.
Celles que nombre d’éperonniers françois appellent
du nom d’étrilles à la lyonnoife , fûmblent à tous
égards mériter la préférence. Nous en donnerons une
exacte defeription, après avoir détaillé les parties
que l’on doit diftinguer dans l’étrille en général, par
comparaifon à celle à laquelle je m’arrête : nous indiquerons
les plus ufitéës entre celles qui font connues.
Les parties de l’étrille font le coffre & fes deux rebords,
le manche, fa foié empâtée, & fa vifole ; les
rangs , leurs dents, & leurs empatemens, le couteau
de chaleur, les deux marteaux : enfin les rivets
qui lient Sc unifient ces diverfes p ièces, pour en
compofer un tout folide.
Le coffre n’eft autre chofe qu’une efpece de gouttière
réfultante du relèvement à l’équerre des deux
extrémités oppofées d’un plan quarré-long. Dans
Vétrille à la lyonnoife il préfente un quarré-long de
tôle médiocrement épaiffe, dont la largeur eft de
fix à fept pouces, Sc la longueur eft huit à dix. Cette
longueur fe trouve diminuée pâr deux ourlets plats
que fait l ’ouvrier en repliant deux fois fur elles-mêmes
les deux petites extrémités dé ce quarré-long ;
Sc ces ourlets larges de deux lignes, Sc dont l’èpâif-
feur doit fe trouver fur le dos de Xétrille, & nôri en-
dedans , font ce que l’on nomme les rebords du coffré.
A l’égard des deux extrémités de ce parallélogramme
bien ajjplani, elles forment les deux Cotés égaux &
oppofes de ce même coffré, lorfqü’elles Ont été' tail-
lées en dents, St repliées à l’équerre fur le plan de
l’étrille'; & ces côtés doivent avoir dix ou doüz-e lignes
de hauteur égale dans toute leur longueur*
j Le manche eft de bôiiis , d’un pouce fix ou dix
lignes de diamètre, Sc long d’environ quatre ou cinq
pouces. Il eft tourné cylindrïqûement, êéftrié dans
tc*ut^ fociréonférence par de petites cannelures é S *
pacées très-près les unes des autres, pour-en rendre
la tenue dans la main plus ferme &plus aifée , Sc il
eft ravalé ^à~ l’extrémité par laquelle la foie doit y
pénétrer , .à cinq ou fix lignes de diamètre , à l’effet
,u5e virole qui en à deux ou trois de
largeur, ôc qui n’y eftpofée que pour la défendre
côntré l’effort de cette foie, qui tend toûjours à le
fendre. Il eft de plus placé à angle droit fur le milieu
d ’une des grandes extrémités, dans un plan qui
feroit avec le dos du coffre un artgle dé vihgt à vingt-
cinq degrés. Il y eft fixé au moyen de la patte , qui fe
termine en une foie affez longue pour l’enfiler dans
le fens de fa longueur, & être rivé au-delà. Cette
PatJe forgée avec fa foie, félon l ’angle ci-deflus, &
arrêtée fur le dos du coffre par cinq rivets au moins ,
ne fert pas moins à le fortifier qu’à l’emmancher :
aulfi eft-elle refendue fur plat en deux lames d’égale
largeur , c’eft-à-dire de cinq ou fix lignes chacune
, qui s’étendent en demi S avec fymmétrie, l’une
à droite Sc l’autre à gauche. Leur union, d’où naît
là foie , & qui doit recevoir le principal rivet, doit
être longue Si forte ; & leur' épaiffeur, fuffifante à
deux tiers, de ligne par-tout ailleurs, doit augmenter
infenfiblement en approchant du manche, & fe trouver
de trois lignes au moins fur quatre de largeur à
la naiffance de là foie, qui peut être, beaucoup plus
mince, mais dont il eft important de river exactement
l’extrémité.
Les deux parois verticales du coffre , & quatre
lames de fer également efpacées &pofées de champ
fur fon fond parallèlement aux deux parois , eom-
pofent ce que nous avons nommé les rangs. Trois de
ces lames fon t, ainfi que celles qui font partie du
coffre, fupérieurement dentées, Sc ajuftées de maniéré
que toutes leurs dents toucheroient en même
tems par leurs pointes,un plan fur lequel on repoferoit
Xétrille. Celle qui ne l’eft point, & qui conftitue le
troifieme rang , à compter dès le manche, eft proprement
ce que nous difons être le couteau de chaleur.
Son tranchant bien dreffé ne doit pas atteindre
au plan fur lequel portent les dents ; mais il faut qu’il
en approche également dans toute fa longueur : fin
intervalle égal à leur profondeur d’une ligne plus ou
moins, fuffit à cet effet. Chacun de ces rangs eft fixé
par deux rivets qui traveifent le coffre, & deux em-
pattefnens qui ont été tirés de leurs angles inférieurs
par le fecours de la forge. Ces empattemens font
ronds ; ils ont fix à fept lignes de d iam è treSc nous
les comptons dans la longueur des lames, qui de l’un
à l ’autre bout eft la même que celle du coffre. Il eft
bôn d’obferver que ces quatre lames ainfi appliquées,
doivent être forgées de façon que tandis que leurs
empattemens font bien alfis, il y ait un efpace d’en-
viton deu-X lignes entre leur bord inférieur & le fond
du coffre, pour laiffer un libre paffage à la craffe St
à la pouffiere que le palefrenier tire du poil du cheval
, Sc dont il cherche à dégager & à nettoyer fon
étrille, en frappant fur le pavé ou contre quelqu’au-
tre ëôrps dur.
C ’eft pour garantir fes rebords & fes carnes des
impfeflïôns de ces coups, que l’on place à fes deux
petits côtés, entre les deux rangs les plus diftans du
manche, un morceau de fer tire fur quarré, de quatre
ou cinq lignes, long de trois ou quatre pouces ,
réfendu, félon fa longueur, jufqu’à cinq lignes près
de fes extrémités, en deux lames d’une égale épaiffeur,
& affez féparées pour recevoir & pour admettre
celle du coffre à fon rebord. Ces morceaux de
fer forment lès marteaux : la lame fupérieure en eft
coupée & raccourcie, pour qu’elle ne recouvre que
ce même fébord ; & l’autre eft couchée entre les
deux rangs, & fermement unie an coffre par deux
ou trois rivets. Les angles de ces marteaux font abattus
& arrondis commê toutes les carnes de l’inftru-
ment, fans exception, & afin de parer à tout ce qui
pourroit bleffer l’animal en l’étrillant. Par cette même
ràifon les dents qui repréfentent le fommet d’un
triangle ifofeele affez allongé , ne font pas aiguës
jufqu’au point de piquer : nulle d’entr’elles ne s’élève '
au- defîus des autres. Leur longueur doit être pro-.
portionnée à là fenfibilité de l’animai auquel Xétrille
eft deftinée. Elles doivent, en paffant au-travers du
p o il, atteindre à la peau, mais non la déchirer. La
lime à tiers-point, dont on fe fert pour les former,
doit aufli être tenue par l’ouvrier très ^couchée fur
le plat des lames , afin que leyrs côtés Sc leurs
fonds dans l’intervalle qui les fépare, préfentent un
tranchant tel que celui du couteau de chaleur ; c’eft-
à-dire un tranchant fin & droit, fans être affilé ou en
état de couper, & elles feront efpacées de pointe à
pointe d’une ligne tout au plus.
Toute paille, eerbe, fauffe ou mauvaife rivure,
faux-joint ou dent fendue, capable d ’accrocher les
crins du cheval, ou le p o il, font des défeétuofités
nuifibles, & qui tendent à. donner atteinte au plus
bel ornement de cet animal.
Entre les efpeces d’étrilles les plus ufitées, il en eft
dans lefquelles on compte fept rangs, le couteau de
chaleur en occupant le milieu : les rebords en font
ronds, le dos du coffre voûté , & les rangs élevés
fur leurs empattemens, jufqu’à laiffer fix ou fept lignes
d’efpace entr’eux Sc le fond du coffre. Leurs
marteaux n’ont pas deux lignés de grofleur Sc de
faillie, Sc ils font placés entre le deuxieme Sc troifieme
rang. La patte du manche eft enfin refendue
en trois lames, dont les deux latérales ne peuvent
être confédérées que comme une forte d’enjolivement.
Il eft évident,-1°. que ce feptieme rang n’eft bon
qu’à augmenter inutilement le poids Sc le volume
de cet inftrument. z°. L’efpace entre le fond & les
rangs eft non - feulement exceflif, puifque quand il
feroit d’une feule ligne , cette ligne fuffiroit pour
empêcher L’adhéfion de la craffe, Sc pour en faciliter
l’expulfion ; mais il eft encore réellement préjudiciable
, parce que les rangs peuvent être d’autant
plus facilement couchés Sc détruits, que les tiges de
leurs empattemens font plus longues. 30. Les marteaux
étant aufli minces & aufîi courts, ne méritent
pas même ce nom ; fitués entre le fetond Sc le troifieme
rang , ils ne fanroient Sc par leur pofition &
par leur faillie garantir les rebords & les carnes. 40.
Ces rebords ronds n’ont nul avantage fur les rebords
plats, & n’exigent que plus de tems de la part de l’ouvrier.
Enfin la patte ne contribuant pas à fortifier le
coffre, ne remplit qu’une partie de la deftination.
Il eft encore d’autres étrilles dans lefquelles les
rangs font feulement dentés jufqu’à la moitié de leur
longueur, tandis que de l’autre moitié ils repréfen-
tentun couteau de chaleur oppofé dans chaque rang,
& répondent à la moitié dentée de l’autre. Communément
l’ouvrier forme les rangs droits fur leurs
bords fupérieurs Sc inférieurs. Ces rangs formés
droits, il en taille en dents la moitié ; mais foit par
ignorance, foit par pareffe ou par intérêt, il s’épargne
le tems Sc la peine de ravaler le tranchant du
refte, Sc dès-fors l ’appui du couteau fur le poil s’op-
pofe à ce que les dents parviennent à la peau. Je
conviens qu’un ouvrier plus intelligent ou de meilleure
fo i, peut, en ravalant les tranchans, obvier
à cette défeftuofité. Cette pratique néanmoins ne
m’offre aucune raifon de préférence fur la méthode
que je confeille, car elle fera toujours plus compliquée
; & d’ailleurs l’expérience démontre qu’un couteau
de chaleur .occupant toute la longueur de IV-
trille, n’eft pas moins efficace que les fix moitiés qui
entrent dans cette derniere conftrufrion.
Au furplus, Sc à l’égard des ouvriers qui blanchif-
fent à la lime le dos du coffre, nous dirons que ce
foin eft affez déplacé relativement à un femblable
inftrument ; Sc nous ajouterons encore qu’il peut apporter
un obftacle à fa durée, l’impreflion de la forge
, dont ils dépouillent le fer en le limant - étant un
Tome VI,
Vérnîs utile qui l’auroit long - tems défehdil des atteintes
de la rouille. ([e)
ETRILLER un cheval, (Mané) Voye7 ETRILLE Panser.
I ETRIPER, (Manège.') mot bas, termeproferit,
Sc qui ne devroit pas trouver une place dans cet ou-»
vrage ; c eft par cette raifon que je renvoie le lecteur
qui en defirera une explication, au dictionnaire
de Trévoux, (e)
Etriper , (Gorderie.') fe dit d’un cordage dont les
filamens s’échappent de tous côtés.
ETR1VIERE, f. f. ( Manège.) courroie de cuir par
laquelle les étriers font fufpendus. Telle eft la définition
que nous trouvons dans le dictionnaire de Trévoux.
5 On pourroit accufer les auteurs de ce vocabulaire
d’avoir ici mis très-mal-à-propos en ufage ûne figure
qu’ils connoiflènt fous le nom de plèonafme ,■ car fi
le ternie de courroie préfente toujours l’idée d’un cuir
coupe en bandes, il s’enfuit que cette maniéré de
5 exprimer, courroie de cuir, eft évidemment redondante.
Il eft vrai que deux lignes, plus bas on lit dans
le meme article cette obfervation très-importante ,
6 très - digne d’être tranfmife à la poftérité par la
voie de leur ouvrage : A la pofe aux ânes de Mon-
treau , il n ’y a que des ètrivieres de corde. Mais cette
diftinftion déétriviere de corde Sc d'ètriviere de cuir,
fuggérée par des notions acquifes dans cette même
pofte, ne doit point autorifer celle de courroie de cuir
Sc de courroie de corde; ainfi la redondance n’en eft
pas moins certaine.
Quoi qu’il en foit, les courroies que nous employons
communément à l ’effet de fufpendre & de
fixer les étriers à une hauteur convenable ,• Sc qui
varie félon la taille du cavalier, font de la longueur
d’environ quatre piés Sc demi, Sc leur largeur eft
d’environ un pouce.
. Plufieurs perfonnes donnent au cuir .d’Angleterre
la préférence, Sc prétendent'que les ètrivieres faites
de ce cuir réfiftent beaucoup plus , Sc font moins
fujettes à s’allonger. Je conyiendrai de ce premier fait
d autant moins ai Cément f qu’il eft démenti par l’expérience.
Le cuir d’Angleterre n’eft jamais à cet
egard d un aufti bon ufage que le cuir cL’Hongrie rafé,
paffe en alun, au fel & au fuif ; & fi quelques-unes des
lanières que l’on en tire, paroiffent fufceptibles d’allongement
, ce n’eft qu’aux Selliers.que nous devons
nous en prendre. La plûpartd’entr’euxfe contentent
en effet de couper une feule longueur de cuir dont
ils forment une paire d’ètrivieres. Celui qui a été enlevé
du côté de la croupe, a uiie force plus confidé-
rable que celui qui a été pris du côté de la tête ; Sc
de-là l’inégalité confiante des ètrivieres. Chacune d’elles
doit donc être faite d’ime feule laniere coupée
dans le cuir du dos Sc de la croupe à-côté.l’une de
l’autre, pour être placée enfuite dans le même fens ;
& comme Xétriviere du montoir, chargée du poids
entier du cavalier, foit qu’il monte à cheval, foit.
qu’il en defeende, ne peut conféquemment à ce fardeau
que fubir une plus grande extenfion, il eft bon
de la porter de tems en tems au hors-montoir, & de
lui fubftituer celle-ci : par ce moyen elles, parviennent
toutes les deux au période dernier Sc poflîbfe
de leur allongement, & elles maintiennent dès-lors
les étriers à une égale hauteur.
Du refte cette précaution n’eft néceflaire qu’autant
que nous perfévererons dans l’idée que l’on doit
toujours Sc abfolument monter à cheval & en descendre
du côté gauche ; car f i , la raifonl’emportant
fur le préjugé, on prenoit le parti d’y monter Sc d’en
defeendre indifféremment à gauche Sc à droite, elle
deviendroit inutile, & l’attention de varier cette ac-
tioq de maniéré à charger les ètrivieres également St
aufli fouvent l’une que l’autre, fuffiroit incontefta-
L i j