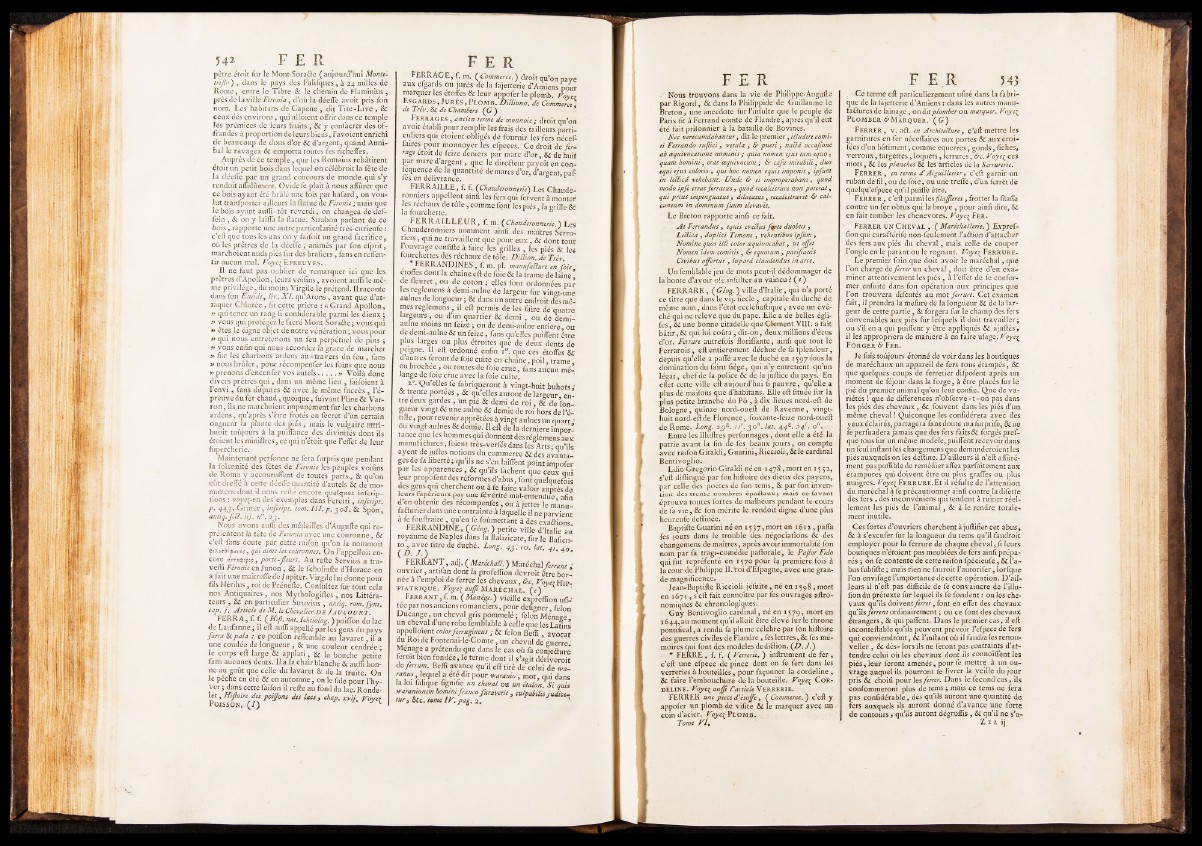
542 FER.
pêtre ëtoit fur le Mont-Sorafte (aujourd’hui Monte-
trifio ) , dans le pays des Falifques, à 24 milles de
Rome, entre le Tibre & le chemin de Flaminius ,
près de la ville Feronia, d’où la dé elfe avoit pris fon
nom. Les habitans de Capene , dit Tire-Live , 6c
ceux des environs, qui alloient offrir dans ce temple
les prémices de leurs fruits , & y confacrer des offrandes
à proportion de leurs biens, l’a voient enrichi
de beaucoup de dons d’or & d’argent, quand Anni-
bal le ravagea & emporta toutes fes ricnefles.
Auprès de ce temple, que les Romains rebâtirent
ctoit un petit bois dans lequel on célébroit la fête de
la c/éeffe par un grand concours de monde qui s’y
rendoitaffidûment. Ovidefe plaît à nous affûrer que
ce bois ayant été brûlé une fois par hafard, on voulut
tranfporter ailleurs la ftatue de Féronie ; mais que
le bois ayant auffi-tôt reverdi, on changea de def-
fein , & on y laiffa la flatue. Strabon parlant de ce
b o is, rapporte une autre particularité très-curieufe :
c’eft que tous les ans on y faifoit un grand facrifice,
où les prêtres de la déeffe , animés par fon efprit,
marchoient nuds piés fur des brafiers, fans en reflen-
tir aucun mal. Voye^ E p r e u v e s .
Il ne faut pas oublier de remarquer ici que les
prêtres d’Apollon, leurs voifins, avoient auffi le même
privilège, du moins Virgile le prétend. Il raconte
dans fon Enéide, Uv. X I . qu’Arons , avant que d’attaquer
Chlorée, fit cette priere : « Grand Apollon,
» qui tenez un rang fi confidérable parmi les dieux ;
» vous qui protégez le facré MontSoraûe ; vous qui
*» êtes le digne objet de notre vénération; vôus pour
» qui nous entretenons un feu perpétuel de pins ;
» vous enfin qui nous accordez la grâce de marcher
»fur les charbons ardens au-travers du fe u , fans
» nous brûler, pour récompenfer les foins que nous
» prenons d’encenfer vos autels . . . . . . Voilà donc
divers prêtres q u i, dans un même lieu , faifoient à
l’en v i, fans difputes & avec le même fuccès, l’épreuve
du fer chaud, quoique, fuivant Pline 6c Var-
ron , ils ne marchoient impunément fur les charbons
ardens, qu’après s’être frotés en fecret d’un certain
onguent la plante des piés ; mais le vulgaire attri-
buoit toûjours à la puiffancé des divinités dont ils
étoient les miniftres, ce qui n’étoit que l’effet de leur
fupercherie.
Maintenant perfonne ne fera furpris que pendant
la folennité des fêtes de Féronie les peuples voifins
de Rome y accouruffent de toutes parts, & qu’on
eût dreffé à cette déeffe quantité d’autels & de mo-
numens dont il nous refte encore quelques infcrip-
tions : voye^en des exemples dans Feretti, infcript.
P • 443- Gmter, infcript. tom. I I I .p .3 oS. & Spon,
antiq.fect. iij. n°. 22.
Nous avons auffi des médailles d’Augufte qui re-
prefentent la tête de Feronia avec une couronne, 6c
c’eft fans doute par çette raifon qu’on la nommoit 1
çiXoffdîtpetvôç, qui aime les couronnes. On l’appelloit encore
àvTwpopoç 9 porte-fleurs. Au refte Servius a tra-
vefti Féronie en Junon , & le fcholiafte d’Horace en
a fait une maîtreffe de Jupiter. Virgile lui donne pour
fils Hérilus, roi de Prénefte. Consultez fur tout cela
nos Antiquaires , nos Mythologiftes , nos Littérateurs
, 6c en particulier Struvius , antiq. rom.Jynt.
cap. j . Article de M. U Chevalier DE J AU COURT.
FERRA, f. f. ( Hiß. nat. Ichtiolog. ) poiffon du lac
de Laufanne ; il eft auffi appellé par les gens du pays
farra 6zpala : ce poiffon reflemble au lavaret, il a
une coudée de longueur, & une couleur cendrée ;
le corps eft large 6c applati, & la bouche petite
fans aucunes dents. Il a la chair blanche & auffi bonne
au goût que celle du lavaret & de la truite. On
le pêche en été & en automne, on le fale pour l’hy-
ver ; dans cette faifon il refte au fond du lac. Rondele
t , Hiftoire des poijfons des lacs, chap. xyii Voyez
P o i s s o n . ( / ) - ' x
F E R
■ g r j • 7 v . ' U1U1C qu on pave
! aux efgards ou jures de la fajetterie d’Amiens pour
marquer les étoffes & leur appofer le plomb. Voyez
Es g a r d s , Ju r é s , Pl o m b . Diclionn. de Commerce,,
de Trév. 6c de Chambers (jG )
Fe r r a g e s , ancien terme de monnoie ; droit qu’ort
avoit établi pour remplir les frais des tailleurs particuliers
qui etoient obligés de fournir les fers nécefi
faires pour monnoyer les efpeces. Ce droit de fer-
rage était de feize deniers par marc d’o r , & de huit
par marc d argent , que le directettr pavoit en eon-
fequênèe de la quanttité de marcs d’or, d’argent, pâlies
en délivrance. r t
FERRAILLE, L f. (Chauderonncrit) Les Chaudè-
ronmers appellent ainu les fers qui fervent à monter
les réchaux dé tôle, comme font les piés, là grillé &c
la fourchette. ’ .
fE I lR A I L I .E U R , f. m. ( Chaudtrentier te. ) Les
Chauderonniers nomment ainfi des maîtres Serruriers,
qui ne travaillent que pour e u x , & dont Tout
1 ouvrage confifte à faire les grilles , les piés & les
fourchettes des réchaux de tôle. Diction. de Trév.
, FERRANDINES, f. m. pl. manufacture en foieJ
étoffés dont la chaîne eft de foie & la trame de laïhë
de fleuret, ou de coton ; elles font ordonnées par
les regîcmens à demi-aulne de largeur fur Vingt-uns
aulnes de longueur ; & dans un autre endroit dés mè-'
mes reglemens, il eft permis de’leis faire de quatre
largeurs j ou d’un quartier & demi , ,ou de llemW
aulne moins Un feize ; Ou de demi-aulne entière, ou
de demi-aulne & un feize , fans qu’elles puiftent être
plus larges ou plus étroites que de deux dents de
peigne. II eft ordonné enfin r°. que cés étoiles &
d autres feront de foie cuite en chaîne, poil trame.
ou brochée, ou toutes de foie crue, fans aucun mélange
de foie crue avec la foie cuite.
*•. Q u’elles fe fabriqueront à vingt-huit buhots i
& trente portées, & qu’elles auront de largeur entre
deux gardes , Un pié & demi de roi & de ’longueur
vingt & une aulne & demie de roi hors de l’é-
tille, pour revenir apprêtées à vingt aulnes un quart.'
ou vingt aulnes 6c demie. II eft de la derniere importance
qite les hommes qui donnent des réglemens aux
manufactures, foient très-verfés dans les Arts; qu’ils
ayent de juftes notions du commerce 6c des a vanta
ges de fa liberté; qu’ils ne s’en laiffent point impofed
par les apparences, Sc qu’ils fâchent que ceux qui
leur propofent des réformes d’abus, font quelquefois
des gens qui cherchent ou à fe faire Valoir auprès de
leurs fupéneurs par une févérité mal-entendue afin
d’en obtenir des récompenfes, ou à jetter le manu-
fa êhirier dans une contrainte à laquelle il ne parvient
à-fe fouftraire, qu’en fe foûmettant à des exaaions
FERRANDÏNE, ( Géog. ) petite ville d’Italie au
royaume de Naples dans la Balizicatè, fur'le Bafien-
to^ avec titre de duché, Long. - fH 'O . fer. 4 ,. 40;
FERRANT, adj. ( Maréehall. ) Maréchal ferrant J
ouvrier, artifan dont la profeffion devroit être bornée
à l’emploi de ferrer les chevaux, &c. Voyer Htp-
p ia tr iq u ë . Vjyei àufji Ma r é ch a l , ( e )
Fe r r an t , f.m. (Manège.') vieille expreflion uflJ
tee par nos anciens romanciers, pour defigner, félon
Ducange, un cheval gris pommelé ; félon Ménage '
un cheval d’une robe fémblable à celle que les Latins
appelloient colotferrugineus ; & félon Be flî, avocat
du Roi de Fontenai-le-Comte, un cheval de guerre.'
Ménage a prétendu que dans le cas où fa conjefturé
feroit bien fondée, le terme dont il s ’agit dériveroit
deferrum. Beflî avance qu’il eft tiré de celui de wa~
ranus, lequel a été dit pour waranio, mot, qui dans
la loi falique fignifie un cheval ou un étalon. Si quia
waranionemhOmini franco furaverit, culpabilis judice-
tur, & c . tome IV . pag, a .
H t
F E R
. Nous trouvons dans la vie de Philippe-Augufte
par Rigord, & dans la Philippide de Guillaume le
Breton, une anecdote fur l’infulte que le peuple de
Paris fit à Ferrand comte de Flandre, après qu’il eut
été fait prifonnier à la bataille de Bovines.
Nec verecumdabantur, dit le premier, illudere comité
Ferrando ruflici , vetulce , & pueri , nactd occafione
ab oequivocatione nominis ; quia nomen ejus tara equo,
quam homini, erat ’cequivocum ; & cafu mirabili, duo
equi ejus coloris , qui hoc nomen equis imponit, ipfum
in leelied vehebant. Unde & et improperabant, quod
modo ipfe errât ferratus , quod recalcitrare non poterat,
qui prius impinguatus , dilatatus, recalcitravit 6* calcanéum
in dominum fuum elevavit.
Le Breton rapporte ainfi ce fait.
A t Fertandus, equis eveclus forte duobiis ,
Lectica , düplici Temone , vehentibus ipfum 9
Nomiiie quos illi color cequivocabat, ut eflet
Nomen idem comités, & equorum , pariflanis
Civibus offertur , luparâ claudendus in atet.
Un fembiable jeu de mots peut-il dédommager de
la honte d’avoir ofé infulter au vaincu ? (« )
FERRARE, ( Géog. ) ville d’Italie, qui n’a porté
ce titre que dans le vij. fiecle , capitale du duché de
même nom, dans l’état eccléfiaftique, avec un évê-
ché'qui ne releve que du pape. Elle a de belles églises
, & une bonne citadelle que Ctement VIII. a fait
bâtir, & qui lui coûta, dit-on, deux millions d’écus
d’or. Ferrure autrefois floriflante, ainfi que tout le
Ferrarois , eft entièrement déchue de fa lplendeur,
depuis qu’elle a paffé avec le duché en 1597 fous la
domination du faint fiége, qui n’y entretient qu’un
légat, chef de la police & de la juftice du pays. En
effet cette ville eft aujourd’hui fi pauvre, qu’elle a
plus de maifons que d’habitans. Elle eft fituée fur la
plus petite branche du Pô , à dix lieues nord-eft de
Bologne, quinze nord-oueft de Ravenne, vingt-
huit nord-eft de Florence, foixante-feize nord-oueft
de Rome. Long. zc>d. n j. g o ", lat. 44dj
; Entré les illuftres p’erfonnages, dont elle a été la
patrie avant la fin de fes beaux jou rs, on compte
avec raifon Giraldi, Guarini, R ic c ioli,& le cardinal
Bentivoglio.
Lilio Gregorio Giraldi lié en 1478, mort en 15 52,
s’eft diftingué par fon hiftoire des dieux des payens,
par celle des poètes de fon tems, & par fon invention
des trente nombres épaôaux; mais ce favant
éprouva toutes fortes de malheurs pendant le cours
de fa v ie , & fon mérite le rendoit digne d’une plus
heureufe deftinée.
Baptifte Guarini né en 1537, mort en 16 12, pafla
Fes jours dans le trouble des négociations & des
changemens de maîtres, après avoir immortalifé fon
nom par fa tragi-comédie paftorale, le Paflor Fido
qui fut repréfenté en 1570 pour la première fois à
la cour de Philippe II.*roi d’Efpagne, avec une grande
magnificence.
Jean-Baptifte Riccioli jéfuite, né en 1 5 9 8 ,mort
en 16 7 1 , s’eft fait connoître par fes ouvrages aftro-
nomiques & chronologiques.
Guy Bentivoglio cardinal, né en 1579, mort en
3 644, au moment qu’il alloit être élevé fur le throne
pontifical, a rendu fa plume célebre par fon hiftoire
des guerres civiles de Flandre, fes lettres, & fes mé*
moires qui font des modèles dedi&ion. (D . ƒ.)
* FEK.RE, f. f. ( Verrerie. ) infiniment de fer ,
c’èft une efpece de pince dont on fe fert dans les
verreries à bouteilles, pour façonner la cordeline ,
& faire l’embouchure de la bouteille. Voye[ C or-
DELINE. Voye^ auffi l'article VERRERIE.
FERRER une piece d'étoffe , ( Commerce. ) c’eft y
appofer un plomb de vifite & le marquer avec un
coin d’acier. Voye^ P l o m b .
Tome Vit
F E R 5 4 3
Ce termé eft particulierpment ufité dans la fabrique
de la fajetterie d’Amiens t dans les autres manu-
faélures de lainage, on dit plomber ou marquer. Voye£
P l o m b e r & M a r q u e r . ( G )
F e r r e r , v . aft. en Architecture, c ’eft mettre les
garnitures en fer néceffaires aux portes & aux enfilées
d’un bâtiment, comme equefres, gonds, fiches,
verroux, targettes, loquets, ferrures, &c. Voye1 ces
mots, & les planches & les articles de la Serrurerie.
F e r r e r , en terme d.'Aiguilletier, c’eft garnir un
ruban de'fil, ou de foie, ou une treffe, d’un ferret de
quelqq’efpece qu’il puiffe être.
F e r r e r , c ’e f t p a rm i l e s filafjieres, f r o t t e r l a f i la f f e
c o n t r e U n f e r o b t u s q u i l a b r o y é , p o u r a in f i d i r e , ô£
e n f a i t t o m b e r l e s c h e n e v o t e s . Voye{ F e r .
F e r r e r u n C h e v a l , ( Maréchallcrie.') Ëxpref-
fion qui caraélérife non-feulement l’aélion d’attacher
des fers aux piés du cheval, mais celle de couper
l’ongle en le parant ou le rognant. Voye^ F e r r u r e .
Le premier foin que doit avoir le maréchal, que
l’on charge de ferrer un cheval, doit être d’en examiner
attentivement les piés , à l’effet de fe conformer
enfuite dans fon opération aüx principes que
l’on trouvera difeutés au mot ferrure. Cet examen
fait, il prendra la mefure de la longueur & de la largeur
de cette partie, & forgera fur le champ des fers
convenables aux piés fur lefquels il doit travailler ;
ou s’il en a qui puiffent y être appliqués & ajuftés,
il les appropriera de maniéré à en faire ufage. Voye^
F o r g e r & F e r .
Je fuis toûjours étonné de voir dans les boutiques
de maréchaux un appareil de fers tous étampés, 6c
que quelques coups de ferretier dilpofent après un
moment de féjour dans la forge, à être places fur le
pié du premier animal qu’on leur confie. Que de va-*
riétés ! que de différences n’ob ferve-t-on pas dans
les piés des chevaux, & fouvent dans les piés d’un
même cheval ! Quiconque les confidérera avec des
yeux éclairés, partagera fans doute ma furprife, & n e
ieperfuadera jamais que des fers faits & forgés pref-
que tous fur un même modèle, puiftent recevoir dans
un feulinftantles changemens que demanderaient les
piés auxquels on les deftine. D ’ailleurs il n’eft affûré-
ment pas poffible de remédier affez parfaitement aux
étampures qui doivent être ou plus graffes ou plus
maigres. Voye^ F e r r u r e . Et il réfulte de l’attention
du maréchal à fe précautionner ainfi contre la difette
des fers, des inconvéniens qui tendent à ruiner réellement
les piés de l’animal, & à le rendre totalement
inutile.
Ces fortes d’ouvriers Cherchent àjuftifier cet abus,
& à s’exeufer fur la longueur du tems qu’il faudrait
employer pour la ferrure de chaque cheval, fi leurs
boutiques n’étoient pas meublées de fers ainfi préparés
; on fe contente de cette raifon fpécieufe, & l’abus
fubfifte ; mais rien ne fauroit l’autorifer, lorfque
l’on envifage l’importance de cette opération. D ’ailleurs
il n’eft pas difficile de fe convaincre de l’illu-
fiondu prétexte fur lequel ils fe~fondent : ou les chevaux
qu’ils doivent ferrer, font en effet des chevaux
qu’ils ferrent ordinairement ; ou ce font des chevaux
etrangers, & qui paflent. Dans le premier cas, il eft:
inconteftable qu’ils peuvent prévoir l’efpece de fers
qui conviendront, 6c l’inftant où il faudra les renou-
veller , & dès - lors ils ne feront pas contraints d’attendre
celui où les chevaux dont ils connoiflent les
piés, leur feront amenés, pour fe mettre à un ouvrage
auquel ils pourront le livrer la veille du jour
pris & choifi pour les ferrer. Dans le fécond cas , ils
confommeront plus de tems ; mais ce tems ne fera
pas confidérable, dès qu’ils auront une quantité de
fers auxquels ils auront donné d’avance une forte
de contours , qu’ils auront dégroffis, & qu’il ne s’a-
Z z z ij