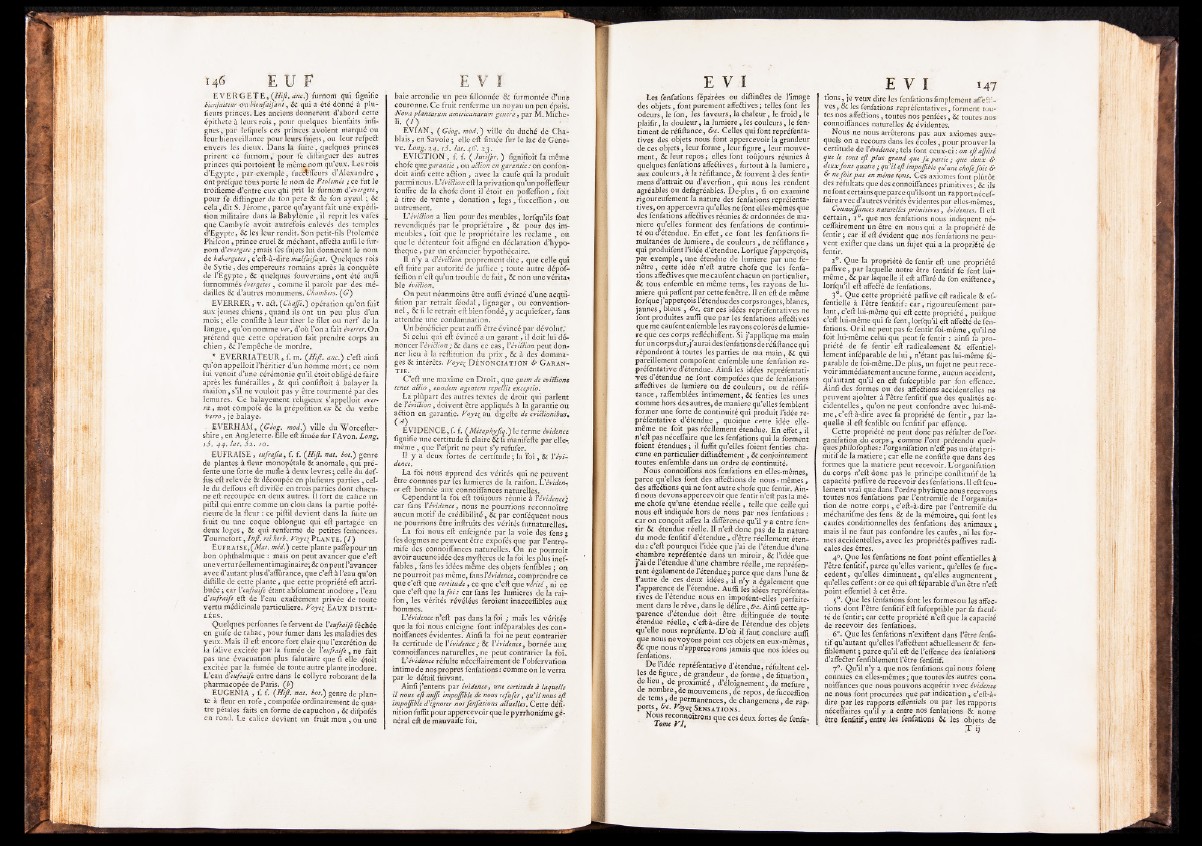
£ U F E V E R G E T E , (ftift. dnc.') furrtom <Jui fignifie
bienfaiteur otl bienfaifaht, & qui a été donné à plu-
fieurs princes* Les anciens donnèrent d’abord cette
épithete à leurs rois, pour quelques bienfaits infi-
gnesypaf tefquels ces princes âvôiënt marqué ou
leur bienveillance pour léüfs fujets, ou leurrefped
envers les dieux. Dans la fuite, quelques princes
prirent eê ftirnom, pour fie diftinguer des autres
princes qui portoient le même.nom qu’eux. Les rôis
d’Egypte, par exemple, fuc&fleürs d’Alexandre,
ortt préfqüe tous porté lé nom de Ptolemée ; ce fut le
troifieme d’entre eux qtii prit le furnom d'évergete,
pour fe diftinguer de l’on pere & de fon ayeul ; &
ce la , dit S. Jérome, parce qu’àyantfait une expédition
militaire dans là Babylônie , il reprit les vafes
que Cambyfe avoir autrefois enlevés des temples
d’Egypte, & les leur rendit. Son petit-fils Ptolemée
Philcon, prince cruel & méchant,affeéla aufli le fur-
nom diverge te ; mais fes fujets lui donnèrent le nom
de kakergetes, c’eft-à-dire malfaifant. Quelques rois
de Syrie, des empereurs romains après la conquête
de l’Egypte, & quelques fouverains, ont été aufli
furnommés é verge tes, comme il paroît par des médailles
& d’autres monumens. Chambers. (G)
EVERRER , v . aû. (Chaffte.) opération qu’on fait
aux jeunes chiens, quand ils ont un peu plus d’un
mois ; elle confifte à leur tirer le filet ou nerf de la
langue, qu’on nomme ver, d’oîi l’on a fait éverrer. On
prétend que cette opération fait prendre corps au
chien, & l’empêche de mordre.
* EVERRIATEUR, f. m. (Hift. anc.) c’eft ainfi
qu’ôn a ppelloit l’héritier d’un homme mort; ce nom
lui venoit d’une cérémonie qu’il étoit obligé de faire
après lés funérailles , & qui confiftoit à balayer la
maifon, s’il ne vouloit pas y être tourmenté par des
lemures. Ce balayement religieux s’appelloit év erra
, mot compofé de la prépofition ex & du verbe
Verro, je balaye.
. EVERHAM, (Géog. mod.) ville du Worcefter-
shire, en Angleterre. Elle eft fituée fur l’Avon. Long.
iS. 44. lut. 3z . 10.
EUFRAISE , eufrafia, f. f. (Hift. nat. bot.*) genre
de plantes à fleur monopétale & anomale, qui préfente
une forte de mufle à deux levres ; celle du def-
fus eft relevée & découpée en plufieurs parties, celle
du deflous eft divifée en trois parties dont chacune
eft recoupée en deux autres. Il fort du calice un
piftil qui entre comme un clou dans la partie pofté-
rieure de la fleur : ce piftil devient dans la fuite un
fruit ou une coque oblongue qui eft partagée en
deux loges, & qui renferme de petites femences.
Tournefort,Inft. reiherb. Voye{Plante. (/ )
bonE uoFpRhAthiSaElm,(Aiqf<uezr :. mméadi.s) ocnet ptee uptla anvtae npcaefrl eqpuoeu cr ’eufnt
une verturéellement imaginaire; & on peutl’avancer
advifeticll de’ aduet acnettt pel pusla dn’atefl,u qraunec cee, qttuee p cr’oepftr iàé lt’ée aeuft q aut’torin
buée ; car Yeufraife étant abfolument inodore , l’eau
vÿeeurtfura mifeé deifcti ndaele lp’eaaruti ceuxliaècrtee.m ent privée de toute Voye^ Eaux distillées.
Quelques perfonnes fe fervent de Yeufraife féchée
en guife de tabac, pour fumer dans les maladies des
yeux. Mais il eft encore fort clair que l’excrétion de
la falive excitée par la fumée de Yeufraife, ne fait
pas une évacuation plus falutaire que fi elle étoit
excitée par la fumée de toute autre plante inodore.
L’eau Yeufraife entre dans le collyre roborant de la
pharmacopée de Paris. (b)
EUGENIA , f. f. (’Hift. nat. bot.*) genre de plante
à fleur en ro fe , compofée ordinairement de quatre
pétales faits en forme de capuchon, & difpofés
en rond. Le calice devient un fruit mou , ou une
e y 1
baie arrondie un peu fillonnée & fur montée d’une
couronne. Çe fruit renferme un noyau un peu épaiÿ.
Novaplahtarum americanarüm généra, par M. Miche-
| ( O y ' ' ; ; ' . H • :
EVIAN, ( Géog. mod. ) ville du duché de Cha-
blais, en Savoie ; elle eft fituée fur le lac de Géne-
v e. Long. 24. tS, lat. 46. 23.
E V IC T ION , f. f. ( Jurifpr. ) fignifioit la mêmé
chofe que garantie, ou action en garantie : on confon-
doit ainfi cette aétion , avec la caufe qui la produit
parmi nous. L’éviction eft la privation qu’un poffeffeur
ioufïfe de la chofe dont il étoit en poffeflioù, foit
à titre de vente , donation , legs, fiicceflion , où
autrement.
L’éviction a lieu pour des meubles, lorfqu’ils font
revendiqués par le propriétaire , & pour des immeubles
, foit que le propriétaire les reclame , où
que le détenteur foit affigné en déclaration d’hypotheque
, par un créancier hypothécaire.
Il n’y a d'éviction proprement dite, que celle qui
eft faite par autorité de juftice ; toute autre dépof-
feflîon n’eft qu’un trouble de fait, & non une vérita^.
ble éviction.
On peut néanmoins être aufli évincé d’une acqux-
fition par retrait féodal, lignager, ou conventionnel
, & fi le retrait eft bien fondé, y acquiefcer, fans
attendre une condamnation.
Un bénéficier peut aufli être évincé par dévolut.'
Si celui qui eft évincé a un garant, il doit lui dénoncer
Y éviction; & dans ce cas, Y éviction peut donner
lieu à la reftitution du p r ix , & à dés dommages
& intérêts. Voye^ DÉNONCIATION & G a r a n -,
TIE.
C ’eft une maxime en D roit, que quem de evietiont
tenet aciio, eundem agentem repellit exceptio.
La plupart des autres textes de droit qui parlent
de Y éviction, doivent être appliqués à la garantie ou
aétion en garantie. Voye? au digefte de evictionibus.
{A )
EVIDENCE, f. f. (Métaphy/iq.) le terme évidence
fignifie une certitude fi claire & fi manifefte par elle-
meme , que l’efprit ne peut s’y refufer.
Il y a deux fortes de certitude ; la ’f o i , & Yévi~
dence.
La foi nous apprend des vérités qui ne peuvent
être connues par les lumières de la raifon. ISéviden*
ce eft bornée aux connoiflances naturelles.
Cependant la foi eft toujours réunie à Y évidence;
car fans Yévidence', nous ne pourrions reconnoître
aucun motif de crédibilité, & par conféquent nous
ne pourrions être inftruits des vérités furnaturelles.
La foi nous eft enfeignée par la voie des fens ;
fes dogmes ne peuvent être expofés que par l’entre-
mife des connoiflances naturelles. On ne pourroit
avoir aucune idée des myfterés de la foi les plus ineffables
, fans les idées meme des objets fenfibles ; on
ne pourroit pas même, fans Y évidence, comprendre ce
que c’eft que certitude , ce que c’eft que vérité, ni ce
que c’eft que la fo i: car fans les lumières de la rai-
lon , les vérités révélées feroient inacceflibles aux
hommes.
L’évidence n’eft pas dans la foi ; mais les vérités
que la foi nous enfeigne font inféparables des connoiflances
évidentes. Ainfi la foi ne peut contrarier
la certitude de Y évidence ; & Y évidence, bornée aux
connoiflances naturelles, ne peut contrarier la foi.
L’évidence réfiilte néceflairement de l’obfervation
intime de nos propres fenfations : comme on le verra
par le détail luivant.
Ainfi j’entens par évidence, une certitude à laquelle
il nous eft auffi impojftble de nous refufer , qu'il nous eft
impojffible d'ignorer nos fenfations actuelles. Cette définition
fuffit pour appercevoir que le pyrrhonifme gé-,
néral eft de mauvaife foi.
E V I Les fenfations féparées ou diftinétes de l’image
des objets, font purement affectives ; telles font les
odeurs, le fon, les faveurs, la chaleur, le froid, le
plaifir, la douleur, la lumière, les couleurs, le fenr
riment de réfiftance, &c. Celles qui font repréfenta-
tives des objets nous font appercevoir la grandeur
de ces objets, leur forme, leur figure, leur mouvement,
& leur repos; elles font toujours réunies à
quelques fenfations affectives, furtout à la lumière,
aux couleurs, à la réfiftance, & fouvent à des fenti-
mens d’attrait ou d’averfion, qui nous les rendent
agréables ou defagréables. De-plus , fi on examine
rigoureufement la nature des fenfations repréfenta-
tives, on appercevra qu’elles ne font elles-mêmes que
des fenfations affectives réunies & ordonnées de maniéré
qu’elles forment des fenfations de continuité
ou d’étendue. En effet, ce font les fenfations fi-
multanées de lumière, de couleurs , de réfiftance,
qui produifent l’idée d’étendue. Lorfque j’apperçois,
par exemple, une étendue de lumière par une fenêtre
, cette idée n’eft autre chofe que les fenfa-
tions affectives que me caufent chacun en particulier,
& tous enfemble en même tems, les rayons de lumière
qui paffent par cette fenêtre. Il en eft de même
lorfque j’apperçois l’étendue des corps rouges, blancs,
jaunes, bleus , &c. car ces idées repréfentatives ne
font produites aufli que par les fenfations affectives
que me caufent enfemble les rayons colorés de lumière
qpe ces corps refléchiffent. Si j’applique ma main
fur un corps dur, j’aurai des fenfations de réfiftance qui
répondront à toutes les parties de ma main, & qui
pareillement compofent enfemble une fenfation re-
préfentative d’étendue. Ainfi les idées repréfentatives
d’étendue ne font compofées que de fenfations
affectives de lumière ou de couleurs, ou de réfiftance,
raffemblées intimement, & fenties les unes
comme hors des autres, de maniéré qu’elles femblent
former une forte de continuité qui produit l’idée re-
préfentative d’étendue , quoique cette idée elle-
même ne foit pas réellement etendue. En effet, il
n’eft pas néceffaire que les fenfations qui la forment
foient étendues ; il luffit qu’elles foient fenties chacune
en particulier diftinCtement, & conjointement
toutes enfemble dans un ordre de continuité.
Nous connoiflons nos fenfations en elles-mêmes,
parce qu’elles font des affeCtions de nous-mêmes,
des affeCtions qui ne font autre chofe que fentir. Ain-
li nous devons appercevoir que fentir n’eft pas la même
chofe qu’une étendue réelle , telle que celle qui
nous eft indiquée hors de nous par nos fenfations :
car on conçoit affez la différence qu’il y a entre fentir
& étendue réelle. Il n’eft donc pas de la nature
du mode fenfitif d’étendue , d’être réellement étendu
: c’eft pourquoi l’idée que j’ai de l’étendue d’une
chambre repréfentée dans un miroir, & l’idée que
j’ai de l’étendue d’une chambre réelle, me repréfen-
tent également de l’étendue ; parce que dans l’une &
l ’autre de ces deux idées, il n’y a.également que
l ’apparence de l’étendue. Aufli les idées repréfentatives
de l’étendue nous en impofent-elles parfaitement
dans le rêve, dans le délire, &c. Ainfi cette apparence
d’étendue doit être diftinguée de toute
etendue reelle, c eft-à-dire de l’étendue des objets
qu’elle nous repréfente. D ’oii il faut conclure aufli
que nous ne voyons point ces objets en eux-mêmes,
& que nous n’appercevons jamais que nos idées ou
fenfations.
De l’idée repréfentative d’étendue, réfultent celles
de figure, de grandeur, de forme, de fituation
de lieu , de proximité, d’éloignement, de mefure*
de nombre, de mouvemens, de repos, de lucceflion
de tems, de permanences, de changement, de rap-
P ° f j s > W Poyei SE N S A T IO N S . ^
Nous reconnoîtrons que ces deux fortes de fenfa-
Temc y i t
E V I 147
rions, je veux dire les fenfations Amplement affectiv
e s, & les fenfations repréfentatives, forment toutes
nos affeCtions, toutes nos penfées, & toutes nos
connoiflances naturelles & évidentes.
Nous ne nous arrêterons pas aux axiomes auxquels
on a recours dans les ecoles, pour prouver la
certitude de l’évidence ; tels font ceux-ci : on eft ajjûré
que le tout eft plus grand que fa partie ; que deux &
deux font quatre ; qu'il eft impojftble qu'une chofe foit &
& ne Joit pas en même tems. Ces axiomes font plutôt
des réfultats que des connoiflances primitives; & ils
ne font certains que parce qu’ils ont un rapport nécef-
faireavec d’autres vérités évidentes par elles-mêmes.
Connoiffances naturelles primitives, évidentes. Il eft
certain, i° . que nos fenfations nous indiquent néceflairement
un être en nous qui a la propriété de
fentir; car il eft évident que nos fenfations ne peuvent
exifter que dans un lujet qui a la propriété de
fentir.
2°* Que la propriété de fentir eft une propriété
paflive, par laquelle notre être fenfitif fe fent lui-
meme, & par laquelle il eft afluré de fon exiftence,
lorfqti’il eft affeCte de fenfations.
3®. Que cette propriété paflive eft radicale & ef--
fentielle à l’être fenfitif: ca r , rigoüreufement parlant
, c’eft lui-même qui eft cette propriété, puilque
c’eft lui-même qui fe fent,lorfqu’il eft affeCte de len-
fations. Or il ne peut pas fe fentir foi-même, qu’il ne
foit lui-même celui qui peut fe fentir : ainfi fa propriété
de fe fentir eft radicalement & effentiel-
lement inféparable de lu i, n’étant pas lui-même fé-
parable de foi-même. De plus, un fujet ne peut recevoir
immédiatement aucune forme, aucun accident,
qu’autant qu’il en eft fufceptible par fon eflence.
Ainfi des formes ou des affections accidentelles ne
peuvent ajouter à l’être fenfitif que des qualités accidentelles
, qu’on ne peut confondre avec lui-même,
c’eft à-dire avec fa propriété de fentir, par laquelle
il eft fenfible ou fenfitif par eflence.
Cette propriété ne peut donc pas réfulter de I’or-
ganifation du corps , comme l’ont prétendu quel-
ques philo fophes : l’organifation n’eft pas un état primitif
de la matière ; car elle ne confifte que dans des
formes que la matière peut recevoir. L organifation
du corps n’eft donc pas le principe conftitutif de la
capacité paflive de recevoir des fenfations. Il eft feu-
lément vrai que dans l’ordre phyfique nous recevons
toutes nos fenfations par l’entremife de l ’organifation
de notre corps, c’eft-à-dire par l’entremife du
méchanifme des fens & de la mémoire, qui font les
caufes conditionnelles des fenfations des animaux ;
mais il ne faut pas confondre les caufes,ni les formes
accidentelles, avec les propriétés paflives radicales
des êtres.
40. Que les fenfations ne font point eflentielles à
l’être fenfitif, parce qu’elles varient, qu’elles fe fuc-
cedent, qu’elles diminuent, qu’elles augmentent,
qu’elles ceffent : or ce qui eft féparable d’un être n’eft
point effentiel à cet être.
50. Que les fenfations font les formes ou les affections
dont l’être fenfitif eft fufceptible par fa faculté
de fentir; car cette propriété n’eft que la capacité
de recevoir des fenfations.
6°. Que les fenfations n’exiftent dans l’être fenfitif
qu’autant qu’elles l’affeftent aéhiellement & fen-
fiblement ; parce qu’il eft de l’effence des fenfations
d’affeâer fenfiblement l’être fenfitif. ;
70. Qu’il n’y a que nos fenfationsqui nous foient
connues en elles-mêmes ; que toutes les autres con*.
noiflances que nous pouvons acquérir avec évidence
ne nous font procurées que par indication, c’eft-à-
dire par les rapports, effenriels ou par les rapports
néceflaires qu’il y a entre nos fenfations & notre
être fenfitif; entre les fenfations & les objets de