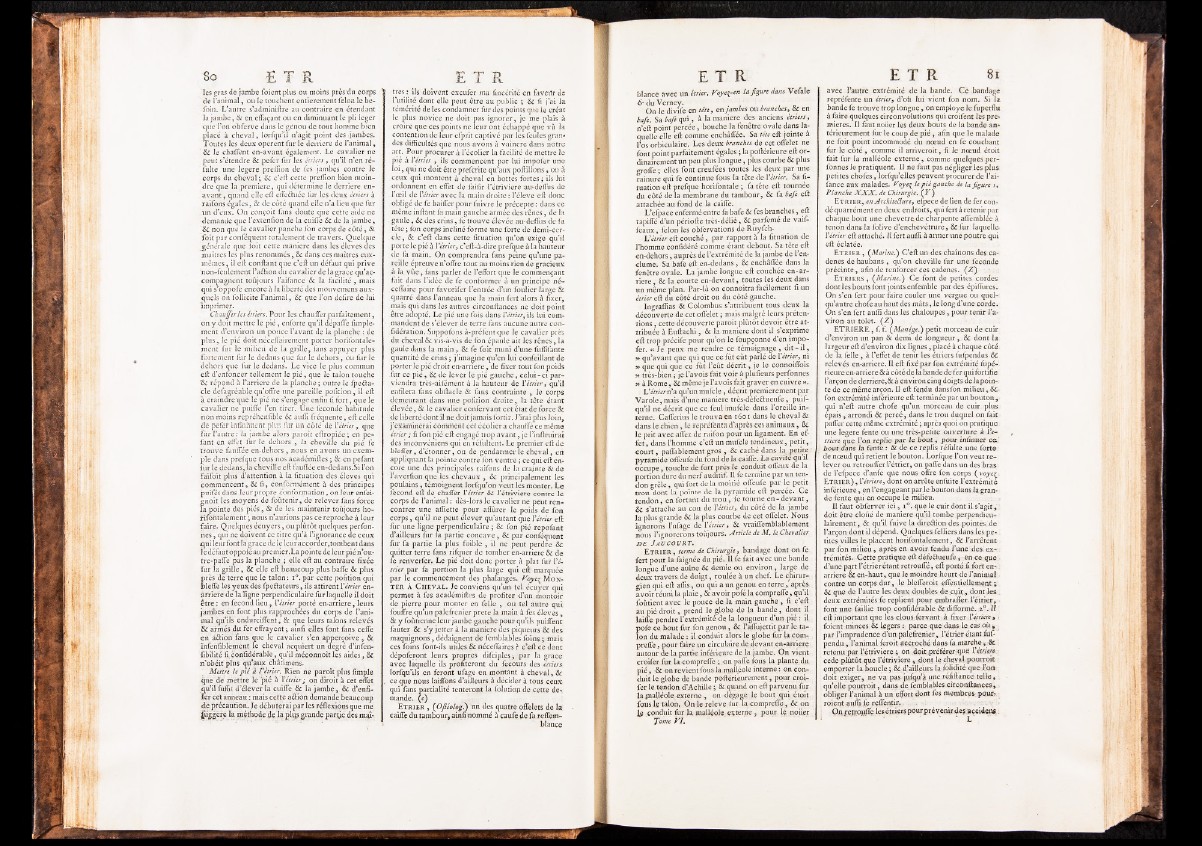
les gras de jambe foientplus ou moins près'du corps
tic l’animal, ou le touchent entièrement félon le besoin.
L’autre s’adminiflre au contraire en étendant
la jambe, & en effaçant ou en diminuant le pli leger
qiie'l’on obferve dans le genou de tout homme bien
placé à cheval, lorfqu’il n’agit point des ..jambes.
Toutes les deux opèrent fur le derrière de l’animal,
& le chaffent en-avant également. Le cavalier ne
peut s’étendre & pefer fur les étriers, qu’il n’en ré-
fulte une legere preffion de fes -jambes contre le
corps du cheval ; & c’efl cette preffion bien moindre
que la première, qui détermine le derrière en-
avant , quand elle efl effectuée fur les deux étriers à
raifons égales, & de côté quand elle n’a lieu que fur
lin d’eux. On conçoit fans doute que cette aide ne
-demande que l’extenfion de la cuiffe & de la jambe,
'& non que le cavalier panche fon corps de côté, &
foit par cônféquent totalement de travers. Quelque
générale que foit cette maniéré dans les éleves des
maîtres les plus renommés, & dans ces maîtres eux-
mêmes , il efl confiant que c’efl un défaut qui prive
non-feulement l’aêlion du cavalier de la grâce qu’accompagnent
toujours l’aifance & la facilité , mais
qui s’oppofe encore à la liberté des mouvemens auxquels
on follicite l’animal, & que l’on defire de lui
Imprimer.
Chauffer les étriers. Pour les chauffer parfaitement,
on y doit mettre le pié, enforte qu’il dépaffe Amplement
d’environ un pouce l’avant de la planche : de
plus, le pié doit néceffairement porter horifontale-
ment fur le milieu de la grille, fans appuyer plus
fortement fur le dedans que fur le dehors, ou fur le
dehors que fur le dedans. Le vice le plus commun
efl d’enfoncer tellement le pié , que le talon touche
fêc répond à l’arriere de la planche ; outre le fpeéla-
cle defagréable qu’offre une pareille pofition, il efl
û craindre que le pié ne s’engage enfin fi fort, que le
cavalier ne puiffe l’en tirer. Une fécondé habitude
non moins repréhenfible & auffi fréquente, efl celle
de pefer infiniment plus fur un côté de Vétrier, que
fur l’autre : "là jambe alors paroît eftropiée ; en pe-
fant en effet fur le dehors , la cheville du pié fe
trouvé fauffée en-dehors , nous en avons un exem-
jple dans préfque tous nos académifles ; & en pefant
fur le dedans, la cheville efl fauffée en-dedans.Sil’on
ïaifoit plus d’attention à la fituation des éleves qui
commencent, & fi, conformément à des principes
puifes dans leur propre conformation, on leur enfei-
gnoit les moyens de fputenir, de relever fans force
la pointe des piés, Sf de les maintenir toujours ho-
rifontalement ; nous n’aurions pas ce reproche à leur
faire. Quelques écuyers, ou plûtôt quelques perfon-
nes, qui ne doivent ce titre qu’à l’ignorance de ceux
qui leurfont la grâce de le leur accorder,tombent dans
le défaut oppofé au premier.La pointe de leur pié n’ou-
tre-paffe pas la planche,; elle efl au contraire fixée
fur la grille, & elle efl beaucoup plus baffe & plus
près de terre que le talon: i° . par cette pofition qui
bleffe les yeux des fpeûateurs, ils attirent Vétrier en-
àifiere de la ligne perpendiculaire fur laquelle il doit
être : en fécond lieu, l’étrier porté en-arriere, leurs
jambes en font plus rapprochées du corps de l'animal
qu’ils endurciffent, & que leurs talons relevés
& armés .du fer effrayent ; ainfi elles font fans ceffe
«n ation fans que le cavalier s’en apperçoiye, &
înfenfiblëment le cheval acquiert un degré d’infen-
fibilité fi. confidérable, qu’il méconnoît les aides, &
«’obéit,plus qu’aux châtimens.
Mettre le pié à Vétrier. Rien ne paroît plus fiinple
que de mettre le pié à l’étrier ; on diroit à cet effet
qu’il fuffit d’élever la cuiffe & la jambe, Sc d’enfiler
cet anneau : mais cette aélion demande beaucoup
«le précaution. Je débuterai par les réflexions que me
fuggére la méthode de la plus grande partie, des maitrès
: ils doivent excufer ma fincérité en faveur de
. l ’utilité dont elle peut être au public ; & fi j’ai la
témérité de les condamner fur des points que le créât
le plus novice ne doit pas ignorer, je me plais à
croire que ces points ne leur ont échappé que vu la
contention de leur efprit captivé par les feules grandes
difficultés que nous avons à vaincre dans notre
art. Pour procurer à l’écolier la facilité de mettre le
pié à l’étrier , ils commencent par lui impofer une
loi, qui ne doit être prefcrite qu’aux poflillons , ou à
ceux qui montent à cheval en bottes fortes ; ils lui
ordonnent en effet de faifir l’étriviere au-deflus de
. l’oeil de l’étrier avec la main droite : l’éleve éfl donc
obligé de fe baiffer pour fuivre le précepte : dans ce
même inflant fa main gauche armée des rênes, de la
. gaule, & des crins, fe trouve élevée au-deffus de fa
tête ; fon corps incliné forme une forte de demi-cercle,
& c’efl dans cette fituation qu’on exige qu’il
porte le pié à l 'étrier, c’efl-à-dire prefque à la hauteur
de fa main. On comprendra fans peine qu’une pareille
épreuve n’offre tout au moins rien de gracieux
:à la vue., fans parler de l’effort que le commençant
fait dans l’idée de fe conformer à un principe né-
ceffaire pour favorifer l’entrée d’un foulier large &
quarré dans l’anneau que la main fert alors à fixer,
mais qui dans les autres circonflances ne doit point
.être adopté. Le pié une fois dans l’étrier, ils lui commandent
de s’élever de terre fans aucune autre considération.
Suppofons à-préfentque le cavalier près
du cheval &: vis-à-vis de fon épaule ait les rênes, la
gaule dans la main, & fe foit muni d’une fuffifante
quantité de crins ; j’imagine qu’en lui confeillant de
porterie pié droit en-arriere, de fixer tout fon poids
fur ce pié , & de lever le pié gauche, ce lu i-ci parviendra
très-aifément à la hauteur de l’étrier , qu’il
enfilera fans obflacle & fans contrainte , le corps
demeurant dans une pofition droite, la tête étant
élevée, & le cavalier confervant cet état de force &
de liberté dont il ne doit jamais fortir. J’irai plus loin,
.j’examinerai comment cet écolier a chauffé ce même
étrier ; fi fon pié efl engagé trop avant, je l’inflruirai
des inconvéniens qui en réfultent. Le premier efl de
bleffer, d’étonner, ou de gendarmer le cheval, en
appliquant la pointe contre fon ventre ; ce qui efl encore
une des principales raifons de la crainte & de
l’averfion que les chevaux , & principalement les
poulains, témoignent lorfqu’on veut les monter. Le
fécond efl de chaffer l’étrier & l’étriviere contre le
corps de l’animal : dès-lors le cavalier ne peut rencontrer
une afliette pour affûrer le poids de fon
corps, qu’il ne peut élever qu’autant que l’étrier efl
fur une ligne perpendiculaire ; & fon pié repofant
d’ailleurs fur la partie concave, & par cônféquent
fur fa partie la plus foible , il ne peut perdre &c
quitter terre fans rifquer de tomber en-arriere & de
le renverfer. Le pié doit donc porter à plat fur l’étrier
par fa portion la plus large qui efl marquée
par le commencement des phalanges. Voyez Mon-
ter À Cheval. Je conviens qu’un tel écuyer qui
permet à fes académifles de profiter d’un.montoir
de pierre pour monter en felle , ou tel autre qui
fouffre qu’un palefrenier prete la main à fes éleves ,
& y foûtienne leur jambe gauche pour qu’ils puiffent
fauter & s’y jettcr à la maniéré des piqueurs & des
maquignons, dédaignent de femblables foins ; mais
ces foins font-ils utiles & néceffaires ? c’efl ce dont
déposeront leurs propres difciples-, par la grâce
avec laquelle ils profiteront du fecours des etriers
lorfqu’ils en feront ufage en montant à cheval, &
ce que nous laiffons d’ailleurs à décider à tous c.eux
qui lans partialité tenteront la folution de cette de-,
mande. ( e) Étrier , (Oftèolog.) un des quatre offelets de la
caiffe du tambour, ainfi nommé à caiife de fa reffem-
blance
Mance avec lin étrier. Vyyeç-en lafigurt dans Vefale
& du Verney.
On le divife en tête, en jambes ou branches, oç en
bafe. Sa bafe qui , à la maniéré des anciens étriers,
n’efl point percée, bouche la fenêtre ovale dans laquelle
elle efl comme enchâffée. Sa tête efl jointe à
l’os orbiculaire. Les deux branches de cet offelet ne
font point parfaitement égales ; la poflérieure efl ordinairement
un peu plus longue, plus courbe & plus
groffe ; elles font creufées toutes les deux par une
rainure qui fe continue fous la tête de l’étrier. Sa fituation
efl prefque horifontale ; fa tête efl tournée
du côté de la membrane du tambour, & fa bafe efl
attachée au fond de la caiffe.
L’efpace enfermé entre fa bafe & fes branches, efl
îapiffé d’un périofle très-délié, & parfeme de vaif-
feaux, félon les obfervations de Ruyfch-
L’étrier efl couché, par rapport à la fituation de
l’homme confidéré comme étant debout. Sa tete efl
en-dehors, auprès de l’extrémité de la. jambe de l’enclume.
Sa bafe efl en-dedans, & enchâffée dans la
fenêtre ovale. La jambe longue efl couchee en-arriere
, & la courte en-devant, toutes les deux dans
un même plan. Par-là on connoîtra facilement fi un
étrier efl du côté droit ou du côté gauche.
Ingraflias & Colombus s’attribuent tous deux la
découverte de cet offelet ; mais malgré leurs prétentions
, cette découverte paroît plûtôt devoir, être attribuée
à Euflachi, & la maniéré dont il s’exprime
efl trop précife pour qu’on le foupçonne d’en impofer.
«Je peux me rendre ce témoignage, d i t - i l , .
» qu’avant que qui que ce fût eût parlé de Y étrier, ni
» que qui que ce fût l’eût décrit, je le connoiffois
» très-bien ; je l’avois fait voir à plufieurs perfonnes
» à Rome, & même je l’avois fait graver en cuivre ».
L’étrier n’a qu’un mufcle, décrit premièrement par
Varole, mais d’une maniéré très-défe£lueufe, puif-
qu’il ne décrit que ce feul imufcle dans l’oreille interne.
Cafferius le trouva en 1601 dans le cheval &
dans le chien ,.le repréfenta d’après ces animaux, &
le prit avec affez de raifon pour un ligament. En effe
t , dans l’homme c’efl un mufcle tendineux, petit ,
cou rt, paffablement gros , & caché dans la petite I
pyramide ôffeufe du fond de la caiffe. La cavité qu’il
occupe, touche de fort près le conduit offeuX de la
portion dure du nerf auditif. Il fe termine par un tendon
grêle, qui fort de la moitié offeufe par le petit
trou dont la pointe de la pyramide efl percée. Ce
tendon, en fortant du trou, fe tourne en - devant,
& s’attache au cou de Yétrier^ du côté de la jambe
la plus grande & la plus courbe de cet offelet. Nous
ignorons l’ufâge de Y étrier, & vraiffemblablement
nous l’ignorerons toûjours'. Article de M. le Chevalier
D E J a V C O U R T . Etrier, terme de Chirurgie, bandage dont on fe
fert pour la faignée du pié.. Il fe fait avec une bande
longue d’une aulne & demie ou environ, large de
deux travers de doigt, roulée à un chef. Le chirurgien
qui efl affis, ou qui a un genou en terre., après
avoir réuni la plaie, & avoir pofé la compreffe, qu’il
lbûtient avec le pouce de la main gauche , fi c’efl
au pié droit, prend le globe de la bande, dont il
laiffe pendre l’extrémité de la longueur d’un pié : il
pofe ce bout fur fon genou, & l’affujettit par le talon
du malade : il conduit alors le globe fur la cont-,
preffe, pour faire un circulaire de devant en-arriere
autour de la partie inférieure de la jambe. Ôn vient
croifer fur la compreffe ; on paffe fous la plantedu
p ié , & on revient fous la malléole interne : on conduit
le globe de, bande poflérieurement, pour croifer
le tendon d’Àchille ; & quand on efl parvenu fur
la jnalléole.externe , on dégage le bout, qui étqit
fous lç talon, On le releve lur la com p re ffe& on
Ig conduit fur la malléole, externe , pour le noiier
J'orne VI.
avec l’autre extrémité de la bande. Cé bandage
repréfente un étrier, d’oti lui vient fon nom. Si la
bande fe trouve trop longue, on employé le fuperflu
à faire quelques circonvolutions qui croifent les pre*
mieres. Il faut noiier les deux bouts de la bande an*
térieurement fur le coup de p ié , afin que le malade
ne foit point incommodé du noeud en fe couchant
fur le côté , comme il arriveroit, fi le noeud étoit
fait fur la malléole externe, comme quelques perfonnes
le pratiquent. 11 ne faut pas négliger les plus
petites chofes, lorfqu’elles peuvent procurer de l’aifance
aux malades. Voye^ le pié gauche de la figure u
Planche X X X . de Chirurgie. ( T ) Etrier, en Architecture, efpece de lien de fer coudé
quarrément en deux endroits, qui fert à retenir par.
chaque bout une chevetre de charpente affemblée à
tenon dans la folive d’enchevêtrure, & fur laquelle.
Yétrier efl attaché. Il fert auffi à armer une poutre qui
efl éclatée« Etrier, (Marine.) C’efl un des chaînons des ca*
denes de haubans , qu’on cheville fur une fécondé
précinte, afin de renforcer ces cadenes. (Z ) Etriers , (Marine.) Ce font de petites cordes
dont les bouts font joints enfemble par des épiffures.
On s’en fert pour faire couler une vergue, ou quel-:
qu’autre chofe au haut des mâts, le long d’une.corde.
On s’en fert auffi dans les chaloupes,.pour tenir l’aviron
au tolet. (Z )
ETR1ER E, f. f. (Manège.) petit morceau de cuir
d’environ un pan & demi de longueur dont la,
largeur efl d’environ dix lignes, placé à chaque côté,
de la felle, à l’effet de tenir les étriers fufpendus &
relevés en-arriere. Il efl fixé par fon extrémité fupé-’.
rieure en-arriere &à côté de la bande de fer qui fortifie
l’arçon de derrière,& à environ cinq doigts de lapoin-,
te de ce même arçon. Il efl fendu dans fon milieu,
fon extrémité inférieure efl terminée par un bouton ,
qui n’efl autre chofe qu’un morceau de cuir plus'
épais,. arrondi & percé, dans le' trou duquel on fait
paffer cette même extrémité ; après quoi on pratique,
une legere fente ou une très-petite ouverture à l’e-
triere que J,’on replie par ie bou t, pour inffnuer ce."
bout-dans la fente : & de ce replis réfulte une forte,
de noeud qui retient le bouton. Lorfque l’bn veut relever
ou retrouffer l’ étrier, on paffe dans un des bras
de l’efpece d’anfé que nous offre fon corps (voye^> Etrier) , Yétriere, dont on arrête enfuite l’extrémité
inférieure, en l’engageant par le bouton dans la grande
fente qui en occupe le milieu«
Il faut obferver ic i , i° . que le cuir dont il,s’agit,
doit être cloiié de maniéré qu’il tombe perpendiculairement
, & qu’il fuive la direction des.pointes.’de
l’arçon dont il dépend. Quelques felliers dans les p e -.
tites villes le placent horifontalement ., & l’arrêtent
par fort milieu, après en , avoir, fendu,l’une des' ex- :
trémités. Cette pratique efl défeélueufe, ,- én ce que
d’une part l’étrier étant retrouffé, efl porté.fifo/t en- :
arriéré & en-haut, que le moindre heurt de l’animal
contre un corps dur, le blefferoit effentiellement.;
& que de l’autre les deux, doubles de .cyir., dont les .
deux extrémités fe replient pour embraffer, l’étrier,
font une faillie trop confidérable & difformè. z°. Il
efl important que les ,cj,ous ferv,ant ,à fixer Yétriere* ■
foient minces & légers :• parce, que .dans de cas où *^
par l’imprudence d’un palefrenier,,l’étrier étantXüf-
pend.u 9 l’animal feroit accroché dans fa marche, & !
retenu par l’étriviere ; on doiCpréférer;que YejrJe/e
cede plûtôt que l’étriviere , .dont le cheyal pourroit
emporter la boucle ; & d’ailleurs la folidité que lcon;
doit exigpr, ne va pas jufqu’à une réfiflance telle,
qu’elle pourroit, dans de femblables circOnRances ,
obliger l’animal à un effort dont fes membres: pôufr. ■
roient.yulfi fe reffentir., .
Onretrouffe les étriers pourpré venir des accidens.
* V