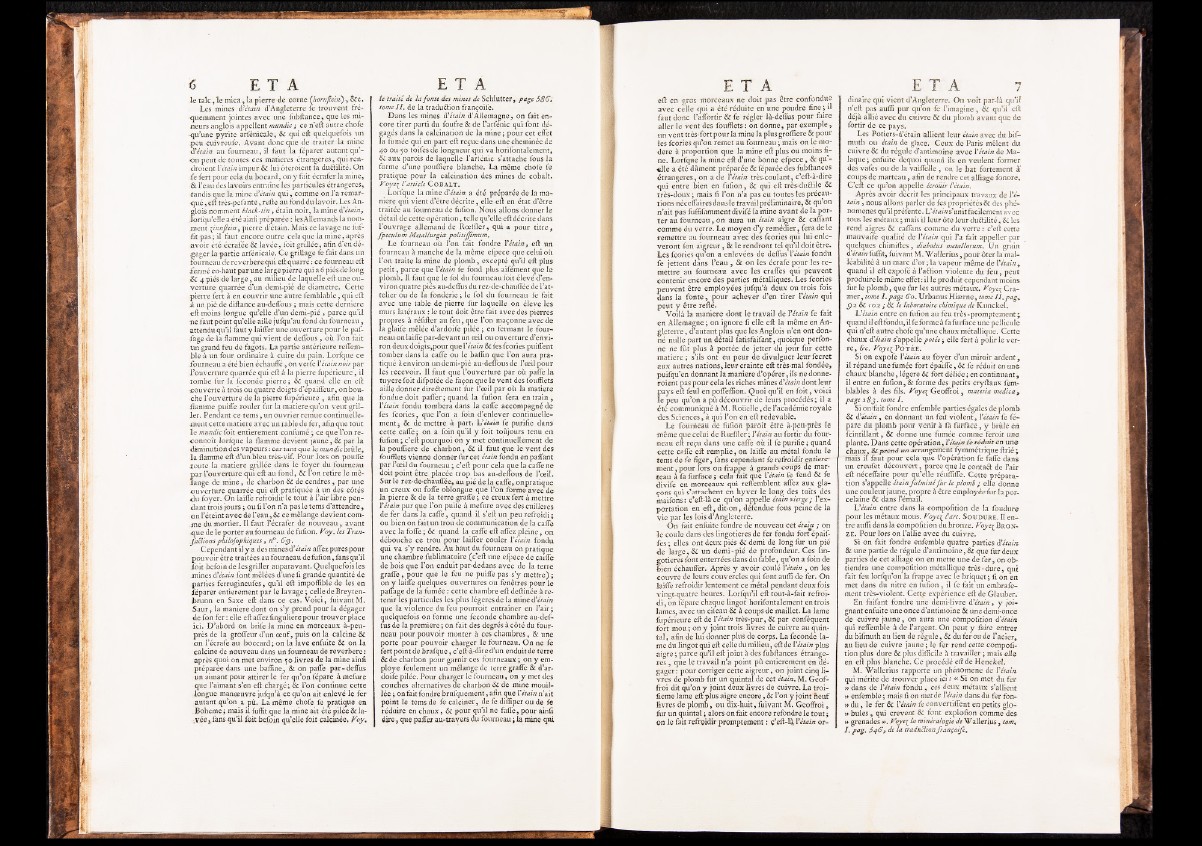
le talc ,1e m ica, la pierre de corne ('homfiein.) , &c.
Les mines $ étain d’Angleterre le trouvent fréquemment
jointes avec une fubftance, que les mineurs
anglois appellent mundic ; ce n’eft autre chofe
-qu’une pyrite arfénicale, &: qui eft quelquefois un
peu cuivreule. Avant donc que de traiter la mine
d ’étain au fourneau, il faut la féparer autant qu’on
peut de toutes ces matières étrangères, qui ren-
droient Y étain impur & lui ôteroient là duâilité. On
fe fert pour cela du bocard, on y fait écrafer la mine,
& l’eau des lavoirs entraîne les particules étrangères,
tandis que la mine d’étain qui, comme on l’a remarqué
, eft très-pefante, relie au fond du lavoir. Les Anglois
nomment black-tin, étain noir,.la mine dé étain,
.Jorfqu’elle a été ainfx préparée : lesAllemands la nomment
{innjlein, pierre d’étain. Mais ce lavage ne fuffit
pas; il faut encore outre cela que la mine, après
avoir été écrafée 6c lavée, foit grillée, afin d'en dégager
la partie arfénicale. Ce grillage fe fait dans un
fourneau de reverbere qui eft quarré : ce fourneau eft
-fermé en-haut par une large pierre qui a 6 piés de long
6c 4 piés de large, au milieu de laquelle eft une ouverture
quarrée d’un demi-pié de diamètre. Cette
pierre fert à en couvrir une autre femblable, qui eft
un pié de diftance au-deffous ; mais cette derniere
eft moins longue qu’elle d’un demi-pié , parce qu’il
me faut point qu’elle aille jufqu’au fond du fourneau,
attendu qu’il faut y laiffer une ouverture pour le paf-
-fage de la flamme qui vient de deffous, oit l’on fait
un grand feu de fagots. La partie antérieure reffem-
ble à un four ordinaire à cuire du pain. Lorfque ce
fourneau a été bien échauffé, on verfe Y étain noir par
l ’ouverture quarrée qui eft à la pierre fupérieure, il
tombe for la fécondé pierre ; 6c quand elle en eft
-couverte à trois ou quatre doigts d’epaiffeur, on bouche
l’ouverture de la pierre fupérieure , afin que la
-flamme puiffe rouler fur la matière qu’on veut griller.
Pendant ce tems, un ouvrier remue continuelle-
jnent cette matière avec un rable de fer, afin que tout
le mundic foit entièrement confumé ; ce que l’on re-
•connoît lorfque la flamme devient jaune, 6c par la
diminution des vapeurs : car tant que le mundic brûle,
la flamme eft d’un bleu très-vif. Pour lors on pouffe
.toute la matière grillée dans le foyer du fourneau
par l’ouverture qui eft au fond, 6c l’on retire le mélange
de mine, de charbon 6c de cendres, par une
ouverture quarrée qui eft pratiquée à un des côtés
du foyer. On laiffe refroidir le tout à l’air libre pendant
trois jours ; ou fi l’on n’a pas le tems d’attendre,
on l’éteint avec de l’eau, 6c ce mélange devient com-
.me du mortier. Il faut l’écrafer de nouveau, avant
que de le porter au fourneau de fufion. Voy. les Transactions
philofophiques , n°. 6g .
Cependant il y a des mines d’étain affez pures pour
pouvoir être traitées au fourneau de fufion, fans qu’il
ibit befoin de les griller auparavant. Quelquefois les
.mines d’étain font mêlées d’une fi grande quantité de
parties ferrugineufes, qu’il eft impoffible de les en
féparer entièrement par le lavage ; celle de Breyten-
brunn en Saxe eft dans ce cas. V oici, fuivantM.
Saur, la maniéré dont on s’y prend pour la dégager
de fon fer : elle eft affez finguliere pour trouver place
ici. D ’abord on brife la mine en morceaux à-peu-
près de la groffeur d’un oeuf, puis on la calcine 6c
on l’écrafe au boccard; on la îave enfuite 6c on la
calcine de nouveau dans un fourneau de reverbere :
après quoi.on met environ 50 livres de la mine ainfi
préparée dans une bafïine, & on paffe par-deffus
un aimant pour attirer le fer qu’on fépare à mefure
que l’aimant s’en eft chargé; & l’on continue cette
;longue manoeuvre jufqu’à ce qu’on ait enlevé le fer
autant qu’on a pû. La même chofe fe pratique en
.Boheme ; mais il fuffit que la mine ait été pilée & larvée
j fans qu’il foit befoin qu’elle foit calcinée. Voy.
te traité de la fonte des mines de Schlutter, page £86i
tome I I . de la traduftion françoife.
Dans les mines d’étain d’Allemagne, on fait encore
tirer parti du foufre & de l’arfénic qui font dégagés
dans la calcination de la mine ; pour cet effet
la fumée qui en part eft reçue dans une cheminée de
40 ou 50 toifes de longueur qui va horifontalement,
6c aux parois de laquelle l’arfénic s’attache fous la
forme d’une pouffiere blanche. La même chofe fe
pratique pour la calcination des mines de cobalt.
Voye^ l ’article COBALT.
Lorfque la mine dé étain a été préparée de la maniéré
qui vient d’être décrite, elle eft en état d’être
traitée au fourneau de fufion. Nous allons donner le
détail de cette opération, telle qu’elle eft décrite dans
l’ouvrage allemand de Roeffler, qui a pour titre,
fpeculum Metallurgice politljjimum.
Le fourneau où l’on fait fondre Y étain, eft un
fourneau à manche de la même efpece que celui où
l’on traite la mine de plomb, excepté qu’il eft plus
petit, parce que Y étain fe fond plus aifément que le
plomb. Il faut que le fol du fourneau foit élevé d’environ
quatre piés au-deffus du rez-de-chauffée de l’at-
telier ou de la fonderie ; le fol du fourneau fe fait
avec une table de pierre fur laquelle on éleve les
murs latéraux : le tout doit être fait avec des pierres
propres à réfifter au feu, que l’on maçonne avec de
la glaife mêlée d’ardoife pilée ; en fermant le fourneau
on laiffe par-devant un oeil ou ouverture d’environ
deux doigts,pour que Y étain 6c fes feories puifl'ent
tomber dans la caffe ou le baflin que l’on aura pratiqué
à environ un demi-pié au-deffous de l’oeil pour
les recevoir. Il faut que l’ouverture par où paffe la
tuyere foit difpofée de façon que le vent des foufïlets
aille donner directement lur l’oeil par où la matière
fondue doit paffer ; quand la fufion fera en train,
Y étain fondu tombera dans la caffe accompagné de
fes feories, que l’on a foin d’enlever continuellement,
& de mettre à part, h ’étain fe purifie dans
cette caffe ; on a foin qu’il y foit toujours tenu en
fufion ; c’eft pourquoi on y met continuellement de
la pouffiere de charbon, 6c il faut que le vent des
foufflets vienne donner fur cet étain fondu en paffant
par l’oeil du fourneau ; c’eft pour cela que la caffe ne
doit point être placée trop bas au-deffous de l’oe il.
Sur le rez-de-chauffée, au pié de la caffe, on pratique
un creux ou foffe oblongue que l’on forme avec de
la pierre & de la terre graffe ; ce creux fert à mettre
Y étain pur que l’on puilè à mefure avec des cuillères
de fer dans la caffe, quand il s’eft un peu refroidi ;
ou bien on fait un trou de communication de la caffe
avec la foffe ; & quand la caffe eft affez pleine, on
débouche ce trou pour laiffer couler Yétain fondu
qui va s’y rendre. Au haut du fourneau on pratique
une chambre fublimatoire (c’eft une efpece de caiffe
de bois que l’on enduit par-dedans avec de la terre
graffe, pour que le feu ne puiffe pas s’y mettre) ;
on y laiffe quelques ouvertures ou fenêtres pour le
paffage de la fumée : cette chambre eft deftinée à retenir
les particules les plus légères de la mine d’étain
que la violence du feu pourroit entraîner en l’air ;
quelquefois on forme une fécondé chambre au-def-
lus de la première ; on fait des degrés à côté du fourneau
pour pouvoir monter à ces chambres, & une
porte pour pouvoir charger le fourneau. On ne fe
fert point de brafque, c’eft-à-dire d’un enduit de terre
& de charbon pour garnir ces fourneaux ; on y employé
feulement un mélange de terre graffe & d’ardoife
pilée. Pour charger le fourneau, on y met des
couches alternatives de charbon 6c de mine mouillée
; on fait fondre brufquement, afin que Y étain n’ait
point le tems de fe calciner, de fe diffiper ou de fe
réduire en chaux, 6c pour qu’il ne faffe, pour ainfi
dire, que paffer au-travers du fourneau ; la mine qui
eft en gros morceaux ne doit pas être confondue
avec celle qui a été réduite en une poudre fine ; il
faut donc l’affortir 6c fe régler là-deffus pour faire
aller le vent des foufflets : on donne, par exemple,
un vent très-fort pour la mine la plus groffiere & pour
les feories qu’on remet au fourneau ; mais on le modéré
à proportion que la mine eft plus ou moins fine.
Lorfque la mine eft d’une bonne efpece, & qu -
«lie a été dûment préparée 6c féparée des fubftances
étrangères, on a de Y étain très-coulant, c’eft-à-dire
qui entre bien en fufion, 6c qui eft très-duâile 6c
très-doux; mais fi l’on n’a pas eu toutes les précautions
néceffairesdansle travail préliminaire, & qu on
n’ait pas fuffifammentdivifé la mine avant de la porter
au fourneau, on aura un étain aigre 6c caffant
comme du verre. Le moyen d’y remédier, fera de le
remettre au fourneau avec des feories qui lui enlèveront
fon aigreur, & le rendront tel qu’il doit être.
Les feories qu’on a enlevées de deffus Yétain fondu
fe jettent dans l’eau , 6c on les écrafe pour les remettre
au fourneau avec les craffes qui peuvent
contenir encore des parties métalliques. Les feories
peuvent être employées jufqu’à deux ou trois fois
dans la fonte, pour achever d’en tirer Yétain qui
peut y être refté.
Voilà la maniéré dont le travail de Y étain fe fait
en Allemagne ; on ignore fi elle eft la même en Angleterre
, d’autant plus que les Anglois n’en ont donné
nulle part un détail làtisfaifant, quoique perfon-
ne ne fut plus à portée de jetter du jour fur cette
matière ; s’ils ont eu peur de divulguer leur fecret
aux autres nations, leur crainte eft très-mal fondée,
puifqu’en donnant la maniéré d’opérer, ils nedonne-
roient pas pour cela les riches mines d’étain dont leur
pays eft feul en poffeffion. Quoi qu’il en foit, voici
le peu qu’on a pû découvrir de leurs procédés ; il a
été communiqué à M. Rouelle, de l’académie royale
des.Sciences, à qui l’on en eft redevable.
Le fourneau de fufion paroît être à-peu-près le
même que celui de Roeffler; Y étain au fortir du fourneau
eft reçu dans une caffe où il fe purifie ; quand
cette caffe eft remplie, on laiffe au métal fondu le
tems de fe figer, fans cependant fe refroidir entièrement
, pour lors on frappe à grands coups de marteau
à fa furface ; cela fait que Y étain fe fend 6c fe
divife en morceaux qui reflemblent affez aux glaçons
qui s’attachent en hy ver le long des toîts des
maifons: c’eft-làce qu’on appelle étain vierge ; l’exportation
en eft, dit-on, défendue fous peine de la
vie par les lois d’Angleterre.
On fait enfuite fondre de nouveau cet étain ; on
ïe coule dans des lingotieres de fer fondu fort épaif-
fes ; elles ont deux piés 6c demi de long fur un pié
de large, 6c un demi-pié de profondeur. Ces lingotieres
font enterrées dans du fable, qu’on a foin de
bien échauffer. Après y avoir coulé Y étain , on les
couvre de leurs couvercles qui font auffi de fer. On
laiffe refroidir lentement ce métal pendant deux fois
vingt-quatre heures. Lorfqu’il eft tout-à-fait refroid
i, on fépare chaque lingot horifontalement entrois
lames, avec un cifèau 6c à coups de maillet. La lame
fupérieure eft de Yétain très-pur, 6c par conféquent
fort mou ; on y joint trois livres de cuivre au quinta
l, afin de lui donner plus de corps. La fécondé lame
du lingot qui eft celle du milieu, eft de Y étain plus
aigre ; parce qu’il eft joint à des fubftances étrangères
, que le travail n’a point pû entièrement en dégager
: pour corriger cette aigreur, on joint cinq livres
de plomb fur un quintal de cet étain. M. Geoffroi
dit qu’on y joint deux livres de cuivre. La troi-
fieme lame eft plus aigre encore, & l’on y joint fieuf
livres de plomb, ou dix-huit, fuivant M. Geoffroi,
fur un quintal ; alors on fait encore refondre le tout ;
on le fait refroidir promptement : ç’eft-là Y étain ordinaire
qui vient d’Angleterre. On voit par-là qu’il
n’eft pas auffi pur qu’on fe l’imagine, 6c qu’il eft
déjà allié avec du cuivre 6c du plomb avant que de
fortir de ce pays.
Les Potiers-d’étain allient leur étain avec du bif-
muth ou étain de glace. Ceux de Paris mêlent du
cuivre 6c du régule d’antimoine avec Y étain de Ma-
laque ; enfuite dequoi quand ils en veulent former
des vafes ou de la vaiffelle , on le bat fortement à
coups de marteau, afin de rendre cet alliage fonore.
C’eft ce qu’on appelle écroüir Cétain.
- Après avoir décrit les principaux travaux de IV-
tain, nous allons parler de fes propriétés 6c des phénomènes
qu’il prélente. L’étain s’unit facilement avec
tous les métaux ; mais il leur ôte leur duèlilité, 6c les
rend aigres & caflàns comme du verre : c’eft cette
mauvaife qualité de Y étain qui l’a fait appeller par
quelques cnimiftes, diabolus metallorum. Un grain
d’étain fuffit, fuivant M. W allerius, pouf ôter la malléabilité
à un marc d’or ; la vapeur même de Y étain,
quand il eft expofé à l’aftion violente du feu , peut
produire le même effet : il le produit cependant moins
fur le plomb, que fur les autres métaux. Voye^ Cramer,
tome 1. page 60. Urbanus Hiærne, tome I I. pag1
6c 102 ; 6c le laboratoire chimique de Kunckel.
L’étain entre en fufion au feu très-promptement;
quand il eft fondu, il fe forme à fa furface une pellicule
qui n’eft autre chofe qu’une chaux métallique. Cette
chaux d’étain s’appelle potée ; elle fert à polir le verre
, &c. Voye^ Potée.
Si on expofe Y étain au foyer d’un miroir ardent,
il répand une fumée fort épaiffe, 6c fe réduit en une
chaux blanche, légère & fort déliée; en continuant,
il entre en fufion, & forme des petits cryftaux fem-
blables à des fils. Voye^ Geoffroi, materia medica,
page 2 83. tome I.
Si ontfait fondre enfemble parties égales de plomb
& détain , en donnant un feü violent, Y étain fe fépare
du plomb pour venir à fa furface, y brûle en
l'cintillant, 6c donne une fiimée comme feroit une
plante. Dans cette opération, Y étain fe réduit en une
chaux, & prend an arrangement fymmétrique ftrié ;
mais il faut pour cela que l’opération fe faffe dans
un creufet découvert, parce que le contaft de l’air
eft néceffaire pour qu’elle réuffiffe. Cette préparation
s’appelle étain fulminéfur le plomb ; elle donne
une couleur jaune, propre à être employée fur la porcelaine
6c dans l’émail.
L’étain entre dans la eompofition de la foudure
pour les métaux mous. Voye£ l ’art. Soudure. Il entre
auffi dans la eompofition du bronze. Voycr Bronze.
Pour lors on l’allie avec du cuivre.
Si on fait fondre enfemble quatre parties détain
& une partie de régule d’antimoine, 6c que fur deux
parties de cet alliage on en mette une de fer, on obtiendra
une eompofition métallique très - dure, qui
fait feu lorfqu’on la frappe avec le briquet ; fi on en
met dans du nitre en fufion , il fe fait un embrafe-
ment très-violent. Cettg expérience eft de Glauber.
En faifant fondre une demi-livre détain, y joignant
enfuite une once d’antimoine & une demi-once
de cuivre jaune, on aura une eompofition d’étain
qui reffemble à de l’argent. On peut y faire entrer
du bifmuth au lieu de régule, & du fer ou de l’acier,
au lieu de cuivre jaune ; le fer rend cette compofi-
tion plus dure 6c plus difficile à travailler ; mais elle
en eft plus blanche. Ce procédé eft de Henckel.
M. Wallerius rapporte un phénomène de Yétain
qui mérite de trouver place ici : « Si on met du fer
» dans de Y étain fondu , ces deux métaux s’allient
» enfemble ; mais fi on met de Y étain dans du fer fon-
» du, le fer & Y étain fe convertiffent en petits glo-
» bules, qui crevent 6c font explofion comme des
» grenades ». Voye^ la minéralogie de Wallerius, tom,
I . pag, £46, de la traduction françoife %