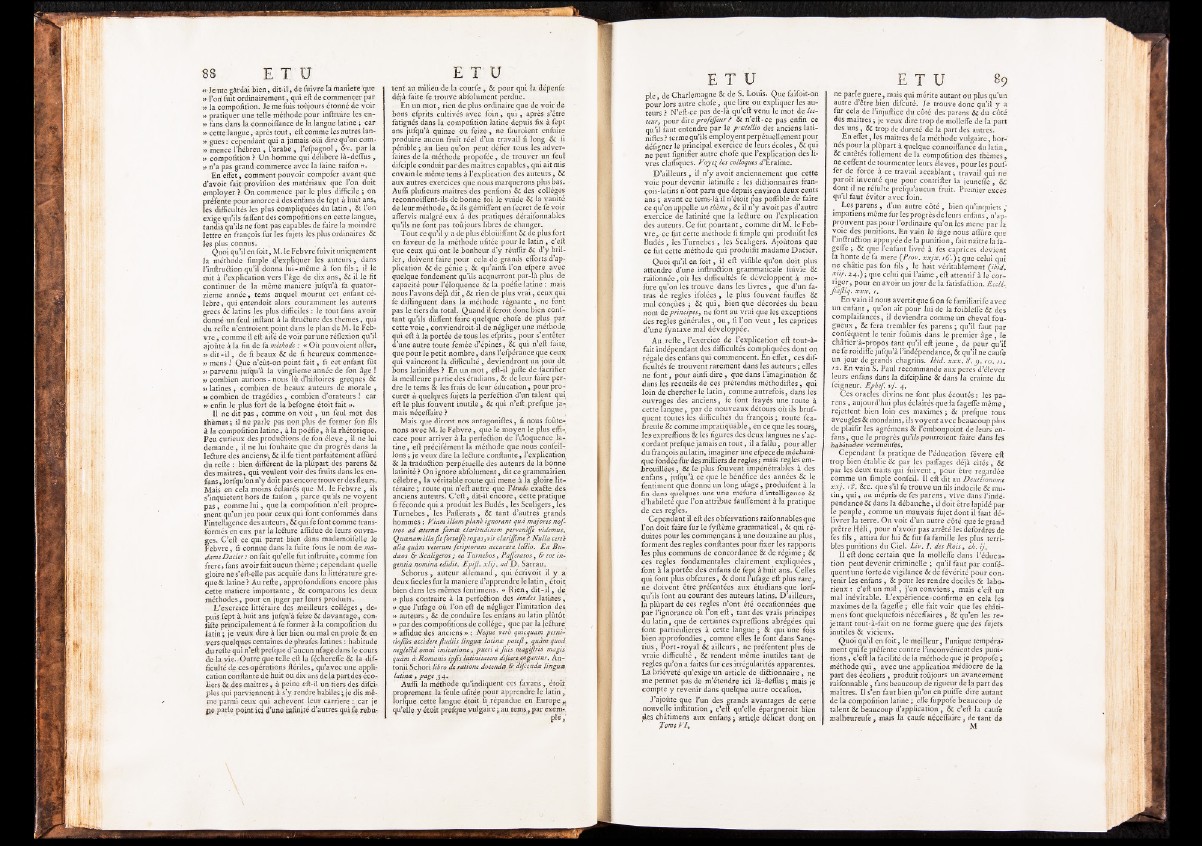
«Jeittc gàrdai bien, dit-il, de fuivre la maniéré que
» l’ori fuit ordinairement, qui eft de commencer par
» la compofition. Je me fuis toujours étonné de voir
» pratiquer une telle méthode pour inftruire les en-
» fans dans laconnoiffanee de la langue latine ; car
» cette langue, après tout, eft comme les autres lan-
» gués : cependant qui a jamais oiii dire qu’on corn-
» mence l’hébreu , l’arabe , Fefpagnol, &c. par la
» compofition? Un homme qui délibéré là - deffus ,
» n’a pas grand commerce avec la faine raifon ».
En effet, comment pouvoir compofer avant que
d’avoir fait provifion des matériaux que l’on doit
employer ? On commence par le plus difficile ; on
préfente pour amorce à des enfans de fept à huit ans,
les difficultés les plus compliquées du latin , & l’on
exige qu’ils faffent des comportions en cette langue,
tandis qu’ils ne font pas capables de faire la moindre
lettre en françois furies fujets les plus ordinaires 6c
les plus cônniis. v
Quoi qu’il en foit, M. le Febvre fuivit uniquement
la méthode fimple d’expliquer les auteurs , dans-
l’inflruélion qu’il donna lui-même à fon fils ; il le
mit à l’explication vers l’âge de dix ans, 6c il le fit
continuer de la même maniéré jufqu’à fa quatorzième
année, tems auquel mourut cet enfant célébré
, qui entendoit alors couramment les auteurs
grecs & latins les plus difficiles : le tout fans avoir
donné un feul inftant à la ftrutture des thèmes, qui
du refte n’entroient point dans le plan de M. le Febvre
, comme il eft ailé de voir par une réflexion qu’il
ajoute à la fin de fa méthode : « Où pouvoient aller,
» d i t - i l , de fi beaux & de fi heureux commence-
» mens ! Que n’eût-on point fa it , fi cet enfant fût
» parvenu jufqu’à la vingtième année de fon âge !•
» combien aurions - nous lû d’hiftoires greques 6c
» latines, combien de beaux auteurs de morale ,
m combien de tragédies , combien d’orateurs ! car
»» enfin le plus fort de la befogne étoit fait ».
Il ne dit pas , comme on v o i t , un feul mot des
thèmes ; il ne parle pas non plus de former fon fils
à la compofition latine, à la poéfie, à la rhétorique.
Peu curieux des productions de fon élev.e, il ne lui
demande, il ne lui fouhaite que du progrès dans la
leCture des anciens^ 6c il fe tient parfaitement alluré
du refte : bien différent de la plûpart des parens 6c
des maîtres, qui veulent voir des fruits dans les en-
fans , lorfqu’on n’y doit pas encore trouver des fleurs.
Mais en cela moins éclairés que M. le Febvre , ils
s’inquiètent hors de faifon , parce qu’ils ne voyent
p a s, comme lu i, que la compofition n’eft proprement
qu’un jeu pour ceux qui font confommés dans
l’intelligence des auteurs, 6c qui fe font comme transformés
en eux par la leCture affidue de leurs ouvrages.
C ’eft ce qui parut bien dans mademoifelle le
Febvre, fi connue dans la fuite fous le nom de madame
Dacier : on fait qu’elle fut inftruite, comme fon
frere, fans avoir fait aucun thème ; cependant quelle
gloire ne s’eft-elle pas acquife dans la littérature gre-
que& latine ? Au refte, approfondiffons encore plus
cette matière importante , 6c comparons les deux
méthodes, pour en juger par leurs produits.
L ’exercice littéraire des meilleurs collèges, de^
puis fept à huit ans jufqu’à feize 6c davantage, con-
lifte principalement à fe former à la compofition du
latin ; je veux dire à lier bien ou mal en profe.&.en
vers quelques centaines de phrafes latines : habitude
du refte qui n’eft prefque d’aucun ufagë dans le cours
de la vie.rOutre que telle eft la féchereffe 6c la difo
ficulté de ces opérations ftériles, qu’avec une application
confiante de huit ou dix ans de la part des écon
liers & .des maîtres,- à peine eft-il un tiers des difci-.
pies qui parviennent à s’y rendre habiles ; je dis même
parmi ceux qui achèvent leur carrière :,,car je
^e. parle point ici d’une infinité d’autres qui fe rebutent
au milieu de la courfe , & pour qui la dépenfe
déjà; faite fe trouve abfolument perdue.
En un m ot, rien de plus ordinaire que de voir de
bons efprits cultivés avec foin, q u i, après s’être
fatigués dans la compofition latine depuis fix à fept
ans jufqu’à quinze ou feize, ne fauroient enfuite
produire aucun fruit réel d’un travail fi long 6c fi
pénible ; au lieu qu’on peut défier tous les adversaires
de la méthode propofée, de. trouver un feul
difciple conduit par des maîtres capables, qui ait mis
envain le même tems à l’explication des auteurs, 6c
aux autres exercices que nous marquerons plus bas.
Aufli plufieurs maîtres des penfions 6c des collèges
reconnoiffent-ils de bonne foi le vuide 6c la vanité
de leur méthode, 6c ils gémiffent en fecret de fe voir
affervis malgré eux à des pratiques déraifonnables
qu’ils ne font pas toûjours libres de changer.
Tout ce qu’il y a de plus ébloiiiffant 6c de plus fort
en faveur de la méthode ufitée pour le latin , c’eft
que ceux qui ont le bonheur d’y réuffir 6c d’y briller,
doivent faire pour cela de grands efforts d’application
& de génie ; & qu’ainfi l’on efpere avec
quelque fondement qu’ils acquerront par-là plus de
capacité pour l’éloquence 6c la poéfie latine : mais
nous l’avons déjà dit, 6c rien de plus v ra i, ceux qui
fe diftinguent dans la méthode régnante, ne font
pas le tiers du total. Quand il feroit donc bien conf-
tant qu’ils dûffent faire quelque chofe de plus par
cette v o ie , conviendroit-il de négliger, une méthode,
qui eft à la portée de tous les efprits, pour s’entêter
d’une autre toute femée d’épines, & qui n’eft faite,
que pour le petit nombre, dans l’efpérance que ceux
qui vaincront la difficulté, deviendront un jour de
bons latiniftes ? En un mot, eft-il jufte de facrifier
la meilleure partie des étudians, & de leur faire perdre
le tems & les frais de leur éducation, pour procurer
à quelques fujets la perfection d’un talent qui,
eft le plus fouvent inutile, 6c qui n’eft.prefque ja-,
mais néceffaire ?
Mais que diront nos antagoniftes, fi nous foûte-
nons avec M. le F ebvre, que le moyen le plus efficace
pour arriver à la perfection de l’éloquence latine,
eft précifément la méthode que nous confeil-
lons ; je veux dire la leCture confiante, l’explication
& la tradudion perpétuelle des auteurs de la bonne
latinité ? On ignore abfolument, dit ce grammairien
célébré, la véritable route qui mene .à la gloire littéraire
; route qui n’eft autre que Vétude exa£le des
anciens auteurs. C’e ft , dit-il encore, cette pratique
fi féconde qui a produit les Budés, les Scaligers, les
Turnebes;, les Pafferats, 6c tant d’autres grands
hommes : V.iam illam plané ignorant qud majores nof-
tros ad aternoe famoe claritudinem pervenijfe videmus.
Qucenam iliafitfortajjé rogas,vir clarijfime ? Nulla certc
alla quàm veterum Jcriptorum accurata leclio. Ea Bu-
dceos & Scaligeros ; ea Turnebos, Pajferatos, & tôt in-
gentia nomina edidit. Epijl. xlij. ad D . Sarrau.
Schorus , auteur allemand , qui écrivoit il y a
deux fiecles fur la maniéré d’apprendre le latin, étoit
bien dans les mêmes fentimens. « Rien, d i t - ii, de
» plus contraire à la perfection des études latines ,
» que l’ufage où l ’on eft de négliger l’imitation des
» auteurs, 6c de ^conduire les enfans au latin plûtôt
» par des compofitions de collège, que par la leCture
» affidue des anciens » : Neque.verb quicquam perni-
tiofius accidere fludiis lingua latince potejl' , quàm qùod.
negleclâ otnni imitationey pueri à fuismagijlris ma fis
quàm à Romanis ipfis latinitatem difeere epgantur. Anton
» S chori libro de ratio ne docendcç & a'ifcendts li/iguce
latince , page 34., ;
Aufli la méthçde qu’indiquent pes favanjs, étoit
proprement la feule ufitée pour apprendre le latin,
lorfque cette langue étoit fi répandue en Europe,^
qu’elle y étoit prefque vulgaire j au tems., par exem-,
p lé ;
pie, de Charlemagne 8c de S. Louis. Que faifoit-on
pour lors autre chofe, que lire ou expliquer les auteurs
? N’eft-ce pas de-là qu’eft venu le mot de lecteur,
pour dire profefieur ? 8c n’eft-ce pas enfin ce
qü’il faut entendre par le proelectio des anciens latiniftes
? terme qu’ils employent perpétuellement pour
défigner le principal exercice de leurs écoles, 6c qui
ne peut lignifier autre chofe que l’explication des livres
claffiques. Foye[ les colloques ^’Erafme.
D ’ailleurs, il n’y avoit anciennement que cette
voie pour devenir latinifte : les dictionnaires fran-
çois-latins n’ont paru que depuis environ deux cents
ans ; avant ce tems-là il n’étoit pas poffible de faire
ce qu’on appelle un thème, 6c il n’y avoit pas d’autre
exercice de latinité que la leClure ou l’explication
des auteurs. C e fut pourtant, comme ditM. le Febv
re , ce fut cette méthode fi fimple qui produifit les
Budés , les Turnebes , les Scaligers. Ajoûtons que
ce fut cette méthode qui produifit madame Dacier,
Quoi qu’il en fo it , il eft vifible qù’on doit plus
attendre d’une inftruCtion grammaticale fuivie 6c
railonnée, où les difficultés fe développent à me-
fure qu’on les trouve dans les livres, que d’un fatras
de réglés ifolées, le plus fouvent fauffes 6c
mal conçues ; 6c qui, bien que décorées du beau
nom de principes, ne font au vrai que les exceptions
des réglés générales, ou , fi l’on v e u t , les caprices
d’une fyntaxe mal développée.
A u , refte, l’exercice de l’explication eft tout-à-
fait indépendant des difficultés compliquées dont on
régale des enfans qui commencent. En effet, ces difficultés
fe trouvent rarement dans les auteurs ; elles
ne font, pour ainfi dire, que dans l’imagination 6c
dans les recueils de ces prétendus méthodiftes, qui
loin de chercher le latin, comme autrefois, dans les
ouvrages des anciens, fe font frayés une route à
cette langue, par de nouveaux détours où ils bruf-
quent toutes les difficultés du françois ; route fea-
breufe 6c comme impratiquable, en ce que les tours,
les expreffions 8c les figures des deux langues ne s’accordant
prefque jamais en tou t, il a fallu, pour aller
du françois au latin, imaginer uneefpecedeméchani-
que fondée fur des milliers de réglés ; mais réglés embrouillées
, & le plus fouvent impénétrables à des
enfans, jufqu’à ce que le bénéfice des années & le
fentiment que donne un long u fage, produifent à la
fin dans quelques-uns une mefure d’intelligence 6c
d’habileté que l’on attribue fauffement à la pratique
de ces réglés.
Cependant il eft des obfervations raifonnablesque
l’on doit faire fur le fyftème grammatical, 8c qui réduites
pour les commençans à une douzaine au plus,
forment des réglés confiantes pour fixer les rapports
les plus communs de concordance & de régime ; 6c
ces réglés fondamentales clairement expliquées,
font à la portée des enfans de fept à huit ans. Celles
qui font plus obfcures, 8c dont l’ufage eft plus rare,
ne doivent être préfentées aux étudians que lorf-
qu’ils font au courant des auteurs latins. D ’ailleurs,
la plûpart de ces réglés n’ont été occafionnées que
par l’ignorance où l’on e ft , tant des vrais principes
du latin, que de certaines expreffions abrégées qui
font particulières à cette langue ; 8c qui une fois
bien approfondies, comme elles le font dans Sanc-
tius, Port-royal 6c ailleurs, ne préfentent plus de
vraie difficulté , 6c rendent même inutiles tant de
réglés qu’on a faites fur ces irrégularités apparentes.
La brièveté qu’exige un article de dictionnaire, ne
me permet pas de m’étendre ici là-deffus ; mais je
compte y revenir dans quelque autre occafion.
J’ajoûte que l’un des grands avantages de cette
nouvelle inftitution, c’eft qu’elle épargneroit bien
jdes châtimens aux enfan$ : article délicat dont on
J'orne F I ,
ne parle guère , mais qui mérite autant ou plus qu’un
autre d’être bien difeuté. Je trouve donc qu’il y a
fur cela de l’injuftice du côté des parens & du côté
des maîtres ; je veux dire trop de molleffe de la part
des uns, 6c trop de dureté de la part des autres.
En effet, les maîtres de la méthode vulgaire, bornes
pour la plûpart à quelque connoiffance du latin, 6c entetes follement de la compofition des thèmes ,
ne ceffent de tourmenter leurs éleves, pour les pouf-
for de force à ce travail accablant \ travail qui ne
paroît .inventé que pour contrifter la jeuneffe , 6c
dont il ne réfulte prefqu’aucun fruit. Premier excès
qu’il faut éviter avec foin.
Les parens , d’un autre côté , bien qu’inquiets
impatiens même fur les progrès de leurs enfans, n’approuvent
pas pour l’ordinaire qu’on les mene par la
voie des punitions. En vain le fage nous affûre que
Pinflruélion appuyée de la punition, fait naître la fa-
gefle ; 6c que l’enfant livré à fes caprices devient
la honte de fa mere (Prov. xxjx. ; que celui qui
ne châtie pas fon fils , le hait véritablement (ibid.
xiij. 24.) ; que celui qui l’aime, eft attentif à le-corriger
> pour en avoir un jour de la fatisfaûion. Ecrié-
fiafiiq. x xx. 1.
En vain il nous avertit que fi on fe familiarife avec
un enfant, qu’on ait pour lui de la foibleffe 6c des
complaifances, il deviendra comme un cheval fougueux
, 6c fera trembler fes parens ; qu’il faut par
conféquent le tenir foûmis dans le premier âge , le
châtierà-propos tant qu’il eft jeune , de peur qu’il
ne fe roidifle jufqu’à l’indépendance, & qu’il ne caufe
un jour de grands chagrins. Ibid. x x x . 8. ç). 10. //.
iz . En vain S. Paul recommande auxperes d’élever
leurs enfans dans la difeipline 8c dans la crainte du
feigneur. Ephef. yj. 4.
Ces oracles divins ne font plus écoutés : les parens
, aujourd’hui plus éclairés que la fagefle même,
rejettent bien loin ces maximes ; 8c prefque tous
aveugles 8c mondains, ils voyent avec beaucoup plus
de plaifir les agrémens 8c l’embonpoint de leurs enfans
, que le progrès qu’ils pourraient faire dans les
habitudes! vertueufes.
Cependant la pratique de l’éducation févere eft
trop bien établie 6c par les paffages déjà cités, 6c
par les deux traits qui fuivent, pour être regardée
comme un fimple confeil. Il eft dit au Deutéronome
x x j. 18. 6cc. que s’il fe trouve un fils indocile & mutin,
qui, au mépris de fes parens, vive dans l’indépendance
6c dans la débauche, il doit être lapidé par
le peuple, comme un mauvais fujet dont il faut délivrer
la terre. On voit d’un autre côté que le grand
prêtre H éli, pour n’avoir pas arrêté les defordres de
fes fils , attira fur lui 6c fur fa famille les plus terri-,
blés punitions du Ciel. Liv. I . des Rois, ch. ij.
Il eft donc certain que la molleffe dans l ’éducation
peut devenir criminelle ; qu’il faut par conféquent
une fortede vigilance 8c de févérité pour contenir
les enfans , 8c pour les rendre dociles 8c laborieux
: c’eft un mal-, j’en conviens, mais ç’eft un
mal inévitable. L’expérience^confirme en cela les
maximes de la fageffe ; elle fait voir que les châtimens
font quelquefois néceffaires , & qu’en les re-
jettant tout-à-fait on ne forme guere que des fujets
inutiles 8c vicieux.
Quoi qu’il en foit, le meilleur, l’unique tempérament
qui fe préfente contre l’inconvénient des punitions
, c’eft la facilité de la méthode que je propofe ;
méthode qui ,, avec une application médiocre de la
part des écoliers , produit toûjours un avancement
raifonnable, fans beaucoup de rigueur delà part des
maîtres. Il s’en faut bien qu’on en puifle dire autant
de la compofition latine ; elle fuppofe beaucoup de
talent 6c beaucoup d’application, 6c c’eft la caufe
malheureufe , mais là caufe néceffaire, de tant de
M