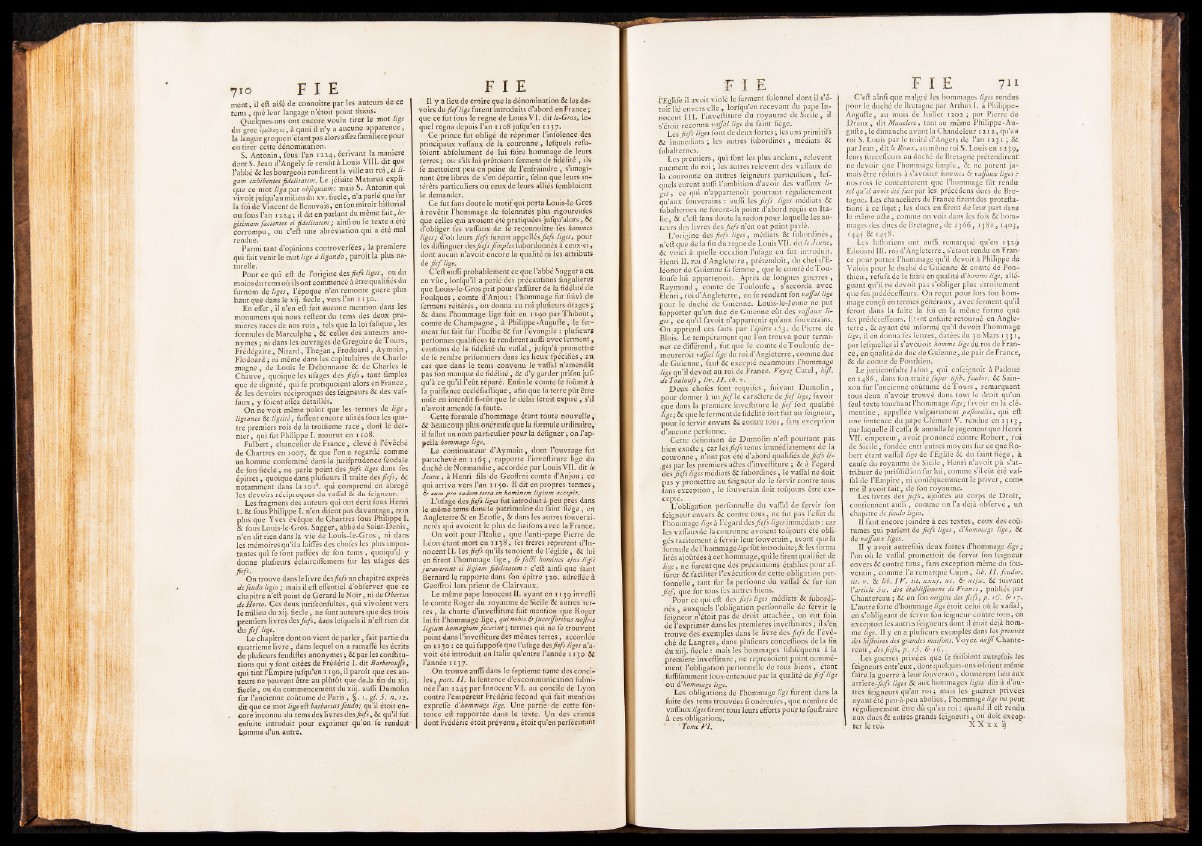
ment, il eft aifé de connoîtrepar les auteurs de ce
tems, que leur langage n’étoit point thiôis.
Quelques-uns ont encoré voulu tirer le mot lige
du grec t/j.ôxoyoç, à quoi il n’y a aucune apparence,
la langue greque n’étant pas alors affez familière pour
en tirer cette dénomination.
S. Antonin, fous l’an 1224, écrivant la manière
dont S. Jean d’Angely fe rendit à Louis VIII. dit que
l’abbé & les bourgeois rendirent la ville au ro i, ei li-
garn exhibentes fidelitatem. Le jefuite Maturus explique
ce mot liga par obfequium-, mais S. Antonin qui
vivoit jufqu’au milieu du xv. liecle, n’a parlé que fur
la foi de Vincent de Beauvais, en fon miroir hiftorial
ou fous l’an 1 124 ; il dit en parlant du meme fait, le-
gitimam facientes ei fidelitatem; ainfi ou le texte a ete
corrompu, ou c’eft une abréviation qui a été mal
rendue. .
Parmi tant d’opinions controverfées, la première
qui fait venir le mot lige à ligando, paroît la plus naturelle.
Pour ce qui eft de l’origine des fiefs liges, ou du
moins du tems où ils ont commencé à être qualifies du
furnom de liges-, l’époque n’en remonte guere plus
haut que dans le xij. fiecle, vers l’an 1130.
En effet, il n’en eft fait aucune mention dans les
monumens qui nous reftent du tems des deux premières
races de nos ro is , tels que la loi falique, les
formules de MarcuLphe , & celles des auteurs anonymes
; ni dans les ouvrages de Grégoire de Tours,
Frédégaire, Nitard, Thegan, Frodoard, Aymoin,
Flodoard ; ni même dans les capitulaires de Charlemagne
, de Louis le Débonnaire & de Charles le
Chauve, quoique les ufages des fiefs, tant fimples
que de dignité, qui fe pratiquoient alors en France,
& les devoirs réciproques des feigneurs & des vaf-
faux, y foient affez détaillés.
On ne voit même point que les termes de lige,
ligeance fa ligeité, fuffent encore ufités fous les quatre
premiers rois de la troifieme race, dont le dernier,
qui fut Philippe I. mourut en 1108.
Fulbert, chancelier de France, élevé à l’evêché
de Chartres en 1007, fa que l’on a regarde comme
un homme confommé dans la jurifprudence féodale
de fon fiecle, ne parle point des fiefs liges dans fes
épîtres, quoique dans plufieurs il traite des fiefs, fa
notamment dans la 101®. qui comprend en abrégé
les devoirs réciproques du vaffal & du feigneur.
Les ff agmens des auteurs qui ont écrit fous Henri
I. fa fous Philippe I. n’en difentpas davantage, non
plus que Yves évêque de Chartres fous Philippe I.
& fous Louis-le-Gros. Sugger, abbé de Saint-Denis,
n’en dit rien dans la vie de Louis-le-Gros , ni dans
les mémoires qu’il a laiffés des chofes les plus importantes
qui fe font paffées de fon tems , quoiqu’il y
donne plufieurs eclairciffemens fur les ufages des
fiefs.
On trouve dans le livre des fiefs un chapitre exprès
de feudo ligio ; mais il eft effentiel d’obferver que ce
chapitre n’eft point de Gérard le Noir, ni de Obertus
de Horto. Ces deux jurifconfultes, qui vivoient vers
le milieu du xij. fiecle, ne font auteurs que des trois
premiers livres des fiefs, dans lefquels il n’eft rien dit
du f ie f lige.
Le chapitre dont on vient de parler, fait partie du
quatrième liv re , dans lequel on a ramaffé les écrits
de plufieurs feudiftes anonymes ; fa par les conftitu-
tions qui y font citées de Frédéric I. dit Barberoujfe,
qui tint l’Empire jufqu’en 1190, il paroît que ces auteurs
ne peuvent être au plûtôt que de.la fin du xij.
fiecle, ou du commencement duxiij. auffi Dumolin
fur l’ancienne coûtume de Paris , § . 1. gl. 5. n. 12.
dit que ce mot lige eft barbarius feudo; qu’il étoit en-
. core inconnu du tems des livres des fiefs, fa qu’il fut
enfuite introduit pour exprimer qu’on fe rendoit
homme d’un autre.
Il y a lieu de croire que la dénomination & les devoirs
du fief lige furent introduits d’abord en France ;
que ce fut fous le régné de Louis V I. dit le-Gros, le*
quel régna depuis l’an 1108 jufqu’en 1137.
Ce prince fut obligé de réprimer l’infolence des
principaux vaffaux de la couronne , lefquels refu-
foient abfolument de lui faire hommage de leurs
terres ; ou s’ils lui prêtoient ferment de fidélité , ils
fe mettoient peu en peine de l’enfraindre , s’imaginant
être libres de s’en départir, félon que leurs intérêts
particuliers ou ceux de leurs alliés fembloient
le demander.
Ce fut fans doute le motif qui porta Louis-le-GroS
à révêtir l’hommage de folennités plus rigoureufes
que celles qui avoient été pratiquées jufqu’alors, 6C
d’obliger fes vaffaux de le rççonnoître fes hommes
liges; d’où leurs fiefs furent appellés fiefs liges, pour
les diftinguer desfiefs firnp les fubordonnés à ceux-ci,
dont aucun n’avoit encore la qualité ni les attributs
de f ie f lige, .
C ’eft auffi probablement ce que l’abbe Sugger a eu
en v u e , lorfqu’il a parlé des précautions fingulieres
que Louis-le-Gros prit pour s’aflïirer de la fidélité de
Foulques, comte d’Anjou: l’hommage fut fuivi de
fermens réitérés, on donna au roi plufieurs otages ;
fa dans l’hommage lige fait en 1190 par Thibaut,
comte de Champagne, à Philippe-Augufte, le fer-:
ment fut fait fur l’hoftie fa fur l’évangile : plufieurs
perfonnes qualifiées fe rendirent auffi avec ferment,
cautions de la fidélité du vaffal, jufqu’à promettre
de fe rendre prifonniers dans les lieux fpécifiés, au
cas que dans le tenis convenu le vaffal n’amendât
pas Ion manque de fidélité, fa d’y garder prifon jufqu’à
ce qu’il l’eût réparé. Enfin le comte fe fournit à
la puiffance eccléfiaftique, afin que fa terre pût être
mile en interdit fi-tôt que le délai feroit expiré , s’il
n’avoit amendé fa faute.
Cette formule d’hommage étant toute nouvelle,'
fa beaucoup plus onéreufe que la formule ordinaire,
il fallut un nom particulier pour la défigner ; on l’ap-
pella hommage lige.
Le continuateur d’Aymoin, dont l’ouvrage fut
parachevé en 1165 , rapporte l’inveftiture lige du
duché de Normandie »accordée par Louis VII. dit le
Jeune, à Henri fils de Geoffroi comte d’Anjou ; ce
qui arriva vers l’an 1150. Il dit en propres termes,
G* eum pro eadem terra in hominem ligium accepit.
L’ufage des fiefs liges fut introduit à-peu près dans
le même tems dans le patrimoine du faint fiége, en
Angleterre fa en Ecoffe, & dans les autres fouverai-
netés qui avoient le plus de liaifons avec la France.
On voit pour l’Italie , que l’anti-pape Pierre de
Léon étant mort en 113 8, fes freres, reprirent d’innocent
II. les fiefs qu’ils tenoient de l’églife, fa lui
en firent l’hommage lige, ,& facli homines ejus ligii
juraverunt ei ligiam fidelitatem : c’eft ainfi que faint
Bernard le rapporte dans fon épître 3 20. adreffée à
Geoffroi lors prieur de Clairvaux.
Le même pape Innocent II. ayant en 1139 inverti
le comte Roger du royaume de Sicile fa autres terres
, la charte d’inveftiture fait mention que Roger
lui fit l’hommage lige, quinobis & fuccefforibus nofiris
ligium homagium fecerint ; termes qui ne fe trouvent
point dans l’inveftiture des mêmes terres-, accordée
en 1130 : ce qui fuppofe que l’ufage des fiefs liges n’avoit
été introduit en Italie qu’entre l’année 1 130 &
l’année 1137.
On trouve auffi dans le feptieme tome des conciles
, part. II. la fentence d’excommunication fulminée
l’an 1245 par Innocent VI. au concile de Lyon
contre l’empereur Frédéric fécond qui fait mention
expreffe d'hommage lige. Une partie de cette fentence
eft rapportée dans le fexte. Un des crimes
dont Frédéric étoit prévenu, étoit qu’en perfécutant
TEglife il avoit violé le ferment folennel dont ils ’é-
toit lié envers elle , lorfqu’en recevant du pape Innocent
III. l’inveftiture du royaume de Sicile , il
s’étoi't reconnu vaffal lige du faint fiege.
Les fiefs liges font dedeuX fortes ; les uns primitifs
•& immédiats ; les autres fubordinés , médiats f a
fubalterneS.
Les premiers, qui font lès plus anciens, relèvent
nuement du roi ; les autres relevent des vaffaux de
la couronne ou autres feigneurs particuliers , lefquels
eurent auffi l ’ambition d’avoir dès vaffaux li-
gei, ce qui n’appartenoit pourtant régulièrement
qu’aux fouverains : auffi les fiefs liges médiats f a
fubalternes ne furent-ils point d’abord reçus en Italie,
& c’eft fans doute la raifon pour laquelle les auteurs
des livres des fiefs n’en ont point parlé.
L’origine des fiefs liges, médiats fa fubordinés,
•n’eft que de la fin du régné de Louis VII. dit le Jeune,
fa voici à quelle occalion l’ufage en fut introduit.
Henri II. roi d’Angleterre, prétendoit, du chefd’E-
-léonor de Guienne fa femme, que le comté de Touloufe
lui appartenoit. Après de longues guerres ,
Raymond , comte de Touloufe , s’accorda avec
Henri, roi d’Angleterre, en fe rendant fon vaffallige
pour le duché de Guienne. Louis-le-Jeune ne put
fupporter qu’un duc de Guienne eût des vaffaux liges
, ce qu’il favoit n’appartenir qu’aux fouverains.
On apprend ces faits par l'épître i3g . de Pierre de
Blois. Le tempérament que l’on trouva pour termi-
ner ce différend, fut que le comte de Touloufe de-
meureroit vaffal lige du roi d’Angleterre, comme duc
-de Guienne, fauf & excepté néanmoins l’hommage
lige qu’il devoit au roi de France. V?ye%_ Catel, hifl. j
1de Touloufe , liv. I I . ch. v.
Deux chofes font requifes, fuivant Dumolin,
pour donner A un fie f le cara&ere de fie f lige; favoir
que dans la première inveftiture le fie f foit qualifie
lige; &qu e le ferment de fidélité foit fait au feigneur,
pour le fervir envers fa contre tous, fans exception
d’aucune perfonne.
Cette définition de Dumolin n’eft pourtant pas
bien exatte ; car les fiefs tenus immédiatement de la
couronne, n’ont pas été d’abord qualifiés dq fiefs liges
par les premiers aéles d’inveftiture ; & à l’égard
des fiefs liges médiats fa fubordinés, le vaffal ne doit
pas y promettre au feigneur de le fervir contré tous
fans exception, le fouverain doit toûjours être ex-
cepte,.
L’obligation perfonnelle dü vaffal de fervir fon
feigneur envers & contre tous, ne fut pas l’effet dè
l’hommage lige à l ’égard des fiefs //'^immédiats : car
les vaffauxde la couronne avoient toûjours été obligés
tacitement à fervir leur fouverain, avant que la
formule de l’hommagei/ge fût introduite; & les forma
lités ajoûtées à cet'hommage, qui le firent qualifier de
lige, ne furent que des précautions établies pour af-
fûrer fa faciliter l’exécution de cette obligation perfonnelle
, tant fur la perfonne du vaffal fa fur fon
fief, que fur tous fes autres biens.
Pour ce qui eft des fiefs liges médiats & fubordi-
nés , auxquels l’obligation perfonnelle dç fçrvir le
feigneur n’étoit pas de droit attachée, on eut foin
de l’exprimer dans les premières inv e futures ; rt s’en
trouve des .exemples dans lé livre des fiefs de l’evêché
de Langres, dans plufieurs concertions dè la fin
du xiij. fiecle : mais les hommages fubféquens à la
première inveftiture, ne reprenoient point nomme-
' ment l’obligation perfonnelle de tous biens , étant
fuffifamment fous-entendue par la qualité de fie f lige
ou d'hommage lige.
Les obligations de l’hommage lige'furent dans la
fuite des tems trouvées fi onéreufes, que nombre de
vaffaux liges firent tous leurs efforts pour le fouftraire
à ces obligations.
'Tome VI.
C’eft ainfi que malgré les hommages Liges rendus
pour le duché de Bretagne pair Arthus I. à Philippe-
Augufte, au mois de Juillet 1202; par Pierre dè
Dreux, dit Mauclerc, tant au même Philippe-Au-
gufte, le dimanche avant la Chandeleur 1212, qu’au
roi S. Louis par lé traité d’Angers de l’an 12 3 1 ; fa
par Jean, dit/cRo«x,.aumêmeroiS. Louis en 1239,
leurs fucceffeurs au duché de Bretagne prétendirent
ne devoir que l’hommage fimple, & ne purent jamais
être réduits à s’avouer hommes 6* vaffaux liges *
nos rois fe contentèrent que l’hommage fut rendu
tel qu'il avoit itè fait par leS précédens ducs de Bretagne.
Les chanceliers de Francè firent des protefta-
tions à ce fujet; les ducs en fifeht de leur part dans
le même àfte, comme on voit dâns les fois &c hommages
des ducs de Bretagne, de 1366, 1381,1403,
144.5 & 1458.
Les hiftoriens ont auffi remarqué qu’en 1329
Edoiiard III. rôi d’Angleterre, s’étant rendu en France
pour porter l’hommage qu’il devoit à Philippe de
Valois pour le duché de Gixienne & comté de Pon-
thieu, refufa de le faire en qualité d’homme lige, alléguant
qu’il ne devoit pas s’obliger plus étroitement
que fes predeceffeurs. On reçut pour Iôrs fon hommage
conçû eh termes généraux, avec ferment qu’il
feroit dans la fuite la foi en la même forme que
fes prédéceffeurs. Etant enfuite retourné en Angleterre
, & ayant été informé qu’il devoit l’hommàgé
lige, il en donna fés lettres, datées du 30 Mars 1331,
par lefquelles il s’avôiioit homme lige du roi de France
, en qualité de duc de Guienne, de pair de France,
& de comté de Pènthieu.
Le jurifconfulte Jafôn , qui énfeignôit à Padoué
en i486, dans fon traité fuper üfib. feudàr. & Sain-
xon fur l’ancienne coûtume de Tours , remarquent
tous deux n’avoir trouvé dans tout le droit qu’un
feul texte touchant l’hommage lige; favoir en la clémentine
, appellée vulgairement pàfloralis, qui eft
une fentence du pâpe Clément V . rendue en 1313,
par laquelle il caffa & annülla le jugement que Henri
VII. empereur, âvoit prononcé contre Robert, roi
de Sicile, fondée éntr’autreS moyens fur ce qne Robert
étant vaffal lige de l’Eglife & du faint fiége, à
caufe du royaume de Sicile, Henri n’avoit pû s’attribuer
de jurifdi&ion fur lui, comme s’il eût été vaffal
de l’Empire, ni coriféquemment le priver, com4,
me il avoit fait, de fon royaume.
Les livres des fiefs, ajôûtés au corps de Droit,'
contiennent auffi , comme on l’a déjà obfervé , un
chapitre de feudo ligio. l
Il faut encore joindre à ces textes, ceux des coûr-
tumès qui parlent de fiefs liges, d?hommage lige, &
de vaffaux liges.
Il y avoit autrefois deux fortes d’hommage lige;
l’un où le vaffal prOmettoit de fervir Ton feigneur
envers & contre tous, fans exception même du foü-
verain, comme l’a remarqué Cujas, lib. I l . ftudof.
tit. v. & lib. IV . iit. xx x j. xc. 6* xcjx. & füivânt
Y article 5o. des établiffemens de France, publiés par
Chantereau ; & en fon origine des fiefs, p i i fi. & //;.
L’autre forte d’hommage lige étoit celui 911 le vaffal,
eh s’obligeant de fervir fon feigneur contre tous, en
excèptoit les autres feigneurs dont il étoit déjà homme
lige. Il y en a plufieurs exemples dahS les p'teüvls
des hijioires des grandes maïfotis. Voyez auffi Chànte-
reàu, des fiefs, p. 0 . & 1 fi. •
Les guerres privées quë.fe faifoient autrefois les
feigneurs entr’eu x, dont quelques-uns ofôiènt meme
faire la guerre à leur fouvèrain, donnèrent lieu aux
arriere-fiefs liges & aux hommages liges, dûs à d’autres
feigneurs qu’au roi ; mais les guerres privées
ayant été peu-à-peu abolies , l’hommage lige ne peut
régulièrement être dû qu’au roi : quand il eft rendu
aux ducs & autres grands feigneurs, on doit excepter
lè foi. X X 'X x ï )