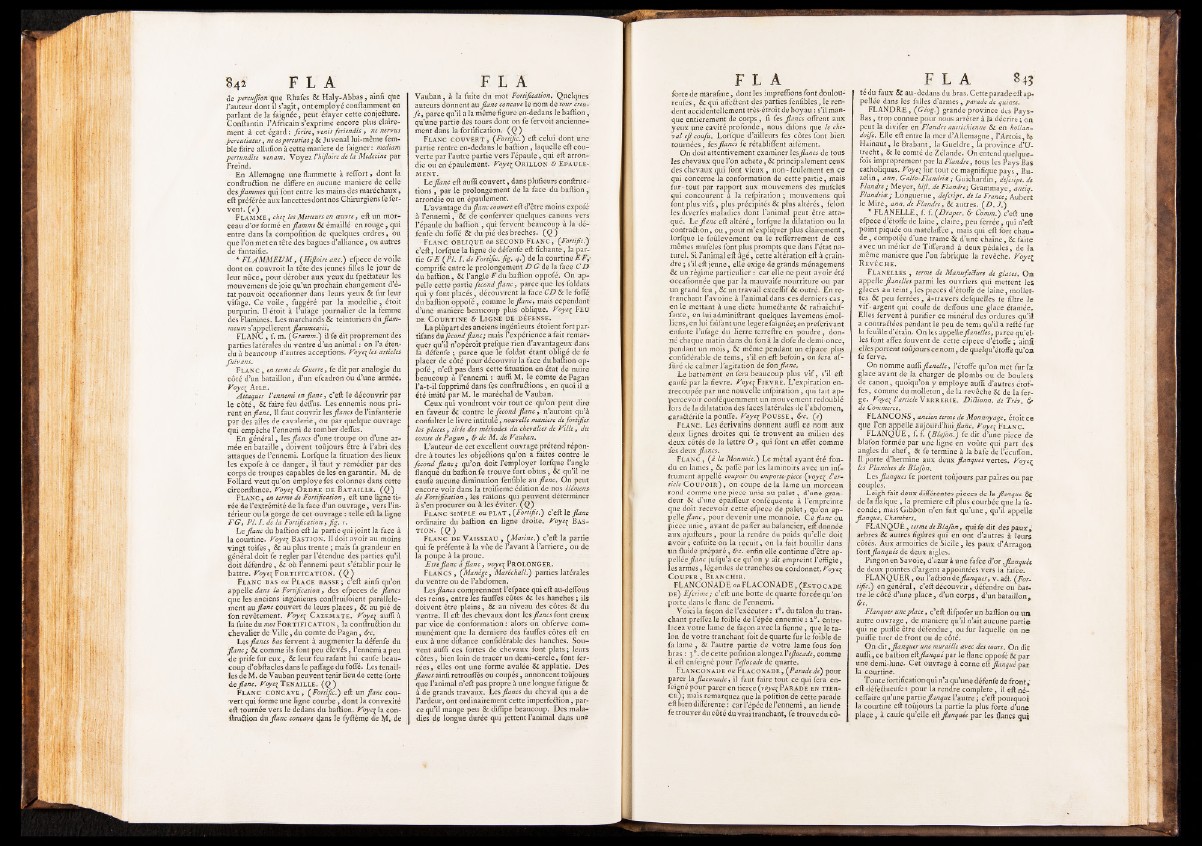
de p e r c u ff lo n que Rhafes & Haly-Abbas, ainfi que
Fauteur dont il s’agit, ont employé conftamment en
parlant de îa faignée, peut étayer cette conjefture.
Conftantin l’Africain s’exprime encore plus clairement
à cet égard : f e r i r e , v e n i s f t r i e n d i s , n e n e r v u s
p t r c u t i a tu r , n e o sp e r c û t ia s ; & Juvenal lui-meme fem-
ble faire allufion à cette maniéré de faigner : m e d iam
p e r tu n d i t e v e n a m . Voyez fh i f lo i r e d e l a M e d e c in e par
Freind.
En Allemagne une flammette à reffort, dont la
conftru&ion ne différé en aucune maniéré de celle
des f la m m e s qui font entre les mains des maréchaux,
eft préférée aux lancettes dont nos Chirurgiens fe fervent.
( e )
F l a m m e , c k e i le s M e t te u r s e n oe u v r e , eft un morceau
d’or formé en f la m m e & émaillé en rouge, qui
entre dans la compofition de quelques ordres, ou
que l’on met en tête des bagues d’alliance, ou autres
ae fantaifie.
* F L A M M E U M , {H i f lo i r e a n c .') efpece dévoilé
dont on couvroit la tête des jeunes filles le jour de
leur noce, pour dérober aux yeux du fpeêlateur les
mouvemens de joie qu’un prochain changement d’état
pouvoit occafionner dans leurs yeux & fur leur
vifage. Ce v o ile , fuggéré par la modeftie, étoit
purpurin. Il étoit à l’ufage journalier de la femme
des Flamines. Les marchands & teinturiers du f l a m -
m eum s’appellerent f ia m m c a r ii .
FLANC , f. m. ( G r am m .) il fe dit proprement des
parties latérales du ventre d ’un animal : on l’a étendu
à beaucoup d’autres acceptions. V o y e l l e s a r t ic le s
fu i v a n s .
F l a n c , en term e d e G u e r r e , fe dit par analogie du
côté d’un bataillon, d’un efcadron ou d’une armée.
V o y e i A i l e .
A t t a q u e r V e n n em i e n f l a n c , c’eft le découvrir par
le cô té, & faire feu deflus. Les ennemis nous prirent
e n f l a n c . Il faut couvrir les f l a n c s de l’infanterie
par des ailes de cavalerie, ou par quelque ouvrage
qui empêche l’ennemi de tomber deffus.
En général, les f l a n c s d’une troupe ou d’une armée
en bataille, doivent toujours être à l’abri des
attaques de l’ennemi. Lorfque la fituation des lieux
les expofe à ce danger, il faut y remédier par des
corps de troupes capables de les en garantir. M. de
Follard veut qu’on employé fes colonnes dans cette
circonftance. V o y e ^ O r d r e d e B a t a i l l e . (Q )
F l a n c , e n te rm e d e F o r t i f i c a t io n , eft une ligne tirée
de l’extrémité de la face d’un ouvrage, vers l’intérieur
ou la gorge de cet ouvrage : telle eft la ligne
F G , P I . I . d e l a F o r t if ic a t io n , f i g . i .
L e f l a n c du baftion eft la partie qui joint la face à
la courtine. V o y e i B a s t i o n . Il doit avoir au moins
vingt toifes, & au plus trente ; mais fa grandeur en
général doit fe regler par l’étendue des parties qu’il
doit défendre, & oîi l’ennemi peut s’établir pour le
battre. V o y e { F o r t i f i c a t i o n . ( Q )
F l a n c b a s ou P l a c e b a s s e ; c’eft ainfi qu’on
appelle d a n s l a F o r t if ic a t io n , des efpeces de f l a n c s
que les anciens ingénieurs conftruifoient parallèlement
au f i la n c couvert de leurs places, & au pié de
fon revêtement. V o y e ^ C a z e m a t e . Voye%_ auffià
la fuite du m o t F o r t i f i c a t i o n , la conftruâion du
chevalier de V ille , du comte de Pagan, & c .
L e s f l a n c s b a s fervent à augmenter la défenfe du
f l a n c ; & comme ils font peu é levés, l’ennemi a peu
de prife fur eu x, & leur feu rafant lui caufe beaucoup
d’obftacles dans le paffage du foffé. Les tenailles
de M. de Vauban peuvent tenir lieu de cette forte
d e f l a n c . V q y e^ T e n a i l l e . ( Q )
F l a n c c o n c a v e , ( F o r t if ie .) eft un f l a n c couvert
qui forme une ligne courbe, dont la convexité
eft tournée vers le dedans du baftion. V o y e ^ la con-
ftruêtion du f l a n c c o n c a v e c|ans le fyftème de M. de
Vauban, à la fuite du mot F o r t if ic a t io n . Quelques
auteurs donnent a u f l a n c co n c a v e le nom de to u r c r eu -
f e , parce qu’il a la même figure en-dedans le baftion,
qu’une partie des tours dont on fe fervoit anciennement
dans la fortification. ( Q )
F l a n c c o u v e r t , ('F o r t i f ie .) eft celui dont.une
partie rentre en-dedans le baftion, laquelle eft couverte
par l’autre partie vers l’épaule, qui eft arrondie
ou en épaidement. V o y e i O r i l l o n & É p a u l e - ,
m e n t .
Le f l a n c eft auflî couvert, dans plufieurs conftruc-:
tions , par le prolongement de la face du baftion,
arrondie ou en épaulement.
L ’avantage du f l a n c c o u v e r t eft d’être moins expofé
à l’ennemi, & de conferver quelques canons vers
l’épaule du baftion , qui fervent beaucoup à la dé-
.fenfe du foffé & du pié des breches. (Q )
F l a n c o b l i q u e ou s e c o n d F l a n c , { F o r t i f i e ! )
c’eft, lorfque la ligne de défenfe eft fichante, la partie
G E { P I . I . d e F o r t if ie , f i g . 4.) de la courtinei?F , -
comprife entre le prolongement D G de la face C D
du baftion, & l’angle F du baftion oppofé. On appelle
cette partie f é c o n d f l a n c , parce que les foldats
qui y font placés, découvrent la face C D & le foffé
du baftion oppofé, comme le f l a n c , mais cependant
d’une maniéré beaucoup plus oblique. V o y e { F e u
d e C o u r t i n e & L i g n e d e d é f e n s e .
La plupart des anciens ingénieurs étoierit fort par-
tifans du f é c o n d f l a n c ; mais l’expérience a fait remarquer
qu’il n’opéroit prcfque rien d’avantageux dans
la défenfe ; parce que le foldat étant obligé de fe
placer de côté pour découvrir la face du baftion oppofé
, n’eft pas dans cette fituation en état de-nuire
beaucoup à l’ennemi : aufliM. le comte de Pagan
l’a-t-il fupprimé dans fes conftru&ions, en quoi il a
été imité par M. le maréchal de Vauban.
Ceux qui voudront voir tout ce qu’on peut dire
en faveur & contre le f é c o n d f l a n c , n’auront qu’à
confulter le livre intitulé, n o u v e l le m a n ié r é d e fo r t ifie r ,
le s p l a c e s , t ir é e d e s m é th o d e s d u c h e v a lie r d e V i l l e , d u
com te d e P a g a n , & d e M . d e V z u b a n .
L’auteur de cet excellent ouvrage prétend répondre
à toutes les objections qu’on a faites contre le
f é c o n d f l a n c ; qu’on doit l’employer lorfque l’angle
flanque du baftion fe trouve fort obtus, & qu’il ne
caufe aucune diminution fenfible au f l a n c . On peut
encore voir dans la troifieme édition de nos è lèm e n s
d e F o r t if ic a t io n , les raifons qui peuvent déterminer
à s’en procurer ou à les éviter. ( Q )
F l a n c s i m p l e ou p l a t , { F o r t i f i e ! ) c’eft le flanc
ordinaire du baftion en ligne droite. V o y c { B a s t
i o n . ( Q )
F l a n c d e V a i s s e a u , {M a r in e ! ) c’eft la partie
qui fe préfente à la vue de l’avant à l’arriere, ou de
la poupe à la proue.
E t r e f l a n c à f l a n c , v o y e ç PROLON GER.
F l a n c s , (M a n è g e , M a r é e h a l l . ) parties latérales
du ventre ou de l’abdomen.
Les f l a n c s comprennent l’efpace qui eft au-deffous
des reins, entre les fauffes côtes & les hanches ; ils
doivent être pleins, & au niveau des côtes & du
ventre. Il eft des chevaux dont les f l a n c s font creux
par vice de conformation : alors on obferve communément
que la derniere des fauffes côtes eft en
eux à une diftance confidérable des hanches. Souvent
aufli ces fortes de chevaux font plats; leurs
côtes, bien loin de tracer un demi-cercle, font ferrées
, elles ont une forme avalée & applatie. Des
f l a n c s ainfi retrouffés ou coupés, annoncent toûjours
que l ’animal n’eft pas propre à une longue fatigue &
à de grands travaux. Les f l a n c s du cheval qui a de
l’ardeur, ont ordinairement cette imperfection, parce
qu’il mange peu & diffipe beaucoup. Des maladies
de longue durée qui jettent l’animal dans une
forte de marafme, dont les impreflïons font doulou-
reufes, & qui affcCtent des parties fenfibles, le rendent
accidentellement très-étroit de boyau : s’il manque
entièrement de corps , fi fes flancs offrent aux
yeux une cavité profonde, nous difons que le cheva
l efl coufu. Lorfque d’ailleurs fes côtes font bien
tournées, fes flancs fe rétabliffent aifément.
On doit attentivement examiner les flancs de tous
les chevaux que l’on acheté, & principalement ceux
des chevaux qui font v ieu x , non-feulement en ce
qui concerne la conformation de cette partie, mais
fur-tout par rapport aux mouvemens des mufcles
qui concourent à la refpiration ; mouvemens qui
font plus v ifs , plus précipités & plus altérés, félon
les diverfes maladies dont l’animal peut être attaqué.
Le flanc eft altéré , lorfque la dilatation ou la
contraction, o u , pour m’expliquer plus clairement,
lorfque le foûlevement ou le refferrement de ces
mêmes mufcles font plus prompts que dans l’état naturel.
Si l’animal eft âgé, cette altération eft à craindre
; s’il eft jeune, elle exige de grands ménagemenS
& un régime particulier : car elle ne peut avoir été
occafionnée que par la mauvaife nourriture ou par
un grand feu , & un travail exceflif & outré. En retranchant
l’avoine à l’animal dans ces derniers ca s,
en le mettant à une diete humectante & rafraîchif-
fante, en lui adminiftrant quelques lavemens émoi-
liens, en lui faifantune legere faignée; en preferivant
enfuite l ’ufage du lierre terreftre en poudre, donné
chaque matin dans du fon à la dofe de demi-once,
pendant un mois, & même pendant un efpace plus
confidérable de tems, s’il en eft b e fo in , on fera af-
furé de calmer l ’agitation de fon flanc.
Le battement en fera beaucoup plus v if, s’il eft
caiffé par la fievre. Voye[ Fie v r e . L’expiration entrecoupée
par une nouvelle infpiration , qui fait ap-
percevoir conféquemment un mouvement redoublé
lors de la dilatation des faces latérales de l’abdomen,
caraCtérife la pouffe. Voye^ Pousse , &c. {e)
Flanc. Les écrivains donnent aufli ce nom aux
deux lignes droites qui fe trouvent au milieu des
deux côtés de la lettre O , qui font en effet comme
les deux flancs.
Flanc , {à la Monnoie.) Le métal ayant été fondu
en lames, & paffé par les laminoirs avec un infiniment
appellé coupoir ou emporte-pièce {voyeç l'article
C o u po ir ) , on coupe de la lame un morceau
rond comme une piece unie au palet, d’une grandeur
& d’une épaiffeur conféquente à l'empreinte
que doit recevoir cette efpece de palet, qu’on ap-
pell q fla n c , pour devenir une monnoie. Ce flanc ou
piece unie, avant de paffer au balancier, eft donnée
aux ajufteurs, pour la rendre du poids qu’elle doit
avoir ; enfuite on la recuit, on la fait bouillir dans
un fluide préparé, &c. enfin elle continue d’être ap-
pellée flanc jufqu’à ce qu’on y ait empreint l’effigie,
les armes, légendes de tranches ou cordonnet. Voyeç
C o u p e r , Bla n ch ir .
FLANCONADE 0# FLACONADE, (Es to c a d e
de) Efcrime; c’eft une botte de quarte forcée qu’on
porte dans le flanc de l’ennemi.
Voici la façon de l’exécuter : i°. du talon du tranchant
preffez le foible de l’épée ennemie : z°. entrelacez
votre lame de façon avec la fienne, que le talon
de votre tranchant foit de quarte fur le foible de
fa lame , & l’autre partie de votre lame fous fon
bras : 30. de cette pofuion alongez Veflocade, comme
il eft enf'eigné pour feflocade de quarte.
Flancon ad e ou Fla co n a d e , {Parade de) pour
parer la flaconade, il faut faire tout ce qui fera enseigné
pour parer en tierce {voye^Parade en tierc
e ) ; mais remarquez que la pofition de cette parade :
eft bien differente : car l’épée de l’ennemi, au lieu de !
fe trouver du côté du vrai tranchant, fe trouve du côté
du faux & au-dedans du bras. Cette parade eft ap-
pellée dans les falles d’armes, p a r a d e d e q u in t e .
FLANDRE, { G é o g . ) grande province des Pays-
Bas , trop connue pour nous arrêter à la décrire ; on
peut la divifer en F la n d r e a u tr ic h ie n n e & en h o l la n -
d o i fe . Elle eft entre la mer d’Allemagne, l’Artois, le
Hainaut, le Brabant, la Gueldre, la province d’U-
trecht, & le comté de Zélande. On entend quelquefois
improprement par la F la n d r e , tous les Pays Bas
catholiques. V o y c { fur tout ce magnifique pays, Bu-
zejin, a n n . G a l lo - F la n d r i c e ; Guicnardin, d e fe r ip t . d e
F la n d r e ; Meyer, h i f l . d e F la n d r e ; Grammaye, a n t iq .
F la n d r ioe ; Longuerue, d e f e r ip t . d e la F r a n c e ; Aubert
le Mire, a n n . d e F la n d r e , & autres. { D , J . )
* FLANELLE, f. f. {D r a p e r . & C o m m . ) c’eft une
efpece d’étoffe de laine, claire, peu ferrée, qui n’eft
point piquée ou matelaflee , mais qui eft fort chaude
, compofée d’une trame & d’une chaîne, & faite
avec un métier de Tifferand à deux pédales, de la
même maniéré que l’on fabrique la revêche. V o y e z
R e v ê c h e .
F l a n e l l e s , term e d e M a n u fa c tu r e d e g la c e s . On
appelle f l a n e l l e s parmi les ouvriers qui mettent les
glaces au teint, les pièces d ’étoffe de laine, mollettes
& peu ferrées, à-travers defquelles le filtre le
vif- argent qui coule de deffous une glace étamée.
Elles fervent à purifier ce minéral des ordures qu’il
a contractées pendant le peu de tems qu’il a relie fur
la feuille d’étain. On les appelle f l a n e l l e s , parce qu’elles
font affez fouvent de cette efpece d’étoffe ; ainfi
e l l e s p o r t e n t t o û j o u r s c e n o m , de quelqu’étoffe qu’on
fe ferve.
On nomme auflî f l a n e l l e , l’étoffe qu’on met fur la
glace avant de la charger de plombs ou de boulets
de canon, quoiqu’on y employé aufli d’autres étoffes
, comme du molleton, de la revêche & de la fer-
ge. V o y e { l 'a r t i c le V e r r e r i e . D i c t i o n n . d e T r é v . &
d e C om m e r c e .
FLANCONS , a n c ie n te rm e d e M o n n a y a g e , étoit ce
q u e l ’o n a p p e lle a u jo u rd ’hui f l a n c . V o y c { F l a n c .
FLANQUE, f. f. { .B la fo n .) fe dit d’une piece de
blafon formée par une ligne en voûte qui part des
angles du chef, & fe termine à la bafe de l’écuffon.
Il porte d’hermine aux deux f l a n q u e s vertes. V o y e ç
le s P la n c h e s d e B l a f o n .
Les f la n q u e s fe portent toûjours par paires ou par
couples.
Leigh fait deux différentes pièces de la f l a n q u e &
de la flafque , la première eft plus courbée que la fécondé;
mais Gibbon n’en fait qu’une, qu’il appelle
f la n q u e . C h am b e r s .
FLANQUÉ, te rm e d e B l a f o n , qui f e d i t d e s p aux,!
arbres & autres figûres qui en ont d’autres à leurs
côtés. Aux armoiries de Sicile, les paux d’Arragon
font f l a n q u é s de deux aigles.
Pingon en Savoie, d’azur à une fafee d’o r ,f la n q u é e
de deux pointes d’argent appointées vers la fai’ce.
FLANQUER, ou l’aélion de f l a n q u e r , v . a£l. { F o r t
i f i e . ) en général, c’eft découvrir, défendre ou battre
le côté d’une place, d’un corps, d’un bataillon.
& c .
F la n q u e r u n e p l a c e , c’eft difpofer un baftion ou un
autre ouvrage, de maniéré qu’il n’ait aucune partie
qui ne puiffe être défendue , ou fur laquelle on ne
puiffe tirer de front ou de côté.
On dit, f l a n q u e r u n e m u r a i lle a v e c d e s t o u r s . On dit
auflî, ce baftion eftf l a n q u é par le flanc oppofé & par
une demi-lune. Cet ouvrage à corne eft f la n q u é par
la courtine.
Toute fortification qui n’ a qu’une défenfe de front,
eft défeélueufe t pour la rendre complété, il eft né-
ceffaire qu’une partie f la n q u e l’autre ; c’eft pourquoi
la courtine eft toûjours la partie la plus forte d’une
place, à caufe qu’elle eft f la n q u é e par les flanc s qui