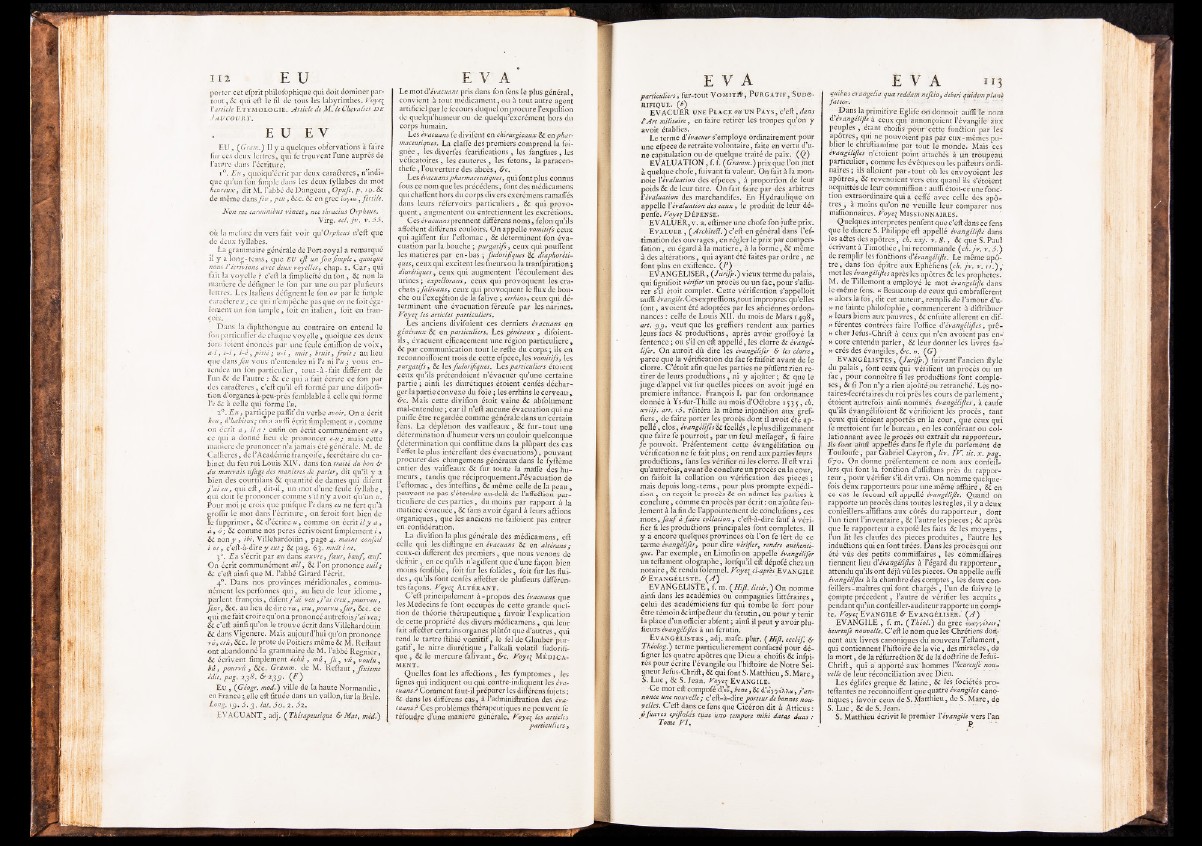
I 1 2 E U
porter cet efprit philofophique qui doit dominer partout,
& qui eft le fil de tous les labyrinthes. Voye^
Yarticle ETYMOLOGIE. Article de M. le Chevalier d e
J a u c o u r t .
E U E V
EU , (Gram.) Il y a quelques observations à faire
fur cës deux lettres, qui fe trouvent l’une auprès de
l’autre dans l’écriture.
i° . Eu y quoiqu’écrit par deux caraôeres, n’indique
qu’un fon {impie dans les deux fyllabes du mot
heureux, dit M. l’abbé deDangeau, Qpufc. p. / o. 8c
de même dans feu, peu, 8cc. 8c en grec ïuytu, fertile.
Non me carminibus vincet, nec tkracius Orpheus.
Virg. ecl. jv .r v. SS.
oîi la mefure du vers fait voir a f Orpheus n’eft que
de deux fyllabes.
La grammaire générale de Port-royal a remarqué
il y along-tems, que e u efi un fon fimple, quoique
nous Vècrivions avec deux voyelles, chap. I . C a r , qui
fait la voyelle ? c’eft la {implicite du fon, 8c non la
maniéré de défigner le fon par une ou par plufieurs
lettres. Les Italiens défignent le fon ou par le fimple
caraétereu ; ce qui n’empêche pas que ou në foit également
un fon fimple, lbit en italien, foit en fran-
çois.
Dans la diphthongue au contraire on entend le
fon particulier de chaque v o y e lle , quoique ces deux
Ions foient énoncés par une feule émiflion de vo ix ,
a-i, e-i , i-ê , pitié ; u-i , nuit, bruit, fruit: au lieu
que dans feu vous n’entendez ni Ye ni Y u j vous entendez
un fon particulier, tout-à-fait différent de
l’un 8c de l ’autre : Sc ce qui a fait écrire ce fon par
des caraûeres , c’efl: qu’il eft formé par un© difpofi-
tion d’organes à-peu-près femblable à celle qui forme
Ye 8c à celle qui forme 1’«.
i ° . E u , participe pafîif du verbe avoir. On a écrit
heu, d’habitus; on a aufîi écrit Amplement u , comme
on écrit a , il a: enfin on écrit communément eu,
ce qui a donné lieu de prononcer e-uj mais cette
maniéré de prononcer n’a jamais été générale. M. de
Callieres, de l’Académie françoife, fecrétaire du cabinet
du feu roi Louis X IV. dans fon traité du bon &
du mauvais ufage des maniérés de parler, dit qu’il y a
bien des courtifans 8c quantité de dames qui difent
f a i eu, qui eft, dit-il, un mot d’une feule fyllabe,
qui doit le prononcer comme s’il n’y avoit qu’un u.
Pour mol je crois que puifque Ye dans eu ne fert qu’à
groflir le mot dans l’écriture, on feroit fort bien de
le ftipprimer, 8c d’écrire u , comme on écrit il y a ,
à , d; & comme nos peres écrivoient Amplement i ,
8c non y , ibi. Villehardoiiin, page 4. maint confeil
i ot, c’eft-à-direy eut; 8c pag. 63. mult i ot.
30. Eu s’écrit par au dans oeuvre, foeur, boeuf, oeuf
On écrit communément oeil, 8c l’on prononce cuil;
8c c’eft ainA que M. l’abbé Girard l’écrit.
40. Dans nos provinces méridionales, communément
les perfonnes q ui, au lieu de leur idiome,
parlent frânçois, difent f a i veu,faicreu,pourveu,
feur, &c. au lieu de dire vu, cru., pourvu, fur, 8cc. ce
qui me fait croire qu’on a prononcé autrefoisfa i veu;
8c c’eft ainA qu’on le trouve écrit dans Villehardoiiin
8c dans Vigenere. Mais aujourd’hui qu’on prononce
vît, crû, 8cc. le prote de Poitiers même & M. Reftaut
ont abandonné la grammaire de M. l’abbé Regnier ,
8c écrivent Amplement échu, mû, f u , vu, voulu,
bû, pourvu, 8cc. Gramm. de M. Reftaut, fxieme
M i t . pag. z ÿ 8 . f e | § ' ( ? )
Eu , (Géogr. mod.) ville de la haute Normandie,
en France elle eft Atuée dans un vallon, fur la Brile.
Long, /g. S. 3. lat. S o . 2, S.2.,
EVACUANT, adj. (Thérapeutique & Mat, médf
E V A '
Le mot Rev autant pris dans fon fens le plus général,
convient à tout médicament., ou à tout autre agent
artificiel par le fecours duquel on procure l’expuffion
de quelqu’humcur ou de quelqu’excrément hors du
corps humain.
Les évacuans fe divifent en chirurgicaux 8c en pharmaceutiques.
La claflè deS premiers comprend la fai-
gnée , les diverfes fcarifications , les fangfues , les
véficatoires, les cautères, les fêtons, {aparacen-
thefe, l’ouverture des abcès, &c.
Les évacuans pharmaceutiques, qui font plus connus
fous ce nom que les précédent, font des médicamens
qui chaffent hors du corps divers excrémens ramaffés
dans leurs réfervoirs particuliers, 8c qui .provoquent
, augmentent ou entretiennent les excrétions.
C e sévacuans prennent différens noms, félon qu’ils
affe&ent différens couloirs. On appelle vomitifs çeux
qui agiffent fur l’eftomac , 8c déterminent fon évacuation
par la bouche ; purgatifs, ceux qui pouffent
les matières par en-bas ; fudorifiques 8c diaphor étiques,
ceux qui excitent les fueursou la tranfpiration ;
diurétiques, ceux qui augmentent l’écoulement des
urines ; expeclorans, ceux qui provoquent les crachats
; falivans, ceux qui provoquent le flux de bouche
ou l’excrétion de la falive ; errhins, ceux qui déterminent
une évacuation féreufe par les narines.
Voye^ les articles particuliers.
Les anciens divifoient ces derniers évacuans en
généraux 8c en particuliers. Les généraux , difoient-
ils , évacuent efficacement une région particulière ,
8c par communication tout le refte du corps ; ils en
reconnoiffoient trois de cette efpece,les vomitifs, les
purgatifs, 8c les fudorifiques. Les particuliers étoient
ceux qu’ils prétendoient n’évacuer qu’une certaine
partie ; ainA les diurétiques étoient cenfés décharger
la partie convexe du foie ; les errhins le cerveau ,
&c. Mais cette diviAon étoit vaine 8c abfolument
mal-entendue ; car il n’eft aucune évacuation qui ne
puiffe être regardée comme générale dans un'certain
fens. La déplétion des vaiffeaux, 8c Air-tout une
détermination d’humeur vers un couloir quelconque
(détermination qui conftitue dans la plupart des cas
l’effet le plus intéreffant des évacuations), pouvant
procurer des changemens généraux dans le fyftème
entier des vaiffeaux 8c fur toute la maffe des humeurs
, tandis que réciproquementd’évacuation de
l’eftomac , des inteftins, 8c même celle de la peau ,
peuvent ne pas s’étendre au-delà de l’affeâion particulière
de ces parties, du moins par rapport à la
matière évacuée, 8c fans avoir égard à leurs a&ions
organiques, que les anciens ne faifoient pas entrer
en confidération. .
La diviAon la plus générale des médicamens, eft
celle qui les diftingue en évacuans 8c en altérans ;
ceux-ci different des premiers, que nous venons de
définir, en ce qu’ils n’agiffent que d’une façon bien
moins lenfible, foit fur les foliaes, foit fur les fluides
, qu’ils font cenfés affetter de plufieurs différentes
façons. Voye^ A l t é r a n t .
C ’eft principalement à-propos des évacuans que
les Médecins fe font occupés de cette grande quef-
tion de théorie thérapeutique ; favoir l ’explication
de cette propriété des divers médicamens , qui leur
fait affe&er certains organes plutôt que d’autres, qui
rend le tartre ftibié vomitif, le fel de Glauber purg
atif, le nitre diurétique , l’alkali volatil fudorifi-
q u e , 8c le mercure falivant, &c. Voye^ Médicament.
Quelles font les affeftions, les fymptomes , les
Agnes qui indiquent ou qui contre-indiquent les évacuans
? Comment faut-il préparer les différens fujets ;
8c dans les différens cas, à l ’adminiftration des èvar
cuans ? Ces problèmes thérapeutiques ne peuvent fe
réfoudfe d’une maniéré générale. Voye^ les articles
particuliers ,
E V A
particuliers, fur-tout Vomitiê, PURGATIF, SUDORIFIQUE.
(b)
EVACUER une Pl a c e ou un Pay s , c’efl:, dans
P Art militaire, en faire retirer les troupes qu’on y
avoit établies.
Le terme d’évacuer s’employe ordinairement pour
une efpece de retraite volontaire, faite en vertu d’une
capitulation ou de quelque traité de paix. (Q)
EVALUATION, f. f. (Gramm.) prix que l’on met
à quelque chofe, fuivarit l’a valeur. On fait à la mon-
noie Y évaluation des efpéces , à proportion, de leur
poids & de leur titre. On fait faire par dés arbitres
dévaluation des marchandées. En Hydraulique on
appelle Y évaluation des eaux, le produit de leur dé-
penfe. Voye^ D épense.
EVALUER, v. a. eftimer une chofe fon jufte prix. ■ Evaluer , (Architecl. ) c’eft en général dans l’ef-
timation des ouvrages, en régler le prix par cbmpen-
fation, eu égard à la matière, à la forme, & même
•à des altérations, qui ayant-été faites-par ordr.e, ne
•font plus en exiftence. (P) -
ÉVANGÉLISER, (Jurifp.) vieux terme du palais,
qui fignifioit vérifier un procès ou un fac, pour s’affu-
rer s’il étoit complet. Cette vérification s’appelloit
aufli évaîigile.Ces expreflions,tout impropres qu’elles
fon t , avoient été adoptées par les anciénnes ordonnances
: celle de Louis XII. du mois de Mars 1498,
art. c)q. veut que les greffiers rendent aux parties
leurs lacs & produ&ions, après avoir groffoyé la
fentence ; ou s’il en eft- appellé, les dorre & évangé-
lifer. On auroit dû dire les évangélifer & les clone,
parce que la vérification du fac fe faifoit avant de le
clorre. C ’étoit afin que les parties ne pûffent rien retirer
de leurs produéfions, n i y ajoûter ; & que le
juge d’appel v ît Air quelles pièces on avoit jugé en
première inftance. François ï. par fon ordonnance
donnée à Ys-fur-Thille au mois d’O&obre 153 5, ch.
xviij. art. t5. réitéra la même injonélion aux greffiers
, de faire porter les procès dont il avoit été appellé
, clos, évangélifés&c fcellés ,1e plus diligemment
que faire fe pourroit, par un feul meffager , A faire
fe pouv-oit. ' Préfentement cette évangélifation ou
vérification ne fe fait plus ; on rend aux parties leurs
produûions, fans les vérifier ni lès clorre. Il eft vrai
qu’autrefois, avant de conclure un procès en la cour,
on faifoit la collation Ou vérification des pièces
mais depuis long-tems, pour plus prompte expédition
, on reçoit le procès & on admet lès parties à
conclure, comme ën procès par écrit : on ajoute feulement
à la fin de l’appointement de cbnclufions, ces
mots, fa u f à faire collation, c’eft-à-dire fauf à vérifier
fi les productions principales font complétés. Il
y . a encore quelques provinces oîi l’on fe fert de ce
terme évangélifer, pour dire vérifier, rendre authentir
que. Par exemple, enLimofinon appelle évangélifer
unteftament olographe, lo.rfqu’il eft dépofé.chezun
notaire, & rendu folennel. foye^ ci-après Evangile
& Ev an g é l iste . ( A )
EVANGÉLISTE, f. m. (Hiß. littér. ) On nomme
ainfi dans les académies ou compagnies littéraires,
celui des académiciens fur qui tombe le fort pour
être témoin & infpeCleur du ferutin, ou pour y tenir
la place d’un officier abfent ; ainfi il peut y avoir plufieurs
évangélifies à un ferutin.
Evangé liste s , adj. mafe. plur. ( Hiß. eccléf. £>
Théolog.) terme particulièrement confacré pour dé-
Agner les quatre apôtres que Dieu a choifiS & infpi-
rés pour écrire l’évangile ou l’hiftoife de Notre Seigneur
Jefus-Chrift, & qui font S. Matthieu, S. Marc,
S. L u c , & S. Jean. Voye^ Ev an g ile .
•Ce mot èft compofé d,’sZ,bene , & àéàyylx^a-, fan-
nonce une nouvelle ; c’eft-à-dire porteur de bonnes nouvelles.
C ’eft dans ce fens que CicérOn dit à Atticüs :
fifuaves epißalas tuas uno (empor,e mihi datas duas :
Tome y i .
E V A 113
quibus evangelia quoe reddarn nefeio, deberi quidemplané
fateor.'
t Dans la primitive Eglife ofi donnoit auflî le nom
d evangélijle à ceux qiu annonçoient l’évangile àiix
peuplés , étant choifis poùi0 cette fonction par les
apôtres, qui ne pouvoient1 pias par eux-mêmes publier
le chriftianifme par tout je monde. Mais ces
evangelijles n’étoient point attachés à un troupeau
particulier , comme les évêques ou les pàfteurs^rdi;
narres \ ils allpient par-tout* o’ti les enivoyoient les
apôtres, &- revenoient vers eiix quand ils s’étoient
acquittés de leur commiflîon : aufli étoit-cë une fonction
extraordinaire qui a' çefle avec celle dés apôtres
, à moins qu’on ne veuille leur comparer nos
millionnaires. Voye^ Missionnaires! !
Quelques interprètes penfent que c’eft dans ce fens
que le diacre S. Philippe eft appellé évangélijle dans
les aftes des apôtres -, • ch: xxj. v. S . , & que S. Pau!
écrivant à Timothée, lui recommande (ch.jv. v. J .)
de remplir les fonctions cYévangélijïe. Le même apôt
re , dans ion epitrë aux Ephéfiëns (ch. jv . v. //.),'
met les évangélifies après les apôtres & les prophètes.
M. dé Tillemont a employé le mot évangelifie dans
le même fens. « Beaucoup de ceux qui embrafferent
» alors la fo i, dit cet auteur, remplis de l’amour d’u-
» ne fainte philofophie, commencèrent à diftribuer
» leurs biens aux pauvres, & enfuite allèrent en dif-
»férentes contrées faire l’office (YévangèUfies, prê-
» cher Jefus-Chrift à ceux qui n’en avoient pas en-
>» core entendu parler, & leur donner lés livres fa-'
» crés des évangiles, &c. ». (G) Evangélistes, (Jurïfpé) fuiv.ant l’ancien ftyle
du palais , font ceux qui vétifient un procès ou un
fa c , pour connoître fi les productions font complétés
, & A l’on n’y a rien ajoûtë.ou retranché. Lés no-
taires-fecrétaires du roi près.lés cours de parlement,1
étoient autrefois ainfi nommés évangélifies, à caufe
qu’ils ëyangélifbiëhf & vérifîoiént lés procès, tant
éeux qui étoient apportés én-la cour, cjue ceux qui
fe mettoient fur le bureau, en les conférant ou collationnant
avec le procès ou extrait du rapporteur.
Ils font ainfi appelles dans Ye ftyle du parlement de
Touloûfe, par Gabriel Cayron, liv. IV . tic. x . pag.
Gyo. On donné préfentement ce nom aux confeilr 1er s, qui Font la fonction d’ afliftans près du rapporteur
, pour vérifier s’il dit vrai. On nomme quelquefois
deux rapporteurs pour une même affaire, & en
ce cas le fécond eft appellé évangélifie. Quand oh
rapporte un procès dans toutes les réglés, il y a deux
confeillers-afliftâns aux côtés du rapporteur, dont
l’An tient l’inventaire, & l ’autre lés pièces ; & après
que le rapporteur a expofé les faits &"les moyens ,
l’un lit les claûfes des "pièces produites, l’autre les
induûions qui en font tirées. Dans les procès qui ont
été vûs des petits commiffaires, les cdmmiffaires
tiènnent lieu àéévangélifies à l’égard du rapporteur ,
attendu qu’ils ont déjà vûles pièces. On appelle aùflï
évangélifies à la chambre des comptes, lès deux con-
feillèrs - maîtres qui font chargés , l’un de fuivre lé
compte précèdent, l’autre de vérifier les acquits,
pendant qu’ùn cônfeiller-auditeur rapporte un compte.
VoyciEvangile & Evangéliser.'"ÇA) J ■
EVANGILE , f. m. (Théol.) du grec èvdyylxtov é
■ heureufe nouvelle. C ’eft le nom qiiè les Chrétiens doiî-
nent aux livres canoniques dû nouveau Teftament,
qui contiennent l’hiftôirë de la v ie , des miracles, dé
la m ort, de la réfurreCtion 8c de là doÇtrine de Jefus-
Chrift , qui a apporté aux hommes Yheureufe nouvelle
de leur réconciliation avec Dieu.
Les églifes gréque 8c latine, 8c les foeiétés pro-
teftanteS hé reconnoiffent que quàtré évarigïlês canoniques
', fayoir ceux de S. Matthieu, de S. Marc, dp
S. L u c , 8c dé S. Jean.
S. Matthièu écrivît le premier Y évangile vers l’an
. p ■ - i