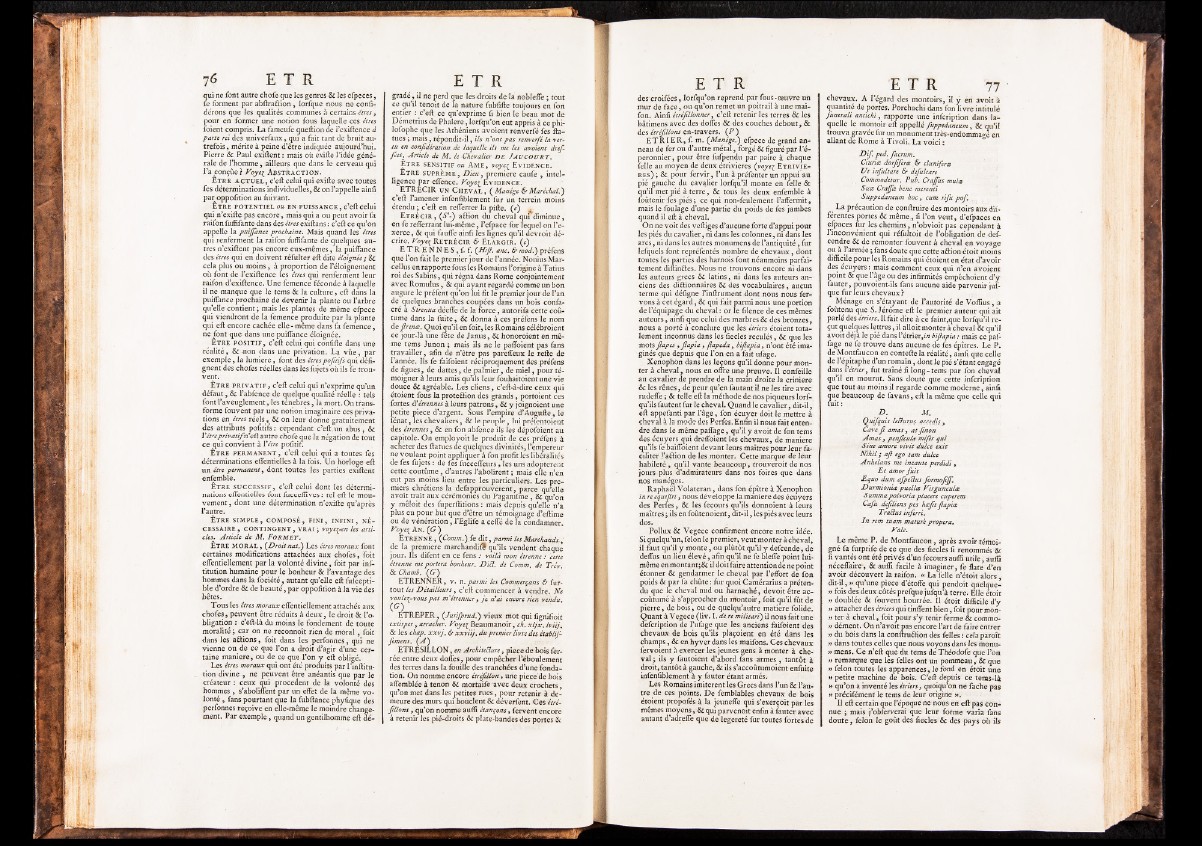
76 E T R
qui ne font autre chofe que les genres & les efpeces,
fe forment par abftraftion, lorfque nous ne confinerons
que les qualités communes à certains êtres >
pour en former une notion fous laquelle ces êtres
foient compris. La fameufe queftion de l’exiftence à
parte rei des univerfaux, qui a fait tant de bruit autrefois
, mérite à peine d’être indiquée aujourd’hui.
Pierre & Paul exiftent : mais oii exifte l ’idée générale
de l’homme , ailleurs que dans le cerveau qui l’a conçûe? Voye.i Abstraction.
Etre actuel, c’efi celui qui exifte avec toutes
fes déterminations individuelles, & on l’appelle ainfi
par oppofition au fuivant. Être potentiel ou en puissance, c’eft celui
qui n’exifie pas encore, mais qui a ou peut avoir fa
raifon fuffifante dans des êtres exiftans : c’eft ce qu’on
appelle la puiffance prochaine. Mais quand les êtres
qui renferment la raifon fuffifante de quelques autres
n’exiftent pas encore eux-mêmes, la puiffance
des êtres qui en doivent réfulter eft dite éloignée; &
cela plus ou moins, à proportion de l’éloignement
où font de l’exiftence les êtres qui renferment leur
raifon d’exiftence. Une femence féconde à laquelle
il ne manque que le tems & la culture, eft dans la
puiffance prochaine de devenir la plante ou l’arbre
qu’elle contient ; mais les plantes de même efpece
qui viendront de la femence produite par la plante
qui eft encore cachée elle - même dans fa femence,
ne font que dans une puiffance éloignée. Être positif, c’eft celui qui confifte dans une
réalité, & -non dans une privation. La v û e , par
exemple, la lumière, font des êtres pofitifs qui défi-
gnent des chofes réelles dans les fujets où ils fe trouvent.
Être privatif , c’eft celui qui n’exprime qu’un
défaut, & l’abfence de quelque qualité réelle : tels
font l’aveuglement, les tenebres, la mort. On transforme
fouvent par une notion imaginaire ces privations
en êtres réels, & on leur donne gratuitement
des attributs pofitifs: cependant c’eft.un abus, &
Vêtreprivatif'n’eft autre chofe que la négation de tout
ce qui convient à l'être pofitif. Être permanent , c’eft celui qui a toutes fes
déterminations effentielles à la fois. Un horloge eft
un être permanent, dont toutes les parties exiftent
enfemble. Être successif, c’eft celui dont les déterminations
effentielles font fucceffives : tel eft le mouvement
, dont une détermination n’exifte qu’après
l’autre. Être simple, composé, fini, infini, nécessaire
, CONTINGENT, vrai ; voye^-en les articles.
Article de M. F o rm e y .
ÊTRE moral , {Droit nat.) Les êtres moraux font
certaines modifications attachées aux chofes, foit
effentiellement par la volonté divine, foit par inf-
titution humaine pour le bonheur & l’avantage des
hommes dans la fociété, autant qu’elle eft fufoepti-
ble d’ordre & de beauté, par oppofition à la vie des
bêtes.
Tous les êtres moraux effentiellement attachés aux
chofes, peuvent être réduits à deux, le droit & l’obligation
: c’eft-là du moins le fondement de toute
moralité ; car on ne reconnoît rien de moral, foit
dans les aôions, foit dans les perfonnes, qui ne
vienne ou de ce que l’on a droit d’agir d’une certaine
maniéré, ou de ce que l’on y eft obligé.
Les êtres moraux qui ont été produits par l ’inftitu-
tion divine , ne peuvent être anéantis que par le
créateur : ceux qui procèdent de la volonté des
hommes , s’aboliffent par un effet de la même v o lonté
, fans pourtant que la fubftance phyfique des
perfonnes reçoive en elle-même le moindre changement.
Par exemple, quand un gentilhomme eft dé-
E T R
gradé, il ne perd que les droits de la nobleffé ; tout
ce qu’il tenoit de la nature fubfifte toujours en fon
entier : c’eft, ce qu’exprime fi bien le beau mot de
Démetrius de Phalere, lorfqu’on eut appris à ce phi-
lofophe que les Athéniens avoient renverfé fes fta-
tues ; mais, répondit-il, ils n'ont pas renverfé la vertu
en confidèration de laquelle ils me les avoient dref-
fies. Article de M. le Chevalier D E J A U c o u R T . Etre sensitif ou Ame, voyez Evidence.
Etre suprême,ligence par effence. Dieu, première caufe , intelVoyez
Evidence.
ETRÉCIR un Cheval, {Manège & Maréchal.')
c’eft l’amener infenfiblement fur un terrein moins
étendu ; c’eft en refferrer la pifte. (e) * en Efet rreéffcerirra,n {t Slu’-i)- maêf tmioen, ld’euf pcahceev faul r qleuqi udeilm oinn lu’ee,
cxreirrcee. , & qui fauffe ainfi les lignes qu’il devroit déVoyez
Rétrécir & Élargir, (e)
E T R E N N E S , f . f. {Hijl. anc. & rnod.) préfens
que l’on fait le premier jour de l’année. Nonius Mar-
cellus en rapporte fous les Romains l’origine à Tatius
roi des Sabins, qui régna dans Rome conjointement
avec Romulus, & qui ayant regardé comme un bon
augure le préfent qu’on lui fit le premier jour de l’an
de quelques branches coupées dans un bois confa-
cré à Strenua déeffe de la force, autorifa cette coutume
dans la fuite, & donna à ces préfens le nom
de firenoe. Quoi qu’il en foit, les Romains célébroient
ce jour-là une fête de Janus, & honoroient en même
tems Junon ; mais ils ne le paffoient pas fans
travailler, afin de n’être pas pareffeux le refte de
l’année. Ils fe faifoient réciproquement des préfens
de figues, de dattes, de palmier, de miel, pour témoigner
à leurs amis qu’ils leur fouhaitoient une vie
douce & agréable. Les cliens, c’eft-à-dire ceux qui
étoient fous la proteftion des grands, portoient ces
fortes à’ étrennes à leurs patrons, & y joignoient une
petite piece d’argent. Sous l’empire d’Augufte , le
fénat, les chevaliers, & le peuple, lui prélentoient
des ètremîes, & en fon abfence ils les dépofoient au
capitole. On employoit le produit de ces préfens à
acheter des ftatues de quelques divinités, l’empereur
ne voulant point appliquer à fon profit les libéralités
de fes fujets : de fes fucceffeurs, les uns adoptèrent
cette coutûme, d’autres l’abolirent ; mais elle n’en
eut pas moins lieu entre les particuliers. Les premiers
chrétiens la defapprouverent, parce qu’elle
avoit trait aux cérémonies dit Paganifme , & qu’on
y mêloit des fuperftitions : mais depuis qu’elle n’a
plus eu pour but que d’être un témoignage d’eftime
ou de vénération, l’Eglife a ceffé de la condamner.
Voyez An. {G ) Etrenne , {Comm.yfe dit, parmi les Marchands.,
de la première marchandift qu’ils vendent chaque
jour, lis difent en çe fens .* voilà mon ètrenne : cette
étrenne me portera bonheur. Dicl. de Comm. de Trév
& Chamb. {G)
ETRENNER, v. n. parmi les Commerçons & fur-
tout les Détailleurs, c’eft commencer à vendre, Ne
voulez-vous pas m'ètrenner , je rCai encore rien vendu.
(G )
ETREPER, {Jurifprud.y vieux mot qui fignifioit
extirper, arracher. Voyez Beaumanoir, ch. x ljx . Iviij.
& les chap. xxvj. & xxviij. du preniier livre des établlf-
femens. {A y
ETRÉSILLON, en Architecture, piece de bois ferrée
entre deux doffes, pour empêcher l’éboulement
des terres dans la fouille des tranchées d’une fondation.
On nomme encore ètréfillon, une piece de bois
affemblée à tenon & mortaife avec deux crochets,
qu’on met dans les petites rues, pour retenir à demeure
des murs qui bouclent & déverfent. Ces étré-
jillons , qu’on nomme auffi élançons , fervent encore
à retenir les pié-droits & plate-bandes des portes &
E T R
des croifées, lorfqu’on reprend par fous-oeuvre un
mur de face, ou qu’on remet un poitrail à une mai-
fon. Ainfi étrèjillonner, c’eft retenir les terres & les
bâtimens avec des doffes & des couches debout, &
des ètrèfillons en-travers. (P )
E T R IE R , f. m. {Manege.y efpece de grand anneau
de fer ou d’autre métal, forgé & figuré par l ’é-
peronnier, pour être fufpendu par paire à chaque
folle au moyen de deux étrivieres {voyez Etrivie-
res) ; & pour fervir, l’un à préfenter un appui au
pié gauche du cavalier lorfqu’il monte en felle &
qu’il met pié à terre, & tous les deux enfemble à
foûtenir fes piés ; ce qui non-feulement l’affermit,
mais le foulage d’une partie du poids de fes jambes
quand il eft à cheval.
On ne voit des veftiges d’aucune forte d’appui pour
les piés du cavalier, ni dans les colonnes, ni dans les
arcs, ni dans les autres monumens de l’antiquité, fur
lefquels font repréfentés nombre de chevaux, dont
toutes les parties des harnois font néanmoins parfaitement
diftinftes. Nous ne trouvons encore ni dans
les auteurs grecs & latins, ni dans les auteurs anciens
des diftionnaires & des vocabulaires, aucun
terme qui défigne l’inftrument dont nous nous fer-
vons à cet égard, & qui fait parmi nous une portion
de l’équipage du cheval : or le filence de ces mêmes
auteurs, ainfi que celui des marbres & des bronzes,
nous a porté à conclure que les étriers étoient totalement
inconnus dans les fieclés reculés, & que les
mots ftapes , fiapia , (iapeda, biflapia, n’ont été imaginés
que depuis que l’on en a fait ufage.
Xenophon dans les leçons qu’il donne pour monter
à cheval, nous en offre une preuve. II confeille
au cavalier de prendre de la main droite la crinière
& les rênes, de peur qu’en fautant il ne les tire avec
rudeffe ; & telle eft la méthode de nos piqueurs lorf-
qu’ils fautent fur le cheval. Quand le cavalier, dit-il,
eft appefanti par l’âg e, fon écuyer doit le mettre à
cheval à la mode des Perfes. Enfin il nous fait entendre
dans le même paffage, qu’il y avoit de fon tems
des écuyers qui dreffoient les chevaux, de maniéré
qu’ils fe baiffoient devant leurs maîtres pour leur faciliter
l’aftion de les monter. Cette marque de leur
habileté , qu’il vante beaucoup, trouveroit de nos
jours plus d’admirateurs dans nos foires que dans
nos manèges.
Raphaël Volateran, dans fon épître à Xenophon
in re equejlri, nous développe la maniéré des écuyers
des Perfes, & les fecours qu’ils donnoient à leurs
maîtres ; ils en foûtenoient, dit-il, les piés avec leurs
dos.P
ollux & Vegece confirment encore notre idée.
Si quelqu’un, félon le premier, veut monter à cheval,
il faut qu’il y monte, ou plutôt qu’il y defeende, de
deffus un lieu élevé, afin qu’il ne fe bleffe point lui-
même en montant; & il doit faire attention de ne point
étonner & gendarmer le cheval par l’effort de fon
poids & par fa chute: fur quoi Camérarius a prétendu
que le cheval nud ou harnaché, devoit être accoutumé
à s’approcher du montoir, foit qu’il fût de
pierre, de bois, ou de quelqu’autre matière folide.
Quant à Vegece (liv. I. de re militari) il nous fait une
defeription de l’ufage que les anciens faifoient des
chevaux de bois qu’ils plaçoient en été dans les
champs, & en hy ver dans les maifons. Ces chevaux
for voient à exercer les jeunes gens à monter à cheval
; ils y fautoient d’abord fans armes , tantôt à
droit, tantôt à gauche; & ils s’accoûtumoient enfuite
infenfiblement à y fauter étant armés.
Les Romains imitèrent les Grecs dans l’un & l’autre
de ces points. De femblables chevaux de bois
étoient propofés à la jeuneffe qui s’exerçoit par les
mêmes moyens, & qui parvenoit enfin à fauter avec
autant d’adreffe que de legereté fur toutes fortes de
E T R 77
chevaux. A l ’égard des montoirs, ’il ÿ en avoit à
quantité de portes. Porchachi dans fon livre intitulé
funerali antichi, rapporte une infeription dans laquelle
le montoir eft appelle fuppedaneum, & qu’il
trouva gravée fur un monument très-endommage en
allant de Rome à T ivoli. La voici :
Dif. ped. facrum.
Ciurice dorfiferoe & clunifem
Ut infultare & defultare
Commodetur. Pub. Crajfus mulet
Suce Crajfoe bene meretiti
Suppedaneum hoc , cum rifu pof.
I La précaution de çonftruire des montoirs aux differentes
portes & même, fi l’on veut, d’efpaces en
efpaces fur les chemins, n’obvioit pas cependant à
l’inconvénient qui réfultoit de l’obligation de def-
cendre & de remonter fouvent à cheval en voyage
°}1 ^ f,arù1ée » fans doute que cette aftion étoit moins
difficile pour les Romains qui étoient en état d’avoir
des écuyers : mais comment ceux qui n’en avoient
point & que l’âge ou des infirmités empêchoient d’y
fauter, pouvoient-ils fans aucune aide parvenir juf-
que fur leurs chevaux }
Ménage en s’étayant de l’autorité de Voflius, a
foutenu que S. Jérôme eft le premier auteur qui ait
parlé des étriers. Il fait dire à ce faint,que lorfqu’il reçut
quelques lettres, il alloit monter à cheval & qu’il
avoit déjà le pié dans l’étrier,in bifiapia : mais ce paffage
ne fe trouve dans aucune de fes épîtres. Le P.
de Montfaucon en conteftela réalité, ainfi que celle
de l’épitaphe d’un romain, dont le pié s’étant engagé
dans Vétrier 9 fut traîné fi long-tems par fon cheval
qu’il en mourut. Sans doute que cette infeription
que tout au moins il regarde comme moderne, ainfi
que beaucoup de favans, eft la même que celle qui
luit:
D . M.
Quifquis lecturus accedis ,
Cave f i amas , at finon
Amas 9 penficula tnijer qui
Sine amore vivit dulce exit
Nihil ; afi ego tam dulce
Anhelans me incaute perdidi ,
E t amor fuit
Equo dum afpectus formofiff.
Durmionict puellct Virgunçulat
Summapolvoria placer e cuperem
Cafu defiliens pes hafit fiapict
Traclus inferri.
In rem tuam maturè propera.
Voie.
Le même P. de Montfaucon, après avoir témoigné
fa furprife de ce que des fiecles fi renommés &
fi vantés ont été privés d’un fecours auffi utile, auffi
néceflàire", & auffi facile à imaginer, fe flate d’en
avoir découvert la raifon. « La felle n’étoit alors ,
dit-il, » qu’une piece d’étoffe qui pendoit qüelque-
» fois des deux côtés prefque jufqu’à terre. Elle étoit
» doublée & fouvent bourrée. Il étoit difficile d’y
» attacher des étriers qui tinffent bien, foit pour mon-
» ter à cheval, foit pour s’y tenir forme & coirnno-
» dément. On n’avoit pas encore l’art de faire entrer
» du bois dans la conftruftion des folles : cela paroît
» dans toutes celles que nous voyons dans les monu-
» mens. Ce n’eft que du tems de Théodofë que l’on
» remarque que les folles ont un pommeau, & que
» félon toutes les apparences, le fond en étoit une
» petite machine de bois. C ’eft depuis ce tems-là
» qu’on a inventé les étriers, quoiqu’on ne fache pas
» précifément le tems de leur origine ».
Il eft certain que l’époque ne nous en eft pas connue
mais j’obferverai que leur forme varia fans
doute, félon le goût des fiecles & des pays où ils