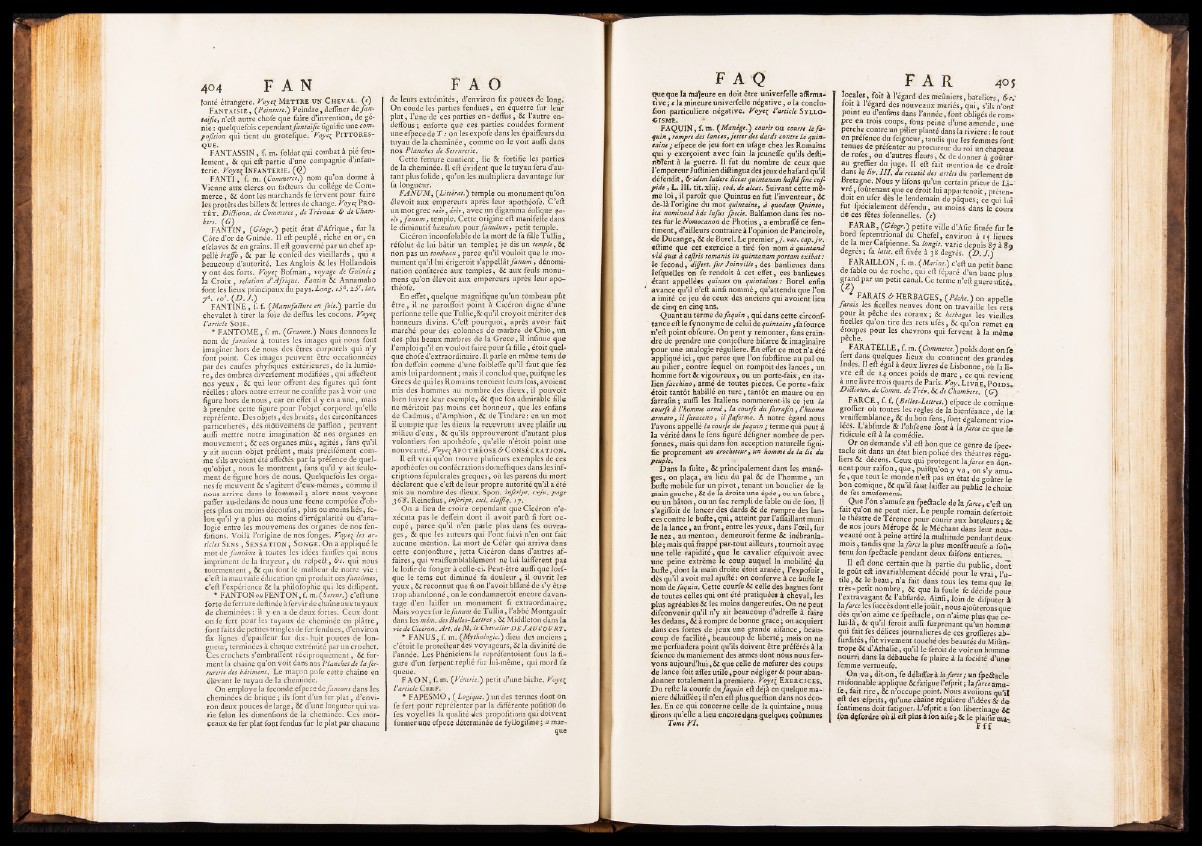
tonte étrangeté. V Me t tre un C hev al. (fi)
Fa n t a is ie , (Peinture?) Peindre,deffinerdefanr-
talfie, n’eft autre chofe que faire d’invention-, de génie
: quelquefois cependant ^/ztaz/ze lignifie une com*
pofitïon qui tient du grotefque. Voyt{ PITTORESQUE.
.,
FANTASSIN, f. m. foldat qui combat à pie feu»
lement, & qui eft partie d’une compagnie d’infanterie.
Voyeç Infanterie. (Q)
FANTI, f. m. (Commerce.) nom qu’on donne à
Vienne aux clercs ou faâeurs du college dé Commerce
, 8c dont les marchands fe fervent pour faire
les protêts des billets 8c lettres de change. Voye\ Prot
ê t . Diclionn. de Commerce, de Trévoux & de Charniers.
(G)
FANTIN, (Géogr.) petit état d’Afrique, fur la
Côte d’or de Guinée. Il eft peuplé, riche en o r , en
efclaves 8c en grains. Il eft gouverné par un chef appelle
brajfo, & par le conteil des vieillards, qui a
beaucoup d’autorité. Les Anglois 8c les Hollandois
y ont des forts. Voye^ Bofman, voyage de Guinée ;
ta C ro ix , relation cTAfrique. Fantin 8c Annamabo
font les lieux principaux du pays. Long. / id. z5'. lat.
7 d. /o'. (Z>. J.)
FANTINE, f. f. (Manufacture en foie.) partie du
chevalet à tirer la foie de deffus les cocons. Voyc{
Varticle SOIE.
* FANTOME, f.' m. (Gramm.) Nous donnons le
nom de fantôme à toutes les images qui nous font
imaginer hors de nous des êtres corporels qui n’y
font point. Ces images peuvent être occafionnées
par des caufes phyfiques extérieures, de la lumièr
e , des ombres diverfement modifiées, qui affe&ent
nos y e u x , 8c qui leur offrent des figures qui font
réelles : alors notre erreur ne confifte pas à voir une
figure hors de nous, car en effet il y en a une, mais
à prendre cette figure pour l’objet corporel qu’elle
repréfente. Des objets, des bruits, des circonftances
particulières, des mouvemens de pafiion , peuvent
auffi mettre notre imagination 8c nos organes en
mouvement ; 8c ces organes mûs, agités, fans qu’il
y ait aucun objet préfent, mais précifément comme
s’ils avoient été affe&és par la préfence de quel-
qu’objet, nous le montrent, fans qu’il y ait feulement
de figure hors de nous. Quelquefois les organes
fe meuvent 8c s’agitent d’eux-memes, comme il
nous arrive dans le lommeil ; alors nous voyons
paffer au-dedans de nous une feene compofée d’objets
plus ou moins découfus, plus ou moins liés, félon
qu’il y a plus ou moins d’irrégularité ou d’analogie
entre les mouvemens des organes de nos fen-
fations. Voilà l’origine de nos fonges. Voye^ les articles
Sens , Sen sat ion , So n g e . On a appliqué le
mot de fantôme à toutes les idées fauffes qui nous
impriment de là frayeur, du refpett, &c. qui nous
tourmentent, 8c qui font le malheur de notre vie :
c’eft la mauvaife éducation qui produit ces fantômes,
ç’eft l’expérience 8c la philofophie qui les difîipent.
* FANTONoaFENTON, f. m.(Serrur.) c’eftune
forte de ferrure deftinée à fervir de chaîne aux tuyaux
de cheminées : il y en a de deux fortes. Ceux dont
on fe fert pour les tuyaux de cheminée en plâtre,
font faits de petites tringles de fer fendues, d’environ
fix lignes d’épaiffeur lur dix-huit pouces de longueur,
terminées à chaque extrémité par un crochet.
Ces crochets s’embraffent réciproquement, 8c forment
la chaîne qu’on voit dans nos Planches de la fer-
rurerie des bâtimens. Le maçon pofe cette chaîne en
élevant le tuyau de la cheminée.
On employé la fécondé efpece de fantons dans les
cheminées de brique ; ils font d’un fer plat, d’environ
deux pouces de large, ÔC d’une longueur qui varie
félon les dimenfions de la cheminee. Ces morceaux
de fer plat font fendus fur le plat par chacune
de leurs extrémités, d’environ fix pouces de long»
On coude les parties fendues, en equërre fur leur
plat, l’une de ces parties en-deflus, 8c l’autre en-
deflous ; enforte que ces parties coudées forment
une efpece de T : on les expofe dans les épaiffeurs du
tuyau de la cheminée, comme on le voit auffi dans
nos Planches de Serrurerie.
Cette ferrure contient, lie 8c fortifie les parties
de la cheminée. Il eft évident que le tuyau fera d’autant
plus folide, qu’on les multipliera davantage fur
fa longueur.
FANl/My (Littéral.) temple ou monument qu’on
élevoit aux empereurs après leur apothéofe. C ’eft
un mot grec moY, aVoV, avec un digàmma éolique <p«-
vov, fanum, temple. Cette Origine eft manifefte dans
le diminutif hanulum pour fanulum, petit temple.
Cicéron inconfolable de la mort de fa fille Tullia,'
réfolut de lui bâtir un temple ; je dis un temple, 8c
non pas un tombeau, parce qu’il vouloit que le monument
qu’il lui érigeroit s’appellât fanum, dénomination
confacrée aux temples, 8c aux feuls monu-
mens qu’on élevoit aux empereurs après leur apothéofe.
En effet, quelque magnifique qu’un tombeau pût
être, il ne paroiffoit point à Cicéron digne d’une
perfonne telle que Tullie,8c qu’il croyoit mériter des
honneurs divins. C ’eft pourquoi, après avoir fait
marché pour des colonnes de marbre de C hio, un
des plus beaux marbres de la G re ce, il infinue que
l’emploi qu’il en vouloit faire pour fa fille, étoit quelque
chofe d’extraordinaire. Il parle en même temsde
fon deffein comme d’une foibleffe qu’il faut que fes
amis lui pardonnent ; mais il conclud que, puifque les
Grecs de qui les Romains tenoient leurs lois, avoient
mis des hommes au nombre des dieux, il pouvoit
bien fuivre leur exemple, 8c que fon admirable fille
ne méritoit pas moins cet honneur, que les enfans
de Cadmus, d’Amphion, 8c de Tindare : en un mot
il compte que les dieux la recevront avec plaifir au
milieu d’eu x, 8c qu’ils approuveront d’autant plus
volontiers fon apothéofe, qu’elle n’étoit point une
nouveauté. Voye^ A p o t h é o s e & C o n sé cr at io n .
Il eft vrai qu’on trouve plufieurs exemples de ces
apothéofes ou confécrationsdomeftiques dans les inf-
criptions fépulcrales greques, où les parens du mort
déclarent que c’eft de leur propre autorité qu’il a été
mis au nombre des dieux. Spon. infeript. cxjv. page
y 68. Reinefius, infeript. cxl. claffiq. r j.
On a lieu de croire cependant que Cicéron n’exécuta
pas le deffein dont il avoit parû fi fort occupé
, parce qu’il n’en parle plus dans fes ouvrages
, 8c que les auteurs qui l’ont fuivi n’en ont fait
aucune mention. La mort de Céfar qui arriva dans
cette conjonfhire, jetta Cicéron dans d’autres affaires
, qui vraisemblablement ne lui laifferent pas
le loifir de fonger à celle-ci. Peut-être auffi que lorf-
que le tems eut diminué fa douleur , il ouvrit les
y e u x , 8c reconnut que fi on l’avoit blâmé de s’y être
trop abandonné, on le condamneroit encore davantage
d’en laiffer un monument fi extraordinaire.'
Mais voyez fur le fanum de Tullia, l’abbé Montgault
dans les mém. des Belles-Lettres, 8c Middleton dans la
vie de Cicéron. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOVRT.
* F ANUS, f. m. (Mythologie.) dieu des anciens ;
c’étoit le protetteur des voyageurs, 8c la divinité de
l’année. Les Phéniciens le repréfentoient fous la figure
d’un ferpent replié fur lui-même, qui mord fa
queue.
F A O N , f. m. (Vénerie.) petit d’une biche. Voye^
Varticle CERF.
* FAPESMO, (Logique. ) un des termes dont on
fe fert pour représenter par la différente pofition de
fes voyelles la qualité des propofitions qui doivent
former une efpece déterminée de fyllogifme ; a marque
fjue que la majeure en doit être universelle affirmative
; e la mineure universelle négative, o la conclu-
fion particulière négative. Vt>ye{ l'a r tic le Syllo-
•GISME. *
F A Q U lN jf. m. (Manège.) courir ou courte le faquin
, rompre des lances, jetter des dards contre la quin-
taine ; efpece de jeu fort en ufage chez les Romains
qui y exerçoient avec foin la jeuneffe qu’ils defti-
nbîent à la guerre. Il fut du nombre de ceux que
l ’empereur Juftinien diftingua des jeux de hafard qu’il
défendit, G idtm tudere liceat quinlanam hafldfine eufi
pide, L . III. tit. x-Iiij. cod. de alcat. Suivant cette même
lo i, il paroît que Quintus en fût l’inventeur, 8c
de-là l’origine du mot quinzaine, à quodam Quinto,
ita notninatâ hdc lufus fpecie. Balfamon dans fes notes
fur le Nomocanon de Photius, a embraffé ce fen-
timent, d’ailleurs contraire à l’opinion de Pancirole,
de Ducange, 8c de Borel. Le premier,/ . var. cap.jv. i
eftime que cet exercice a tiré fon nom à quintanâ
via quoi à cafiris romanis in quintanam portam exibat:
le fécond, differt. fur Joinville , des banlieues dans
lefquelies on fe rendoit à cet effet, ces banlieues
étant appellécs quintes ou quintaines : Borel enfin
avance qu’il n’eft ainfi nommé, qu’attendu que l’on
a imité ce jeu de ceux des anciens qui avoient lieu
de cinq en cinq ans.
Quant au terme de faquin, qui dans cette circonstance
eft le fynonyme de celui de quintaine , fa fource
»’eft point obfcure. On peut y remonter, fans craindre
de prendre une conjeôure bifarre & imaginaire
pour une analogie régulière. En effet ce mot n’a été
appliqué i c i, que parce que l’on fubftitue au pal ou
au pilier, contre lequel on rompoitdes lances, un
homme fort 8c vigoureux, ou un porte-faix, en italien
facchino, armé de toutes pièces. Ce porte-faix
étoit tantôt habillé en turc, tantôt en maure ou en
farrafin ; auffi les Italiens nommerent-ils ce jeu la
courfe à l'homme armé, la courfe du farrafin , l'huomo
armato , il faraceno, ilfiafermo. A notre égard nous
l ’avons appellé la courfe du faquin ; terme qui peut à
la vérité dans le fens figuré défigner nombre de per*
fonnes, mais qui dans Ion acception naturelle figni-
fie proprement un crocheteur, un homme de la lie du
peuple.
Dans la fuite, & principalement dans les mané»
fes, on plaça, au lieu du pal 8c de l’homme, un
ufte mobile fur un pivot, tenant un bouclier de la
main gauche, & de la droite une épée, ou un fabre,
ou un bâton, ou un fac rempli de labié ou de fon. Il
s’agiffoit de lancer des dards 8c de rompre des landes
contre le bufte, qui, atteint par l’aflaillant muni
de la lance, au front, entre les yeux, dans l’oeil, fur
le nez, au menton, demeurait ferme 8c inébranlable
; mais qui frappé par-tout ailleurs, toumoit avec
une telle rapidité, que le cavalier elquivoit avec
une peine extrême le coup auquel la mobilité du
bufte, dont la main droite étoit armée, l’expofoit,
dès qu’il avoit mal ajufté : on conferve à ce bufte le
nom de faquin. Cette courfe 8c celle des bagues font
de toutes celles qui ont été pratiquées à cheval, les
plus agréables 8c les moins dangereufes. On ne peut
difeonvenir qu’il n’y ait beaucoup d’adreffe à faire
les dedans, 8c à rompre de bonne grâce ; on acquiert
dans ces fortes de jeux une grande aifance, beaucoup
de facilité, beaucoup ue liberté ; mais on ne
me perfuadera point qu’ils doivent être préférés à la
fcience du maniement des armes dont nous nous fer-
vons aujourd’hui ,8c que celle de mefurer des coups
de lance foit affez utile, pour négliger & pour abandonner
totalement la première. Voye( Ex er c ic e s .
Du refte la courfe du faquin eft déjà en quelque maniéré
délaiffée ; il n’en eft plus queftion dans nos écoles.
En ce qui concerne celle de la quintaine, nous
«dirons qu’elle a lieu encore dans quelques coutumes
Tome VU
locales , foït à l’égard des meûniers, bateliers, &cê
foit à l’égard des nouveaux mariés, qui, s’ils n’ont
point eu d’enfims dans l’année, font obligés de rom-
pre en trois coups, fous peine dVne amende, une
perche contre un pilier planté dans la riviere : le tout
en prefence du feigneur, tandis que les femmes font
tenues de préfenter au procureur du roi Un chapeau
de rofes, ou d’autres fleurs, 8c de donner à goûter
au greffier du juge. Il eft fait mention de Ce droit
dans le liv. Ï II. du recueil des arrêts du parlement de
stagne. Nous y lifons qu’un certain prieur de L i-'
v ré , foûtenant que ce droit lui appartenoit, préten-
doit en ufer dès le lendemain de pâques ; ce qui lui
fut Spécialement défendu, au moins dans le cours
de ces fêtes folennelles. (e)
FARAB, (Géogr.) petite ville d’Afie fituée fur le
bord Septentrional du Chefel, environ à i j lieues
de la mer Cafpienne. Sa longit. varie depuis 8? à 89
degrés ; fa latit. eft fixée à 3 8 degrés. (D . j . )
FARAILLON, f. m. (Marine.) c’eft un petit banc
de fable ou de roche, qui eft féparé d’un banc plus
grand par un petit canal. Ce terme n’eft guere ufité.
m
* FARAIS & HERBAGES, (Pêche.) on appelle
ferais les ficelles neuves dont on travaille les rets
pour la pêche des coraux ; 8c herbages les vieilles
ficelles qu’on tire des rets ufés, 8c qu’on remet en
étoupes pour les chevrons qui fervent à la même
pêche.
FARATELLE, f. m. (Commerce.) poids dont on fe
fert dans quelques lieux du continent des grandes
Indes. Il eft égal à deux livres de Lisbonne, où la livre
eft de 14 onces poids de marc , ce qui revient
à une livre trois quarts de Paris. Voy. L iv r e , P o id s ,
Diclionn, de Comm. de Trév. 8c de Chambers. (G) " •
FARCE, f. f. (Belles-Lettres.) efpece de comique
greffier où toutes les réglés de la bienféance, de la.
vraiffemblance, 8c du bon féns, font également violées.
L’abfurde & l’obfcene font à la farce ce que le
ridicule eft à la comédie.
Or on demande s’il eft bon que te genre de fpec-
tacle ait dans un état bien policé des théâtres réguliers
8c décens. Ceux qui protègent la farce en donnent
pour raifon, que, puifqu’on y v a , on s’y amu-
f e , que tout le monde n’eft pas en état de goûter le
bon comique, 8c qu’il faut laiffer au public le choix
de fes amufemens.
Que l’on s’amufe au fpeaacle de là farce t c’eft un
fait qu’on ne peut nier. Le peuple romain defertoit
le theatre de Térence pour courir aux bateleurs; 8c
de nos jours Mérope 8c le Méchant dans leur nouveauté
ont à peine attiré la multitude pendant deux
mois, tandis que l^ farce la plus monftrueufe a fou-
tenu fon fpeûacle pendant deux fàifons entières.
Il eft donc certain que la partie du public, dont
le goût eft invariablement décidé pour le v rai, l’utile,
8c le beau, n a fait dans tous les tems que le
très-petit nombre, 8c que la foule fe décide pour
l’extravagant 8c l’abfurde. Ainfi, loin de difputer à
h farce les fuccès dont elle jôiüt, nous ajoûterons que
dès qu’on aime ce fpe&acle, on n’aime plus que celui
là, 8c qu’il feroit auffi furprenant qu’un homme
qui fait fes délices journalières de ces groffieres ab-
lurdités, fut vivement touché des beautés du Mifan-
trope 8c d’Athalie, qu’il le feroit de voir un homme
nourri dans la débauche fe plaire à la fociété d’une
femme vertueufe.
On v a , dit-on, fe délafferà la farce ; wn fpe&acle
raifonnable applique 8c fatigue l’efprit ; Izfarce amù-
f e , fait rire, 8c n’occupe çoint. Nous avoüons qu’il
eft des efprits, qu’une chaîne régulière d’idées & de
fentimens doit fatiguer. L’efprit a fon libertinage 8c
fon dçfordre où il eft plus à ion aife ; 8c le plaifir ma*
F f f