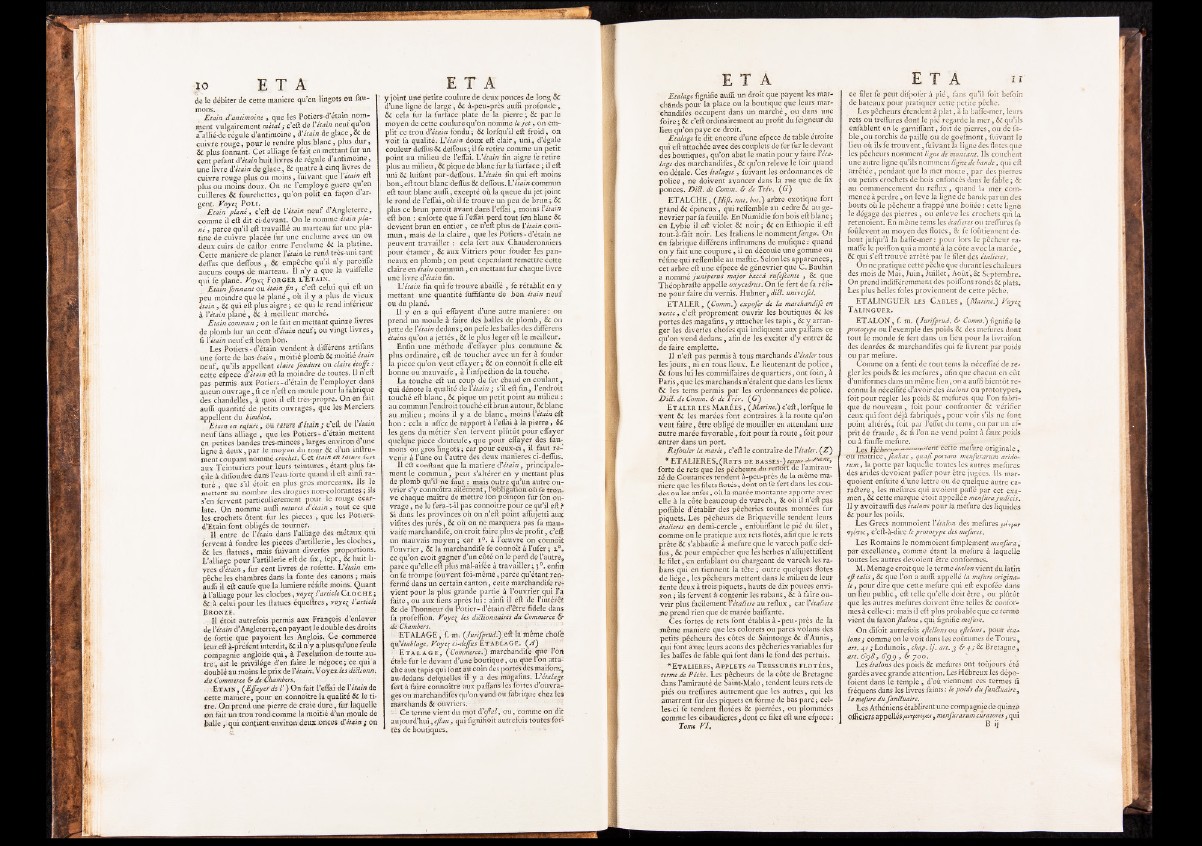
de le débiter de cette maniéré qu’en lingots ou fau-
Etain d'antimoine , que les Potiers-d etam nomment
vulgairement métal; c’eft de Yetain neuf qu on
a~allié-de régule d’antimoine, d'étain de glace, & de
cuivre rouge, pour le rendre plus blanc, plus dur,
St çenptl upse ffaonntn dant. Cet alliage fe fait en mettant fur un une livre 'étain huit livres de régule d’antimoine, à?étain de glace, St quatre à cinq livres de
cpuluivs roeu r omuogien sp dluosu oxu. Omno innes ,l 'feumivpalnoty eq ugeu è1 reet aqinu eefnt
cuillères St fourchettes, qu’on polit en façon d argent.
Voyc{ Poli. Etain plané, c’eft de Yétain neuf d’Angleterre,
comme il eft dit ci-devant. On le nomme uain plané
, parce qu’il eft travaillé au marteau fur une platine
de cuivre placée fur une enclume avec un ou
deux cuirs de caftor entre renclume St la platine.
Cette maniéré de planer l'étain le rend tres-uni t?nt
deffus que deffous , St empêche qu’il n’y paroiffe
aucuns coups de marteau. Il n’y a que la vaiffelle
qui fe plane. Vqye^ Forger l’Étain. ^ _
Etain fonnant ou étain fin , c’ eft celui qui eft un
peu moindre que le plané, où il y a plus de vieux
étain , St qui eft plus aigre ; ce qui le rend inferieur
à Y étain plané, St à meilleur marché.
Etain commun ; on le fait en mettant quinze livres
de plomb fur un cent d’étain neuf; ou vingt livres,
fi l'étain neuf eft bien bon.
Les Potiers - d’étain vendent à différens artifans
une forte de bas -étain, moitié plomb St moitié etain
neuf, qu’ils appellent claire foudure ou claire étoffé :
cette efpece à!étain eft la moindre de toutes. Il n eft
pas permis aux Potiers-d’étain de l’employer dans
aucun ouvrage, fl ce n’eft en moitié pour la fabrique
des chandelles, à quoi il eft très-propre. On en fait
auffi quantité de petits ouvrages, que les Merciers
appellent du bimblot.
Etain en ramure, ou rature Pétain ; c’eft de V etain
neuf fans alliage , que les Potiers - d’étain mettent
en petites bandes très-minces, larges environ d’une
ligne à deux, par le moyen .du tour St d’un infiniment
coupant nommé crochet. Cet etain en rature Ici-t
aux Teinturiers pour, leurs teintures, étant plus facile
à diffoudre dans l’eau-forte quand il eft ainfi raturé
, que s’il étoit en plus gros morceaux. Ils le
mettent au nombre des drogues non-colorantes ; ils
s’en fervent particulièrement pour le rouge écarlate.
On nomme aufli ratures d?etain, tout ce que
les crochets ôtent fur les pièces , que les Potiersr
d’Etain font obligés de tourner. .
Il entre de Y étain dans l’alliage des métaux qui
fervent à fondre les pièces d’artillerie, les cloches,
& les ftatues, mais fuivant diverfes proportions.
L’ailiage pour l’artillerie eft de fix, fept, St huit li-
yres d'étain, fur cent livres de rofette. L’étain empêche
les chambres dans la fonte des canons ; mais
aufti il eft caufe que la lumière réfifte moins. Quant
à l’aftiage pour les cloches, voyei Çarticle Cloche ;
à celui pour les ftatues équeftres, voyei l'article Bronze.
Il étoit autrefois permis aux François d’enlever
de Y étain d’Angleterre, en payant le double des droits
de fortie que payoient les. Anglois. Ce commerce
leureft à-prëfent interdit, St il n’y a plus qu’une feule
compagnie angloife qui, à Texdufion.detoute autre
§ ait le privilège d’en faire le négoce ; ce qui a
doublé au moins le prix de Y étain. Voyez les dicHonm
du Commerce 6* de.Chàmbers.
. . - Etain , (Effayer de V ) On fait Teffai de Y étain de
cette, maniéré, pour en connoître la qualité St le titre.
,Qm prend une pierre de craie dure, fur. laquelle
©n fâit iun trou rond comme la moitié d’un moule de
b a lle , qui contient environ.deux onces d'étain i on
y joint une petite coulure de deux pouces de long 8c
d’une ligne de large, St à-peu-près aufli profonde,
St cela lur la furface plate de la pierre ; St par le
moyen de cette coulure qu’on nomme le j e t , on emplit
ce trou ù? étain fondu ; St lorfqu’il eft froid, on
voit fa qualité; L'étain doux eft clair, uni, d’égale
couleur deffus St deffous ; il fe retire comme un petit
point au milieu de l’effai. L'étain fin aigre fe retire
plus au milieu, St pique de blanc fur la furface ; il eft
uni St luifant par-deffous. L'étain fin qui eft moins
bon, eft tout blanc deffus St deffous. Vétain commun
eft tout blanc aufti, excepté où la queue du jet joint
le rond de l’effai, où il fe trouve un peu de brun ; St
plus ce brun paroît avant dans l’effa i, moins Y étain
eft bon : enforte que fi l’effai perd tout fan blanc St
devient brun en entier, ce n’eft plus de Y étain commun
, mais de la claire, que les Potiers - d’étain ne
peuvent travailler : cela fert aux Chauderonniers
pour étamer, St aux Vitriers pour fouder les panneaux
en plomb ; on peut cependant remettre cette
claire en étain commun, en mettant fur chaque livre
une livre d’étain fin.
L'étain fin qui fe trouve abaiffé , fe rétablit en y
mettant une quantité fuffifante de bon étain neuf
ou du plané.
Il y en a qui effayent d’une autre maniéré: on
prend un moule à faire des balles de plomb, St on
jette de Y étain dedans ; on pefe les balles des différens
étains qu’on a jettés, St le plus leger eft le meilleur.
Enfin une méthode d’effayer plus commune St
plus ordinaire, eft de toucher avec un fer à fouder
la piece qu’on veut effayer ; St on connoît fi elle eft
bonne ou mauvaife, à l’infpeélion de la touche.
La touche eft un coup de fer chaud en coulant,
qui dénote la qualité de Y étain ; s’il eft fin, l’endroit
touché eft blanc, St pique un petit point au milieu :
au commun l’endroit touché eft brun autour, St blanc
au .milieu ; moins il y a de blanc, moins l'étain eft
bon : cela a affez de rapport à Teflài à la pierre > St
les gens du métier s’en fervent plutôt pour effayer
i quelque piece douteufe, que pour effayer des fau-
; mons ou gros lingots ; car pour ceiix-ci, il faut revenir
à l’une ou rautre des deux maniérés ci-deffus.
Il eft confiant que la matière d'étain, principale-
: ment le commun, peut s’altérer en y mettant plus
: de plomb qu’ il ne faut : mais outre qu’un autre ouvrier
s’y connoitra aifément, l'obligation où fe trouv
e chaque maître de mettre fon poinçon fur fôn ouvrage
, ne le fera-t-il pas connoître pour ce qu’il eft ï
Si dans les provinces où on n’eft point affujetti aux
vifiteS des jurés, & où on ne marquera pas fa mauvaife
marchandife, on croit faire plus de profit, c’eft
un mauvais moyen; car i° . à l’oeuvre on connoît
| l’ouvrier, St la marchandife fe connoît à l’ufer ; z°.
ce qu’on croit gagner-d’un côté on le perd de l’autre,
parce qu’elle eft plus mal-aifée à travailler ; 3 °. enfin
on fie trompe foiivent foi-même, parce qu’étant renfermé
dans un Certain canton, cette marchandife rei
vient pour la plus grande partie à l’ouvrier qui l’a
: faite, ou aux fiens après lui : ainfi il eft dé l’intérêt
& de l’honneur du Potier-d’étain d’être fidele dans
fa profeflion. Voye^ les dictionnaires du Commerce <S*
de Chambers.
• ETALAGE, f. m. (Jurifprud.) eft la même chofç
qu'établage, Voyeç ci-deffus Et a BLaGÉ'. (f4)
E t a l a g e , ( Commerce.) marchandife que Ton
étale fur le devant d’une boutique, oit qüe Ton attache
aux tapis qui font àû coin des portés dès maifonsj
ait-dedans def quelles il y a des magafins. L'étalage
fert à faire connoître aux paffafls les fortes d’ouvrages
ou'mafehandifes qu’on vend ou fabrique chez les
marchands & ouvriers. - - r
Ge terme vient du mot d'ejlal, ou, comme on dit
aujourd’hui, efiau, qui fignihoit autrefois toutes for*
tes de boutiques.
Etalage lignifie aufli un droit que payent les marchands
pour la place ou la boutique que leurs mar-
chandifes occupent dans un marché, ou dans une
foire ; St c’eft ordinairement au profit du feigneur du
lieu qu’on paye ce droit.
Etalage fe dit encore d’une efpece de table étroite
qui' eft attachée avec des couplets de fer fur le devant
des boutiques, qu’on abat le matin pour y faire Y étalagé
des marchandifes, St qu’on releve le foir quand
on détale. Ces étalages, fuivant les ordonnances de
po lice, ne doivent avancer dans la rue que de fix
pouces. Dict. de Comm. & de Trév. (G)
ETALCHE, (Hifl. nat. bot.) arbre exotique fort
grand St épineux, qui reflemble au cedre St au genévrier
par fa feuille. En Numidie fon bois eft blanc ;
en Lybie il eft violet & noir ; St en Ethiopie il eft
îout-à-fait noir. Les Italiens le nommentfangu. On
en fabrique différens inftrumens de mufique : quand
on y fait une coupure, il en découle une gomme ou
réfine qui reflemble au maftic. Selon les apparences,
cet arbre eft une efpece de génevrier que C. Bauhin
a nommé juniper us major baccâ rufefeente , St que
Théophrafte appelle oxycedrus. On fe fert de fa réfine
pour faire du vernis. Hubner, dict. univerfel.
E TA LER, (Comm.) expofer de la marchandife en
y ente, c’eft proprement ouvrir les boutiques St les
portes des magafins, y attacher les tapis, & y arranger
les diverfes chofes qui indiquent aux paffans ce
qu’on vend dedans, afin de les exciter d’y entrer St
de faire emplette.
Il n’eft pas permis à tous marchands d’étaler tous
les jours, ni en tous lieux. Le lieutenant de police,
St fous lui les commiffaires de quartiers, ont foin, à
Paris, que les marchands n’étalent que dans les lieux
St les tems permis par les ordonnances de police.
Dict. de Comm. & de Trév. (G) Etaler les Marées , (Marine.) c’eft,lorfque le
vent & les marées font contraires à la route qu’on
veut faire, être obligé de mouiller en attendant une
autre marée favorable, foit pour fa route, foit pour
entrer dans un port.
Refouler la marée, c’eft le contraire de Y étaler. (Z )
* ETALIERES, (Rets de basses-) t e r m ^ ^ ^
forte de rets que les pêcheurs du rcïîbft ae 1 amirauté
de Coutances tendent à-peu-près de la meme maniéré
que les filets flotés, dont on fe fert dans les coudes
ou les anfes, où la marée montante apporte avec
elle à la côte beaucoup de varech, & où il n’éft pas
poflible d’établir des pêcheries toutes montées fur
piquets. Les pêcheurs de Briqueville tendent leurs
étalieres en demi-cercle , enfoiiiffant le pié du filet,
comme on le pratique aux rets flotés, afin'que le rets
prête & s’abbaiffe à mefure que le varech paffe deffus
, St pour empêcher que les herbes n’affujettiffent
le filet, en enfablant ou chargeant de varech les ra-
bans qui en tiennent la tête ; outre quelques flotés
de liège, les pêcheurs mettent dans le milieu de leur
tente deux à trois piquets, hauts de dix pouces environ
; ils fervent à contenir les rabans, St à faire ouvrir
plus facilement r étaliere au reflux, car Yétaliere
ne prend rien que de marée baillante.
Ces fortes de rets font établis à -peu-près de la
même maniéré que les colorets ou parcs volans des
petits pêcheurs des côtes de Saintonge St d’Aunis,
qui font avec leurs acons des pêcheries variables fur
les baffes de fable qui font dans le fond des pertuis.
* Etalieres, Applets omTressures flotées,
terme de Pêche. Les pêcheurs de la côte de Bretagne
dans l’amirauté de Saint-Malo, tendent leurs rets de
piés ou treffures autrement que les autres, qui les
amarrent fur des piquets en forme de bas parc; celles
ci fe tendent flotées St pierrées, ou plommées
comme les cibaudieres, dont ce filet eft une efpece :
Tome VI,
ce filet fe peut difpofer à pié, fans qu’il foit befoin
de bateaux pour pratiquer cette petite pêche.
Les pêcheurs étendent à plat, à la baffe-mer, leurs
rets ou treffures dont le pie regarde la mer, St qu’ils
enfablent en le garniffant, foit de pierres, ou de fable
, ou torchis de paille ou de goefmont, fuivant le
lieu où ils fe trouvent, fuivant Ta ligne des flotés que
les pêcheurs nomment ligne de montant. Ils couchent
une autre ligne qu’ils nomment ligne de bande, qui eft
arrêtée, pendant que la mer monte, par des pierres
ou petits crochets de bois enfoncés dans le fable ; &
au commencement du reflux, quand la mer commence
à perdre , on leve la ligne de bande par un des
bouts où le pêcheur a frappé une boiiée : cette ligné
le dégage des pierres , ou enieve les crochets qui la
retenoient. En même tems les étalieres ou treffures fe
foûlevent au moyen des flotés, & fe foutiennent debout
jufqu’à la baffe-mer : pour lors le pêcheur ra-
maffe le poiffon qui a monté à la côte avec la marée ,
St qui s’eft trouvé arrêté par le filet des étalieres.
On ne pratique cette pêche que durant les chaleurs
des mois de Mai, Juin, Juillet, Août’, 8c Septembre*
On prend indifféremment des poiffons ronds 8c plats.
Les plus belles foies proviennent de cette pêche.
ETALINGUER les Cables , (Marine.') Voye^ Talinguer.
ETALON , f. m. (Jurifprud. & Comm?) lignifie le
prototype ou l’exemple des poids St des mefures dont
tout le monde fe fert dans un lieu pour la livraifon
des denrées St marchandifes qui fe livrent par poids
ou par mefure.
Comme on a fenti de tout tems la néceflité de régler
les poids St les mefures, afin que chacun en eut
d’uniformes dans un même lieu, on a auffi bientôt reconnu
la néceflité d’avoir des étalons ou prototypes,
foit pour regler les poids St mefures que Ton fabrique
de nouveau, foit pour confronter St vérifier
ceux qui font déjà fabriqués, pour voir s’ils ne font
point altérés, foit par l’effet du tems, ou par un ef-
prit de fraude, St fi Ton ne vend point à faux poids
ou à fauffe mefure.
Les Hébr#” --“ cette mefure originale,
"Ou màtrice, fcahac , quafi portant menfurarum arido-
rum, la porte par laquelle toutes les autres mefures
des arides dévoient paffer pour être jugées. Ils mar-
quoient enfuite d’une lettre ou de quelque autre ca-
radere, les meiiires qui avoient paffé par cet examen
, St cette marque étoit appellee menfura judicis.
Il y avoit auffi des étalons pour la mefure des liquides
St pour les poids..
Les Grecs nommoient Y étalon des mefures
Tpévoç, c’eft-à-dire le prototype des mefures.
Les Romains le nommoient Amplement menfura,
par excellence, comme étant la mefure à laquelle
toutes les autres dévoient être conformes.
M. Ménagé croit que le terme étalon vient du latin
eft talis y St que Ton a auffi appellé la mefure originale
y pour dire que cette mefure qui eft expofée dans
un lieu public, eft telle qu’elle doit ê tre, ou plfttôt
que les autres mefures doivent être telles St conformes
à celle-ci: mais il eft plus probable que ce terme
vient du faxon jlaloney qui fignifie mefure.
On difoit autrefois efiellons ou ejlelonsy pour étalons
; comme on le voit dans les coutumes de T ours ,
art. 41 ; Lodunois, chap. ij. art. 3 & 4 ; St Bretagne,
art. 6ÿ8, 6g9 , & y 00. )
Les étalons des poids St mefures ont toujours été
gardés avec grande attention. Les Hebreux les depo-
foient dans le temple , d’où viennent ces termes fi
fréquens dans les livres faints: le poids du fancluaire,
la mefure du fancluaire.
Les Athéniens établirentune compagnie de quinze
officiers appellesptTpovopu , menfurarum curatores , qui
B ij