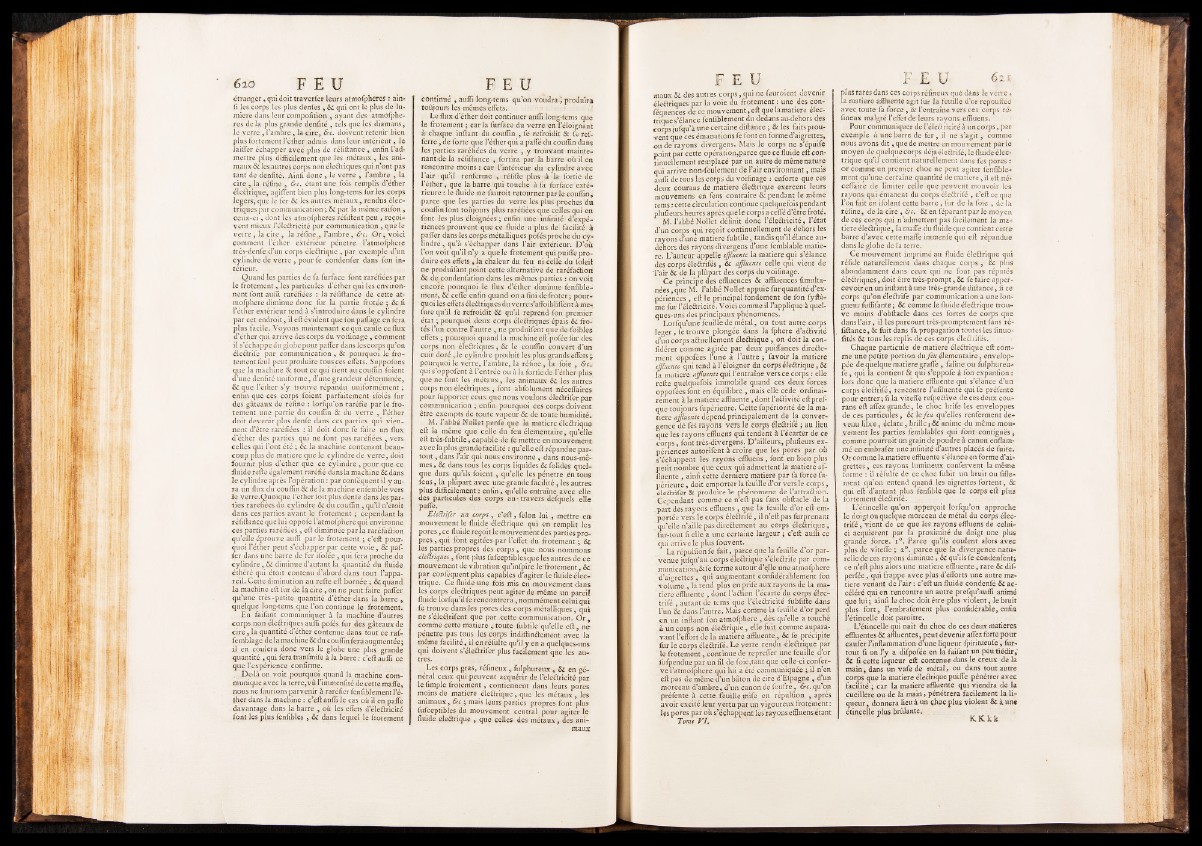
étranger, qui doit traverfer leurs atmofpheres : ain-
li les corps les plus denfes , & qui ont le plus de lumière
dans leur compofition , ayant des atmofpheres
delà plus grande denfité , tels que les diamans,
le verre , l’ambre, la cire, &c. doivent retenir bien
plus fortement l’éther admis dans leur intérieur, le
laiffer échapper avec plus de réfiftance ,, enfin l’admettre
plus difficilement que les métaux, les animaux
&: les autres corps non électriques qui n’ont pas
tant de denfité., Ainfi donc , le verre , l’ambre , la
cire , la réfine , &c. étant une fois remplis d’éther
éleCtrique, agiffent bien plus long-tems furies corps
légers", que le fer & les autres métaux, rendus.électriques
par communication ; & par la même raifon ,
ceux-ci, dont les atmofpheres réfiftent peu , reçoivent
mieux l’éleCtricité par communication , que le
verre, la cire , la réfine4, l’ambre, &c. Or-,.voici
comment l’éther extérieur pénétré l’atmofphere
très-denfe d’un corps éleCtrique , par exemple d’un
cylindre de verre , pour fe condenfer dans fon intérieur.
Quand les parties de fa furface font raréfiées par
le frotement, les particules d’éther qui les environnent
font auffi raréfiées : la réfiftance de cette at-
mofphere diminue donc fur la partie frotée ; 8c ,fi
l’éther extérieur tend à s’introduire dans le cylindre
par cet endroit, il eft évident que fon paffage en fera
plus facile. Voyons maintenant ce qui caufe ce flux
d’ éther qui arrive des corps du voifinage , comment
il s’échappe du globe pour paffer dans les corps qu’on
éle&rife par communication , & pourquoi le frôlement
feul peut produire tous ces effets. Suppofons
que la machine & tout ce qui tient au couffin foient
d’une denfité uniforme, d’une grandeur déterminée,
8c que l’éther s’y trouve répandu uniformément ;
enfin que ces corps foient parfaitement ifolés fur
des gâteaux de réfine : lorfqu’on raréfie par le frotement
une partie du couffin & du verre , l’éther
doit devenir plus denfe dans ces parties qui viennent
d’être raréfiées : il doit donc.fe faire un flux
d’éther des parties qui ne font pas raréfiées , vers
celles qui l’ont été ; 8c la machine contenant beaucoup
plus de matière que le cylindre de verre, doit
fournir, plus d’éther que ce cylindre , pour que ce
fluide refte également raréfié dans la machine 8c dans
le cylindre après l’opération : par conféquent il y aura
un flux du couffin 8c de la machine enfemble vers
le verre.Quoique l’éther foit plus denfe dans les parties
raréfiées du cylindre 8c du couffin, qu’il n’étoit
dans ces parties avant le frotement ; cependant la
réfiftance que lui oppofe l ’atmofphere qui environne
ces parties raréfiées , eft diminuée parla raréfaâion
qu’elle éprouve auffi par le frotement ; c’eft pourquoi
l’éther peut s’échapper par cette v o ie , & paf-
fer dans une barre de fer ifolee , qui fera proche du
cylindre, 8c diminue d’autant la quantité du fluide
éthéré qui étoit contenu d’abord dans tout l’appareil.
Cette diminution au refte.eft bornée ; 8c quand
la machine eft fur de la cire , on ne peut faire paffer
qu’une très-petite quantité d’éther dans la barre ,
quelque long-tems que l’on continue le frotement.
En faifant communiquer à la machine d’autres
corps non éleftriques auffi pofés fur des gâteaux de
c ire , la quantité d’éther contenue dans tout ce raf-
femblage de la machine & du couffin fera augmentée;
il en coulera donc vers le globe une plus grande
quantité , qui fera tranfmife à la barre : c’eft auffi ce
que l’expérience confirme.
. De-là on voit pourquoi quand la machine communique
avec la terre,vû l’immenfité de cette maffe,
nous ne faurions parvenir à raréfier fenfiblement l’éther
dans la machine : c’eft auffi le cas où il en paffe
davantage dans la barre , où les effets d’éleûricité
font les plus fenfibles , 8c dans lequel le frotement
continué , auffi long-tems qu’on voudra > produira
toujours les mêmes effets.
Le flux d’éther doit continuer auffi long-tems que
le frotement ; car la fùrfâce du verre en l’éloignant
à chaque inftant du couffin , fe refroidit & feref-
ferre, de forte que l’éther qui a paffé du couffin dans
les parties raréfiées du verre , .y trouvant maintenant
;de la réfiftance ,. fortira par la barre où il en
rencontre moins : car l’intérieur du cylindre avec
1 air qu’il renferme ,!.réfifte plus ;à fortie de
l’éther, que la. barre iqui touche, à fa furface extérieure
: le fluide ne fauroit retourner parle couffin,
parce que les parties du verre les plus, proches du
couffin l’ont toûjours plus raréfiées que celles qui en
font les plus éloignées ; enfin une infinité d’expériences
prouvent que ce fluide a plus de: facilité à
paffer dans les corps métalliques pofés proche du cylindre,
qu’à s’échapper dans l’air extérieur. D ’où
l’on voit qu’il n’y a que le frotement qui puiffe produire
ces effets , :la chaleur du feu ni celle du foleil
ne produifant point cette alternative de raréfaâion
8c de.condenfation dans les mêmes parties : on voit
encore pourquoi le flux d’éther diminue fenfiblement,
8c celle enfin quand on a fini defroter ; pourquoi
les effets éleÛriques du verre s’àffoibliffent à me-*
fure qu’il fe refroidit 8c qu’il reprend fon premier
état ; pourquoi deux corps éleélriques: épais 8c fro-
tés l’un contre l’autre , ne produifent que de foibles
effets ; pourquoi quand la machine eft pofée fur des
corps non éle&riques, ■ & le couffin couvert d’un
cuir doré ,1e cylindre produit lès plus grands effets y
pourquoi le verre, l’ambre, la réfine -, la foie , &c.
qui s’oppofent à l’entrée ou à la fortie de l’éther plus
que ne font les métaux, les animaux & les autres
corps non éle&riques , font abfolument néceffaires
pour fupporter ceux que nous vouions éleûrifer par
communication ; enfin pourquoi ces corps doivent
être exempts de toute vapeur 8c de toute humidité.
M. l’abbé Nollet penfe.que la matière éleârique
eft la même que celle du feu élémentaire, qu’elle
eft très-fubtile, capable de fe mettre en mouvement
avec la plus grande facilité : qu’elle eft répandue partout
, dans l’air qui nous environne , dans nous-mêmes
, 8c dans tous les corps liquides 8c folides quelque
durs qu’ils foient , qu’elle les pénétré ën tous
. fens, la plupart avec une grande facilité, les autres
plus difficilement : enfin, qu’elle entraîne avec elle
des particules des corps au-travers defquels elle
paffe.
Eleclrifer un corps, c’e ft , félon lui , mettre en
mouvement le fluide éleftrique qui en remplit les
pores, ce fluide reçoit le mou vement des parties propres.,
qui font agitées par l’effet du frotement ; 8c
les parties propres dès corps , que nous nommons
électriques, font plus fufceptibles que les autres de ce
mouvement de vibration qu’infpire le'ftotement, 8c
par conféquent plus capables d’agiter le fluide électrique.
Ge fluide une fois mis en mouvement dans
les corps électriques peut agiter de même un pareil
fluide lorfqu’il fe rencontrera, nommément celui qui
fe trouve dans les pores des corps métalliques, qui
ne s’éleCtrifent que par Cette communication. O r ,
comme cette matière , toute fubtile qu’eUe e ft , ne
pénétré pas tous les eprps indiftinftement avec la
meme facilité, il enréfulte qu’il y en a quelques-uns
qui doivent s’éleCtrifer plus facilement que les autres.
Les corps gras, réfineux, fulphureux, 8c en général
ceux qui peuvent acquérir de l’eleCtricité par
le fimple frotement, contiennent dans leurs pores
moins de matière éleCtrique, que les métaux, les
animaux, &c ; mais leurs parties propres font plus
fufceptibles du mouvement central pour agiter le
fluide eleCtrique , que celles des métaux, des animaux
maux 8c des autres corps, qui ne fauroient devenir
électriques par la voie du frotement i une des con-
féquences de ce mouvement, eft que la matière électrique
s’élance fenfiblement du dedans au-dehors des
corps jufqu’à une certaine diftance ; & les faits prouvent
que ces émanations fe font en forme d’aigrettes,
ou de rayons divergens. Mais le corps ne s’épuife
point par cette opération,parce que ce fluide eft continuellement
remplacé par un autre de même nature
qui arrive non-feulement de l’air environnant, mais
auffi de tous les corps du voifinage : enforte que ces
deux courans de matière éleCtrique exercent leurs
mouvemens en fens contraire 8c pendant le même
tems : cette circulation continue quelquefois pendant
plufieurs heures après que le corps a ceffé d’être froté.
M. l’abbé Nollet définit donc l’éleCtricité, l’état
d’un corps qui reçoit continuellement de dehors les
rayons d’une matière fubtile, tandis qu’il élance au-
dehors des rayons divergens d’une femblable matière.
L’auteur appelle effluente la matière qui s’élance
des corps éleôrifés , 8c affluente celle qui vient de
'l’àir 8c de la plûpart des corps du voifinage.
Ce principe des effluences & affluences fimulta-
nées, que M. l’abbé Nollet appuie fur quantité d’expériences
, eft le principal fondement de fon fyftè-
me fur l’éleûricite. Voici comme il l’applique à quelques
uns des principaux phénomènes.
Lorfqu’une feuille de métal, ou tout autre corps
léger, fe trouve plongée dans la fphere d’aCtivité
d’un corps aûuellement éle&rique, on doit la con-
fidérer comme agitée par deux puiffances dirette-
ment oppofées l’une à l’autre ; favoir la matière
effluente qui tend à l’éloigner du corps éleârique, 8c
la matière affluente qui l’entraîne vers ce corps : elle
refte quelquefois immobile quand ces deux forces
oppofées font en équilibre , mais elle cede ordinairement
à la matière affluente, dont l’a&ivité eftpref-
que toujours fupérieure. Cette fupériorité de la matière
affluente dépend principalement de la convergence
de fes rayons vers le corps éleftrifé ; au lieu
que les rayons effluens qui tendent à l’écarter de ce
corps, font très-divergens. D ’ailleurs, plufieurs expériences
autorifent à croire que les pores par où
s’échappent les rayons effluens , font en bien plus
petit nombre que ceux qui admettent la matière affluente
, ainfi cette dermere matière par fa force fupérieure
, doit emporter la feuille d’or vers le corps,
éleftrifer & produire le phénomène de l’attra&ion.
Cependant comme ce n’eft pas fans obftacle de la
. part des rayons effluens , que la feuille d’or eft emportée
vers le corps élettrifé, il n’eft pas furprenant
qu’elle n’aille pas direûement au corps éle&rique,
fur-tout fi elle a une certaine largeur ; c’eft auffi ce
qui arrive le plus fouvent.
La répulfionfe fait, parce que la feuille d’or parvenue
jufqu’au corps éleûrique s’éle&rife par communication,&
fe forme autour d’elle une atmofphere
d’aigrettes , qui augmentant confidérablement fon
volume , la rend plus en prife aux rayons de la matière
effluente , dont l ’a&ion l’écarte du corps élec-
trifé , autant de tems que l’éleclricité fubfifte dans
l’un 8c dans l’autre. Mais comme la feuille d’or perd
en un inftant fon atmofphere , dès qu’elle a touché
à un corps non éle&rique, elle- fuit comme auparavant
l’effort de la matière affluente, & fe précipite
fur le corps éle&rifé. Le verre rendu é le étriqué par
le frotement, continue de repreffer une feuille d’or
fufpendue par un fil de foie,tant que celle-ci çonfer-
v e l’atmofphere qui lui a été communiquée,; il n’en
eft pas de même d’un bâton de cire d’Efpagne , d’un
morceau d’ambre, d’un canon dé foufre, &c. qu’on
préfente à cette feuille pfife en répulfion , après
avoir excité leur vertu par un vigoureux frotement :
les pores par où s’échappent les rayons effluens étant
Tome VI,
plus rares dans ces corps réfineux quê dans le v erre,
la matière affluente agit fur la feuille d’or repoufféè
avec toute fa force , & l’entraîne vers ces corps ré4
fineux malgré l’effet de leurs rayons effluens.
Pour communiquer de l’éleftricité à un corps, par
exemple à une barre de fe r , il ne s’agit > comme
nous avons d it , que de mettre en mouvement parlé
moyen de quelque corps déjaéle&rifé, le fluide électrique
qu’if contient naturellement dans fes pores :
or comme un premier choc ne peut agiter fenfiblement
qu’une certaine quantité de matière, il eft né*
ceffaire de limiter celle que peuvent mouvoir les
rayons/qui émanent du corps électrifé , c’eft ce que
l’on fait en ifolant cette barre, fur de la foie , de la
réfine, de la cire , &c. 8c en féparant par le moyen
de ces corps qui n’admettent pas facilement la matière
éleétrique, la maffe du fluide que contient cette
barre d’avec cette maffe immenfe qui eft répandue
dans le globe de la terre.
Ce mouvement imprimé au fluide éleétrique qui
réfide naturellement dans chaque corps , 8c plus
abondamment dans ceux qui ne font pas réputés
électriques, doit être très-prompt, 8c fe faire apper-
cevoiren un inftant à une très-grande diftance, fi ce
corps qu’on éleétrife par communication a une longueur
(uffifante ; 8c comme le fluide éleétrique trouv
e moins d’obftacle dans ces fortes de corps que
dans l’air, il les parcourt très-promptement fans réfiftance,
& fuit dans fa propagation toutes les finuo-
fités 8c tous les replis de ces corps éleétrifés.
Chaque particule de matière éleétrique eft comme
une petite portion du feu élémentaire, enveloppée
de quelque matière graffe , faline ou fulphureu-
fe , qui la contient & qui s’oppofe à fon expanfion :
lors donc que la matière effluente qui s’élance d’un
corps éleétrifé, rencontre l’affluente qui fe préfente
pour entrer ; fi la vîteffe refpeétive de ces deux courans
eft affez grande, le choc brife les enveloppes
de ces particules, 8c le feu qu’elles renferment devenu
libre, éclate, brille, 8c anime du même mouvement
les parties femblables qui font contiguës,
comme pourroit un grain de poudre à canon enflammé
en embrafer une infinité d’autres placés de fuite.
Or comme la matière effluente s’élance en forme d’aigrettes
, ces rayons lumineux confervent la même
forme : il réfulte de ce choc fubit un bruit ou fifle-
ment qu’on entend quand les aigrettes fortent, &
nui eft d’autant plus lënfible que le corps eft plus
fortement éleétrifé.
L’étincelle qu’on apperçoit lorfqu’on approche
le doigt ou quelque morceau de métal du corps élec-
trifé, vient de ce que les rayons effluens de celui-
ci acquièrent par la proximité du doigt une plus
grande force. i° . Parce qu’ils coulent alors avec
plus de vîteffe ; z°. parce que la divergence naturelle
de ces rayons diminue, 8c qu’ils fe condenfent;
ce n’eft plus alors une matière effluente * rare 8c dit-
perfée, qui frappe avec plus d’efforts une autre matière
venant de l’air : c’eft un fluide condenfé 8c accéléré
qui en rencontre un autre prefqu’auffi animé
que lui ; ainfi le choc doit être plus violent, le bruit
plus fort, l’embrafement plus confidérable, enfin
l’étincelle doit paroître.
L’étincelle qui naît du choc de ces deux matières
effluentes 8c affluentes, peut devenir affez forte pour
caufer l’inflammation d’une liqueur fpiritueufe, fur-
tout fi on l’y a difpofée en la faifant un peu tiédir,"
8c fi cette liqueur eft contenue dans le creux de la
main, dans un vafe de métal, ou dans tout autre
corps que la matière éle&rique puiffe pénétrer avec
facilité ; car la matière affluente qui viendra de la
cueillere ou de la main, pénétrera facilement la liqueur,
donnera lieu à un çhoc plus violent 8c à une
etinçelle plus brûlante,
* K K k k