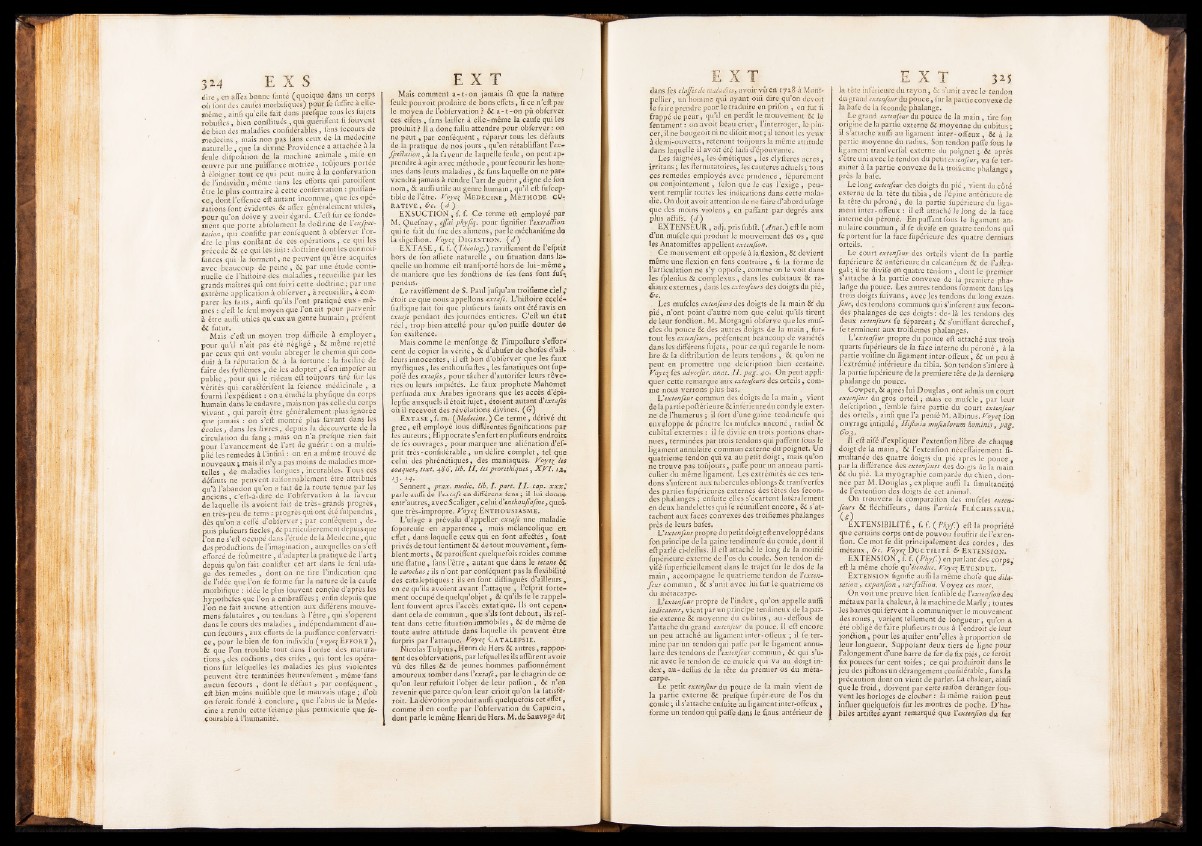
dire, en allez bonne fanté (quoique dans un corps
où l'ont des caules morbifiques) pour fe liiffire à elle-
même , ainfi qu’elle fait dans prefque tous les fujets
robuftes, bien conftitués , qui gueriffent li foUvent
de bien des maladies cOnfidérables, fans fecours de
médecins , mais non pas fans ceux de la medecine
naturelle , que la divine Providence a attachée a la
feule difpoution de la machine animale , mile en
oeuvre par une puiffance motrice, toujours portée
à éloigner tout ce qui peut nuire à la confervation
de l’individu, même dans les efforts qui paroiffent
être le plus contraire à cette confervation : puiffanc
e , dont l’effence eft autant inconnue, que les operations
font évidentes & affez generalement utiles,
pour qu’on doive y avoir égard. C ’eft fur ce fondement
que porte abfolument la doélnne de 1 exfpec-
tation, qui confifte par conféquent à obferver l’ordre
le plus confiant de ces opérations, ce qui les
précédé & ce qui les fuit : do&rine dont les connoif-
fances qui la forment, ne peuvent qu’être acquifes
avec beaucoup de peine , & par une etude continuelle
de l ’hifioire des maladies, recueillie par les
grands maîtres qui ont fuivi cette doûrine ; par une
extrême application à obferver, a recueillir, à conv
parer les faits, ainfi qu’ils l’ont pratiqué eux - mêmes
: c’eft le feu! moyen que l’on ait pour parvenir
à être aufîi utiles qu’eux au genre humain, prefent
& futur. •
Mais c’eft un moyen trop difficile à employer,
pour qu’il n’ait pas été négligé , & même rejetté
par ceux qui ont voulu abréger le chemin qui conduit
à la réputation & à la fortune : la facilité de
faire des fyftèmes , de les adopter, d’en impofer au
public , pour qui le rideau eft toujours tire fur les
vérités qui cara&érifent la fcience médicinale , a
fourni l’expédient : on a étudié la phyfique du corps
humain dans le cadavre, mais non pas celle du cor^s
vivant , qui paroît être généralement .plus ignorée
que jamais : on s’eft montré plus favant dans les
écoles, dans les livres, depuis la découverte de la
circulation du fang ; mais on n’a prefque rien fait
pour l’avancement de. l’art de guérir^; on a multiplié
les remedes à l’infini : on en a même trouvé de
nouveaux j mais il n’y a pas moins de maladies mortelles
de maladies longues, incurables. Tous ces
défauts ne peuvent raifonnablement être attribués
qu’à l’abandon qu’on a fait de la route tenue par les
anciens, c’eft-à-dire de l’obfervation à la faveur
de laquelle ils avoient fait de très-r grands progrès,
en très-peu de tems : progrès qui ont été fufpendus,
dès qu’on a ceffé d’obferver ; par conféquent , depuis
plufieurs fiecles, & particulièrement depuis que
l ’on ne s’eft occupé dans l’étude de la Medecine, que
des productions de l’imagination, auxquelles on s’eft
efforcé de foumettre , d’adapter la pratique de l’art ;
depuis qu’on fait eonfifter cet art dans le feul ufa-
ge des remedes , dont on ne tire l’indication que
de l’idée que l’on fe forme fur la nature de la caufe
morbifique : idée le plus fouvent conçue d’après les
hypothèfes que l’on a embraffées ; enfin depuis que
l’on ne fait aucune attention aux différens mouve-
mens falutaires , où tendans à l’être, qui s’opèrent
dans le cours des maladies, indépendamment d’aucun
fecours, aux efforts de la puiffance confervatri-
c e , pour le bien de fon individu Ef f o r t ) ,
& que l’on trouble tout dans l’ordre des maturations
, des codions , des crifes , qui font les opérations
fur lefquelles les maladies les plus violentes
peuvent être terminées heureufement , mêmefans
aucun fecours , dont le défaut , par conféquent,
eft bien moins nuifible que le mauvais ufage ; d’oii
on feroit fondé à conclure , que l’abus de la Medecine
a.rendu cette fcience plus pernicieufe que fe-
çourable à l’humanité.
Mais comment a - t-o n jamais fû que la nature
feule pouvoit produire de bons effets, fi ce n ’eft par
le moyen de l’obfervation ? & a - t - o n pu obferver
ces effets , fans laiffer à elle-même la caufe qui les
produit ? Il a donc fallu attendre pour obferver : on
ne p eu t, par conféquent, réparer tous les défauts
de la pratique de nos jours , qu’en rétabliffant Vex-
fpecîation, à la faveur de laquelle feule, on peut apprendre
à agir avec méthode, pour fecourir les hom-,
mes dans leurs maladies , & fans laquelle on ne parviendra
jamais à rendre l ’art de guérir, digne de fon
nom, & aufîi utile au genre humain, qu’il eft fufeep-
tiblede l’être. Foye{ Medecine, Méthode curative
, &c. (</)
EXSU CTION , f. f. Ce terme eft employé par
M. Quefnay, ejfai phyjîq. pour fignifier Yextraction
qui le fait du fuc des alimens, par le méchanifme do
la digeftion. Foye^ Digestion. (</)
EX TA SE , f. f. ( Thèolog.) ravinement de l’efprit
hors de fon afliete naturelle , ou fituation dans laquelle
un homme eft tranfporté hors de lui-même ,
de maniéré que les fonctions de fes fens font fufpendus.
Le raviffement de S. Paul jufqu’au troifieme ciel ;
étoit ce que nous appelions extafe. L’hiftoire ecclé-
fiaftique fait foi que plufieurs faints ont été ravis en
extafe pendant des journées entières. C ’eft un état
réel, trop bien attefté pour qu’ori puiffe douter de
fon exiftence.
Mais comme le menfonge & l’impofture s’effor-'
cent de copier la vérité, & d’abufer de chofes d’ailleurs
innocentes, il eft bon d’obferver que les faux
myftiques, les enthoufiaftes, les fanatiques ont fup-
pofé des extafes, pour tâcher d’autorifer leurs rêveries
ou leurs impiétés. Le faux prophète Mahomet
perfuada aux Arabes ignorans que les accès d’épi-
lepfie auxquels il étoit fujet, étoient autant d'extafes,
oii il recevoit des révélations divines. (Cr) Extase , f. m. (Medecine. ) Ce terme, dérivé du
grec, eft employé fous différentes lignifications par
les auteurs ; Hippocrate s’en fert en plufieurs endroits
de fes ouvrages, pour marquer une aliénation d’ef-
prit très - confidérable , un délire complet, tel que
celui des phrénétiques, des maniaques. Foye^ les
eoaques, text. 486. lib. I I . les proréthiques, X F I . 12;
13 .14 .
Sennert, prax. medic. lib. I. part. I L cap. x x x l
parle aufîi de Yextafe en différens fens ; il lui donne
entr’autres, avec Scaliger, celui d\nthouJiafme, quoi»
que très-impropre. Foye[ Enthousiasme.
L’ufage a prévalu d’appeller extafe une maladie
foporeufè en apparence , mais mélancolique en
effet, dans laquelle ceux qui en font affeélés , font
privés de tout lentiment & de tout mouvement, fem-
blent morts, & paroiffent quelquefois roides comme
une ftatue, fans l’être , autant que dans le tetane &c
le catochus ; ils n’ont par conféquent pas la flexibilité
des cataleptiques : ils en font diftingués d’ailleurs
en ce qu’ils avoient avant l’attaque , l’efprit fortement
occupé de quelqu’objet, & qu’ils fe le rappellent
fouvent apres l’accès extatique. Ils ont cependant
cela de commun, que s’ils font debout, ils ref-
tent dans cette fituation immobiles, & de même de
toute autre attitude dans laquelle ils peuvent être
furpris par l’attaque. Foye^ Catalepsie.
Nicolas Tulpius, Henri de Hers & autres, rappoiv
tent des obfervations, par lefquelles ils aflïirent avoir
vû des filles & de jeunes hommes paflionnément
amoureux tomber dans l’extafe, par le chagrin de ce
qu’on leur refufoit l’objet de leur pafîion , & n’en
revenir que parce qu’on leur crioit qu’on la fatisfe-
roit. La dévotion produit aufîi quelquefois cet effet,
comme il en confie par l’obfervation du Capucin,
dont parle le même Henri de Hers. M. de Sauvage dit
dans fe.s claffesde maladies, avoir vu en 1718 à Montpellier
, un homme qui ayant oui dire qu’on devoit
le faire prendre pour le traduire en prifon , en fut fi
frappé de peur, qu’il en perdit le mouvement & le
fentimlent : on avoit beau crier, l’interroger, le pincer,
il ne bougeoit ni ne difoit mot ; il tenoit les yeux
à demi-ouverts, retenant toujours la même attitude
dans laquelle il avoit été faifi d’épouvante.
. Les faignées, les émétiques , les .clyfteres acres,
irritans ; les fternutatoires, les cautères actuels ; tous
ces remedes employés avec prudence , féparément
ou conjointement, félon que le cas l ’exige , peuvent
remplir toutes les indications dans cette maladie.
On doit avoir attention de ne faire d’abord ufage
que des moins violens, en paffant par degrés aux
plus aétifs. (</)
EXTENSEUR, adj. pris fubft. (Anat.) eft le nom
d’un mufcle qui produit le mouvement des o s , que
les Anatomiftes appellent extenfion.
Ce mouvement eft oppofié à la flexion, & devient
même une flexion en fens contraire , fi la forme de
l ’articulation ne s’y oppofe, comme on le voit dans
les fplenius & complexus , dans les cubitaux & radiaux
externes , dans les extenfeurs des doigts du p ié,
&c.
, Les mufcles extenfeurs des doigts de la main &? du
p ié , n’ont point d’autre nom que celui qu’ils tirent
de leur fonélion. M. Morgagni obferve que les mufcles
du pouce & des autres doigts de la main , fur-
tout les extenfeurs, préfentent beaucoup de variétés
dans les différens fujets, pour ce qui regarde le nombre
& la diftrib.ution de leurs tendons , & qu’on ne
peut en promettre une defeription bien certaine.
Foye^ fes adverfar. anat. 11. pag. 40. On peut appliquer
cette remarque aux extenfeurs des orteils, comme
nous verrons plus bas.
. U extenfeur commun des doigts de la main, vient
de la partie poftérieure & inférieure du condy le externe
de l’humerus ; il fort d’une gaine tendineufe qui
enveloppe & pénétré les mufcles anconé, radial &
cubital externes : il fe divife en trois portions charnues,
terminées par trois tendons qui paffent fous le
ligament annulaire commun externe du poignet. Un
quatrième tendon qui va au petit doigt, mais qu’on
ne trouve pas toujours, paffe pour un anneau particulier
du même ligament. Les extrémités de ces tendons
s’inferent aux tubercules oblongs & tranfverfes
des parties fupérieures externes des têtes des fécondés
phalanges ; enfuite elles s’écartent latéralement
en deux bandelettes qui fe réunifient encore, & s’attachent
aux faces convexes des troifiemes phalanges
près de leurs bafes.
Uextenfcur propre du petit doigt eft enveloppé dans
fon.principe de la gaine tendineufe du coude, dont il
eft parlé ci-deffus. Il eft attaché le long de la moitié
fupérieure externe de l’os du coude. Son tendon di-
viféüiperficiellement dans le trajet fur le doS de la
main accompagne le quatrième tendon de Yexten-
feur commun , & s’unit avec lui fur le quatrième os
du métacarpe.
U extenfeur propre de l’index, qu’on appelle aufli
indicateur, vient par un principe tendineux de la partie
externe & moyenne du cubitus , au - deffous de
l’attache du grand extenfeur du pouce. Il eft encore
un peu attaché au ligament inter-offeux ; il fe termine
par un tendon qui paffe par le ligament annulaire
des tendons de Yextenfeur commun, & qui s’unit
avec le tendon de ce mufcle qui va au doigt inde
x, au-deffus de la tête du premier os du métacarpe.
Le petit extenfeur du pouce de la main vient de
la partie externe & prefque fupérieure de l’os du
coude ; il s’attache enfuite au ligament inter-offeux ,
forme un tendon qui paffe dans le finus antérieur de
la tête inférieufé du rayon, & s’unit avec le tendon
du grand extenfeur du pouce, f ur la partie convexe de
la bafe de la fécondé phalange.
Le grand extenfeur du pouce de la main , tire fon
origine de la partie externe & moyenne du cubitus ;
il s’attache aufîi au ligament inter-offeux , & à la
partie moyenne du radius. Son tendon paffe fous le
ligament tranfverfal externe du poignet ; & après
s’être uni avec le tendon du petit extenfeur, va fe terminer
à la partie convexe de la troifieme phalange,
près la bafe.
Le long extenfeur des doigts du pié , vient du côté
exterile de la tête du tibia, de l’épine antérieure de
la tête du péroné, de la partie fupérieure du ligament
inter-offeux : il eft attaché le long de là face
interne du péroné. En paffant fous le ligament annulaire
commun, il fe divife en quatre tendons qui
fe portent fur la face fupérieure des quatre derniers
orteils. ,
. Le court extenfeur des orteils vient de la partie
fupérieure & antérieure du calcanéum & de i’aftra-
gai ; il fe divife en quatre tendons, dont le premier
s’attache à la partie convexe de la première phalange
du pouce. Les autres tendons forment dans les
trois doigts fuivans, avec les tendons du long extenfeur
, des tendons communs qui s’inferent aux fécondés
phalanges de ces doigts : de-là les tendons des
deux extenfeurs fe féparent ; & s’uniffant derechef,
fe terminent aux troifiemes phalanges.
Vextenfeur propre du pouce eft attaché aux trois
quarts fupérieurs de la face interne du péroné, à la
partie voifine du ligament inter-offeux, &c un peu à
l ’extrémité inférieure du tibia. Son tendon s’infere à
la partie fupérieure de la première tête de la derniers
phalange du pouce.
Cowper, & après lui Douglas, ont admis un court
extenfeur du gros orteil ; mais ce mufcle , par leur
delcription, femble faire partie du court extenfeur
des orteils, ainfi que l’a penfé M. Albinus. Foye^ fon
ouvrage intitule, Hijloria mufculorum ho minis, pag,
603.
Il eft aifé d’expliquer Pextenfion libre de chaque
doigt de la main , &(. Pextenfion nécefîairement fi-
multanée des quatre doigts du pié après le pouce ,
. par la différence des extenfeurs des doigts de la main
&C du pié. La myographie comparée du chien, donnée
par M. Douglas , explique aufli la fimultanéüé
de Pextenfion des doigts de cet animal. On trouvera la comparaifon des mufcles exten*
feurs fléchiffeurs, dans Yarticle Fléchisseur; H I - H EXTENSIBILITÉ, f. f. ( Phyff\ eft la propriété
que certains corps ont de pouvoir fouffrir de Pextenfion.
Ge mot fe dit principalement des cordes , des
métaux, &c. Foye^ Ductilité & Ex ten s io n .
EXTENSION, f. f. (Phyf.)eft la même chofe qu’ en parlant des côrps-; étendue, Foye%_ Etendue.
Extension lignifie aufli la même chofe que dila-
tation, expanjîon, raréfaction. Voyez ces mots.
On voit une preuve bien fenfible de Yextenjion des
métaux par la chaleur, à la machine de Marly ; toutes
les barres qui fervent à communiquer le mouvement
des roues , varient tellement de longueur, qu’on a
été obligé de faire plufieurs trous à Pendroit de leur
jonâtion, pour les ajufter entr’elles à proportion de
leur longueur. Suppofant deux tiers de ligne poüf
l’alongement d’une barre de fer de fix pies, ce feroit
fix pouces fur cent toifes ; ce qui produirait dans le
jeu des pillons un dérangement confidérable, fans la
précaution dont on vient de parler. La chaleur, ainfi
que le froid, doivent par cette raifon déranger fouvent
les horloges de clocher : la même raifon peut
influer quelquefois fur les montres de poche. D ’habiles
artiftes ayant remarqué que Yextenjion du fej;