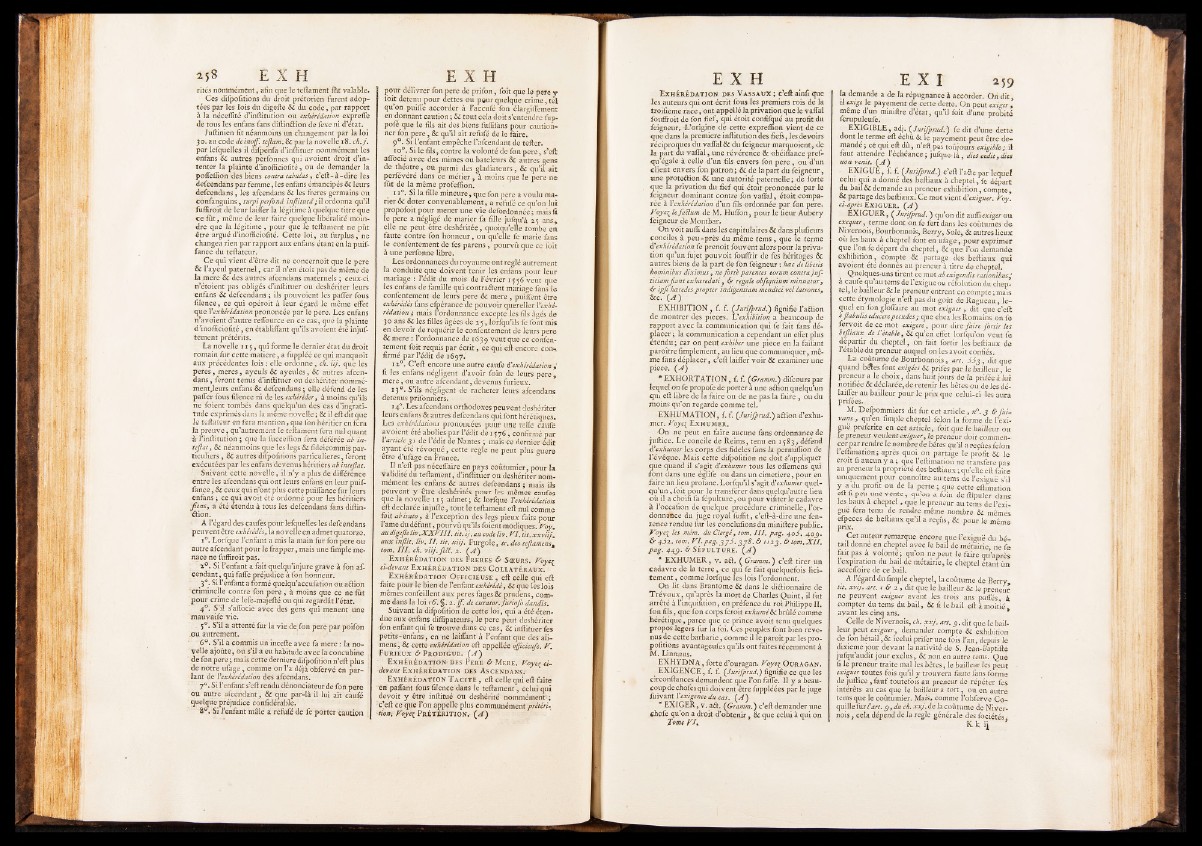
rites nommément, afin que le teftament fût valable.
Ces difpofitions du droit prétorien furent adoptées
par les lois du digefte & du code, par rapport
à la néceflîté d’inftitution ou exhérédation expreffe
de tous les enfans fans diftin&ion de fexe ni d’etat.
Juftinien fit néanmoins un changement par la loi
30. au code de inoff. tejlarn. 6c par la novelle 18. ch.j.
par lefquelles il cüfpenfa d’inftituer nommément les
enfans & autres perfonnes qui avoient droit d’intenter
la plainte d’inofficiofité, ou de demander la
poffefîion des biens contra tabulas , c’eft-à-dire les
defcendans par femme, les enfans émancipés & leurs
defcendans, les afcendans & les freres germains ou
confanguins, turpiperfonâ injlitutâ; il ordonna qu’il
fuffiroit de leur laiffer la légitime à quelque titre que
ce fut, même de leur faire quelque libéralité moindre
que la légitime , pour que le teftament ne pût
être argué d’inofficiofité. Cette lo i, au furplus, ne
changea rien par rapport aux enfans étant en la puif-
fance du teftateur.
Ce qui vient d’être dit ne concernoit que le pere
& l’ayeul paternel, car il n’en étoit pas de même de
la mere 6c des autres afcendans maternels ; ceux-ci
n’étoient pas obligés d’inftituer ou deshériter leurs
enfans 6c defcendans ; ils pouvoient les palier fous
filence, ce qui opéroit à leur égard le même effet
que l’exhérédation prononcée par le pere. Les enfans
Ti’avoient d’autre reffource en ce cas, que la plainte
d ’inofficiofité, en établiffant qu’ils avoient été injuf-
tement prétérits.
La novelle 1 15 , qui forme le dernier état du droit
romain fur cette matière, a fuppléé ce qui manquoit
aux précédentes lois : elle ordonne, ch. iij. que les
peres, meres, ayeuls 6c ayeules, 6c autres afcendans
, feront tenus d’inftituer ou deshériter nommé-
ment^leurs enfans & defcendans ; elle défend de les
paffer fous filence ni de les exhéréder, à moins qu’ils
ne foient tombés dans quelqu’un des cas d’ingratitude
exprimés dans la meme novelle ; 6c il eft dit que
le teftateur en fera mention, que fon héritier en fera
la p reuve, qu’autrement le teftament fera nul quant
à l’inftitution ; que la fucceffion fera déférée ab in-
teflat, 6c néanmoins que les legs 6c fideicommis particuliers
, 6c autres difpofitions particulières, feront
exécutées par les enfans devenus héritiers ab intejlat.
Suivant cette novelle, il n’y a plus de différence
entre les afcendans qui ont leurs enfans en leur puif-
fance, 6c ceux qui n’ont plus cette puiffance fur leurs
enfans ; ce qui avoit été ordonné pour les héritiers
Jiensy a été etendu à tous les defcendans fans diftin-
étion.
A l’égard des caufespour lefquelles les defcendans
peuvent être exhèrédès, la novelle en admet quatorze.
i°. Lorfque l ’enfant a mis la main fur fon pere ou
autre afcendant pour le frapper, mais une fimple menace
ne fuffiroit pas.
a0. Si l’enfant a fait quelqu’injure grave à fon afcendant
, qui faffe préjudice à fon honneur.
3 °. Si l’enfant a formé quelqu’accufation ou a&ion
'criminelle contre fon pere, à moins que ce ne fut
pour crime de lefe-majefté ou qui regardât l’état.
4 0. S’il s’affocie avec des gens qui mènent une
mauvaife vie.
5°. S’il a.attenté fur la v ie de,fon pere par poifon
.ou autrement.
- 6°. S’il a commis un incefte avec fa mere : la novelle
ajoute, où s’il a eu habitude avec la concubine
de fon pere ; mais cette derniere difpofition n’eft plus ,
de notre ufage, comme on l’a déjà obfervé en parlant
de Vexhérédation des afcendans.
7 0. Si l’enfant s’eft rendu dénonciateur de fon pere
ou autre afcendant, & que par-là il lui ait caufé
quelque préjudice confidérable.
8°. Si l’enfant mâle a refufé de fe porter caution
pour délivrer fon pere de prifon, foit que le pere y
foit detenu pour dettes ou pour quelque crime, tel
qu’on puiffe accorder à l’accufé fon élargiffement
en donnant caution ; & tout cela doit s’entendre fup-
pofé que le fils ait des biens fuffifans pour cautionner
fon pere, 6c qu’il ait refufé de le faire.
90. Si l ’enfant empêche l ’afcendant de tefter.
io ° . Si le fils, contre la volonté de fon pere, s’eft:
affocié avec des mimes ou bateleurs 6c autres gens
de théâtre, où parmi des gladiateurs, & qu’il ait
perfevere dans ce métier, à moins que le pere ne
fût de la même profefïion.
, 1 1°. Si la fille mineure, que fon pere a voulu marier
6c doter convenablement, a refûfé ce qu’on lui
propofoit pour mener une vie defordonnée ; mais fi
le pere a négligé de marier fa fille jufqu’à 25 ans,
elle ne peut être deshéritée, quoiqu’elle tombe en
faute contre fon honneur, ou qu’elle fe marie fans
le confentement de fes parens, pourvu que ce foit
à une perfonne libre.
Les ordonnances du royaume ont réglé autrement
la conduite que doivent tenir les enfans pour leur
mariage : l’édit du mois de Février 1556 veut que
les enfans de famille qui contractent mariage fans le
confentement de leurs pere 6c mere, puiffent être
exhérédés fans efpérance de pouvoir quereller Y exhérédation
; mais l’ordonnance excepte les fils âgés de
30 ans & les filles âgées de 25, lorfqu’ils fe font mis
en devoir de requérir le confentement de leurs pere
&mere : l’ordonnance de 1639 veut que ce confentement
foit requis par écrit, ce qui eft encore con-*
firmé par l’édit de 1697.'
12°. C ’eft encore une autre caufe 8 exhérédation
fi les enfans négligent d’avoir foin de leurs pere ,
mere, ou autre afcendant, devenus furieux.
13°. S’ils négligent de racheter leurs afcendans
détenus prifonniérs.
140. Les afcendans orthodoxes peuvent deshériter
leurs enfans & autres defcendans qui font hérétiques.
Les exhérédations prononcées pour une telle caufe
avoient été abolies par l’édit de 1576 , confirmé par
¥ article 3 1 de l’édit de Nantes ; mais ce dernier édit
ayant été révoqué, cette réglé ne peut plus guere
être d’ufage en France.
if i| | § Pas néceffaire en pays coutumier, pour la
validité du teftament, d’inftituer ou deshériter nommément
les enfans 6c autres defcendans ; mais ils
peuvent y être déshérités pour tes mêmes caufes
que la novelle 115 admet; 6c lorfque ¥ exhérédation
eft déclarée injufte, tout le teftament eft nul comme
fait abirato y à l’exception des legs pieux faits pour
l’ame du défunt, pourvu qu’ils foient modiques. Voy.
au digefle liv.XXVIII. tit. ij. au code liv. VI. tit.xxviij.
aux inflit. liv. II. tit. xiij. Furgole, tr. des teltamens,
tom. I I I . ch, viij.fecl. 2. (A )
Exhérédation des Freres & Soeurs. Voye1
ci-devant Exhérédation des Collatéraux.
Exhérédation Officieuse , eft celle qui eft
faite pour le bien de l’enfant exhérédé, 6c que les lois
mêmes confeillent aux peres fages& prudens, comme
dans la loi / (T. § . 2. ff. de curator, furiofo dandis.
Suivant la difpofition de cette loi , qui a été étendue
aux enfans diflipateurs, le pere peut deshériter
fon enfant qui fe trouve dans ce cas, & inftituer fes
petits-enfans , en ne laiflant à l’enfant que des ali-
mens, & cette exhérédation eft appellée officieufe. V. Furieux & Prodigue. ( A )
~ Exhérédation Des Pere & Mere. Voyez ci-
devant Exhérédation des Ascendans/
Exhérédation Tacite , eft celle qui eft faite
en paffant fous filence dans le teftament, celui qui
deyoit y être inftitué ou déshérité nommément ;
c’eft ce que l’on appelle plus communément prétéri-
■ tion, Voyez Préterition,- (A )
Exhérédation des Vassaux ; e’eft ainfi que
les, auteurs qui ont écrit fous les premiers rois de la
troifieme race, ont appellé la privation que le vaflal
foufîroit de fon fief, qui étoit confifoué au profit du
feigneur. L’origine de cette expreflion vient de ce
que dans la première inftitution des fiefs, les devoirs
réciproques du vaflal & du feigneur marquoient, de
la part du vaflal, une révérence & obéiflance pref-
qu’é.gale à celle d’un fils envers fon pere, ou d’un
client envers fon patron ; & de la part du feigneur,
une protettion & une autorité paternelle ; de forte
que la privation du fief qui étoit prononcée par le
feigneur dominant contre fon vaflal, étoit comparée
à ¥ exhérédation d’un fils ordonnée par fon pere.
yoyei le factum de M. Huflon, pour le fieur Aubery
feigneur de Montbar.
On voit aufli dans les capitulaires & dans plufieurs
conciles à peu-près du même tems, que le terme
d’exhérédation fe prenoit fouvent alors pour la privation
qu’un fujet pouvoit fouffrir de fes héritages &
autres biens de la part de fon feigneur : hcec de liberis
hominibus diximus , ne forté parentes eorum contra juf-
litiam fiant exhoeredati, & regale obfeqüium minuatur,
•& ipji hoeredes propter indigentiam mendici vel lattones3
&c. (.A )
EXHIBITION, f. f. ('Jurifprüd.) lignifie l’aétion
de montrer des pièces. exhibition a beaucoup de
rapport avec la communication qui fe fait fans déplacer
; la communication a cependant un effet plus
étendu ; car on peut exhiber une piece en la faifant
paroître Amplement, au lieu que communiquer, même
fans déplacer, c’eft laiffer voir & examiner une
piece. ( A )
* EXHORTATION, f. f. (Gramm.) difcours par
lequel on fe propofe de porter a une aéhon quelqu’un
qui eft libre de la faire ou de ne pas la faire , ou du
moins qu’on regarde comme tel.
EXHUMATION, f. f. (Jurifprud.) aétion d’exhum
e r . Voye^ -Ex H U M ER.
On ne peut en faire aucune fans ordonnance de
juftice. Le concile de Reims, tenu en 1583 , défend
d’-exhumer les corps des fideles fans la permiflîon de
l ’évêque. Mais cette difpofition ne doit s’appliquer
que quand il s’agit d'exhumer tous les offemens qui
font dans une églife ou dans un cimetiere, pour en
faire un lieu profane. Lorfqu’il s’agit d'exhumer quelqu’un
, foit pour le transférer dans quelqu’autre lieu
oit il a choifi fa fépulture, ou pour vifiter le cadavre
â l’occafion de quelque procedure criminelle, l’or-
donnafice du juge royal fuffit, c’eft-à-dire une fen-
tence rendue fur les conclufions du miniftere public.
Voye.1 les mém. du Clergé, tom. I I I . pag. 40S. 4 0 0 .
& 4 â z . tom. VI.pag.3 7 6 .3 78 . & 1123. & tom.Xll.
pag. 4 4 9 . & SÉ PU L TU R E . ( A )
* EXHUMER, v . aft. ( Gramm. ) c’eft tirer un
cadavre de la terre, ce qui fe fait quelquefois licitement
, comme lorfque les lois l’ordonnent.
On lit dans Brantôme 6c dans le dictionnaire de
T révoux , qu’après la mort de Charles Quint, il fut
arrêté à l’inquifition, en préfence du roi Philippe IL
fon fils, que fon corps feroit exhumé 6c brûlé comme
hérétique, parce que ce prince avoit tenu quelques
propos légers fur la foi. Ces peuples font bien revenus
de cette barbarie, comme il le paroît par les pro-
pofitions avantageufes qu’ils ont faites récemment à
M. Linnæus.
EXH YDN A, forte d’ouragan. Voyez Ouragan.
^ EXIGENCE, f. f. (Jurifprud.) lignifie ce que les
circonftances demandent que l’on faffe. Il y a beaucoup
de chofes qui doivent être fuppléées par le juge
fuivant ¥ exigence du cas. (A )
* EXIGER, v . aét. (Gramm.) c’eft demander une
chofe qu’on a droit d’obtenir, 6c que celui à qui on
Tome VJ*.
la demande a de la répugnance à accorder. Ori d it,
il exige le payement de cette dette. On peut exiger ,
même d’un miniftre d’état, qu’il foit d’une probité
fcrupuleufe.
EXIGIBLE, adj. ( Jurifprud..) fe dit d’une dette
dont le terme eft echû & le payement peut être demande
; ce qui eft dû, n’eft pas toûjours exigible; ii
faut attendre l’échéance; jufque-là, dies cedit,dies
non venit. (A )
EXIGUE, f. f. (Jurifprud.) c’eft l’a&e par lequel
celui qui a donné des beftiaux à cheptel, fe départ 4“ bail & demande au preneur exhibition, compte,
6c partage des beftiaux. Ce mot vient d’exiguer, Voy.
ci-apres ExiGUER. (A )
EXIGUER, (Jurifprud. ) qu’on dit aufli exiger ou
exequer y terme dont on fe lertdans les coûtumes de
Nivernois, Bourbonnois, Berry, Sole, 6c autres lieux
ou les baux à cheptel font en ufage, pour exprimer
que 1 on fe départ du cheptel, 6c que l’on demande
exhibition, compte 6c partage des beftiaux qui
avoient été donnés au preneur à titre de cheptel.
Quelques-uns tirent ce mot ab exigendis rationibusy
à caufe qu’au tems de l’exigue ou réfolution du cheptel,
le bailleur & le preneur entrent en compte ; mais
cette étymologie n’eft pas du goût de Ragueau, lequel
en fon gloffaire au mot exiguer > dit que c’efl:
e jlabulis educere pecudes ; que chez les Romains on fe
fervoit de ce mot exigere, pour dire faire fortir les
befliaux de Vetable, 6c qu’en effet lorfqu’on veut fe
départir du cheptel, on fait fortir les beftiaux de
l’étable du preneur auquel on les avoit confiés.
La coûtume de Bourbonnois, art. 663 , dit que
quand bêtes font exigées ôc prifes par le bailleur, le
preneur a le choix, dans huit jours de la prifée à lui
notifiée 6c déclarée, de retenir les bêtes ou de les dé-
laifler au bailleur pour le prix que celui-ci les aura
prifées.
M. Defpommlers dit fur cet article, n°. 3 & fui*
vans , qu’en fimple cheptel félon la forme de l’exiguë
prefcrite en cet article, foit que le bailleur ou
le preneur veulent exiguer, le preneur doit commencer
par rendre le nombre de bêtes qu’il a reçues félon
l’eftimation; après quoi on partage le profit 6c le
croît fi aucun y a ; que l’eftimation ne transféré pas
au preneur la propriété des beftiaux ; qu’elle eft faite
uniquement pour connoître au'tems de l’exiguë s’il
y a du profit ou de la perte ; que cette eftimation
eft fi peu une vente, qu’on a foin de ftipuler dans
les baux à cheptel, que le preneur au tems de l’exigue
fera tenu de rendre même nombre 6c mêmes
efpeces de beftiaux qu’il a reçûs, 6c pour le même
prix.
Cet auteur remarque encore que l’exiguë du bétail
donné en cheptel avec le bail de métairie ne fe
fait pas à volonté; qu’on ne peut le faire qu’après
1’expira.tion du bail de métairie, le cheptel étant ùn
acceffoire de ce bail.
A l’égard du fimple cheptel, lacoûtume de Berry
tit. xvij, art. / & 2 , dit que le bailleur 6c le preneur
ne peuvent exiguer avant les trois ans paffés, à
compter du tems du bail, & fi le bail eft à moitié
avant les cinq ans.
Celle de Nivernois, ch. x x j. art. 3 . dit que le bailleur
peut exiguer., demander compte 6c exhibition
de fon bétail ,& icelui prifer une fois l’an, depuis le
dixième jour devant la nativité de S. Jean-Baptifté
jufqu’audit jour exclus, 6c non en autre tems. Que
fi le preneur traite mal les bêtes, le bailleur les peut
exiguer toutes fois qu’il y trouvera faute fans forme
de juftice, faut' toutefois au preneur de répéter fes
intérêts au cas que le bailleur a tort, ou en autre
tems que le coûtumier. Mais, comme l’obferve Coquille
furl'art. 3 , du ch. xxj. de lacoûtume de Nivernois
, cela dépend de la regie générale des fociétés