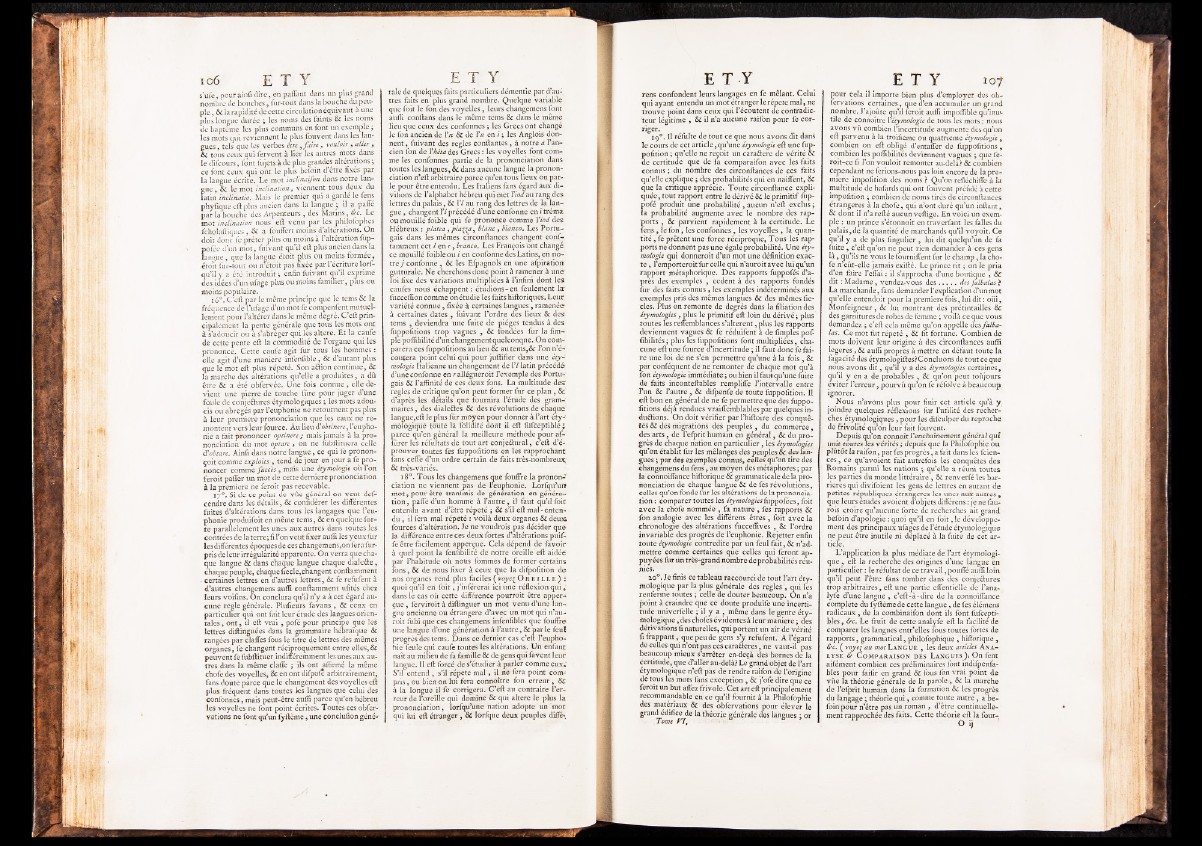
ro6 E T Y s’ufe, .pour ainfi dire, en paffant dans un plus grand
nombre de bouches, fur-tout dans la bouçhe du peuple
, St la rapidité de cette circulation équivaut à une
plus longue durée ; les noms des faints St les noms
de baptême les .plus communs en font un exemple ;
les mots qui reviennent le plus fouvent dans les langues
, tels que les verbes être, faire, vouloir , aller ,
oc tous ceuxqui fervent à lier les autres mots dans
le difeours, font fujets à de plus grandes alterations ;
ce font Ceux qui ont le plus beîoin d’etre fixés par
la langue écrite. Le mot inclinaifon dans notre langue
, St le mot inclination, viennent tous deux du
latin inclinatio. Mais le premier qui a garde le fens
phyfique eft plus ancien dans la langue ; il a palfe
par la bouche des Arpenteurs , des Marins, &c. Le
mot inclination nous eft venu par les philofophes
lcholaftiques, & a fouffert moins d’altérations. On
doit donc fe prêter plus ou moins à l’altération fup-
pofée d’un mot» fuivant qu’il eft plus ancien dans la
langue, que la langue étoit plus ou moins formée,
étoit fur-tout ou n’étoit pas fixée par l’écriture lorf-
qu’il y a été introduit ; enfin fuivant qu’il exprime
des idées d’un ufage plus ou moins familier, plus ou
moins populaire.
i6°. C ’eft par le même principe que lé tems St la
fréquence de l’ufage d’un mot fe compenfent mutuellement
pour l’altérer dans le même degré. C ’eft principalement
là pente 'générale que tous les mots ont
à s’adoucir ou à s’abréger qui les altéré. Et la caufe
de cette pente eft la commodité de l’ofgâne qui les
prononce. Cette caufe agit fur tous les hommes :
elle agit d’une maniéré infenfible, St d’autant plus
que le mot eft plus répété. Son aftion continue, St
la marche des altérations qu’elle a produites, a dû
être St a été obfervée. Une fois connue, elle devient
une pierre de touche lûre pour juger d’une
foule de conjectures étymologiques ; les mots adoucis
ou abrégés par l’euphonie ne retournent pas plus
à leur première prononciation que les eaux ne remontent
vers leur fource. Au lieu d’obtinere, l’euphonie
a fait prononcer opdnere • mais jamais à la prononciation
du mot optare , on ne fubftituera celle
8 obture. Ainfi dans notre langue, ce qui fe pronon-
çoit comme exploits , tend de jour en jour à fe pro-,
noncer comme fucchs , mais une étymologie ou I on
feroit paffer un mot de cette derniere prononciation
à la première ne feroit pas recevable.
17°. Si de ce point de vue général on veut def-
cendre dans les détails, St confidérer les différentes
fuites d’altérations dans tous les langages que l’euphonie
produifoit en même tems, St en quelque forte
parallèlement les unes aux autres dans toutes les
contrées de la terre; fi l’on veut fixer auffi les yeux fur
les différentes époques de ces changemens,on fera fur-
pris de leur irrégularité apparente. On verra que chaque
langue & dans chaque langue chaque dialefte,
chaque peuple, chaque fiecle,changent conftamment
• certaines lettres en d’autres lettres, St fe refufent à
d’autres changemens auffi conftamment ufités chez
leurs voifins. On conclura qu’il n’y a à cet égard aucune
réglé générale. Plufieurs favans , St ceux en
particulier qui ont fait leur étude des langues orientales
, ont, il eft vrai , pofé pour principe que les
lettres diftinguées dans la grammaire hébraïque &
rangées par claffes fous le titre de lettres des mêmes
organes, fe changent réciproquement entre elles, &
peuvent fefubftituer indifféremment les unes aux autres
dans la même claffe ; ils ont affirmé la même
chofe des voyelles, & en ont difpofe arbitrairement,
fans doute parce que le changement des voyelles eft
plus fréquent dans toutes les langues que celui des
confonnes, mais peut-être auffi parce qu’en hébreu
les voyelles ne font point écrites. Toutes ces obfer-
vations ne font qu’un fyftème, une conclufion géné»
E T Y raie de quelques faits particuliers démentie par d’au-,
très faits en plus grand nombre. Quelque variable
que foit le fon des voyelles, leurs changemens font
auffi cohftans dans le même tems St dans le mêmè
lieu que ceux des confonnes ; les Grecs ont changé
le fon ancien de Vn St de Vu en i ; les Anglois donnent,
fuivant des réglés confiantes, à notre a l’ancien
fon de Vhêta des Grecs : les voyelles font comme
les confonnes partie de là prononciation dans
toutes les langues, St dans aucune langue la prononciation
n’eft arbitraire parce qu’en tous lieux on parle
pour être entendu. Les Italiens fans égard aux di-
vifions de l’alphabet hébreu qui met Vïod au rang des
lettres du palais, St VI au rang des lettres de la langue
, changent 1’/ précédé d’une confonne en i tréma
ou mouillé foible qui fe prononce comme Vïod des
Hébreux : platea , pïa\ga, blanc , bianco. Les Portugais
dans les mêmes circonftances changent conftamment
cet / en r , branco. Les François ont changé
ce mouillé foible ou i en confonne des Latins, en notre
j confonne , St les Efpagnols en itne afpiration
gutturale. Ne cherchons donc point à ramener à uné
loi fixe des variations multipliées à l’infini dont les
caufes nous échappent: étudions-en feulement la
fucceffion comme on étudie les faits hiftoriques. Leur,
variété connue, fixée à certaines langues, ramenée
à certaines dates , fuivant l’ordre des lieux & des
tems , deviendra une fuite de pièges tendus à des
fuppofitioris trop vagues , St fondées fur la fim-
ple poffibilité d’un changement quelconque. On comparera
ces fuppofitions au lieu St autems,& l’on n’é-i
coulera point celui qui pour juftifief dans une étymologie
Italienne un changement de IV latin précédé
d’une confonne en r allégueroit l’exemple des Portugais
& l’affinité de ces deux fons. La multitude des
réglés de critique qu’on peut former fur ce plan, &
d’après les détails que fournira l’étüdé dès grammaires
, des diale&es St des révolutions de chaque
langue,eft le plus fûr moyen pour donner à l’art étymologique
toute la folidité dont il eft fufceptible j
parce qu’en général la meilleure méthode pour af-
lïirer les réfultats de tout art conjeéhiral, c’eft d’éprouver
toutes fes fuppofitions en les rapprochant
fans celle d’un ordre certain de faits très-nombreux^
St très-variés;
i8°. Tous les changemens que fouffre la prononciation
ne viennent pas de l’euphonie. Lorfqu’urt
mot, pouf être tranfmis de génération en génération
, paffe d’un homme à l’autre, il faut qu’il foit
entendu avant d’être répété ; St s’il eft mal-entendu
, il fera mal répété : voilà deux organes St deux,
fources d’altération. Je rie voudrois pas décider que
la différence entre ces deux fortes d’altérations puif-
fe être facilement apperçue. Cela dépend de favoir
à quel point la fenfibilité de notre oreille eft aidée
par l’habitude oîi nous fommés de former certains
Ions, St de nous fixer à ceux que la difpofition de
nos organes rend plus faciles ( voye^ O r e il l e ) :
quoi qu’il eri fo i t , j’inféf erai ici une réflexion qui
dans le cas oit cette différence pôurroit être apper-i
çu e , ferviroit à diftinguer un mot venu d’iine langue
ancienne ou étrangère d’avec un mot qui n’au-
roit fubi que ces changemens infenfibles que fouffre
une langue d’une génération à l’autre, & par le feul
progrès des tems. Dans ce dernier cas c’eft l’eupho-
hie feule qui caufe toutes les altérations. Un enfant
naît au milieu de fa famille St de gens qui favent leur
langue. Il eft forcé de S’étudier à parler comme eux;'
S’il entend , s’il répété mai, il ne fera point côm-*
pris, ou bien on lui fera corinoître fon erreur, &
à la longue il fe corrigera. C’èft au contraire l’erreur
de l’oreille qui domine & qui altéré le plus la
prononciation, lorfqu’une nation adopte un mot
qui lui eft étranger, Si lorfque deux peuples diffé».
E T Y
rens confondent leurs langages en fe mêlant. Celui
qui ayant entendu un mot étranger le répété mal, ne
trouve point dans ceux qui l’écoutent de contradicteur
légitime , & il n’à auciine raifon pour fe corriger.
io°. Il réfulte de tout cé que nous avons dit dans
le cours de cet article,qu’une étymologie eft une fup-
pofition ; qu’elle ne reçoit un caraôere de vérité St
de certitude que de fa comparaifon avec les faits
connus ; du nombre des circonftances de ces faits
qu’elle explique ; des probabilités qui en naiffent, St
que la critique apprécie. Toute circonftance expliquée,
tout rapport entre ie dérivé St le primitif fup-
pofé produit une probabilité, aucun n’eft exclus ;
la probabilité augmente avec le nombre des rapports
, St parvient rapidement à la certitude. Le
len s , le fon , les confonnes , les voyelles , la quantité
, fe prêtent une force réciproque, Tous les rapports
ne donnent pas une égale probabilité. Une étymologie
qui donneroit d’un mot une définition exacte
, l’emporteroit fur celle qui n’auroitavec lui qu’un
rapport métaphorique. Des rapports fuppofés d’après
des exemples , cedent à des rapports fondés
îur des faits connus, les exemples indéterminés aux
exemples pris des mêmes langues & des mêmes fie-
cles. Plus on remonte de degrés dans la filiation des
étymologies , plus le primitif eft loin dit dérivé; plus
toutes les reffemblances s’altèrent, plus les rapports
deviennent vagues St fe réduifent à de fimples pcf-
fibilités ; plus les fuppofitions font multipliées, chacune
eft une fource d’incertitude ; il faut donc fe faire
une loi de ne s’en permettre qu’une à la fois , St
par conféquent de ne remonter de chaque mot qu’à
fon étymologie immédiate ; ou bien il faut qu’une fuite
de faits inconteftables rempliffe l’intervalle entre
l’un St l’autre , St difpenfe de toute fuppofition. Il
eft bon en général de ne fe permettre que des fuppofitions
déjà rendues vraiffemblables par quelques induirions.
On doit vérifier par l’hiftoire des conquêtes
St des migrations des peuples , du commerce,
des arts, de l’efprit humain en générai, St du progrès
de chaque nation en particulier, les étymologies
qu’on établit fur les mélanges des peuples & des langues
; par des exemples connus, celles qu’on tire des
changemens du fens, au moyen des métaphores ; par
la connoiffance hiftorique St grammaticale delà prononciation
de chaque langue & de fes révolutions,
celles qu’on fonde iur les altérations de la prononciation
: comparer toutes les étymologies fuppofées, foit
avec la chofe nommée , fa nature, fes rapports St
fon analogie avec les différens êtres, foit avec la
chronologie des altérations fucceffives , St l’ordre
invariable des progrès de l’euphonie. Rejetter enfin
toute étymologie contredite par un feul fait, St n’admettre
comme certaines que celles qui feront appuyées
fur un très-grand nombre de probabilités réunies.
zo°. Je finis ce tableau raccourci de tout l ’art é tymologique
par la plus générale des réglés , qui les
renferme toutes ; celle de douter beaucoup. On n’a
point à craindre que ce doute produite une incertitude
univerfelle ; il y a ? même dans le genre étymologique
, des chofes évidentes à leur maniéré ; des
dérivations fi naturelles, qui portent un air de vérité
fi frappant ,• que peu de gens s’y refiifent. A l’égard
de celles qui n’ont pas ces caraéteres, ne vaut-il pas
beaucoup mieux s’arrêter en-deçà des bornes de la
certitude, que d’aller au-delà? Le grand objet de l’art
étymologique n’eft pàs de rendre raifon de l’origine
de tous les mots fans exception , St j’ofe dire que ce
feroit un but affez frivole. Cet art eft principalement
recommandable en ce qu’il fournit à la Philofophie
des matériaux St des obfervations pour élever le
grand édifice de la théorie générale des langues ; or
Tome Kl,
E T Y 107
pour cela il importe bien plus d’employer des obfervations
certaines, que d’en accumuler un grand
nombre. J’ajoute qu’il feroit auffi impoffible qu’inu*-
tile de confloître Vétymologie de tous les mots : nous
ayons vu combien l’incertitude augmente dès qu’on
eft parvenu à la troifieme ou quatrième étymologie ,
combien on eft obligé d’entaffer de fuppofitions ,
combien les pofïîbilités deviennent vagues ; que fe-
roit-ce fi l’on vouloit remonter au-delà? St combien
cependant ne ferions-nous pas loin encore de la première
impofition des noms ? Qu’on refléchiffe à la
multitude de hafards qui ont fouvent préfidë à cette
impofition ; combien de noms tirés de circonftances
étrangères à la chofe, qui n’ont duré qu’un inftant,
St dont il n’a refté aucun veftige. En voici un exemple
: un prince s’étonnoit en traverfant les falles du
palais, de la quantité de marchands qu’il voyoit. C e
qu il y a de plus fingulier , lui dit quelqu’un de fa
fuite , c’eft qu’on ne peut rien demander à ces gens
là , qu’ils ne vous le fourniffent fur le champ, la chofe
n’eût-elle jamais exifté. Le prince rit ; on le pria
d’en faire l’effai : il s’approcha d’une boutique , St
dit : Madame, vendez-vous des.........des falbalas ?
La marchande, fans demander l’explication d’un mot
qu’elle entendoit pour la première fois, lui dit : oiii,
Monfeigrieur, St lui montrant des prétintailles St
des garnitures de robes de femme ; voilà ce que vous
demandez ; c’eft cela même qu’on appelle des falbalas.
Ce mot fut répété , St fit fortune. Combien de
mots doivent leur origine à des circonftances auffi
legeres, St auffi propres à mettre en défaut toute la
fagacité des étymologiftes? Concluons de tout ce que
nous avons d it , qu’il y a des étymologies certaines,
qu’il y en a de probables , St qu’on peut toujours
éviter l’erreur, pourvu qu’on fe réfolve à beaucoup
ignorer.
Nous n’avôns plus pour finir cet article qu’à y,
joindre quelques, réflexions fur l’utilité des recherches
étymologiques , pour les difculper du reproche
de frivolité qu’on leur fait fouvent.
Depuis qu’on connoît l’enchaînement général qui
unit toutes les vérités ; depuis que la Philofophie ou
plutôt la raifon, par fes progrès, a fait dans les feien-
ces, ce qu’avoient fait autrefois les conquêtes des
Romains parmi les nations ; qu’elle a réuni toutes
les parties du monde littéraire, St renverfé les barrières
qui divifoient les gens de lettres en autant de
petites républiques étrangères les unes aux autres ,
que leurs études avoient d’objets différens : je ne fau-
rois croire qu’aucune forte de recherches ait grand
befoin d’apologie : quoi qu’il en fo it , le développement
des principaux ufages de l’étude étymologique
ne peut être inutile ni déplacé à la fuite de cet article.
L ’application la plus médiate de l’art étymologique
, eft la recherche des origines d’une langue en
particulier : le réfultat de ce travail, pouffé auffi loin,
qu’il peut l’être fans tomber dans des conjectures
trop arbitraires, eft une partie effentielie de l’ana-
lyfe d’une langue , c’eft-à-dire de la conrioiffance
complété du fyftème de cette langue, de fes élémens
radicaux, de la combinaifon dont ils font fufeepti-
bles, &c. Le fruit de cette analyfe eft la facilite de
comparer les langues entr’elles fous toutes fortes de
rapports, grammatical, philofophique , hiftorique ,
&c. ( voyeç au mot LANGUE , les deux articles Analyse
& Comparaison des Langues )» On fent
aifément combien ces préliminaires font indifpenfa-
bles pour faifir en grand St fous fbn vrai point de
vûe la théorie générale de la parole/, St la marche
de l’efprit humain dans la formation St les progrès
du langage ; théorie q ui, comme toute autre, a befoin
pour n’être pas un roman , d’être continuellement
rapprochée des faits. Cette théorie eft la four