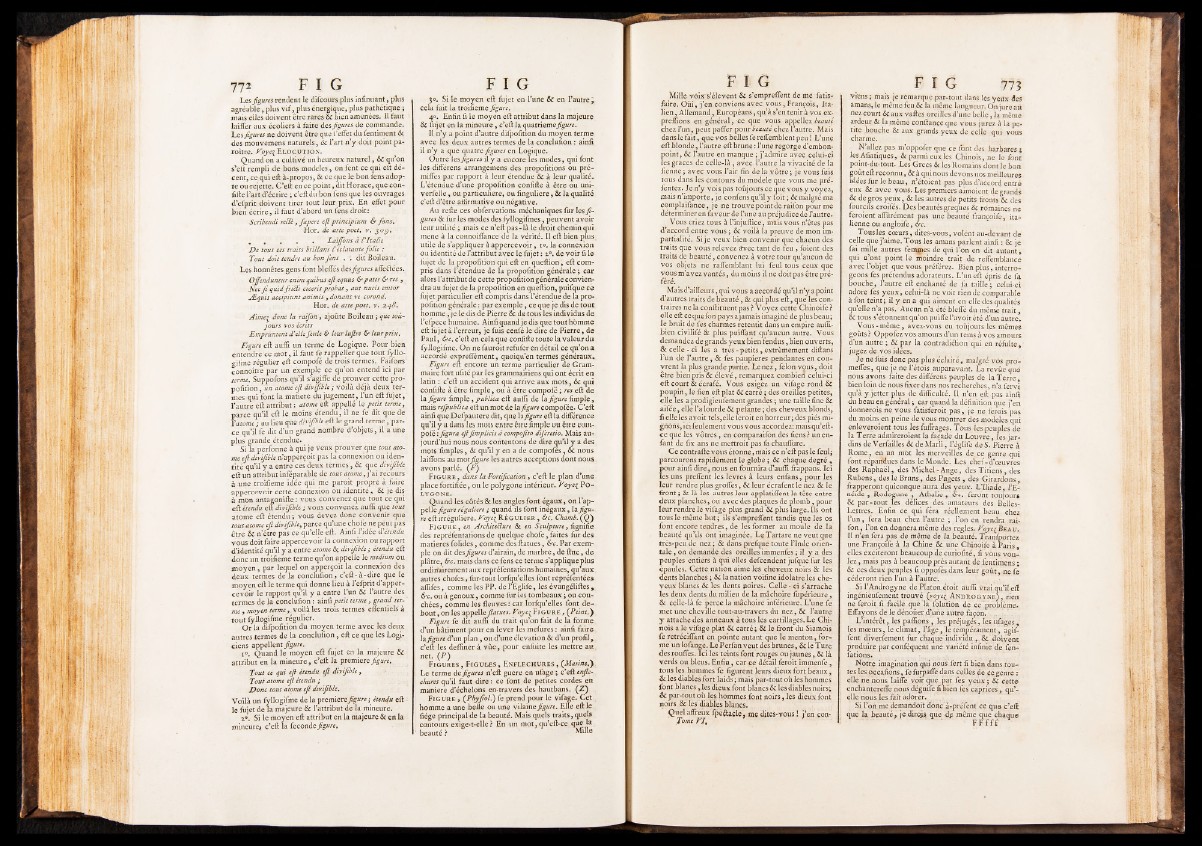
Les figures rendent le difcoursplus infirmant, plus
agréable, plus v if, plus énergique, plus pathétique ;
mais elles doivent être rares & bien amenées. Il faut
laifler aux écoliers à faire d es figures de commande.
Les figures ne doivent être que l’effet du l'entiment &
des mouvemens naturels, l’art n’y doit point pa-
roître. F oye^ E l o c u t i o n .
Quand on a cultivé un heureux naturel, & qu’on
s’efi rempli de bons modèles, on fent ce qui elt décent,
ce qui eft à-propos, & ce que le bon lèns adopte
ou rejette. C’eft en ce point, dit Horace, que confifte
l’art d’écrire ; c’eft du bon fens que les ouvrages
d’efprit doivent tirer tout leur prix. En effet pour
bien écrire, il faut d’abord un fens droit;
Scribendi reclé , fapere efl principium & fions.
Hor. de arte poet. v. joc). 1 ’
, . . . . LaiJJons à 1'Italie
D e tous ces traits brillons L'éclatante folie :
Tout doit tendre au bon fens . '. dit Boileau.
Les honnêtes gens font bleffés desfigures affeûéès.
Ojfenduruur enirn quibus efi equus & pater & res ,
filée f i quidfiricli ciçeris probat, aut nucis emtor
Æqüis accipiunt animis ,,donantve corotiâ.
Hor. de arte poet. v. 2.4S.
Aime1 donc la raifion , ajoûte Boileau ; que toujours
vos écrits
Empruntent d'elle feule & leur lufire & leur p r ix .
Figure eft aufli un terme de Logique. Pour bien
entendre ce mot, il faut le rappeller que tout fyllo-
gifme régulier elt compofé de trois termes. Faiforts'
connoître par un exemple ce qu’on entend ici par
terme. Suppofons qu’il s’agiffe de prouver cette pro-
pofition, un atome efi divifible; voilà déjà deux termes
qui font la matière du jugement, l’un elt fujet,
l’autre eft attribut : atome eft appellé le petit terme,
parce qu’il eft le moins étendu, il ne le dit que de
Y atome ; au lieu que divifible eft le grand terme, parce
qu’il fe dit d’un grand nombre d’objets, il a une
plus grande étendue.
Si la perfonne à qui je veux prouver que atome
efi divifible n-’apperçoit pas la connexion ou identité
qu’il y a entre ces deux termes, & que divifible
eft un attribut inféparable de tout atome, j’ai recours
à une troilieme idée qui me paroît propre a faire
appercevoir cette connexion ou identité, & je dis
à mOn antagonifte : vous convenez que tout ce qui
eft étendu eft divifible ; vous convenez aufli que tout
atome eft étendu ; vous devez donc convenir que
tout atome efi divifible, parce qu’une chofe ne peut pas
être & n’être pas ce qu’elle eft. Ainfi l’idée d’étendu
vous doit faire appercevoir la connexion ou rapport
d’identité qu’il y a entre atome divifible ; étendu eft
donc un troilieme terme qu’on appelle le medium ou
moyen, par lequel on apperçoit la connexion des
deux termes de la conclulion, c’eft-à-dire que le
moyen eft le terme qui donne lieu à l’efprit d’apper-
cevôir le rapport qu’il y a entre l’un & l’autre des
termes de la conclufion : ainfi petit terme , grand term
e , moyen terme, voilà les trois termes effentiels à
tout fyllogifme régulier.
Or la difpolition du moyen terme avec les deux
autres termes de la conclufion, eft ce que les Logiciens
appellent figure.
i°. Quand le moyen eft fujet en la majeure &:
attribut en la mineure, c’eft la première figure.
Tout ce qui efi étendu efi divifible,
Tout atome efi étendu ;
Donc tout atome efi divifible.
Voilà un fyllogifme de la première figure ; étendu eft
le fujet de la majeure & l’attribut de la mineure.
1®. Si le moyen eft attribut en la majeure & en la
mineure* c’eft la fécondé figure.
30. Si le moyen eft fujet en l’une & en l’autre ÿ
cela fait la troilieme figure.
40. E n fin fi l e m o y e n è f t a t t r ib u t d an s la m a je u r e
& fu je t e n la m in e u r e , c ’ e f t la q u a t r ièm e figure.
Il n’y a point d’autre difpofition du moyen terme
avec les deux autres termes de la conclufion : ainfi
il n’y a que quatre figures en Logique.
Outre les figures il y a encore les modes, qui font
les différens arrangemens des propofitions ou pré-
milfes par rapport à leur étendue & à leur qualité.
L’étendue d’une propofition confifte à être ou uni-
verfelle, ou particulière, ou finguliere, & la qualité
c’eft d’être affirmative ou négative.
Au refte ces obfervations méchaniques fur les f i gures
& furies modes des fyllogifmes, peuvent avoir
leur utilité ; mais ce n’eft pas-là le droit chemin qui
mene à la connoiffance de la vérité. Il eft bien plus,
utile de s’appliquer à appercevoir, 10. la connexion
ou identité de l’attribut avec le fujet : z°. de voir fi le
lujet de la propofition qui eft en queftion \ eft compris
dans l’étendue de la propofition générale ; car
alors l’attribut de cette propofition générale conviendra
au fujet de la propofition en queftion, puifque ce
fujet particulier efl compris dans l’étendue de la propofition
générale : par exemple, ce que je dis de tout
homme, je le dis de Pierre & de tous les individus de
l’efpece humaine. Ainfi quand je dis que tout homme
eft fujet à l’erreur, je fuis cenfé le dire de Pierre, de
Paul, &c. c’eft en cela que confifte toute la valeur du
fyllogifme. On ne fauroit refufer en détail ce qu’on a
accordé expreffément, quoiqu’en termes généraux.
Figure eft encore un terme particulier de Grammaire
fort ufité par les grammairiens qui ont écrit en
latin : c’eft un accident qui arrive aux mots, & qui
confifte à être fimple, ou à être compofé ; res eft de
la figure fimple, publica eft aufli de la figure fimple,
mais refpublica eft un mot de la figure compofée. C’eft
ainfi que Defpautere dit, que la figure eft la différence
qu’il y a dans les mots entre être fimple ou être compofé
: figura, efi fimplicis à compofito diferetio. Mais aujourd’hui
nous nous contentons de dire qu’il y a des
mots fimples, & qu’il y en a de compofes, & nous
laiffons au mot figure les autres acceptions dont nous,
avons parlé. (F)
F i g u r e , dans la Fortification, c’eft le plan d’une
place fortifiée, ou le polygone intérieur. Foye{ Pol
y g o n e .
- Quand les côtés & les angles font égaux, on l’ap-
pell e figure régulière ; quand ils font inégaux, la figure
eft irrégulière. Foye^ R é g u l i e r , &c. Chamb. ( Q )
FIGURE, en Architecture & en Sculpture, lignifie,
des repréfentations de quelque chofe, faites fur des
matières folides, comme des ftatues, &c. Par exemple
on dit des figures d’airain, de marbre, de ftuc, de
plâtre, &c. mais dans ce fens ce terme s’applique plus
ordirifcirement aux repréfentations humaines, qu’aux
autres chofes, fur-tout lorfqu’elles font repréfentées
aflifes, comme les PP. de l’Eglife, les évangéliftes ,
& c. ou à genoux, comme fur les tombeaux ; où couchées,
comme les fleuves: car lorfqu’elles font debout
, on les appelle/?^««- Foy eçFi g u r e , (F e in t .j
Figure fe dit aufli du trait qu’on fait de la forme
d’un bâtiment pour en lever les mefures : ainfi faire
la figure d’un plan, ou d’une élévation & d’un profil,
c’eft les defliner à vue, pour enfuite les mettre au.
net. (jP)
F i g u r e s , F i g u l e s , E n f l e c h u r e s , (‘Marine.)
Le terme de figures n’eft guere en ufage; c’eft enfie-
chures qu’il faut dire : ce font de petites cordes en
maniéré d’échelons en-travers des hautbans. (Z)
F i g u r e , {Pbyfioli) fe prend pour le vifage. Cet
homme a une belle ou une vilaine figure. Elle eft le
fiége principal de la beauté. Mais quels traits, quels
contours exige-t-elle ? En un mot, qu’eft-ce que la
beauté? Mille
Mille voix s’élèvent & s’empreflent de me fatis-
faire. Oui, j’en conviens avec vous, François, Italien
, Allemand, Européans, qu’à s’en tenir à vos ex-
preflions en général, ce que vous appeliez beauté
chez l’un, peut palier pour beauté chez l’autre. Mais
dans le fait, que vos belles fereffemblent peu! L’une
eft blonde, l’autre eft brune : l’une tegorge d’embonpoint,
& l’autre en manque ; j’admire avec celuirçi
les graeçs de celle-là, avec l’autre la vivacité de la
fienne ; avec vous l’air fin de la vôtre ; je vous fuis
tous dans les contours du modèle que vous me pré-
féntez. Je n’y vois pas toujours ce que vous y voyez,
mais n’importe, je confens qu’il y loit ; & maigre ma
complaifance, je ne trouve point de raifon pour me
déterminer en faveur de l’une au préjudice de l’autre.
Vous criez tous à Finjufticé, mâis vous n’êtes pas
d’accord entre vous ; & voilà la preuve de mon impartialité.
Si je veux bien convenir que chacun des
traits que vous relevez avec tant de feu, foient des
traits de beauté, convenez à votre tour qu’aucun de
vos objets ne raffemblant lui feul tous ceux que
vous m’avez vantés, du moins il ne doit pas être préféré.
Mais d’ailleurs, qui vous a accordé qu’il n’y a point
d’autres traits de beauté, & qui plus eft, que les contraires
ne la conftitüent pas ? Voyez cette Chinoife ?
elle eft ce que fon pays a jamais imaginé de plus beau;
le bruit de fes charmes retentit dans un empire aufli-
bien civilifé & plus puiflant qu’aucun autre. Vous
demandez de grands yeux bien fendus, bien ouverts,
& celle - ci les a très - petits, extrêmement diftans
l’un de l’autre, & fes paupières pendantes en couvrent
la plus grande partie. Le nez, félon vous, doit
etre bien pris & élevé, remarquez combien celui-ci
eft court & écrafé. Vous exigez un vifage rond &
poupin, le lien eft plat & carré ; des oreilles petites,
elle les a prodigieufement grandes ; une taille fine &
aifée, elle l’a lourde & pefante ; des cheveux blonds,
!i elle les avoit tels,elle feroit en horreur; des piés mignons,
ici feulement vous vous accordez: mais qu’eft-
ce que les vôtres, en comparaifon des liens? un enfant
de fix ans ne mettroit pas fa chauflure.
Ce contrafte vous étonne, mais ce n’eft pas le feul;
parcourons rapidement le globe ; & chaque degré ,
pour ainfi dire, nous en fournira d’aufli frappans. Ici
les uns preflent les Ievres à leurs enfans, pour les
leur rendre plus groffes, & leur écrafentle nez & le
front ; & là les autres leur applatiffent la tête entre
deux planches, ou avec des plaques de plomb, pour
leur rendre le vifage plus grand & plus large. Ils ont
tous le même but ; ils s’empreflent tandis que les os
font encore tendreis, de les former au moule de la
beauté qu’ils ont imaginée. LçTartare ne veut que
très-peu.de nez ; & dans prefque toute l’Inde orientale
, on demande des oreilles immenfes ; il y a des
peuples entiers à qui elles defeendent jufque fur les
épaules. Cette nation aime les cheveux noirs & lés
dents blanches ; & la nation voifine idolâtre les cheveux
blancs & les dents noires. Celle - ci s’arrache
les deux dents du milieu de la mâchoire fupérieure,
& celle-là fe perce la mâchoire inférieure. L’une fe
met une cheville tout-au-travers du nez, & l’autre
y attache des anneaux à tous les cartillages. Le Chinois
a le vifage plat & carré ; & le front du Siamois
fe retréciflant en pointe autant que le menton, forme
un Iofange. Le Perfan veut des brunes, &c le Turc
des roufles. Ici les teints font rouges ou jaunes, & là
verds ou bleus. Enfin, car ce détail feroit immertfe,
tous les hommes fe figurent leurs dieux fort beaux,
& les diables fort laids ; mais par-tout où les hommes
font blancs, les dieux font blancs &: les diables noirs;
& par-tout où les hommes font noirs, les dieux font
noirs & les diables blancs.
Quel affreux fpe&acle, me dites-vous ! j’en con-
Tomc F J , ,
viens; mais je rémarque par-tout dans lés yetix des
amans, le même feu,& la même langueur. On jure au
nez court & aux vaftes oreilles d’une belle, la même
ardeur & la mêmé confiance que vous jurez à la petite
bouche & aux grands yeux de celle qui vous
charme.
N’allez pas m’oppofer que ce font des barbares ;
les Afiatiques, & parmi eux les Chinois, ne le font
point-du-tout. Les Grecs & les Romains dont le bon
goût eft reconnu, & à qui nous devons nos meilleures
idées fur le beau, n’étoient pas plus d’accord entré
eux & avec vous. Les premiers aimoient de grands
& de gros yeiix, & les autres de petits fronts & des
fourcils croifés. Des beautés greqùes & romaines ne
feroient aflïirément pas une beauté françoife, italienne
ou angloife, &c.
Tous les coeurs, dites-vous, voîént au-devant de
celle que j’aime. Tous les amans parlent ainfi : & je
fai mille autres femmes de qui l’on en dit autant ;
qui n’ont point le moindre trait de reffemblancé
avec l’objet que vous préférez. Bien plus, interrogeons
fes prétendus adorateurs. L’un eft épris de fé
bouche, l’autre eft enchanté de fa taille ; celui-ci
adore fes yeux, celui-là ne voit rien de comparable
à fon teint; il y en a qui aiment en elle des qualités
qu’elle n’a pas. Aucun n’a été bleffé du même trait,
& tous s’étonnent qu’on puiffe l’avoir été d’un autre.
Vous-même, avez-vous eu toujours les mêmes
goûts ? Oppofez vos amours d’un tems à vos amours
d’un autre ; & par la contradi&ion qui en réfulte *
jugez de Vos idées.
Je ne fuis donc pas plus eciairé, malgré vos pro-
mefles, que je ne l’étois auparavant. La revue que
nous avons faite des différens peuples de la Terre i
bien loin de nous fixer dans nos recherches, n’a fervi
qu’à y jetter plus de difficulté. Il n’en eft pas ainfi
du beau en général ; car quand la définition que j’en
donnerois ne vous fatisferoit pas, je ne ferais pas
du moins en peine de vous montrer des modèles qui
enleveroient tous les fuffrages. Tous les peuples de
la Terre admireroient la façade du Louvre, les jardins
de Verfailles & de Marli, l’églife de S. Pierre à
Rome, ep un mot les merveilles de,ce genre qui
font réparMues dans le Monde. Les chef-d’oeuvres
des Raphaël, des Michel^Ange, desTitiens, des
Rubens, des le Bruns, des Pugets, des Giraxdons ,
frapperont quiconque aura des yeux. L’Iliade, l’E-
néïde , Rodogune , Athalie , & c . ferdnt toujours
& par-tout les délices dès amateurs des Belles-
Lettres. Enfin ce qui fera réellement beau chez
l’un, fera beau chez l’autre ; . l ’on en rendra rai^
fon, l’on en donnera même des réglés. Foye% Be a u .
II n’en fera pas de même de la beauté. Tranfportez
une Françoife à la Chine & une Chinoife à Paris ,
elles exciteront beaucoup de curiofité, fi vous voulez
, mais pas à beaucoup près autant de fentimens ;
& ces deux peuples fi oppofés.dans leur goût , ne fe
céderont rien l’un à l’aütre.
Si l’Androgyne de Platon, étoit aufli vrai qu’il eft
ingénieufement trouvé (voye£ Androgyne) , rien
ne feroit fi facile que là folution de ce problème^
Effayons de le dénouer ft’une autre façon. - r.
L’intérêt, les paflions , les préjugés, les ufages
les moeurs, le climat, l’âgë,'le tempérament, agiG
fent diverfement fur chaque individu 6c doivent
produire par conféquent une variété infinie deTentations.
Notre imagination qut nous fert fi bien dans toutes
les pecafions, fe furpàffe dans celles de Çe genre :
elle ne nous laifle Voir que par fes yeux ; & cette
enchantereffe nous déguife fi bien fes caprices , qu’elle
nous les fait adorer., ,
Si l’on me demandoit donc' à-prefent ce qua c’eft
que la beauté, je dirojs. que dp même que chaque
F F f f f