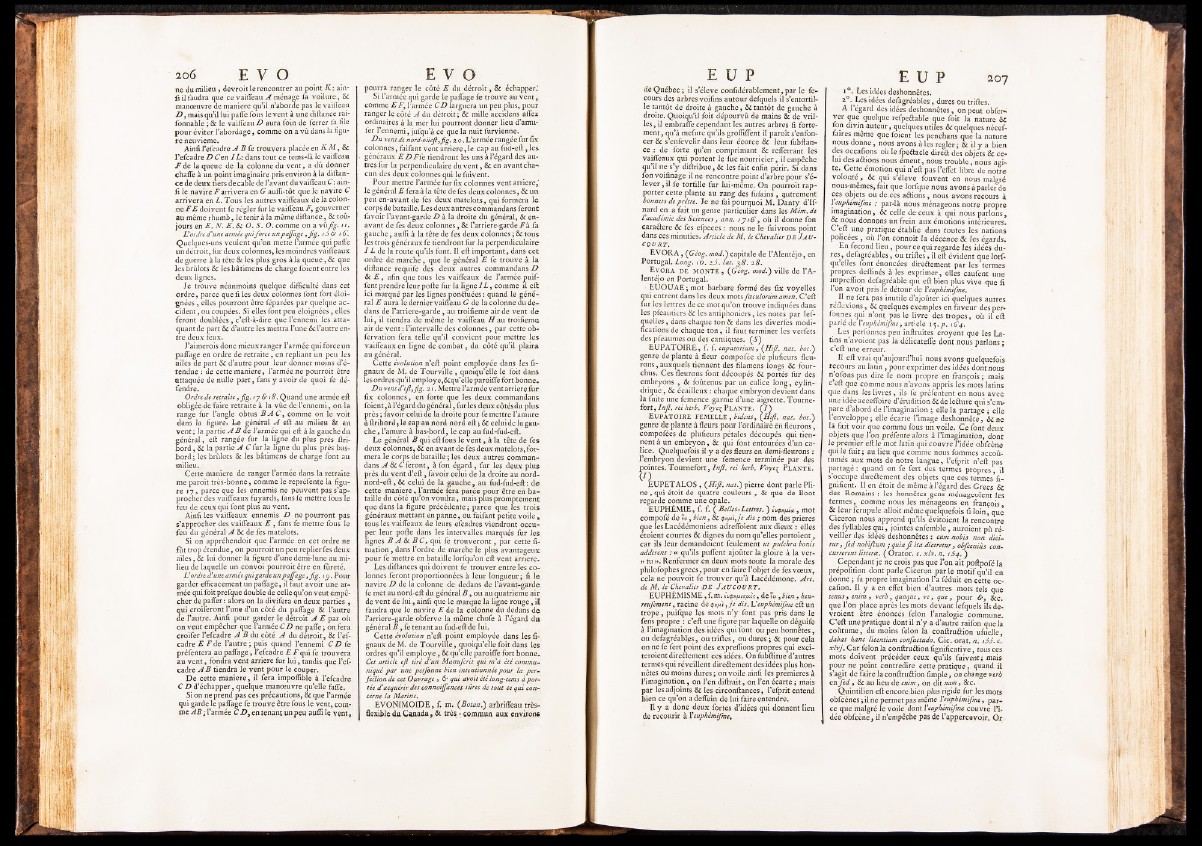
ne du milieu , devroit le rencontrer au point K : ainfi
il faudra que ce vaiffeau A ménage fa voilure, &
manoeuvre de maniéré qu’il n’aborde pas le vaiffeau
Z>, mais qu’il lui paffe fous lèvent à une diftance rai-
fonnable ; & le vaiffeau D aura foin de ferrer fa file
pour éviter l’abordage, comme on a vu dans la figure
neuvième.
Ainli l’efcadre A B fe trouvera placée en K M
l ’efcadre D C en IL : dans tout ce tems-là le vaiffeau
F de la queue de la colonne du vent, a dû donner
chaffe à un point imaginaire pris environ à la diftance
de deux tiers de cable de l’avant du vaiffeau C : ainfi
le navire F arrivera en G aufti-tôt que le navire C
arrivera en L. Tous les autres vaiffeaux de la colonne
F E doivent fe régler fur le vaifleau Fy gouverner
au même rhumb ,.Ie tenir à la même diftance, & toû-
jours en E. N. E. & O. S. O. comme on a vu fig- " •
Vordre d’une armée qui force un pajfage , fig. iS & / 6V
Quelques-uns veulent qu’on mette l’armée qui paffe
un détroit, fur deux colonnes, les moindres vaiffeaux
de guerre à la tête & les plus gros à la queue, & que
les brûlots & les bâtimens de charge foient entre les
deux lignes.
Je trouve néanmoins quelque difficulté dans cet
ordre, parce que fi les deux colonnes font fort éloignées
, elles pourront être féparées par quelque accident
, ou coupées. Si elles font peu éloignées, elles
feront doublées, c’eft-à-dire que l’ennemi les attaquant
de part & d’autre les mettra l’une & l’autre entre
deux feux.
J’aimerois donc mieux ranger l’armée qui force un
paffage en ordre de retraite, en repliant un peu les
ailes de part & d’autre pour leur donner moins d’étendue
: de cette maniéré, l’armée ne pourroit être
attaquée de nulle part, fans y avoir de quoi fe défendre.
Ordre de retraite, fig. iy& i8 . Quand une armée eft
obligée-de'faire retraite à la vûe de l’ennemi, on la
range fur l’angle obtus B A C , comme on le voit
dans la figure. Le général A eft au milieu & ait
vent; la partie A B de l ’armée qui eft à la gauche du
général, eft rangée fur la ligne du plus près ftri-
bord, & la partie A C fur la ligne du plus près bas-
bord; lés brûlots & les bâtimens de charge font au
milieu.
Cette maniéré de ranger l’armée dans la retraite
me paroît très-bonne, comme le repréfente la figure
1 7 , parce que les ennemis ne peuvent pas s’approcher
des vaiffeaux fuyards, fans fe mettre fous le
feu de ceux qui font plus au vent.
Ainfi les vaiffeaux ennemis D ne pourront pas
s’approcher des vaiffeaux E , fans fe mettre fous le
feu du général A & de fes matelots.
Si on appréhendoit que l’armée en cet ordre ne
fût trop étendue, on pourroit un peu replier fes deux
ailes, & lui donner la figure d’une demi-lune au milieu
de laquelle un convoi pourroit être en fureté.
Vordre d'une armée qui garde un pajfage ffig. 1 C). Pour
garder efficacement un paffage, il faut avoir une armée
qui foit prefque double de celle qu’on veut empêcher
de paffer : alors on la divifera en deux parties ,
qui croiferont l’une d’un côté du paffage & l’autre
de l’autre. Ainfi pour garder le détroit A E par où
on veut empêcher que l’armée C D ne paffe ; on fera
croifer l’efcadre A B du côté A du détroit, & l’efcadre
E F de l’autre ; puis quand l’ennemi C D fe
préfentera au paffage, l’efcadre E F qui fe trouvera
au v ent, fondra vent arriéré fur lui, tandis que l’efcadre
A B tiendra le vent pour le couper.
D e cette maniéré, il fera impoflible à l’efcadre
C D d’échapper, quelque manoeuvre qu’elle faffe.
Si on ne prend pas ces précautions, & que l’armée
qui garde le paffage fe trouve être fous le vent, comme
A B ; l’armée C D , en tenant un peu aulfi le vent,
pourra raiiger le côté E du détroit, & échapper.'
Si l’armée qui garde le paffage fe trouve au v ent,
comme E F, l’armée C D larguera un peu plus, pour
ranger le côté A du détroit; & mille accidens affez
ordinaires à la mer lui pourront donner lieu d’amu-
fer l’ennemi, jufqu’à ce que la nuit furvienne.
Du vent de nord-oiiejl,fig. 2 o. L’armée rangée fur fix
colonnes, faifant vent arriéré, le cap au fud-eft, les
généraux E D F ie tiendront les uns à l’égard des autres
fur la perpendiculaire du vent, & en avant chacun
des deux colonnes qui le fuivent.
Pour mettre l’armée fur fix colonnes vent arriéré,'
le général E fera à la tête de fes deux colonnes, & un
peu en-avant de fes deux matelots, qui formera le
corps de bataille. Les deux autres commandans feront
favoir l’avant-garde D à la droite du général, & en-
avant de fes deux colonnes, & l’arriere-garde -F à fa
gauche, auffi à la tête de fes deux colonnes ; & tous
les trois généraux fe tiendront fur la perpendiculaire
/ L de la route qu’ils font. Il eft important, dans cet
ordre de marche, que le général E fe trouve à la
diftance requife des deux autres commandans D
& E , afin que tous les vaiffeaux de l’armée puif-
fent prendre leur pofte fur la ligne I L , comme il eft
ici marqué par les lignes ponûuées : quand le général
E aura le dernier vaiffeau G de la colonne du dedans
de l’arriere-garde, au troifieme air de vent de
lui, il tiendra de même le vaiffeau H au troifieme
air de vent : l’intervalle des colonnes, par cette ob-
fervation fera telle qu’il convient pour mettre les
vaiffeaux en ligne de combat, du côté qu’il plaira
au général.
Cette évolution n’eft point employée dans les fi-
gnaux de M. de Tourville , quoiqu’elle le foit dans
les ordres qu’il employé,&qu’elle paroiffe fort bonne.
Du vent d'ejl, fig. 21. Mettre l’armée vent arriéré fur
fix colonnes, en forte que les deux commandans
foient,à l’égard du général, furies deux côtésdu plus
près ; favoir celui de la droite pour fe mettre l’amure
à ftribord, le cap au nord-nord-eft ; & celui de la gauche
, l’amure à bas-bord, le cap au fud-fud-eft.
Le général B qui eft fous le v en t, à la tête de fes
deux colonnes, & en avant de fes deux matelots, formera
le corps de bataille ; les deux autres commandans
A &cCferont, à fon égard, fur les deux plus
près du vent d’e ft , favoir celui de la droite au nord-
nord-eft , & celui de la gauche , au fud-fud-eft : de
cette maniéré, l ’armée fera parée pour être en bataille
du côté qu’on voudra, mais plus promptement
que dans la figure précédente ; parce que les trois
généraux mettant en panne, ou faifant petite voile ,
tous les vaiffeaux de leurs efeadres viendront occuper
leur pofte dans les intervalles marqués fur les
lignes B A & B C , qui fe trouveront, par cette fi-
tuation, dans l’ordre de marche le plus avantageux
pour fe mettre en bataille lorfqu’on eft vent arriéré.
Les diftances qui doivent fe trouver entre les colonnes
feront proportionnées à leur longueur; fi le
navire D de la colonne de dedans de l’avant-garde
fe met au nord-eft du général B , ou au quatrième air
de vent de lu i, ainfi que le marque la ligne rouge, il
faudra que le navire E de la colonne du dedans de
l’arriere-garde obferve la même chofe à l’égard du
général B , fe tenant au fud-eft de lui.
Cette évolution n’eft point employée dans les fi-
gnaux de M. de Tourville, quoiqu’elle foit dans les
ordres qu’il employé, & qu’elle paroiffe fort bonne.
Cet article efi tiré d’un Manufcrit qui m'a été communiqué
par une perfonne bien intentionnée pour la perfection
de cet Ouvrage , & qui avoit été long-tems à portée
d'acquérir des connoijfanccs sures de tout ce qui concerne
la Marine.
EVONIMOIDE, f. m. (Botan.) arbriffeau très-
flexible du Canada, & très : commun aux environs
de Québec ; il s’élève confidérablement, par le fe-
cours des arbres voifins autour defquels il s’entortille
tantôt de droite à gauche, & tantôt de gauche à
droite. Quoiqu’il foit dépourvû de mains & de vrilles
, il embraffe cependant les autres arbres fi fortement
, qu’à mefure qu’ils groffiffent il paroît s’enfoncer
& s’enfevelir dans leur écorce & leur fubftan-
ce : de forte qu’en comprimant & refferrant les
vaiffeaux qui portent le fuc nourricier, il empêche
qu’il ne s’y distribue, & les fait enfin périr. Si dans
ion voifinage il ne rencontre point d’arbre pour s’élever
, il fe tortille fur lui-même. On pourroit rapporter
cette plante au rang des fufains , autrement
bonnets de prêtre. Je ne fai pourquoi M. Danty d’If-
nard en a fait un genre particulier dans les Mém. de
l academie des Sciences , ann. / y 16 , où il donne fon
caraélere & fes efpeces : nous ne le fuivrons point
dans ces minuties. Article de M. le Chevalier d e Ja u -
COV R T .
E VO R A , (Géog. mod.') capitale de l’AIentéjo, en
Portugal. Long. iO. 2S. lat. g 8. 28.
Evo ra de m o nt e , ([Géog. mod.) ville de l’AIentéjo
en Portugal.
EÜOUAE; mot barbare formé des fix voyelles
qui entrent dans les deux mots foeculordmamen. C ’eft
fur les lettres de ce mot qu’on trouve indiquées dans
les pfeautiers & les antiphoniers, les notes par Ief-
quelles, dans chaque ton & dans les diverfes modifications
de chaque ton, il faut terminer les verfets
des pfeaumes ou des cantiques. (51)
EUPATOIRE, f. f. eupatorium, (Hifi. nat. bot.)
genre de plante à fleur compofée de plufieurs fleurons,
auxquels tiennent des filamens longs & fourchus.
Ces fleurons font découpés & portés fur des
embryons , & foûtenus par un calice long, cylindrique
, & écailleux : chaque embryon devient dans
la fuite une femence garnie d’une aigrette. Tourne-
fort,Infi. rei herb. Voye^Plante, (ƒ )
Eu pa to ir e femelle , bide ns, (Hifi. nat. bot.)
genre de plante à fleurs pour l’ordinaire en fleurons,
compofées de plufieurs pétales découpés qui tiennent
à un embryon, & qui font entourées d?un calice.
Quelquefois il y a des fleurs en demi-fleurons :
l’embryon devient une femence terminée par des
pointes. Tournefort, Infi. rei herb. Voye£ Plan t e .
EUPETALOS , (Hifi. nat.) pierre dont parle Pline
, qui étoit de quatre couleurs , & que de Boot
regarde comme une opale.
EUPHÉMIE, f. f. (Belles-Lettres. ) lvtpnfj.la. , mot
compofé de îv , bien , & tpufije dis ; nom des prières
que les Lacédémoniens adreffoient aux dieux : elles
étoient courtes & dignes du nom qu’elles portoient,
car ils leur demandoient feulement ut pulchra bonis
adderent : « qu’ils puffent ajouter la gloire à la ver-
» tu ». Renfermer en deux mots toute la morale des
philofophes grecs, pour en faire l’objet de fes voeux,
cela ne pouvoit fe trouver qu’à Lacédémone. Art.
de M. le Chevalier D E J A U COU R T .
EUPHÉMISME, f. m. tvqmjxurpoç, de tu, bien, keu-
reufement, racine de tpnfii }je dis. \d euphémifme eft un
trope, puifque les mots n’y font pas pris dans le
fens propre : c’eft une figure par laquelle on déguife
à l’imagination des idées qui font ou peu honnêtes,
ou defagréablgs, ou trilles, ou dures; & pour cela
on ne fe fert point des expreffions propres qui exci-
teroient dire&ement ces idées. On fubftitue d’autres
termes qui réveillent directement des idées plus honnêtes
ou moins dures ; on voile ainfi les premières à
l’imagination, on l’en diftrait, on l’en écarte ; mais
par les adjoints & les circonftances, l’efprit entend
bien ce qu’on a deffein de lui faire entendre.
Il y a donc deux fortes d’idées qui donnent lieu
de recourir à l'eupkémifme,
1 °. Les idées deshonnêtes.
1 °-îLes idées defagréables, dures ou trilles.
A l’égard des idées deshonnêtes, on peut obfer*i
ver que quelque refpeétable que foit la nature &c
fon divin auteur, quelques utiles & quelques nécef-
farres meme que foient les penchans que la nature
nous donne, nous avons à les regler; & il y a bien
des occafions ou le Ipeâacle direct des objets & celui
des allions nous émeut, nous trouble, nous agite.
Cette émotion qui n’eft pas l’effet libre de notre
volonté: , & qui s’élève fouvent en nous malgré
nous-memes, fait que lorfque nous avons à parler de
ces objets ou de, ces a étions, nous avons recours à
1 euphemifme : par-là nous ménageons notre propre
imagination, & celle de ceux à qui nous parlons,
& nous donnons un frein aux émotions intérieures.
C eft une pratique établie dans toutes les nations
policées , où l’on connoît la décence & les égards.
En fécond lieu, pour ce qui regarde les idées dures^,
defagreables, ou trilles, il eft évident que lorl-
qu’elles font énoncées direâement par les termes
propres deftinés à les exprimer, elles caufent une
impreffion defagréable qui eft bien plus vive que li
l’on avoit pris le détour de l'euphémifme.
' Il ne fera pas inutile d’ajoûter ici quelques autres
reflexions, & quelques exemples en faveur des per-
fonnes qui n’onç. pas le livre des tropes, où il eft
parlé de Veuphémifme, article 1 5 ./ . 1G4.
Les personnes peu inftruites croyent que les Latins
n’avoient pas la délicateffe dont nous parlons ;
c’eft une erreur.
Il eft vrai qu’aujourd’hui nous avons quelquefois
recours au latin, pour exprimer des idées dont nous
n’ofons pas dire le nom propre en françois ; mais
c’eft que comme nous n’avons appris les mots latins
que dans les livres, ils fe préfentent en nous avec
une idée acceffoire d’érudition ôc de leélure qui s’env
pare d’abord de l’imagination ; elle la partage ; elle
l’enveloppe; elle écarte l’image deshonnête, & n e
la fait voir que comme fous un voile. Ce font deux
objets que l’on préfente alors à l'imagination, dont
le premier eft le mot latin qui couvre l'idée obfcène
qui le fuit ; au lieu que comme nous fommes accoû-
tumés aux mots de notre langue, l’efprit n’eft pas
partagé : quand on fe fert des termes propres il
s’occupe direélement des objets que ces termes lignifient.
Il en étoit de même à l’égard des Grecs &
des Romains : les honnêtes gens ménageoient les
termes, comme nous les ménageons en françois
& leur fcrupule alloit même quelquefois fi loin, que
Cicéron nous apprend qu’ils évitoient la rencontre
des fyllables q ui, jointes enfemble, auroient pû réveiller
des idées deshonnêtes : cum nobis non dici-
tur , fed nobijium ; quia f i ita diceretur , obfceniàs concurrent
Huera. ( Orator. c. xlv. n. tSq. )
Cependant je ne crois pas que l’on ait poftpofé la
prépofition dont parle Cicéron par le motif qu’il en
donne ; fa propre imagination l’a féduit en cette oc-
cafion. Il y a en effet bien d’autres mots tels que
tenus, enim , ver b , quoque ,v e s que, pour &y &c.
que l’on place après les mots devant lefquels ils de-
vroient être énoncés félon l’analogie commune.
C ’eft une pratique dont il n’y a d’autre raifon que la
coûtume, du moins félon la conftruélion ufuelle,
dabat hanc licentiam confuetudo. Cic. orat. n. iJJ. c.
xlvj. Car félon la conftruétion fignificative, tous ces
mots doivent précéder ceux qu’ils fuivent; mais
pour ne point contredire cette pratique, quand il
s’agit de faire laconftruftion fimple, on change verb
en fed , & au lieu de enim, on dit nam, & o
Quintilien eft encore bien plus rigide fur les mots
obfcènes ; il ne permet pas même Veuphémifme , parce
que malgré le voile dont l'eupkémifme couvre l’idée
obfcène, il n’empêche pas de l’qppercevoir, Qr