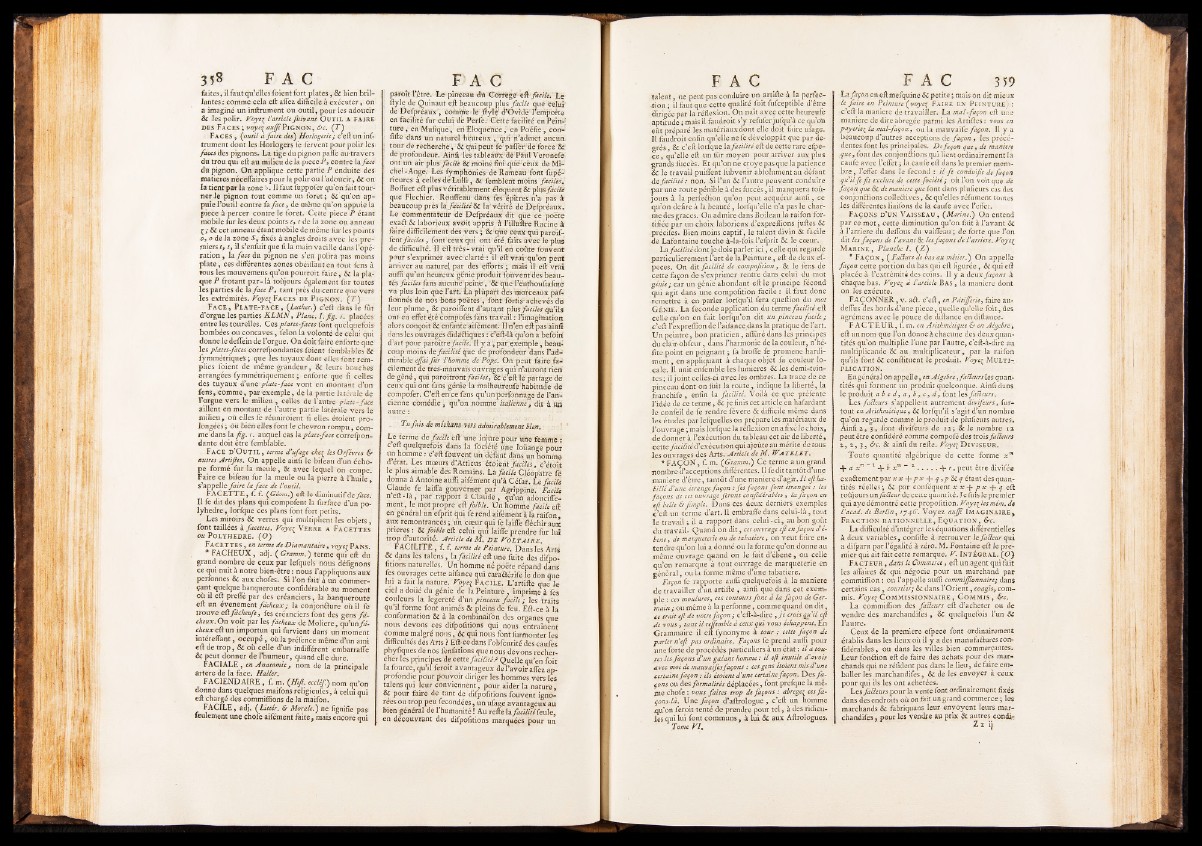
I 1 Ü
fa i te s , i l fa u t q if f ë l le s fo ie n t f o r t p l a t e s , & b ie n b r illa
n te s : comme: c e la e ft a lle z d iffic i le à e x é c u t e r , o n
a im a g in é u n in f in im e n t :ou o u t i l , p o u r les a d o u c ir
& le s p o lir . Foyt{ L'article fuivant O u t i l A FAIRE
DES F a c e s ; voyez aufliViGnoü, &e. (T )
• FA C E S , (outil a faire des) Horlogerie; c’eft un inf-
trument dont les Horlogers fe fervent pour polir les-
faces des pignons. La tige du pignon paffe au-travers
du trou qui eft au milieu de la pièce contre la face
du pignon. On applique cette partie P enduite des
matières néceflaires pour la polir ou l ’adoucir, & on
la tient parla zone 5. Il faut fuppofer qu’on fait tourner
Je pignon tout comme un foret ; & qu’on appuie
l ’outil contre fa face, de même qu’on appuie la
piece à percer contre le foret. Cette pièce P étant
mobile fur les deux points t , t de la zone on anneau
çy & cet anneau étant mobile de même fur les points
o, o de la zone S , fixés à angles droits avec les pre-;
tniers t, t, il s’enfuit que fi la main vacille dans l’opération
, la face du pignon ne s’en polira pas moins
plate, ces différentes zones obéiffant en tout fens à
tous les mouvemens qu’on pourroit faire, & la plaque
P frotant par-là toujours également fur toutes
les parties de la face P , tant près du-centre que Vers
les extrémités. Foye^P a.ces de Pign on. ( F )
F a c e , P l a t e - f a g e , {Luther.) c’eft dans le fût
d’orgue les parties KLM N , Plane. I .f ig .i. placées
entre les tourelles. Ces plaies-faces font quelquefois^
bombées ou concaves, félon la volonté de celui qui
donne le deffein de l’orgue. On doitfaireenforte que
les plaies-faces correfpondantes foient femblables &•
fymmétriqueS ; que les tuyaux dont elles font remplies
foient de même grandeur, & leurs bouches'
arrangées fymmétriquement ; enforte que fi celles
des tuyaux d’un & plaie-face vont en montant d’un
fens, comme, par exemple, de la partie latérale de
l’orgue vers le milieu , celles de 1’autpe plate -face
aillent en montant de l’autre partie latérale vers lé
milieu, oii elles fe réuniroient fi elles étoiênt prolongées
; ou bien elles font le chevron rompu comme
dans la fig. /. auquel cas la plate-face correfpon-
dante doit être femblable.
F a c e D’O U T I L , terme d'ufage che%_ les Orfèvres &
autres Artijles. On appelle ainfi le bifeau d’un écho-
pe formé fur la meule, & avec lequel on coupe.
Faire ce bifeau fur la meule ou la pierre à l ’huile,
s’appelle faire la face de l'outil.
FA CE TTE , f. f. (Géom.) eft le diminutif de face.
Il fe dit des plans qui compofent la furface d’un po-
lyhedre, lorfque ces plans font fort petits.
Les miroirs & verres qui multiplient les objets,
font taillées à facettes. Foyei V e r r e a F a c e t t e s
ou POL YH ED R E . (O)
F A C E T T E S , en terme de Diamantaire y voyeç P a n s .
* FACHEUX, adj. ( Gramm. ) terme qui eft du
grand nombre de ceux par lefqüels nous défignons
ce qui nuit à notre bien-être : nous l’appliquons aux
perfonnes & aux chofes. Si l’on faiü à un commerçant
quelque banqueroute confidérable au moment
où il eft preffé par des créanciers, la banqueroute
eft un evenement fâcheux ; la conjoncture où il fe
trouve efàfdcheufe, fes créanciers font des gens fâ cheux.
On voit par les fâcheux de Moliere, cfann fâcheux
eft un importun qui furvient dans un moment
intereffant, occupe, ou la préfence même d’un ami !
eft de trop, & où celle d’un indifférent embarrafle
& peut donner de l’humeur, quand elle dure.
FACIALE, en Anatomie 3 nom de la principale
artere de la face. Haller.
FACIENDAIRE, f. m. (H fi. cccléf.) nom qu’on
donne dans quelques maifons religieufes, à celui qui
eft chargé des commiffions de la maifon.
FACILE, adj. ( Littér. & Morale.) ne lignifie pas
feulement une chofe aifément faite, mais encore qui
; pâroît l’être. Le pinceau d û ‘Cori^gé-eft Lé
| ftyle de Quinaut eft beaucoup plus facile que fcelùp
de DefpréauV, cofnmte{le wyîe crOvide l ’emporte
en facilité fur celui de Perlé;' Cette'facilité en Pein-?
tùrè ; en Mufiqué eri ÉtoquéùCe ,0fen Poçfie, con-
.■ ftftfe *danS un naturel -hetireux ,:'qitïJ ri’àdmet aucun
j tour de recherche , & qüi peut fé ' pafféi" de force 8ç
j de profondeur. Ainfi-l'es tableàtÛïPdé P&ül Vetonèfei
j ont un air plus' facile 8£moins, fîhf qùe!i cëux de Mi-
! chel-Ange. Les fymphoniés 'dù Rameau'font fupé-
; rieures à Celles!dé Lüllr, & femblerif inoïns faciles 1
Boffuet eft plus' véritablement éloquent &
que Flechier. RpüîTeàu dans fe$ cintres n’a pas à
beaucoup près la facilite & la vérité de Defpréaux.
Le commentateur de Defpréaux dit que ce poète
exaCt & laborieux avdit appris/ à I’illnftre Racine à
faire difficilement dés vers ; '& q ü e Ceux qui pardif-
fent faciles, font1 ceux qui o n f été. faits aVec le plus
de difficulté, f l éft très -vrai qn’il en coûte fouvent
pour s'exprime* aveC-cIarté : il eft vrai'qu’on peut
arriver au naturel par des efforts.; mais il eft vrai
auffi qu’un héutieitx génie prodüù’ffoûvénf des beautés
faciles fans aücutfe'peiné, '& 'qne-I’ën¥houfiafme
va plus loin qùéfai't. Là plupart desiûoirceaüx pàf*
fiohnés de nos-bons'pdetes', font fôrti^kchèvés de
leur plume , & paroiffent d’aytant plus faciles qu’ils
ont-en effet été compbfés fans travail : l’imagiûation
alors conçoit & enfante aifémenri II n’en eft pas àinlî
dans les ouvragés didactiques :d’ëft-là qu’où a befôitf
d’art pour pâroîtré/açfte. Il y à parexeùiple, beaucoup
moins de faàtïcé que de profondeur dans l’ad-
mirabié èffai f tir l'homme, dePàpç. Oiipeut' fa ire fa -
cilement de très-mauvais Ouvrages qui Sauront rien
de gêné, qui pztdiiràntfaciles, & c’çft le part'age de
ceux qui ont fans génie la malheütepfe habitude de
compofer. C ’éft en'ce fens qu’un‘jj'erfonnage de l’ancienne
comédie, qli’on nomme italienne, dit à.Uil
autre :
- l'jt fiis de mechafis vers admirablement bien. r ’
Le terme de facile ëft uûê irijttrë poiir une femme ;
c eft quelquefois dàfls là fôciéte uÂè foüà'nge poût
iin homme : c’eft foitvent iih défaut dans un Hômmë
d’etàt. Les moeurs d’Atticüs ëtÔièrît faciles, C’étoit
le plus aimable des Romaihs. La facile Ciéôp'âtrê fô
donna à Antoine aitffi kïfémëfit qu’à Céfat, Lè facili
Claude fe laiffa gouvérnef paf Agrippiné. Facile
n’eft - l à , par rapport à Claude , qu’un àdôuciffe-
ment, le mptpropfê & faible. Üriliomme facile eft
en général un efprit «qui ferénd aiféiiient à la fâifon,
âux remontrances ; un coeur qui fe laiflë fléchir aux
prières : & faible eft celui qui Iaifle prendre fur lui
trop d’autorité. Article de M. d e V o l t a ir e .
FACILITÉ, f. f. terme de Peinture. Dans lés Arts
& dans les talens, la,facilité eft une fuite des difpo-
fitions naturelles. Un homme né poète répand dans
fes ouvrages Cette aifance qui caraaériféle don que
hu à fait la nature. Foye{ F A C I L E . L’artifte que le
ciel a doiié du génie de la Peinturé, imprime à fes
Couleurs la legerèté d’un pinceau facile; les traits
qu’il forme font animés & pleins de feu. Eft-ce à la
conformation & à la combinaison des organes que
nous devons ces difpofîtions qui nous entraînent
comme malgré nous, & qui nous font furmonter les
difficultés des Arts ? Eft-ce dans l’obfcurité des caufes
phyfiques de nôs fenfations que nous devons rechercher
les principes de cette facilité ? Quelle qu’en foit
lafource, qu’il feroit avantageux de l’avoir affez approfondie
pour pouvoir diriger les hommes vers les
talens qui leur conviennent, pour aider la nature,
& pour faire de tant de difpofîtions fouvent ignorées
ou trop peu fécondées, un ufage avantageux au
bien général de l’humanité! Au reftelafacilité(eule,
en découvrant des difpofitions marquées pour un
\ lW Sm
l l i
talent, ne peut pas conduire un artifte à la perfection
; il faut que cette qualité foit fufceptible d’être
dirigée par la réflexion. On naît avec cette heureufe
aptitude ; mais il faudroit s’y refufer julqu’à ce qu’où
eût préparé les matériaux dont elle doit faire ufage.
Il faudroit enfin qu’elle ne fe développât que par degrés
, & c’eft-lorfque.la facilité eft de cette rare efpe-
c e , qu’elle eft un fur moyen pour arriver aux plus
grands fuccès. Et qu’on ne croye pas que la patience
6c le travail puiffent fubvenir abfolument au défaut
de facilité: non. Si l’un & l’autre peuvent conduire
par une route pénible à des fuccès, il manquera toujours
à la perfe&ion qu’on peut acquérir ainfi, ce
qu’on defire à la beauté, lorfqu’elle n’a pas le charme
des grâces. On admire dans Boileau la raifon fortifiée
par un ehoix laborieux d’éxpreflions juftes Sé
précifes. Bien moins captif, le talent divin & facile
de Lafontaine touche à-la-fois l’efprit & le coeur.
La facilité dont je dois parler ic i , celle qui regarde
particulièrement l’art de la Peinture, eft de deux ef-
peces. On dit facilité de ;compoJîtion , & le fens. de
cette façon de s’exprimer rentre dans celui du mot
■ génie; car un génie abondant eft le principe fécond
qui agit dans une compolition facile : Il faut donc
remettre à en parler iorfqu’il fera queftion du mot
G é n ie . La fécondé application du terme facilité eft
celle qu’on en fait lorfqu’on dit un pinceau facile;
c ’eft l ’expreflion de l’ailance dans la pratique de l’art.
Un peintre, bon praticien, affûré dans les principes
du clair-obfcur, dans l’harmonie de la couleur, n’hé-
fite point en peignant ; fa broffe fe promene hardiment
, en appliquant à chaque objet fa couleur locale.
Il unit enfemble les lumières & les demi-teintes;
il joint celles-ci avec les ombres. La trace de ce
pinceau dont on fuit la route, indique la liberté, la
franchife, enfin la facilité. Voilà ce que préfente
l’idée de ce terme, je finis cet article en hafardant
le confeil de fe rendre févere & difficile même dans
les études par lefquelles on prépare les matériaijx de
l ’ouvrage ; mais lorfque la réflexion en a fixé le choix,
de donner à l’exécution du tableau cet air de liberté,
cette facilité d’exécution qui ajoûte au mérite de tous
les ouvrages des Arts. Article de M. W a t e l e t .
* FA ÇO N , £ m. ( Gramm.) Ce terme a un grand
nombre d’acceptions différentes. Il fe dit tantôt d\me
maniéré d’être, tantôt d’une maniéré d’agir. I l efl habillé
d'une étrange façon : fes façons font étranges : les
façons de cet ouvrage feront confidèrables , la façon en
eft belle & fimplc. Dans ces deux derniers, exemples
c ’eft un terme d’art. Il embraffe dans celui-là, tout
le travail ; il a rapport dans ce lu i-c i, au bon goût
du travail. Quand on dit, cet ouvrage efl en façon d'é-
bene, de marqueterie ou de tabatière, on veut faire entendre
qu’on lui a donné ou la forme qu’on donne au
même ouvrage quand on le fait d’ébene , ou celle
qu’on remarque à tout ouvrage de marqueterie en
general, ou la forme même d’une tabatière.
Façon fe rapporte auffi quelquefois à la maniéré
de travailler d’un artifte , ainfi que dans cet exemple
: ces moulures, ces contours font à la façon de Germain;
ou même à la perfonne, comme quand on dit,
ce trait eft de votre façon; c’eft-à-dire , je crois gu'il efl
de vous , tant il refftmble à ceux qui vous échappent. En
Grammaire il eft fynonyme à tour : cette façon de
parler n'efl pas ordinaire. Façons fe prend auffi pour
une forte de procédés particuliers à un état : il a toutes
les façons d'un galant homme : il efl inutile d'avoir
avec moi de mauvaifes façons : ces gens etoient mis d'une
certaine façon : ils étoient d'une certaine façon. Des fa çons
ou des formalités déplacées, font prefque la même
chofe : vous faites trop de façons : abrégéç ces fa çons
là. Une façon d’aftrologue, c’eft un homme
qu’on feroit tenté de prendre pour te l, à des ridicules
qui lui font communs, à lui ài aux Aftrologues.
Tome FI,
La façon en eft mefquine & petite ; mais on dit mieux
le faire en Peinture ( voye[ Fa ir e en Pe in t u r e ) :
c’eft la maniéré de travailler. La mal-façon eft une
. maniéré de dire abrégée parmi les Artiftes : vous en
payeriez la mal-façon, ou.la mauvaife façon. Il y a
beaucoup d’autres acceptions de façon, les précédentes
font les principales. De façon que, de maniéré
gue, font des conjonéHons qui lient ordinairement la
caufe avec l’effet ; la caufe eft dans le premier membre,
l’effet dans le fécond : il fe conduiflt de façon
qu'il fe fit exclure de cette fociété ; oïl l’on voit que de
faço^que Sc de maniéré que font dans plufieurs cas des
conjon&ions colleriives, & qu’elles réfument toutes
.lés différentes liaifons de la caufe avec l’ effet.
Fa ç o n s , d ’u n V a i s s e a u , ( Marine.) On entend
par ce mot, cette diminution qu’on fait à l’avant &
à l’arriere du deffous du vaiffeau ; de forte que l’on
dit les façons de l'avant & les façons de 1'arriéré. Foyeç
M a r in e , Planche I. (Z )
* Fa ç o n , ( Facture de bas au métier.') On appelle
façon cette portion du bas qui eft figurée, & qui eft
placée à l’extrémité des coins. Il y a deux façons à
chaque bas. Foye^ à l'article Ba s , la maniéré dont
on lès exécute.
FAÇONNER, v .a ft. c’eft, en Pâtijférie, faire au-
deffus des bords d’une piece, quelle qu’elle foit, des
agrémens avec le pouce de diftance en diftance.
F A C T E U R , f. m. en Arithmétique & en Algèbre^
eft un nom que l’on donne à chacune des deux quantités
qu’on multiplie l’une par l’autre, c’eft-à-dire ail
multiplicande & au, multiplicateur, par la raifon
qu’ils font & conftituent le produit. F?yeç M u l t i - i
p l i c a t io n .
En général on appelle, tn Algèbre, facteurs les quantités
qui forment un produit quelconque. Ainfi dans
le produit a b c d , a , b, c , d , font les facteurs.
Les fa c t e u r s^ s’appellent autrement d i v i f e u r s , fur-
tout e n A r i t h m é t iq u e , & lorfqu’il s’agit d’un nombre
qu’on regarde comme le produit de plufieurs autres.
Ainfi 2 , 3 , font divifeurs de 12; & le nombre 12
peut être confidéré comme compofé des trois fa c t e u r s
z , 2, 3 , & c . & ainfi du refte. F o y e i D i v i s e u r .
Toute quantité algébrique de cette forme x m
+ a xm~ l -]-bxm~ 2 . . . . . A* r, peut être divifée
exaâementpar x x p x q ,p &cq étant des quan-
I tités réelles ; & par conféquent x x -p p x q eft
toûjours un facteur de cette quantité. Je fuis le premier
qui ayedémontré cette propofition. Foyefaesmém. de
l'acad. de Berlin, ty q -G . Voyez aujji Im a g in a ir e >
Fr a c t io n r a t io n n e l l e , Eq u a t io n , & c .
La difficulté d’intégrer les équations différentielles
à deux variables, confifte à retrouver le facteur qui
a difparu par l’égalité à zéro. M. Fontaine eft le premier
qui ait fait cette remarque. F . In t é g r a l . (O )
F a c t e u r , dans le Commerce , eft un agent qui fait
les affaires & qui négocie pour un marchand par
commiffion : on l’appelle auffi commiffionnaire; dans
certains ca s, courtier; & dans l’Orient, coagis, commis.
Foye^ C o m m is s io n n a ir e , C o m m i s , &c.
La commiffion des facteurs eft d’acheter ou de
vendre des marchandises , & quelquefois l’un &
l ’autre.
Ceux de la première efpece font ordinairement
établis dans les lieux où il y a des manufactures con-
fidérables, ou dans les villes bien commerçantes.
Leur fonCtion eft de faire des achats pour des marchands
qui ne réfident pas dans le lieu, défaire emballer
les marchandifes, & de les envoyer à ceux
pour qui ils les ont achetées.
Les facteurs pour la vente font ordinairement fixés
dans des endroits où on fait un grand commerce ; les
marchands & fabriquans leur envoyent leurs marchandifes,
pour les vendre au prix & autres condir
Z z ij
f
j: