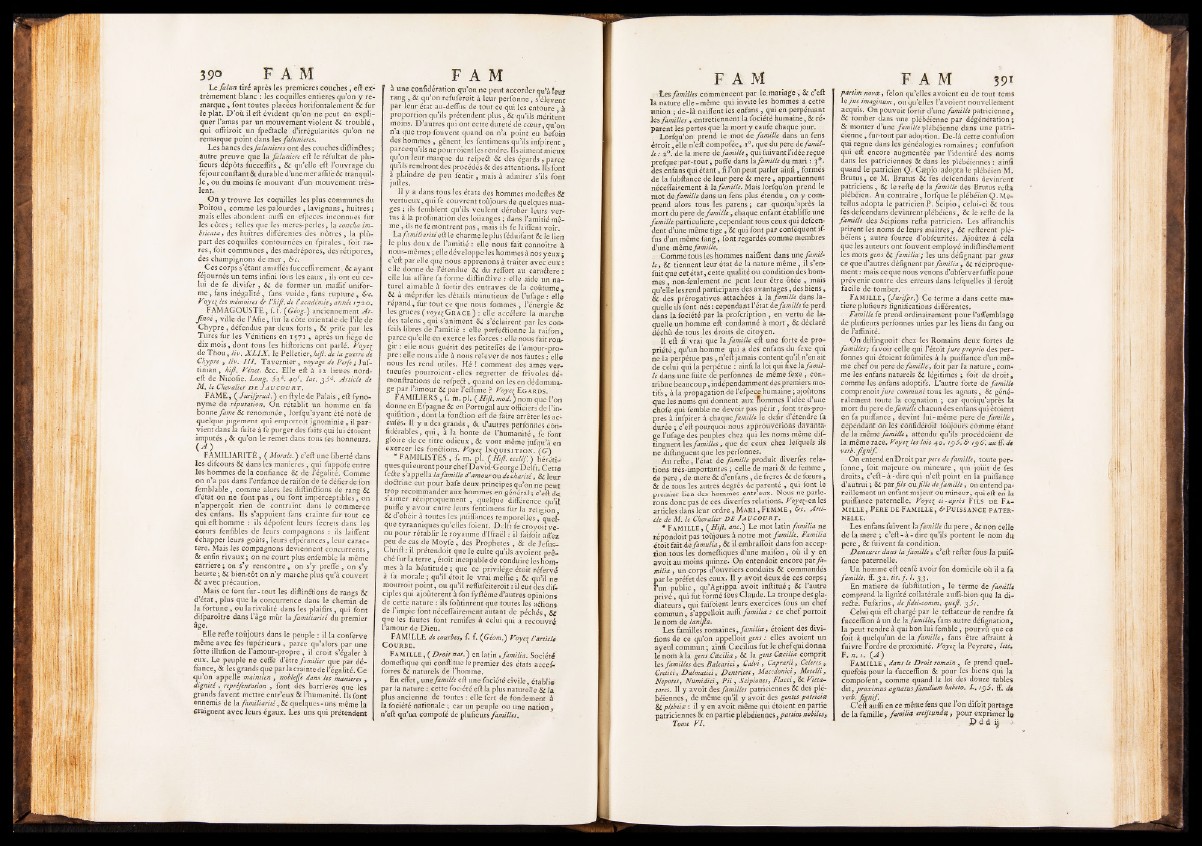
3 9° F A M Le falun tiré après les premières couches, eft extrêmement
blanc : les coquilles entières qu’on y remarque
, font toutes placées horifontalement & fur
le plat. D ’oii il eft évident qu’on ne peut en expliquer
l’amas par un mouvement violent & troublé,
qui offriroit un fpe&acle d’irrégularités qu’on ne
remarque point dans les falunieres.
Les bancs des falunieres ont des couches diftinéles ;
autre preuve que la faluniere eft le réfultat de plu-
fieurs dépôts fuecelîifs , & qu’elle eft l’ouvrage du
féjour confiant & durable d’une mer aflife& tranquille
, ou du moins fe mouvant d’un mouvement très-
lent*
On y trouve les coquilles les plus communes du
Poitou, comme les palourdes , lavignans, huîtres ;
mais elles abondent aufli en efpeces inconnues fur
les côtes ; telles que les meres-perles, la concha im-
bricata , des huîtres différentes des nôtres, la plupart
des coquilles contournées en fpiraies , fort ra-
, res, foit communes, des madrépores, des rétipores,
des champignons de mer, &c.
Ces corps s’étant amaffés fucceflivement. & ayant
féjournés un tems infini fous les eaux, ils ont eu celui
de fe divife r, & de former un maflif uniforme
, fans inégalité , fans vuide, fans rupture , &c.
Voye^les mémoires & l'hiß.de Ü académie, année 1720.
FAMAGOUSTE, f. f. (Géog.) anciennement Ar-
ßno'e , ville de l’Afie, fur la côte orientale de l’île de
Chypre , défendue par deux forts , & pril'e par les
Turcs fur les Vénitiens en 1571 , après un fiége de
dix m ois, dont tous les hiftoriens ont parlé. Foye^
de Thou, Uv. X L IX . le Pelletier, hiß. de ta guerre de
Chypre , liv. I I I . Tavernier , voyage de Perfe; Juf-
tinian, hiß. Fénet. & c . Elle eft à 12 lieues nord-
eft de Nicofie. Long. 5z A. 40'. lat. 36*. Article de
M. le Chevalier DE J AV COURT.
FAME, ( Jurifprud. ) en ftyle de Palais, eft fyno-
nyme de réputation. On rétablit un homme en fa
bonne famé & renommée, lorfqu’ayant été noté de
quelque jugement qui emportoit ignominie , il parvient
dans la fuite à fe purger des faits qui lui étoient
imputés , & qu’on le remet dans tous lès honneurs.
■ h h h FAMILIARITÉ, ( Morale. ) c’eft une liberté dans
les difcours & dans les maniérés , qui fuppofe entre
les hommes de la confiance & de l’égalité. Comme
on n’a pas dans l’enfance deraifon de fe défier de fon
femblable, comme alors les diftinftions de rang &
d’état ou ne font pas , ou font imperceptibles, on
n’apperçoit rien de contraint dans le commerce
des enfans. Ils s’appuient fans crainte fur tout ce
qui eft homme : ils dépofent leurs fecrets dans les
coeurs fenfibles de leurs compagnons : ils laiffent
échapper leurs goûts, leurs efpérances, leur caractère.
Mais les compagnons deviennent concurrents,
& enfin rivaux ; on ne court plus enfemble la même
carrière ; on s’y rencontre , on s’y preffe , on s’y
heurte ; & bien-tôt on n’y marche plus qu’à couvert
& avec précaution.
Mais ce font fur - tout les diftinâions de rangs &
d’état, plus que la concurrence dans le chemin de
la fortune , ou la rivalité dans les plaifirs, qui font
difparoitre dans l’âge mûr la familiarité du premier
âge.
Elle refte toujours dans le peuple : il la conferve
même avec fes fupérieurs , parce qu’alors par une
fotte illufion de l’amour-propre , il croit s’égaler à
eux. Le peuple ne ceffe d’être familier que par défiance,
& les grands que parla crainte de l’égalité. Ce
qu’on appelle maintien , nobleffe dans les manières ,
dignité , repréfentation , font des barrières que les
grands favent mettre entr’eux & l’humanité. Ils font
ennemis de la familiarité, & quelques-uns même la
craignent avec leurs égaux. Les uns qui prétendent
F A M à une confidération qu’on ne peut accorder qu’à Ienf
rang , & qu’on refuferoit à leur perfonne, s elevent
par leur état au-deffus de tout ce qui les entoure à
proportion qu’ils prétendent plus, & qu’ils méritent
moins. D ’autres qui ont cette dureté de coeur, qu’on
n a que trop fouvent quand on n’a point eu befoin
des hommes , gênent les fentimens qu’ils infpirent,
parce qu’ils ne pourroient les rendre. Ils aiment mieux
qu’on leur marque du refpett & des égards, parce
qu’ils rendront des procèdes & des attentions. Ils font
à plaindre de peu fentir , mais à admirer s’ils font
j uftes.
Il y a d a n s t o u s l e s é t a t s d e s h o m m e s m o d e f t e S &T
v e r t u e u x , q u i f e c o u v r e n t t o û j o u r s d e q u e l q u e s n u a g
e s ; i l s l e m b l e n t q u ’ i l s v e u l e n t d é r o b e r l e u r s v e r t
u s à l a p r o f a n a t i o n d e s l o i i a n g e s ; d a n s l ’ a m i t i é m ê m
e , - i I s n e f e m o n t r e n t p a s , m a i s i l s f e l a i f f e n t v o i r .
La familiarité e f t le c h a rm e l e p lu s f é d u i f a n t & l e l i e n
l e p lu s d o u x d e l ’ a m i t i é : e l l e n o u s f a i t c o n n o î t r e à
n o u s -m ê m e s ; e l l e d é v e l o p p e l e s h o m m e s à n o s y e u x ;
c ’ e f t p a r e l l e q u e n o u s a p p r e n o n s à t r a i t e r a v e c e u x :
e l l e d o n n e d e l’ é t e n d u e & d u r e f f o r t a u c a r a & e r e :
e l l e lu i a f f u r e f a f o rm e d i f t i n û i v e : e l l e a i d e u n n a t
u r e l a im a b l e à f o r t i r d e s e n t r a v e s d e l a c o û t u m e ,
& à m é p r i f e r l e s d é t a i l s m i n u t i e u x d e l ’u f a g e : e l l e
r é p a n d , f u r t o u t c e q u e n o u s f o m m e s , l ’ é n e r g i e &
l e s g r â c e s (voye^G r â c e ) : e l l e a c c é l é r é l a m a r c h e
d e s t a l e n s , q u i s ’ a n im e n t &c s ’é c l a i r e n t p a r l e s c o n -
f e i l s l ib r e s d e l ’ a m i t i é : e l l e p e r f e c t i o n n e l a r a i f o n ,
p a r c e q u ’ e l l e e n e x e r c e l e s f o r c e s : e l l e n o u s f a i t r o u g
i r : e l l e n o u s g u é r i t d e s p e t i t e f f e s d e l ’a m o u r - p r o p
r e : e l l e n o u s a i d e à n o u s r e l e v e r d e n o s f a u t e s : e l l e
n o u s l e s r e n d u t i l e s . Hé ! c o m m e n t d e s â m e s v e r »
t u e u f e s p o u r r o i e n t - e l l e s r e g r e t t e r d e f r i v o l e s d é -
m o n f t r a t i o n s d e r e f p e f t , q u a n d o n l e s e n d é d o m m a g
e p a r l ’ a m o u r & p a r l ’ e f t im e ? Foye^ Eg a r d s .
FAMILIERS, f. m. pl. ( H fl. mod. ) nom que l ’on
donne en Efpagne & en Portugal aux officiers de l’in-
quifition , dont la fon&ion eft de faire arrêter les ac-
eufes. Il y a des grands, & d’autres perfonnes con-
liderables, qui, à la honte de l’humanité, fe font
gloire de ce titre odieux, & vont même jufqu’à en
exercer les fondions. Foye{ In q u i s i t io n . (G )
* FAMILISTES , f. m. pl. ( Hifl. eccléf. ) hérét-i-*
ques qui eurent pour chef David-George Delft. Cette
feâ e s’appella la famille d'amour ou de charité, & leur
do&rine eut pour bafe deux principes qu’on ne peut
trop recommander aux hommes en général ; c’eft de.
s’aimer réciproquement , quelque différence qu’il
puiffe y avoir entre leurs fentimens fur la religion
& d’obéir à toutes les puiffances temporelles, quelque
tyranniques qu’elles foient. Delft fe croyoit venu
pour rétablir le royaume d’Ifraël : il faifoit affez
peu de cas de Moyfe, des Prophètes , & de Jefus-
Chrift : il prétendoit que le culte qu’ils avoient prêché
fur la terre, étoit incapable de conduire les hommes
à la béatitude ; que ce privilège étoit réfervé
à fa morale ; qu’il étoit le vrai meflie ; Sc qu’il ne
mourroit point, ou qu’il reffufeiteroit : il eut des disciples
qui ajoûterent à fon fyftème d’autres opinions
de cette nature : ils foûtinrent que toutes les aftions
de l’impie font nécèffairement autant de péchés &
que les fautes font remifes à celui qui a recouvré
l’amour de Dieu.
FAMILLE de courbes, f. f. (Géom.') Foyeç l'article
C o u r b e .
F a m i l l e , (Droit nat.') en latin , familia. Société
domeftique qui conftitue le premier des états accef-
foires & naturels de l’homme.
En effet, une famille eft une foçiété civile, établie
par ta nature : cette fociété eft la plus naturelle & la
plus ancienne de toutes : elle fert de fondement à
la fociété nationale ; car un peuple ou une nation,
n’eft qu’un çompofé de plufxeurs familles.
F A M lL.es familles commencent par le.mariage , & c’eft
la nature elle-même qui.invite les hommes à cette
union ; dé-là naiffent lés enfans , qui en perpétuant
les familles., entretiennent la fociété humaine, & réparent
les pertes que la mort y caufe chaque jour. ; i
Lorfqu’on prend le mot de famille dans un fens
étroit ,elle n’eft compofée, ï° . que du pereAefamille:
%°.de la mere de famille, qui fuivant l’idée reçue
prefque par-tout, paffe dans la famille du mari : 30.
des enfans qui étant, fi l’on peut parler ainfi, formés
de la fubftance de leur pere & mere, appartiennent
néceffairement à la famille. Mais lorfqu’on prend le
moi de famille dans un fens plus étendu, on y comprend
alors tous 'les parens ; car quoiqu’après la
mort du père de famille, chaque enfant établiffe une
famille: particuliere, cependant tous ceux qui defeen-
dent d’une même tige, & qui font par conféquent if-
fus d’un même fang, font regardés comme membres
d\xne meme famille.,
_ Comme tous les hommes naiffent dans une famil-
ley & tiennent leur état de la nature même,.il s’enfuit
que cet état, cette qualité ou condition des hommes.,
non-feulement ne peut leur être ôtée , mais
qu’elle lesrend partic ipa i des avantages, des biens,
& des prérogatives attachées à la famille dans laquelle
ils font nés : cependant l’état de famille fe perd
dans 1a fociété par la profeription , en vertu de laquelle
un homme eft condamné à mort, & déclaré
déchu de tous les droits de citoyen.
Il eft ft' vrai que la famille eft une forte de propriété
, qu’un homme qui a des’ enfans du fexe qui
ne la perpétue pas, n’eft jamais content qu’il n’en ait
de celui qui la perpétue : ainfi la loi qui fixe \<s famille
dans une fuite de perfonnes de même feXe , contribue
beaucoup , indépendamment des premiers motifs
,.à la propagation de l’efpeçe humaine ; ajoûtons
que les noms qui donnent aux nommes l’idée d’une
chofe qui femble ne devoir pas périr, font très-propres
à infpirer à chaque famille le defir d’étendre fa
durée ; c’eft pourquoi nous approuverions davantage
l’ufage des peuples chez qui les noms meme distinguent
les familles , que de ceux chez lefquels ils
ne diftinguent que les perfonnes. ^ ^ . jj -, .
Au refte , l’état de famille produit divèrfes relations
très-importantes ; celle de mari & de femme,
de pere, de mere & d’enfans , de freres & de foeurs,
& de tous les autres degrés de parenté , qui font le
premier lien des hommes entr’eux. Nous ne parlerons
donc pas de ces diverfes relations. Foye^-en les
articles dans leur ordre, M a r i , F em m e , &c. Article
de M. le Chevalier D E J a U C O U R T .
* F a m i l l e , (Hifl. anc.) Le mot latin familiane
répondoit pas toujours à notre mot famille. Familia
étoit fait de famulia, & il embraffoit dans fon acception
tous les domeftiques d’une maifon, où il y en
avoit au moins quinze. On entendoit encore familia
, un corps d’ouvriers conduits & commandés
par le préfet des eaux. U y avoit deux de ce.s corps ;
l’un public, qu’Agrippa avoit inftitué ; & l’autre
privé » qui fut formé fous Claude. La troupe deS gladiateurs,
qui faifoient leurs exercices fous un chef
commun, s’appelloit aufli familia ; ce chef portoit
le nom de lanifia.
Les familles romaines, familia, étoient des divi-
fions de ce qu’on appelloit gens : elles avoient un
ayeul commun ; ainfi Cæcilius fut le chef qui donn a
le nom à la gens .Coecilia , & la gens Cacilia comprit
les familles des Balearici 9 Calvi, Caprarii, Celeres9
Cntici, Dalmaùci, Dentriçes, Maccdonici, Metelli,
Nepotes, Numidici , Pii , Scipiones, Flacci, & Fifta-
tores. Il y avoit des familles patriciennes ÔC des plébéiennes
, de même qu’il y avoit des gent.es patricite
& plfibéia : il y en avoit même qui étoient en partie
patriciennes & en partie plébéiennes, partim nobilest
Tome VL
F A M 391 partim nova, félon qu’elles avoient eu de tout tems
lejus imaginum, oïl qu’elles l’avoient nouvellement
acquis. On pouvoit fortir d’une famille patricienne,
& tomber dans une plébéienne par dégénération ;
& monter d’une famille plébéienne dans une patricienne
, fur-tout par adoption. De-là cette confufion
qui régné dans les généalogies romaines ; confufion
qui eft encore augmentée par l’identité des noms
dans les patriciennes & dans les plébéiennes : ainfi
quand le patricièn Q . Caépio adopta le plébéien M.
Brutus, ce M. Brutus & fes defeendans devinrent
patriciens, ôc le refte de la famille des Brutus refta
plébéien. Au contraire, lorfque le plébéien Q . Me-
tellus adopta le patricien P. Scipio, cëlui-ci & tous
fes defeendans devinrent plébéiens, & le refte de la
famille des Scipions refta patricien. Les affranchis
prirent les noms de leurs maîtres, & refterent plébéiens
; autre fource d’obfcurités. Ajoutez à cela
que les auteurs ont fouvent employé indiftinclement
les mots gens & familia ; les uns défignant par gens
ce que d’autres défignent par familia , & réciproque*
ment : mais ce que nous venons d’obferver fuffit pour
prévenir contre des erreurs dans lefquelles il feroit
facile de tomber.
Fa m i l l e , (Jurïfpré) Ce terme a dans cette ma»
tiere plufieurs lignifications différentes.
Famille.fe prend ordinairement pour l’affemblage
de plufieurs perfonnes unies par les liens du fang ou
de l’affinité.
On diftinguoit chez les Romains deux fortes de
familles; fa voir celle qui l’étoit jure proprio des perfonnes
qui étoient foûmifes à la puiffance d’un même
cher ou pere de famille, foit par la nature, comme
les enfans naturels & légitimes ; foit de droit,
comme les enfans adoptifs. L*autre forte de famille
comprenoit jure commuai tous les agnats, & généralement
toute la cognation ; car quoiqu’après la
mort du pere de famille chacun des enfans qui étoient
en fa puiffance, devînt lui-même pere de famille,
cependant on les confidérôit toûjours comme étant
de la même famille, attendu qu’ils procédoient de
la même racé. Foye£ les lois 40. tgS, ô ta S. au ff. de
yerb. jîgnif.
On entend en Droit par pere de famille, toute perforine,
foit majeure ou mineure , qui joiiit'de fes
droits, c’eft-à-dire qui n’eft point en la puiffance
d’autrui ; & par fils ou fille de famille, on entend pareillement
un enfant majeur ou mineur, qui eft en la
puiffance paternelle. Foye{ ci-après Fil s d e F a m
i l l e , P e r e p e F a m i l l e , & P u i s s a n c e p a t e r n
e l le»
Les enfans fuivent la,famille du pere, & non celle
de la mere ; c’eft-à -d ire qu’ils portent le nom du
pere, & fuivent fa condition.
Demeurer dans la famille , c’eft refter fpus la puife
fance paternelle.
Un homme eft cenfé avoir fon domicile oîi il a fa
famille, ff. 32. tit .j. 1.'33,
En matière de fubftitution, le terme de famille
comprend la lignite collatérale aufli-bien que la directe.
Fiafarius, de fidei-comm. quejl. 3S1.
Celui qui eft chargé par le tëftateur de rendre fa
fucceflion à un de la famille, fans autre défignation,
la peut rendre à qui bon lui femble, pourvû que ce
foit ;à quelqu’un de la famille, fans être aftraint à
fuivre l’ordre de proximité. Foye^ la Peyrere, lett,
F. /z. /. (A )
F a m il l e , dans le Droit romain, fe prend quelquefois
pour la fucceflion & pour les biens qui la
compofent, comme quand la loi des douze tables
dit , proximus agnatus familiam habeto. L. t <)5, ff. de
verb. fignif.
C ’eft aufli en ce même fens que l’on difoit partage
de la famille, famtt* treifeundtt, pour exprimer fe
P d d ij i