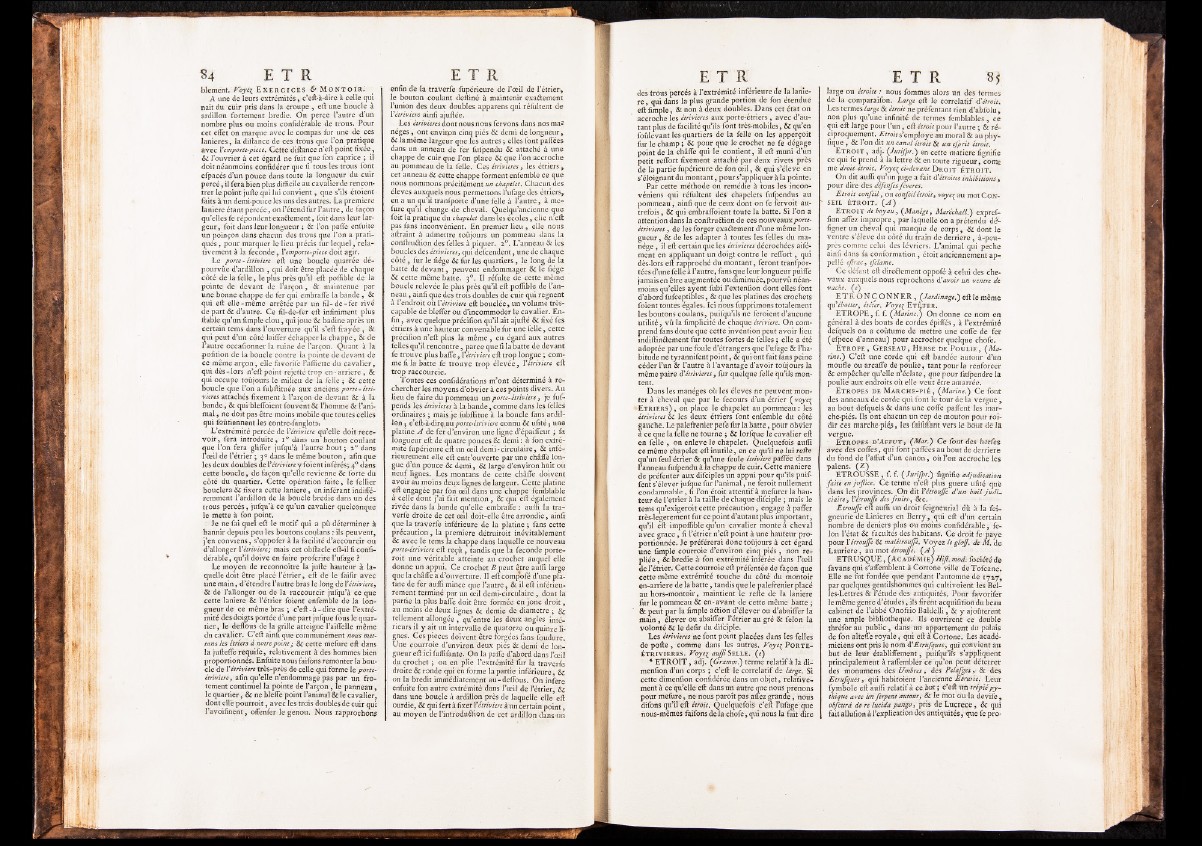
blemeht.'f’qyéç E x e r c i c e s & M o n t o i r .'
A une de leurs extrémités, c’eft-à-dire à celle qui
naît du cuir pris dans la croupe , eft une boucle à
ardillon fortement bredie. On perce l’autre d’un
nombre plus ou moins confidérable de trous. Pour
cet effet on marque avec le compas fur une de ces
lanières, la diftance de ces trous que l’on pratique
avec l’emporte-piece. Cette diftance n’eft point fixée,
& l’ouvrier à cet égard ne fuit que fon caprice ; il
doit néanmoins confidérer que fi tous les trous font
efpacés d’un pouce dans toute la longueur du cuir
percé, il fera bien plus difficile au cavalier de rencontrer
le point jufte qui lui convient, que s’ils étoient
faits à un demi-pouce les uns des autres. La première
laniere étant percée, on l’étend fur l’autre, de façon
qu’elles fe répondent exa&ement, foit dans leur largeur
, foit dans leur longueur ; & l’on pafle enfuite
un poinçon dans chacun des trous que l’on a pratiqués
, pour marquer le lieu précis fur lequel, relativement
à la fécondé, V emporte-piece doit agir.
Le porte-étriviere eft une boucle quarrée dé-
pourvûe d’ardillon , qui doit être placée de chaque
côté, de la felle, le plus près qu’il eft poflible de la
pointe de devant de l’arçon, & maintenue par
une bonne chappe de fer qui embraffe la bande, &
qui eft elle-même arrêtée par un fil-d e -fe r rivé
de part & d’autre. Ce fil-de-fer eft infiniment plus
ftable qu’un fimple clou, qui joue '& badine après un
certain tems dans l’ouverture qu’il s’eft fra yée, &
qui peut d’un côté laiffer échapper la chappe, & de
l’autre occafionner la ruine de l’arçon. Quant à la
pofition de la boucle contre la pointe de devant de
ce même arçon, elle favorife l’afîiette du cavalier,
qui dès-lors n’eft point rejetté trop en-arriéré , &
qui occupe toujours le milieu de la felle ; & cette
boucle que l’on a fubftituée aux anciens porte -étrivieres
attachés fixement à l’arçon de devant & à la
bande, & qui bleflbient fouvent & l’homme & l’animal
, ne doit pas être moins mobile que toutes celles
qui foûtiennent les contre-fanglots.
L’extrémité percée de Vétriviere qu’elle doit recev
o ir , fera introduite, i ° dans un bouton coulant
que l ’on fera gliffer jufqu’à l ’autre bout ;• 2° dans
l’oeil de l’étrier ; 30 dans le même bouton, afin que
les deux doubles de Vétriviere y foient inférés; 40 dans
cette boucle, de façon qu’elle revienne & forte du
côté du quartier. -Cette opération faite, le fellier
bouclera & fixera cette laniere, en inférant indifféremment
l’ardillon de la boucle bredie dans un des
trous percés, jufqu’à ce qu’un cavalier quelconque
le mette à fon point.
: Je ne fai quel eft le motif qui a pu déterminer à
bannir depuis peu les boutons coulans : ils peuvent,
j’en conviens, s’oppofer à la facilité d’aecourcir ou
d’allonger Vétriviere; mais cet obftacle eft-il fi confidérable
, qu’il doive en faire profcrire l’ufage ?
Le moyen de reconnoître la jufte hauteur à laquelle
doit être placé l’étrier, eft de le faifir avec
une main, d ’étendre l’autre bras le long de Vétriviere,
& de l’allonger où de la raccourcir jufqu’à ce que
cette laniere & l’étrier foient enfemble de la longueur
de ce même bras ; c’eft-à-dire que l’extrémité
des doigts portée d’une part jufque fous le quartier,
le deffous de la grille atteigne l’aiffelle même
du cavalier. C ’eft ainfi que communément nous mettons
les' étriers a notre point ; & cette niefure eft dans
la jufteffe requife, relativement à des hommes bien
proportionnés. Enfuite nous faifons remonter la boucle
de Vétriviere très-près de celle qui forme le porte-
étriviere, afin qu’elle n’endommage pas par un frôlement
continüel la pointe de l’arçon, le panneau,
le quartier, & ne bleffe point l’animal & le cavalier,
dont elle pourroit, avec les trois doubles de cuir qui
l’avoifinent, offenfer le genou. Nous rapprochons
enfin de la traverfe fupérieure de l’oeil de l’étrier,
le bouton coulant deftiné à maintenir exactement
l’union des deux doubles apparens qui réfultent de
Vétriviere ainfi ajuftée.
Les étrivieres dont nous nous fervons dans nos manèges
, ont environ cinq piés & demi de longueur,
& la même largeur que les autres ; elles font palfées
dans un anneau de fer fufpendu & attaché à une
chappe de cuir que l’on place & que l’on accroche
au pommeau de la felle. Ces étrivieres ; les étriers ,
cet anneau & cette chappe forment enfemble ce que
nous nommons précifément un chapelet. Chacun des
éleves auxquels nous permettons l’ufage des étriers,
en a un qu’il tranfporte d’une felle à l’autre, à me-
fure qu’il change de cheval. Quelqu’ancienne que
foit la pratique du chapelet dans les écoles, elle n’efl:
pas fans inconvénient. En premier lieu , elle nous
aflraint à admettre toujours un pommeau dans la
conftruCtion des felles à piquer. 20. L’anneau & les
boucles des étrivieres, qui defcendent, une de chaque
cô té , fur le fiége & fur les quartiers, le long de la
batte de devant, peuvent endommager & le fiége
& cette même batte. 30. Il réfulte de cette même
boucle relevée le plus près qu’il eft poflible de l’anneau
, ainfi que des trois doubles de cuir qui régnent
à l’endroit oit Vétriviere eft bouclée, un volume très-
capable de bleffer ou d’incommoder le cavalier. Enfin
, avec quelque précifion qu’il ait ajufté & fixé fes
étriers à une hauteur convenable fur une felle, cette
précifion n’eft plus la même , eu égard aux autres
felles qu’il rencontre, parce que fi la batte de devant
fe trouve, plus baffe, Vétriviere eft trop longue ; comme
fi la batte fe trouve trop élevée, Vétriviere eft
trop raccourcie.
Toutes ces confidérations m’ont déterminé à rechercher
les moyens d’obvier à ces points divers. Au
lieu de faire du pommeau un porte-étriviere , je fuf-
pends les étrivieres à la bande, comme dans les fellès
ordinaires ; mais j e fubftitue à la boucle fans ardillon
, c’éfl-à-direcau porte-étriviere connu & u fité, une
platine A de fer d’environ une ligne d’épaiffeur ; fa
longueur eft de quatre pouces & demi : à fon extrémité
fupérieure eft un oeil demi-circulaire, & inférieurement
elle eft entr’ouverte par une châffe longue
d’ùn pouce & demi, & large d’environ hùit où
neuf lignes. Les montans de cette châffe doivent
avoir au moins deux lignes de largeur. Cette platine
eft engagée par fon oeil dans une chappe femblable
à celle dont j’ai fait mention, & qui eft également
rivée dans la bande qu’elle embraffe : aufli la traverfe
droite de cet oeil doit-elle être arrondie, ainfi
que la traverfe inférieure de la platine ; fans cette
précaution, la première détruiroit inévitablement
& avec le tems la chappe dans laquelle ce nouveau
porte-étriviere eft reçu, tandis que la fécondé porte-
roit une véritable atteinte au crochet auquel elle
donne un appui. Ce crochet B peut être aufli large
que la châffe a d’ouverture. Il eft compofé d’une platine
de fer aufli mince que l’autre, & il eft inférieurement
terminé par un oeil demi-circulaire , dont la
partie la plus baffe doit être formée en jonc droit,
au moins de deux lignes & demie de diamètre ; 5c
tellement allongée , qu’entre les deux angles intérieurs
il y ait un intervalle de quatorze ou quinze lignes.
Ces pièces doivent être forgées fans foudùre.
Une courroie d’environ deux piés & demi de longueur
eft ici fuffifante. On la pafle d’abord dans l’oeil
du crochet ; on en plie l’extrémiteTTur la traverfe
droite & ronde qui en forme la partie inférieure &
on la bredit immédiatement au-deffous. On inféré
enfuite fon autre extrémité dans l’oeil de l’étrier, ôc
dans une boucle à ardillon près de laquelle elle eft
ourdie, & qui fertàfixer Vétriviere à un certain point,
au moyen de l’introduftion de cet ardillon dans un
des trous percés à l’extrémité inférieure de la laniere
, qui dans la plus grande portion de fon étendue
eft fimple, & non à deux doubles. Dans cet état on
accroche les étrivieres aux porte-étriers , avec d’autant
plus de facilité qu’ils font très-mobiles, & qu’en
foûlevant les quartiers de la felle on les apperçoit
fur le champ ; & pour que le crochet ne fe dégage
point de la châffe qui le contient, il eft muni d’un
petit reffort fixement attaché par deux rivets près
de la partie fupérieure de fon oe il, & qui s’élève en
s’éloignant du montant, pour s’appliquer à la pointe.
Par cette méthode on remédie à tous les incon-
véniens qui réfultent des chapelets fufpendus au
pommeau, ainfi que de ceux dont on fe fervoit autrefois
, & qui embraffoient toute la batte. Si l’on a
attention dans la conftruétion de ces nouveauxporte-
étrivieres, de lesforger exactement d’une même longueur
, & de les adapter à toutes les felles du manège
, il eft certain que les étrivieres décrochées aifé-
ment en appliquant un doigt contre le reffort, qui
dès-lors eft rapproché du montant, feront tranfpor-
tées d’une felle à l’autre, fans que leur longueur puiffe
j amais en être augmentée ou diminuée, pourvu néanmoins
qu’elles ayent fubi l’extenfion dont elles font
d’abord fufceptibles, & que les platines des crochets
foient toutes égales. Ici nous fupprimons totalement
les boutons coulans, puifqu’ils ne feroient d’aucune
utilité, vû la fimplicité de chaque étriviere. On comprend
fans doute que cette invention peut avoir lieu
indiftin&ement fur toutes fortes de felles ; elle a été
adoptée par une foule d’étrangers que l’ufage & l’habitude
ne tyrannifent point, & qui ont fait fans peine
céder l’un & l’autre à l ’avantage d’avoir toujours la
même paire <Vétrivieres, fur quelque felle qu’ils montent.
Dans les manèges où les éleves ne peuveiit monter
à cheval que par le fecours d’un étrier ( voye^
•Etriers) , on place le chapelet au pommeau : les
étrivieres & les deux étriers font enfemble du côté
gauche. Le palefrenier pefe fur la batte, pour obvier
à ce que la felle ne tourne ; & lorfque le cavalier eft
en felle , on enleve le chapelet. Quelquefois aufli
ce même chapelet eft inutile, en ce qu’il ne lui refte
qu’un feul étrier & qu’une feule étriviere pàflee dans
l’anneau fufpendu à la chappe de cuir. Cette maniéré
de préfenter aux difciples un appui pour qu’ils puif-
fent s’élever jufque fur l’animal, ne l'eroit nullement
condamnable, fi l’on étoit attentif à mefurer la hauteur
de l ’etrier à la taille de chaque difciple ; mais le
tems qu’exigeroit cette précaution, engage à paffer
très-legerement fur ce point d’autant plus important;
qu’il eft impoflible qu’un cavalier monte à cheval
avec grâce, fi l’étrier n’eft point à une hauteur proportionnée.
Je préférerai donc toûjours à cet égard
une fimple courroie d’environ cinq piés, non re^
pliée, & bredie à fon extrémité inférée dans l’oeil
de l’étrier. Cette courroie eft préfentée de façon que
cette même extrémité touche du côté du montoir
en-arriere de la batte, tandis que le palefrenier placé
au hors-montoir, maintient le relie de la laniere
fur le pommeau & en-avant de cette même batte ;
& peut par la fimple aCtion d’élever ou d’abaiffer la
main, elever ou abaiffer l’étrier au gré & félon la
volonté & le defir du difciple.
Les étrivieres ne font point placées dans les felles
de pofte, comme dans les autres. Voye% Porte-
étrivières. Voye^ aujji Selle, (e)
* E TR O IT , adj. ('Gramm.) terme relatif à la di-
menfion d’un corps ; c’eft le corrélatif de large. Si
cette dimenfion confidérée dans un objet, relative-*
ment à ce qu’elle eft dans un autre que nous prenons
pour mefure, ne nous paroît pas affez grande, nous
difons qu’il eft étroit. Quelquefois c’en l’ufagé que
nous-mêmes faifons delà chofe-, qui nous la fait dire
large ou étroite : nous fommes alors lin dès termes
de la comparaifon. Large eft le corrélatif d’étroit.
Les termes large & étroit ne préfentant rien d’abfolu ,
non plus qu’une infinité de termes femblables , ce
qui eft large pour l’un, eft étroit pour l’autre ; & réciproquement.
Etroit s’employe au moral & au phy-
fique , & l’on dit un canal étroit & un efprit étroit. Etroit , adj. ( Jurifpr'.) en cette matière lignifie
ce qui fe prend à la lettre & en toute rigueur, com;
me droit-étroit. Voye^ ci-devant Droit ÉTROIT.
On dit aufli qu’un juge a fait d’étroites inhibitions>
pour dire des défenfes fèveres.
Etroit confiil, ou confiilétroit,SEIL ÉTROIT. ( voye^ au mot CONA
)
ETROIT de boyau, (Manége, Maféchalt.) expref-
fion affez impropre, par laquelle on a prétendu dé-
figner un cheval qui manque de corps, & dont le
ventre s’élève du côté du train de derrière, à-peu-
près comme celui des lévriers. L ’animal qui peche
ainfi dans fa conformation, étoit anciennement ap-,
pelle efirac, efclame.
Ce défaut eft directement oppofé à celui des chevaux
auxquels nous reprochons d’avoir un ventre de
vache, (e)
E T R O N Ç O N N E R , (Jardinage.) eft le même
qa’ébotter, étêter. Voye{ Et^-TER.
ETROPE, f. f. (Marine. J On donne ce nom en
général à des bouts de cordes épifles, à l’extrémité
defquels on a coûtume de mettre ime coffe de fer
(efpece d’anneau) pour accrocher quelque chofe. Etrope , Gerseau , Herse de Poulie , (Marine.")
C ’eft une corde qui eft bandée autour d’un
moufle ou arcaffe de poulie, tant pour la renforcer
& empêcher qu’elle n’éclate, que pour fufpendre la
poulie aux endroits où elle veut être amarrée. EtroPES DE MarchE-PIÉ, (Marine.') Ce font
des anneaux de corde qui font le tour de la vergue ,
au bout defquels & dans une coffe paflent les mar-
che-piés. Ils ont chacun un cep de mouton pour roi-
dir ces marche-pi&> les faififfant vers le bout de la
vergue.
Etropes d’A f f û t , (Mar.) Ce foiit des héifes
avec des coffes, qui font paffées au bout de derrière
du fond dé l’affût d’un canon ; où l ’on accroche les
palens. (Z )
ETROUSSE, f. f. ( Jurifprï) lignifie adjudication
faite en juflice. Ce terme n’eft plus guere Ufité què
dans les provinces. On dit l’ètroujfe d’un bail judiciaire,
Vétrouffi des fruits-) &C.
Etrotiffe eft aufli un droit feigneurial dû à la fei-
gneurie de Linieres en Berry, qui eft d’un certain
nombre de deniers plus ou moins Confidérable ; félon
l’état & facultés des habitans. Ce droit fe pàye
pour Vétrouffe & malétróuffe. Voyez le gloff. de M. de
Laurîere ; au mot étroujfè. (A )
ETRUSQUE, (Académie) Hifi. mod. fociété de
favans qui s’affémblent à Cörtohe ville de Tofcàhe.
Elle ne fut fondée que pendant l’automne de 1727,
par quelques gentilshommes qui cultivoient les Belles
Lettres & l’étude des antiquités. Pour favorifer
le même genre d’études,.ils firent acquifition du beau
cabinet de l’abbé Onofriq Baldelli, & y ajoutèrent
une ample bibliothèque. Ils ouvrirent ce double
thréfor au public, dans wri appartement du palais
de fon altefle royale, qui eft à Cortoné. Les académiciens
ont pris le nom d’Etrufques, qui convient au
but de leur établiffement, puifqu’ils s’appliquent
principalement àraffemblér ce qu’on peut déterrer
des momïmens des- Urhbres, dès Pelafgés ,< & des
Etrufijucs, qui habitaient Tancienne Etrurie. Léur
fymbole eft aufli relatif à ce but ; c’eft un trépiépy-
tkique avec iiriferpent autour, & le mot ou la devife ,
obfiurâ de re lucida pango, pris dé Lucrèce, & qui
fait allufion à l’explication dés antiquités, tjue fe pro