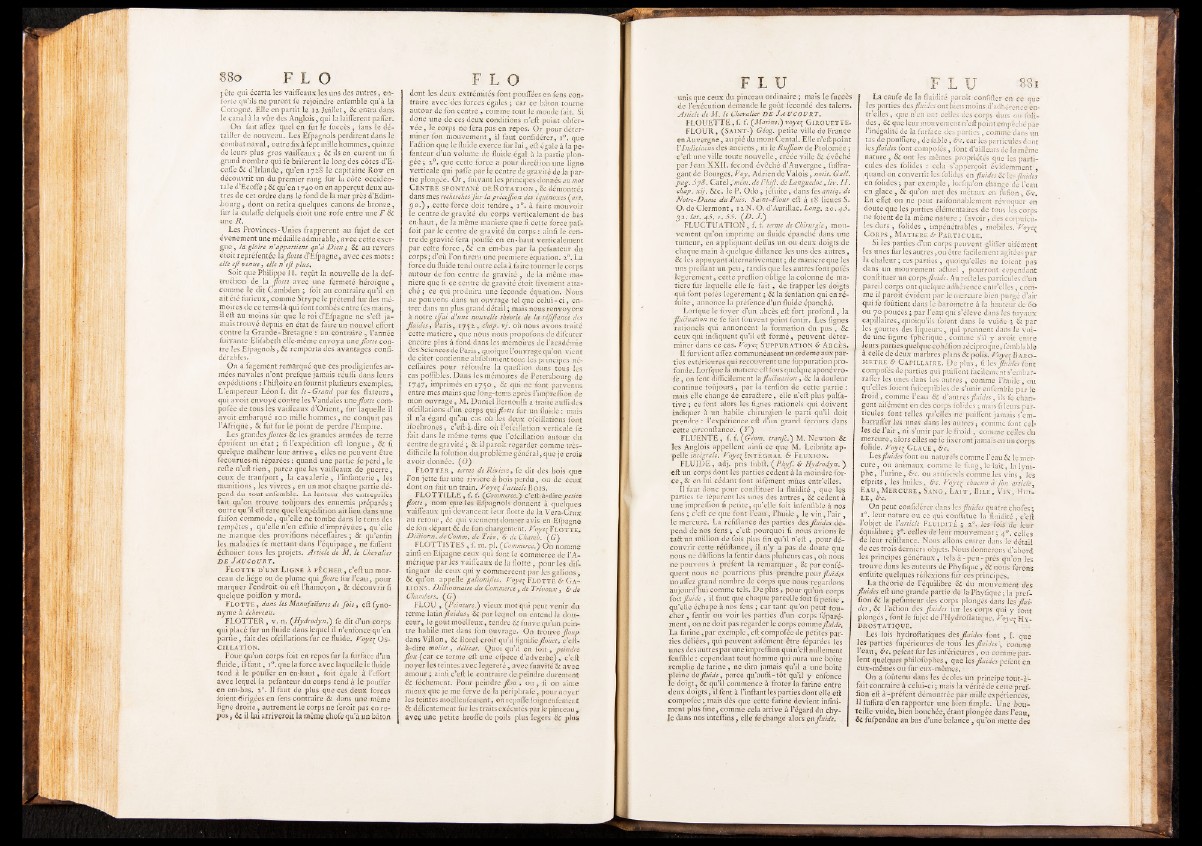
88o F L O pête qui écarta les vaiffeaux les uns des autres, en-
îorte qu’ils ne purent fe rejoindre enfemble qu’à la
Corognd. Elle en partit le 12 Juillet, 6c entra dans
le canal à la vue des Anglois, qui lalaifferent paffer.
On fait affez quel en fut le fuccès , fans le détailler
de nouveau. Les Efpagnols perdirent dans le
combat naval, outre fix à fept mille hommes, quinze
de leurs plus gros vaiffeaux ; 6c ils en eurent un li
grand nombre qui fe briferent le long des côtes d’E-
coffe 6c d’Irlande, qu’en 1728 le capitaine Row en
découvrit un du premier rang fur la côte occidentale
d’Ecoffe ; 6c qu’en 1740 on en apperçut deux autres
de cet ordre dans le fond de la mer près d’Edim-
Lourg, dont on retira quelques canons de bronze,
fur la culaffe defquels étoit une rofe entre une F 6c
une R.
Les Provinces-Unies frappèrent au fujet de cet
événement une médaille admirable, avec cette exergue
, la gloire n'appartient qu'à Dieu ; 6c au revers
etoit repréfentée la flotte d’Efpagne, avec ces mots :
elle efl venue, elle n'efl plus.
Soit que Philippe IL reçût la nouvelle de la def-
truâion de la flotte avec une fermeté héroïque,
comme le dit Cambden ; foit au contraire qu’il en
ait été furieux, comme Strype le prétend fur des mémoires
de ce tems-là qui font tombés entre fes mains,
il eft au moins sûr que le roi d’Efpagne ne s’eft jamais
trouvé depuis en état de faire un nouvel effort
contre la Grande - Bretagne : au contraire , l’année
fuivante Elifabeth elle-même envoya une flotte contre
les Efpagnols, & remporta des avantages confi-
dérables.: -
On a fagement remarqué que ces prodigieufes armées
navales n’ont prefque jamais réulîi dans leurs
expéditions : l’hiftoire en fournit plufieurs exemples.
L ’empereur Lé on l. dit le-Grand par fes flateurs,
qui a voit envoyé contre les Vandales une flotte com-
pofée de tous les vaiffeaux d’Orient, fur laquelle il
avoit embarqué 100 mille hommes, ne conquit pas
l ’Afrique-, & fut fur le point de perdre l’Empire.
Les gyand.es flot tes 6c les grandes armées de terre
épuifent un état ; fi l’expédition eft longue , & fi
quelque malheur leur arrive, elles ne peuvent être
feconruesmi réparées : quand une partie fe perd, le
refte n’eft r ien, parce que les vaiffeaux de guerre,
ceux de tranfport, la cavalerie , l’infanterie , les
munitions, les v iv re s, en un mot chaque partie dépend
du tout enfemble. La lenteur des entreprifes
fait qu’on trouve toûjours des ennemis préparés ;
outre qu’il eft rare que l’expédition ait lieu dans une
faifon commode, qu’elle ne tombe dans le tems des
tempêtes , qu’elle n’en effuie d’imprévûes, qu’elle
ne manque des provifions néceffaires ; & qu’enfin
les maladies fe mettant dans l’équipage, ne faffent
échouer tous les projets. Article de M. le Chevalier
DE JAUCOURT.
F l o t t e d ’u n e L i g n e à p ê c h e r , c ’ e ft u n m o r c
e a u d e liè g e o u d e p lum e q u i flotte fu r l ’e a u , p o u r
m a r q u e r l ’e n d r o it o ù e ft l’h am e ço n , & d é c o u v r i r fi
q u e lq u e p o if fo n y m o rd .
F l o t t e , dans lesManufaUures de foie, e ft fy n o -
nyme à écheveau.
F LO T TE R , v . n. (Hydrodyn.') fe dit d’un corps
qui placé fur un fluide dans lequel il n’enfonce qu’en
partie, fait des ofciliations fur ce fluide. Voye^ Os-
CILLATÜON.
Pour qu’un corps foit en repos fur la furface d’un
fluide, il faut, i° . que la force avec laquelle le fluide
tend à le pouffer en en-haut, foit égale à l’effort
avec lequel la pefanteur du corps tend à le pouffer
en em-bas. z°. Il faut de plus que ces. deux forces
foient dirigées en fens contraire & dans une même
ligne droite, autrement le corps ne feroit pas en repos
, 6c il lui arriYeroit la même chofe qu’à un bâton
F L O
dont les deux extrémités font pouffées en fens contraire
avec des forces égales ; car ce bâton tourne
autour de fon centre , comme tout le monde fait. Si
donc une de ces deux conditions n’eft point obferi-
v é e , le corps ne fera pas en repos. Or pour déterminer
fon mouvement, il faut confidérer, i°. que
l’adion que le fluide exerce fur lu i, eft égale à la pefanteur
d’un volume de fluide égal à la partie plongée
; 20. que cette force a pour dire&ion une ligne
verticale qui paffe par le centre de gravité de la partie
plongée. O r , fuivant les principes donnés au mot
C e n t r e s p o n t a n é de R o t a t i o n , & démontrés
dans mes recherches fur la préceffion des équinoxes {art.
5>°‘) > cette force doit tendre, i° . à faire mouvoir
le centre de gravité du corps verticalement de bas
en-haut, de la même maniéré que fi cette force paf-
foit par le centre de gravité du corps : ainfi le centre
de gravité fera pouffé en en-haut verticalement
par cette force , & en em-bas par la pefanteur du
corps ; d’où l’on tirera une première équation. 20. La
force du fluide tend outre cela à faire tourner le corps
autour de fon centre de gravité , de la même maniéré
que fi ce centre de gravité étoit fixement attaché
; ce qui produira une fécondé équation. Nous
ne pouvons dans un ouvrage tel que c e lu i- c i, entrer
dans un plus grand détail ; mais nous renvoyons
à notre ejfai d'une nouvelle théorie de la réjîflance des
fluides, Paris, 1752 , chap. vj. où nous avons traité
cette matière, que nous nous propofons de difeuter
encore plus à fond dans les mémoires de l’académie
des Sciences de Paris, quoique l’ouvrage qu’on vient
de citer contienne abfolument tous les principes néceffaires
pour réfoudre la queftion dans tous les
cas pofiibles. Dans les mémoires de Petersbourg de
1747, imprimés en 1750 , 6c qui ne font parvenus
entre mes mains que long-tems après i’impreflion de
mon ouvrage, M. Daniel Bernoulli a traité auffi des
ofciliations d’un corps qui flotte fur un fluide : mais
il n’a égard qu’au cas où les deux ofciliations font
ifochrones, c’eft-à-dire où l’ofciilation verticale fe
fait dans le même tems que l’ofcillation autour du
centre de gravité ; & il paroît regarder comme très-
difficile la folution du.problème général, que je crois
avoir donnée. (O)
F l o t t e r , terme de Riviere, fe dit des bois que
l’on jette fur une riviere à bois perdu, ou de ceux
dont on fait un train. Voye^ l'article B Ois.
F LOTTIL LE, f. f. (Commerce.). c’eft-à-dire petite
flotte , nom que les Efpagnols donnènt à quelques
vaiffeaux qui devancent leur flotte de la Vera-Crux
au retour, 6c qui viennent donner avis en Efpagne
de fon départ de fon chargement. Voye^ F l o t t e *
Diclionn. de Comm. de Trèv. & de Chamb. {G)
FLOTTISTES , f. m. pl. {Commerce.') On nomme
ainfi en Efpagne ceux qui font le commerce de l’Amérique
par les vaiffeaux de la flotte , pour les distinguer
de ceux qui y commercent par les galions ,
& qu’on appelle gaUonifles. Voye{ F l o t t e & G a l
io n s . Dictionnaire du Commerce , de Trévoux , & de
Chambers. {G)
FLOU , {Peinture.) vieux mot qui peut venir du
terme latin fluidus, 6c par lequel on entend la douceur,
le goût m oelleux, tendre 6c fuave qu’un peintre
habile met dans fon ouvrage. On trouve floup
dans Villon, 6c Borel croit qu’il fignifïe floüet, c’eft-
à-dire mollet, délicat. Quoi qu’il en fo i t , peindre
flou (car ce terme eft une efpeee d’adverbe), c’eft:
noyer les teintes avec legereté, avec fuavité & avec
amour ; ainfi c’eft le contraire de peindre durement
6c féchement. Pour peindre flou , o u , fi on aime
mieux que je me ferve de la périphrafe, pour noyer
les teintes moëlleufement, on repaffe foigneufemer.t
& délicatement fur les traits exécutés parle pinceau ,
avec une petite broffe de poils plus légers 6c plus
F L U F L U
unis que ceux du pinceau ordinaire ; mais le fuccès
de l’exécution demande le goût fécondé des talens.
Article de M . le Chevalier DE J A U COURT.
FLOUETTE , f. f. {Marine.) voye£ GIROUETTE.
F LOUR, ( S a i n t - ) Géog. petite ville de France
en Auvergne, au pié du mont Cental. Elle n’eftpoint
■l’Indiciacus des anciens, ni le Rufflum de Ptolomée ;
c ’eft une ville toute nouvelle, créée ville 6c évêché
par Jean XXII. fécond évêché d’Auvergne, fuffra-
gant de Bourges. Voy, Adrien de V alois, notit. G ail.
pag. 5y8. Catel {mém. de l'hifl. de Languedoc, Uv. I I .
ehap. xij. 6cc. le P. O d o , jéfuite, dans fes antiq. de
Notre-Dame du Puis. Saint-Flour eft à 18 lieues S.
O. de Clermont, 12 N. O. d’Aurillac. Long. 20.4^.
ß z . lat...qS. 1 .55. {D. J.)
FLUCTUATION, f. f. terme de Chirurgie, mouvement
qu’on imprime au fluide épanché dans une
tumeur, en appliquant deffus un ou deux doigts de
chaque main à quelque diftance les uns des autres,
6c les appuyant alternativement ; de maniéré que les
uns preffant un peu, tandis que les autres font pofés i
legerement, cette preffion oblige la colonne de matière
fur laquelle elle fe fa it , de frapper les doigts
q.ui font poiés legerement ; 6c la fenfation qui en ré-
fulte , annonce la préfence d’un fluide épanché.
Lorfque le foyer d’un abcès eft fort profond, la
fluctuation ne fe fait fouvent point fentir. Les lignes
rationels qui annoncent la formation du pus , 6c
ceux qui indiquent qu’il eft formé, peuvent déterminer
dans ce cas. Voye1 S u p p u r a t i o n & A b c è s * ;
Il furvient affez communément un oedeme aux parties
extérieures qui recouvrent une fuppuration profonde.
Lorfque la matière eft fous quelque aponévro-
f e , on fent difficilement la. fluctuation, 6c la douleur
continue toûjours , par la tenfion de cette partie :
mais elle change de cara&ere, elle n’eft plus pulfa-
tive ; ce font alors les lignes rationels qui doivent
indiquer à un habile chirurgien le parti qu’il doit
prendre : l’expérience eft d’un grand feconrs dans ,
cette circonftancel ( T )
FLUENTE, f. f. {Géom. tranfe.) M. Newton 6c
les Anglois appellent ainfi ce que M. Leibnitz appelle
intégrale. Voye^ INTÉGRAL & FLUXION.
FLUIDE, adj. pris lubft. {Phyfl If Hydrodyn.)
eft un corps dont les parties cedent à la moindre force
, & en lui cédant font aifément mûes entr’elles.
Il faut donc pour conftituer la fluidité , que les
parties fe féparent les unes des autres , Sc cedent à
une impreflion fi petite, qu’elle foit infenfible à nos
fens ; c’eft ce que font l’eau , l’huile , le v in , l’air ,
le mercure. La réfiftanee des parties des fluides dépend
de nos fens ; c’eft, pourquoi fi nous âvionîs le
taft un million de fois plus fin qu’il n’eft , pour découvrir
cette réfiftanee, il n’y a pas de doute que
nous ne dûflio'ns la fentir dans plufieurs cas, où nous
ne pouvons à préfent la remarquer, 6c par confé-
quent nous ne pourrions plus prendre pour fluides
un affez grand nombre de corps que nous regardons
aujourd’hui comme tels. De p lu sp o u r qu’un corps
foit fluide, il faut que chaque parcelle foit fi petite,
qu’elle échape à nos fens ; car tant qu’on peut toucher
, fentir ou voir les parties d’un corps féparé-
ment, on ne doit pas regarder le corps commefluide.
La farine, par exemple, eft compofée de petitès parties
déliées, qui peuvent aifément être féparées les
unes des autres par une impreflion qui n’eft nullement
fenfible : cependant tout homme qui aura une boîte
remplie de farine , ne dira jamais qu’il a une boîte
pleine de fluide, parce qu’aufli-tôt qu’il y enfonce
le doigt, 6c qu’il commence à froter la farine entre
deux doigts, il fent à l’inftant les parties dont elle eft
compofée ; mais dès que cette farine devient infiniment
plus fine, comme cela arrive à l’égard du chy-
Je dans nos inteftins, elle fe change alors en fluide.
881
La caufe de la fluidité paroît confifter en ce que
les parties des fluides ont bien moins d’adhérence entr’elles
, que n’en ont celles des corps durs ou félidés
, & que leur mouvement n’eftpoint empêchépàr
l’inegalite de la furface des parties , comm.e dans un
tas de poufliere, de fable, &c. car les particules dont
les fluides font compofés, font d’ailleurs de la même
nature, 6c ont les mêmes propriétés que les particules
des folides : cela s’gpperçoit évidemment ,
,quand on convertit les folides en fluides & le s fluides
en folides ; par exemple, lorfqu’on change de l’eau
en g lace , & qu’on met des métaux en fufion, &c.
En effet on ne peut raifonnablement révoquer en
doute que les parties élémentaires de tous les corps
ne foient de la même nature ; favoir, des corpufcu-
les durs , folides , impénétrables , mobiles. Voyes^
C o r p s , M a t i è r e & P a r t i c u l e .
Si les parties d’un corps peuvent gliffer aifément
les unes fur les autres, ou être facilement agitées pat
la chaleur ; ces parties , quoiqu’elles ne foient pas
dans un mouvement a&uel , pourront cependant
conftituer un corps fluide. Au refte les particules d’un
pareil corps ont quelque adhérence entr’elles, comme
il paroît évident par le mercure bien purgé d’air
qui fe foûtient dans le baromètre à la hauteur de 60
ou 70 pouces ; par l’eau qui s’élève dans les tuyaux
capillaires, quoiqu’ils foient dans le vuide ; & par
les gouttes des liqueurs, qui prennent dans le Vuide
une figure fphérique, comme s’ il y aVoit entre
leurs parties quelque cohéfion réciproque, femblable
à celle de deux marbres plans & polis. Voye£ B a r o m
è t r e & C a p i l l a i r e . De plus * fi les fluides {ont
compofés de parties qui puiffent facilement s’embar-
raffer les unes dans les autres , comme l’huile , 011
qu’elles foient fufceptibles de s’unir enfemble par te
froid, comme l’eau 6c d'autres fluides, ils fe changent
aifément en des Corps folides ; mais fi leurs particules
font telles qu’elles ne puiffent jamais s’em-
barraffer les unes dans les autres, comme font celles
de l’air , ni s’unir par le froid , comme celles du
mercure, alors elles ne fe fixeront jamais en un corps
folide. Voye[ G l a c e , &c.
Les fluides font ou naturels comme l’eau & le mercure
, ou animaux comme le fang, le la it , la lymphe,
l’urine, &c. ou artificiels comme les vins, les
efprits, les huiles, &c. Voye[ chacun à- fo n article,
E a u , M e r c u r e , S a n g , L a i t , B i l e , V i n , H u i l
e , &c.
On peut confidérer dans les fluides quatre chofes;
i°. leur nature ou ce qui conftitue la fluidité , ç’eft
l’objet de l’article Fluidité ; 20. les loi# de leur
équilibre ; 30. celles de leur mouvement ; 40. celles
de leur réfiftanee. Nous allons entrer dans le détail
de ces trois derniers objets. Nous donnerons d’abord
les principes généraux , tels à-peu-près qu’on les
trouve dans les auteurs de Phyfique, 6c nous ferons
enfuite quelques réflexions fur ces principes.
La théorie de l’équilibre 6c du mouvement des
fluides eft une grande partie de la Phyfique ; la preffion
6c la pefanteur des corps plongés dans les flui~
des, 6c l ’a dion des fluides fur les corps qui y ipnt
plongés, font le fujet dé l’Hydroftatique. Voye? H y d
r o s t a t i q u e .
Les lois hydroftatiques des fluides font , I. que
les parties fupérieures de tous les fluides \ comme
l’eau, &c, pefent fur les inférieures, ou comme parlent
quelques philofophes , que 1 es fluides pefent en
eux-mêmes ou fur eux-mêmes.
On a foûtenu dans les écoles un principe tout-ài
fait contraire à celui-ci ; mais la vérité de cette preffion
eft à-préfent démontrée par mille expériences.
Il fuffira d’en rapporter une bien fimple. Une bouteille
vuide, bien bouchée, étant plongée dans l ’eau
6c fufpendue au bas d’une balance, qu’on mette des