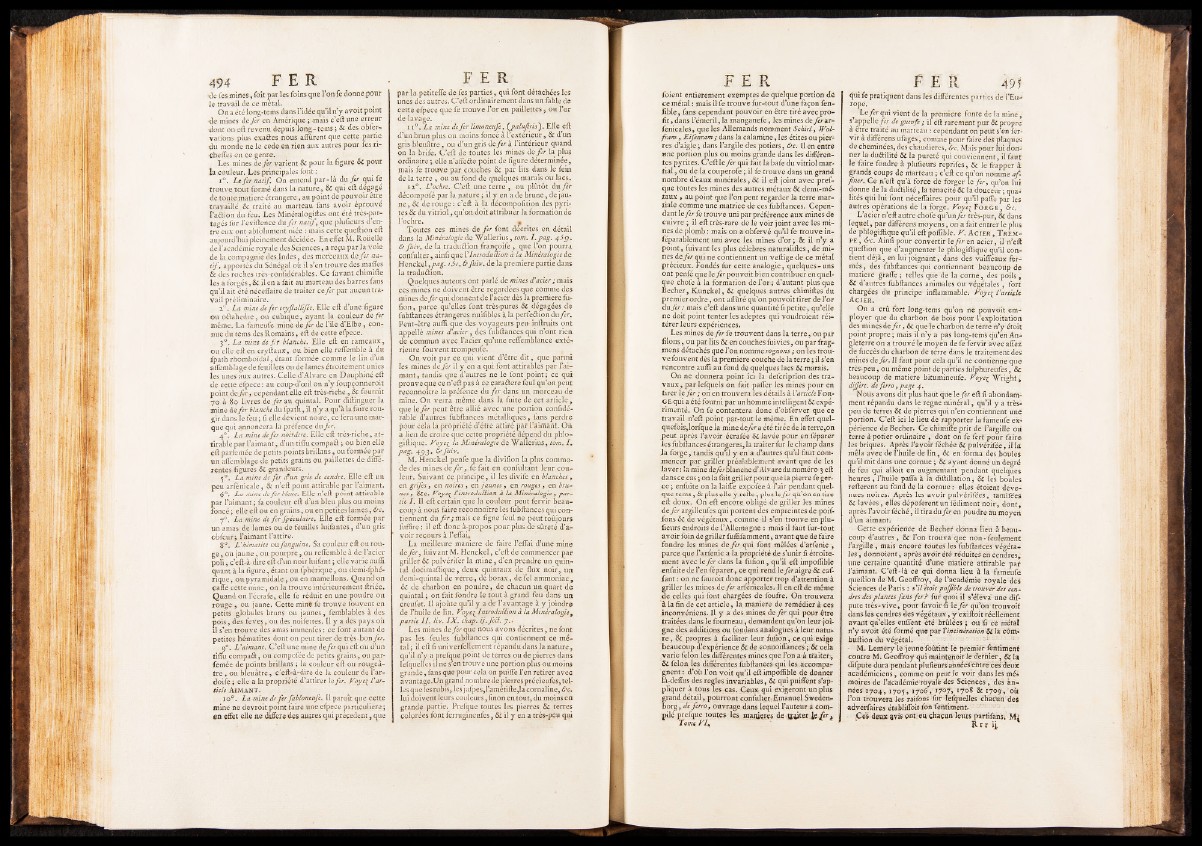
'de Tes mines, foit par les foins que l’on fe donne poulie
travail de ce métal. . ,
On a été long-tems dans l’idée qu’il n’y avoit point
-de mines de fer en Amérique ; mais c’eft une erreur
dont on eft revenu depuis long-tems ; & des obfer-
varions plus exaôes nous aflïirent que cette partie
du monde ne le cede en rien aux autres pour les ri-
cheffes en ce genre.
Les mines de fer varient & pour la figure & pour
la couleur. Les principales font :
Ie*. Le fer natif. On entend par-là du fer qui fe
trouve tout formé dans la nature, & qui eft dégagé
de toute.matière étrangère, au point de pouvoir etre
travaillé & traité au marteau fans avoir éprouvé
Paétion du feu. Les Minéralogiftes ont été très-par-
tagés fur l ’exiftence du fer natif, que plufieurs d’entre
eux ont abfolument niée : mais cette queftion eft
aujourd’hui pleinement décidée. En effet M. Roiielle
de l ’académie royale des Sciences, a reçu par la voie
de la compagnie des.Indes, des morceaux de fer natif\
apportés du Sénégal oit il s’en trouve des maffes
& des roches très-confidérables. Ce favant chimifte
les a forgés, & il en a fait au'marteau des barres fans
qu’il ait été néceffaire de traiter ce fer par aucun travail
préliminaire.
i ° . La mine de fer cryftallifée. Elle efl d’une figure
ou o&ahedre, ou cubique, ayant la couleur de fer
même. La fameufe mine de fer de l’île d’Elbe, connue
du tems des Romains, eft de cette efpece.
30. La mine de fer blanche. Elle eft en rameaux,
ou elle eft en cryftaux, ou bien elle reffemble à du
fpath rhomboïdal, étant formée comme le lin d’un
affemblage de feuillets ou de lames étroitement unies
les unes aux autres. Celle d’Al va re en Dauphiné eft
de cette efpece : au eôup-d’oeil on n’y foupçonneroit
point de fer, cependant elle eft très-riche, & fournit
70 à 80 livres de fer au quintal. Pour diftinguer la
mine de fer blanche du fpath, il n’y a qu’à la faire rougir
dans le feu ; fi elle devient noire, ce fera une mar- ■
que qui annoncera la préfence du fer.
40. La mine de fer noirâtre. Elle eft très-riche, at-
tirable par l’aimant, d’un tiffu compaû ; ou bien elle
eft parfeiiiée de petits points brilians, ou formée par
un affemblage de petits grains ou paillettes de différentes
figures & grandeurs.
e°. La mine de fer cPun gris de cendre. Elle eft un
peu arfénicale, & n’eft point attirable par l’aimant.
6°. La mine de fer bleue. Elle n’eft point attirable
par l’aimant ; fa couleur eft d’un bleu plus ou moins
foncé ; elle eft ou en grains, ou en petites lames, &c.
} 70. La mine de fer fpéculaire. Elle eft formée par
un amas de lames ou de feuilles luifantes, d’un gris
obfcur ; l’aimant l’attire.
8°. L'hématite ou fanguine. Sa couleur eft ou rouge
H ou jaune, ou pourpre, ou reffemble à de l’acier
poli, c’eft-à-dire eft d’un noir luifant ; elle varie auffi
quant à la figure, étant ou fphérique, ou demi-fphé-
nque , ou pyramidale, ou en mamellons. Quand on
cafté cette mine, on la trouve intérieurement ftriée.
Quand on l’écrafe, elle fe réduit en une poudre ou
rouge , ou jaune. Cette mine fe trouve fou vent en
petits globules bruns ou jaunes, femblables à des
pois, des feves ,'ou des noifettes. Il y a des pays où
il s’en trouve des amas immenfes : ce font autant de
petites hématites dont on peut tirer de très-bon fer.
o°. L'aimant. C ’eft une mine de fer qui eft ou d’un
tiffu compaét, ou compofée de petits grains, ou par-
femée de points brilians ; la couleur eft ou rougeâtre
, ou bleuâtre, c ’eft-à-dire de la couleur de l’ar-
doife ; elle a la propriété d’attirer le fer. Voye{ l'article
A im a n t .
io ° . La mine de fer fabloneufe. Il pafoît que cette
mine ne devroit point faire une efpece particulière ; en effet elle ne différé des autres qui precedent, que
parla petiteffe de fes parties, qui font détachées les
unes des autres. C ’eft ordinairement dans un fable de
cette efpece que fe trouve l’or en paillettes, ou l’or
de lavage.
1 1° . La mine de fer limoneufe, ( paluflris) . Elle eft
d’un brun plus ou. moins foncé à l’exterieur, & d’un
gris bleuâtre, ou d’un gris de ftr à l’intérieur quand
on la brife. C ’eft de toutes les mines de f r la plus
ordinaire ; elle n’affefte point de figure déterminée,
mais fe trouve par couches & par lits dans le fein
de la terre , ou au fond de quelques marais ou lacs.
iz ° . L'ochre. C ’eft une terre , ou plutôt du fer
décompofé par la pâture ; il y en a de brune, de jaune
, & de rouge : c’eft à la décompofition des pyrites
& du vitriol, qu’on doit attribuer la formation de
l ’ochre. «
Toutes ces mines de fer font décrites en détail
dans la Minéralogie de Wallerius, tom. I.pag. 46g.
& fuiv. de la traduction françoife , que, l’on pourra
confulter, ainfi que VIntroduction à la Minéralogie de
Henckel ,/><*£. 1S1. & fuiv. de la première partie dans
la traduction.
Quelques auteurs ont parlé de mines d'acier ; mais
ces mines ne doivent être regardées que comme des
mines de fer qui donnent de l’acier dès la première fu-
fion, parce qu’elles font très-pures & dégagées de
fubftances étrangères nuifibles à la perfection du fer.
Peut-être auffi que des voyageurs peu inftruits ont
appellé mines d'acier, des fubftances qui n’ont rien
de commun avec l’acier qu’une reffemblance extérieure
fouvent trompeufe.
On voit par ce qui vient d’être dit, que parmi
les mines de fer il y en a qui font attirables par l’aimant
, tandis que d’autres ne le font point ; ce qui
prouve que ce n’eft pas à ce caraâtere feul qu’on peut
reconnoitre la préfence du fer dans un morceau de
mine. On verra même dans la fuite de cet article,
que le fer peut être allié avec une portion confidé-
ràble d’autres fubftances métalliques, fans perdre
pour cela la propriété d’être attiré par l’aimant. On
a lieu de croire que cette propriété dépend du phlo-
giftique. Voyt^ la Minéralogie de W allerius, tom. I .
P“g- ■ ' ']
M. Henckel penfe que la divifion la plus commode
des mines de f r , f ç . fait en confultant leur couleur.
Suivant ce principe, il les divife en blanches ,
en grifes , en noires, en jaunes, en rouges, en brunes
, & c . Voye^ l'introduction a la Minéralogie , partie
I . Il eft certain que la couleur peut fervir beaucoup
à nous faire reconnoître les fubftances qui contiennent
du fer; mais ce ligne feul ne peut toujours
fuffire : il eft donc à-propos pour plus de sûreté d’avoir
reçours à l’effai,
La meilleure maniéré de faire l’eflai d’une mine
de fer, fuivant M. Henckel, c’eft de commencer par
griller & pulvérifer la mine, d’en prendre un quintal
docimaftique, deux quintaux de flux noir, un
demi-quintal cle verre, de borax, de fel ammoniac ,
& de charbon en poudre, de chacun un^quart de
quintal ; on fait fondre le tout à grand feu dans un
creufet. Il ajoute qu’il y a de l’avantage à y joindre
de l’huile de lin. Voye^ Introduction à la Minéralogie,
partie II. liv. IX . chap. ij.fect. y,.
Les mines de fer que nous a vons décrites, ne font
pas les feules fubftances qui contiennent ce métal
; il eft fi univerfellement répandu dans la nature,
qu’il n’y a prefque point de terres ou de pierres dans
lefquelles il ne s’en trouve une portion plus ou moins
grande, fans que pour cela on puiffe l’en retirer avec
avantage.Un grand nombre de pierres précieufes, telles
que les rubis, les jafpes,l’ametifte,la cornaline, &c.
lui doivent leurs couleurs, finon en tout, du moins en
grande partie. Prefque toutes les pierres & terres
colorées font ferrugineufes, & il y en a très-peu qui
foient entièrement exemptes de quelque portion dâ
ce métal : mais il fe trouve fur-tout d’une façon fen-
fible, fans cependant pouvoir en être tiré avec profit,
dans l’émeriljla manganefe, les mines de fer ar-
fenicales, que les Allemands nomment Schirl, Wolfram
, Eifenram ; dans la calamine, les étites ou pierres
d’aigle ; dans l’argile des pbtiers, &c. Il en entre
une portion plus ou moins grande dans les différentes
pyrites. C ’eft le fer qui fait la bafe du vitriol martial
, ou de la eouperofe ; il fe trouve dans un grand
nombre d’eaux minérales, & il eft joint avec prefque
toutes les mines des autres métaux & demi-mé-
ïaux , au point que l’on peut regarder la terre martiale
comme une matrice de ces fubftances. Cependant
le fer fe trouve uni par préférence aux mines de
cuivre ; il eft très-rare de le voir joint avec les mines
de plomb : mais on a obfervé qu’il fe trouve in-
féparablement uni avec les mines d’or ; & il n’y a
point, fuivant les plus célébrés naturaliftes, de mines
de fer qui ne Contiennent un veftige de ce métal
précieux. Fondés fur cette analogie, quelques - uns
ont penfé qiie le fer pouvoit bien contribuer en quelque
chofe a la formation de l’or ; d’autant plus que
Becher, Kunckel, & quelques autres chimiftes du
premier ordre, ont affûré qu’on pouvoit tirer de l’or
du fer: mais c’eft dans une quantité fi petite, qu’elle
ne doit point tenter les adeptes qui voudroient réitérer
leurs expériences»
Les mines de^èr fe trouvent dans îa terre, ou par
filons, ou par lits & en couches fui vies, ou par frag-
mens détachés que l’on nomme rognons ; on les trouv
e fouvent dès la première couche de la terre ; il s’en
rencontre auffi au fond de quelques lacs & marais.
On ne donnera point ici la deferiprion des travaux
, par lefquéls on fait paffer les mines pour en
tirer le fer ; on en trouvera les détails à l'article For-
GE-qui a été fourni par un homme intelligent & expérimenté.
On fe contentera donc d’obferver que ce
travail n’eft point partout le même. En effet quelquefois,
lorfque la mine défér a été tirée de la terre,on
peut après l’avoir écrafée & lavée pour en féparer
les fubftances étrangères, la traiter fur le champ dans
Ja forge, tandis qu’il y en a d’autres qu’il faut commencer
par griller préalablement avant que de les
laver: la mine de/crblanehe d’Alvaredu numéro 3 eft
dans ce cas ; on la fait grillef pour que la pierre fe gerce
; enfuite on la laiffe expofée à l’air pendant quelque
tems, & plus elle ÿ refte, plus le fer qü’ôn en tire
eft doux. On eft encore obligé .de-griller les mines
de fer argilleufes qui portent des empreintes de poif-
fons Sc de végétaux, comme -il s’en trouve en plufieurs
endroits de l’Allemagne : mais il faut fur-tout
avoir foin de griller fuffifamment, avant que de faire
fondre les mines de fer qui font mêlées d’arfenic ,
parce que l’arfenic a la propriété de s’unir fi étroitement
avec le fer dans la fufion, qu’il eft impoffible
enfuite de l’en féparer, ce qui rend le fer aigre & cafi
fant : on ne fauroit donc apporte! trop d’attention à
griller les mines-de^r arfenicalës. Il en eft de même
de celles qui font chargées de foufre. On trouvera
à la fin de cet article, la maniéré de remédier à ces
inconvéniens. Il y a des mines, de fer qui pour être
traitées dans le fourneau, demandent qu’On leur joigne
des additions ou fondans analogues à leur natur
e , & propres à faciliter leur fufion, ce qui exige
beaucoup d.’expérience & de .coprioiffancés ; & cela
varie félon les différentes mines que l’on a à traiter ^
& félon les différentes fubftances qui les accompagnent
: d’où l’on voit qu’il eft impoffible de donner
là-deffus des réglés invariables, & qui puiffent s’appliquer
à tous les cas. Ceux- qui exigeront un plus
grand détail, pourront cpnfultÇfilLmanuel Swedenborg
, de ferro, ouvrage dans lequel l’auteur à compilé
prefque toutes- les maniérés de twiter ie./<r*
Tome VI<
qüi fe pratiquent dans les différentes parties de I’EuJ
ropé.
Fe fer qui vient de la première fonte de la miné y
5 appelle fer de gueufe ; il éft rarement pur ôc propre
à être traité au martcàu : cependant on peut s’en fer-
vir à differens ufages, comme pour faire des plaques
de cheminées, des chaudières, &c. Mais pour lui donner
la duétilite & la pureté qui conviënnent, il faut
le taire fondre à plufieurs reprifes, & lé frapper à
grands coups de marteau ; c’eft ce qu’on nomme affiner.
Ce n’eft qu’à force dé forger le fer, qu’on lui
donne de la ductilité, la ténacité & la douceur ; qualités
qüi lui font néceffaires pour qii’il paffe par les
autres opérations de la forge. Voye^ Fo r g e , & c.
L’acier n’eft autre chofë qu’un fer très-pur, & dans
lequel, par différens moyens, on a fait entrer le plus
de phlogiftique qu’il eft poffible; V. A c ie r , T r em p
e , &c. Ainfi pour convertir le fer en acier, il n’eft
queftion que d’augmenter le phlogiftique qu’il contient
déjà, en lui joignant, dans des vaiffeaux fermés
j des fùbftances qui contiennent beaucoup de
matieré graffe ; telles que de la corne, des poils ,
6 d’autres fubftances animales ou végétales , fort
chargées du principe inflammable» P'oye^ Varticle
A c ie r .
On a crû fort long-tems qu’on né pouvdit employer
que du charbon de bois pour l’exploitation
des mines de fer, & que le charbon de tër'ré ri’y êtôit
point propre ; mais il n’y a pas Iong-tèms qü’eri Angleterre
on a trouvé le moyen de fe fervir avec affez
de fuccès du charbon de terre dans le traitement dei
mines de fer. Il faut pour cela qu’il nè contienne que
très-peu, ou même point de parties fulphureufes, &
beaucoup de matière bittimineufe» Voyè{ Wright j
diffère, de ferro, page 4.
Noüs avons dit plus haut qiie le fer éft fi abondamment
répandu dans le régné minéral, qu’il y a très-
peu de tetrés Ô£ de pierres qui n’en contiennent uné
portion. C ’eft ici le lieu dë rapporter la fameufe expérience
de Becher. Ce ehimifte prit de l’argille où
terre à potier ordinaire , dont on fe fert pour faire
les briques. Après l’avoir féëhée & pulvériféè, il Iat
mêla avec de l’huile de lin, & en forma des fioules
qu’il mit dans une cornue ; & ayant donné un degré
de feu qui al foit en augmentant pendant quelques
heures , l’huile paffa à la diftillation ÿ & les boules
refterent aü fond de là cornue : elles étoierit devenues
noires. Après les avoir pülvérifées, tamifées
& lavées, elles dépoferentun fédiment noir , dont,
après l’avoir féché, il tira du fer en poudre au moyeti
d’un aimant»
Cette expérience dé Beche! donna lieu â beaucoup
d’autres , & l’on trouva que non- feulement
l’argille , mais encore toutes les fubftarices végétales
, donnoient, après avoir été réduites en cendres,
une certaine quantité d’une matière attirable pa!
l’aimant» C ’eft-là ce qui donna lieu à là fameufe
quèftion de M. G eoffroy, de l’académie royale deà
Sciences de Paris : s 'il éioit poffible de trouvée1 dès cendres
des plantes fdris fer ? fur quoi il s’éleva7 Une dif-
pute très-vive, pour favoir-fi le fer qii’On trouvoit
dans les cendres des végétaux, y efciftoit réellement
avant qu’elles eüffent été brûlées ; ou f i cé métal
n’y avoit été formé que par i'incinération Sc ia, côm«
buftion du-végétai. , . . - . : • VVL : '
M. Lemery le^euné fôûtihf lè premier fentiment
contre M» Geoffroy qui màintenoit ië dernier, ôt.la
difpute dura pendant plufieurs annéës"éhrtré cés deux
académiciens, comme on peut le voir dans les mé*
moires de l’académiè-rOyalé des Scienèés Y des années
1 7 0 4 ,1 7 0 5 ,1 7 0 6 , lytiyj 1708 & Ï707Y0Ü
l ’on trouvera les raiforts fur lefquelles éhaéun des
adverfaires établiffoit fort fe'iifiment.
CeS deux avis ont eu chacun leurs partifaris. Ml
R r r ij^.