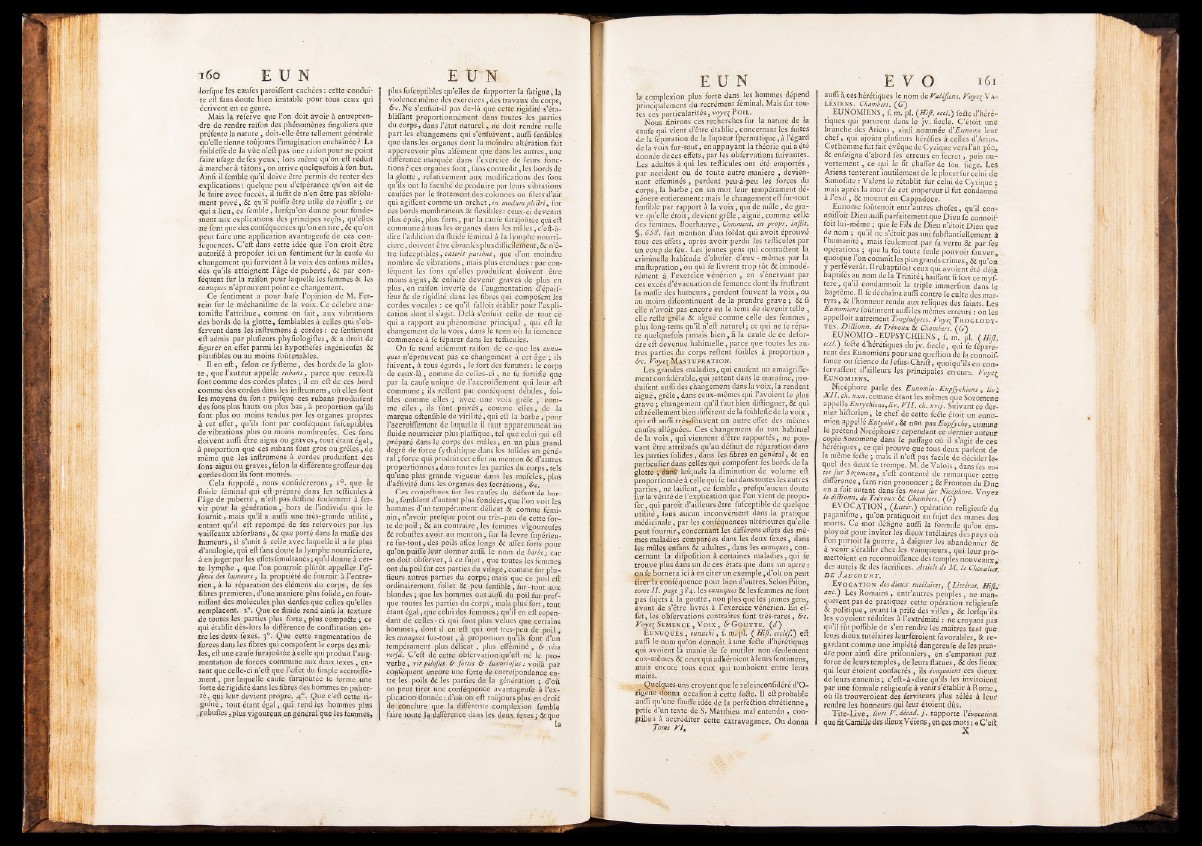
i6o E U N •lorfgue les caufes paroiffent cachées : cette 'Conduite
eft fans doute bien imitable pour -tous ceux qui
■ écrivent en ce genre.
Mais la referve que l’on doit avoir à entreprendre
de rendre raifon des phénomènes finguliers que
préfente la nature, doit-elle être tellement générale
qu’elle tienne toujours l’imagination enchaînée ? La
foiblefle de la vûe n’efhpas une raifon pour ne point
faire ufage de fes yeux ; lors même qu’on eft réduit
à marcher à tâtons, on arrive quelquefois à fon but.
Ainfi il femble qu’il doive être permis de tenter des
explications: quelque peu d’efpérance qu’on ait de
•le faire avec fuccès, il fuffit de n’en être pas àbfolu-
•ment privé, & qu’il puifle être utile de réufïir ; ce
qui a lieu , ce femble, lorfqu’on donne pour fondement
aux explications des principes reçus, qu’elles
•ne font que des conféquences qu’on en tire, & qu’on
peut faire une application avantageufe de ces con-
lequences. C ’eft dans cette idée que l’on croit être
uutorifé à propofer ici un fentiment fur la caufe du
changement qui furvient à la voix des enfans mâles,
dès qu’ils atteignent l’âge de puberté, & par con-
féquent fur la raifon pour laquelle les femmes & les
-eunuques n’éprouvent point ce changement.
Ce fentiment a pour bafe l’opinion de M. Fer-
rein fur le méchanifme de la voix. Ce célébré ana-
tomifte l’attribue, comme on fait, aux vibrations
des bords de la glotte, femblables à celles qui s’ob-
fervent dans les inftrumens à cordes : ce fentiment
eft admis par plufieurs phyfiologiftes, & a droit de
figurer en effet parmi les hypothèfes ingénieufes &
plaufibles ou au moins foûtenables.
Il en e f t , félon ce fyftème, des bords de la glotte
, que l’auteur appelle rubans, parce que ceux-là
font comme des cordes plates ; il en eft de ces bord
comme des cordes dans les inftrumens, où elles font
les moyens du fon : puifque ces rubans produifent
des fons plus hauts ou plus bas , à proportion qu’ils
font plus ou moins tendus par les organes propres
à cet effet, qu’ils font par conféquent fufceptibles
de vibrations plus ou moins nombreufes. Ces fons
doivent aufîi être aigus ou graves, tout étant égal,
à proportion que ces -rubans font gros ou grêles, de
même que les inftrumens à cordes produifent des
fons aigus ou graves, félon la différente groffeur des
cordes dont ils font montés.....
Cela fuppofé, nous; çpnfidérerons, i °. que le
fluide féminal qui eft préparé dans les tefticules à
l ’âge de puberte, n’eft pas deftiné feulement à fer-
vir pour la génération ,h o r s de l’individu qui le
-fournit, mais qu’il a aufîi une .très-grande utilité,
entant qu’il eft repompé, de fes refer voirs par les
vaiffeaux abforbans, & que porté dans la maffe des
humeurs, il s’unit à celle avec laquelle il a le plus
d’analogie, qui eft fans doute la lymphe nourricière,
à en juger par les effets fimultanés;; qu’il donne à cette
lymphe , que l’on pourroit plutôt .appeller lV/7
fencedes humeurs, la propriété .de fournir, à,l’entretien,
à la réparation des élémens du corps , de fes
fibres premières, d’une maniéré plus folide , en four-
niflant des molécules plus denfésque celles qu’elles
remplacent.| z°. Que ce fluide, rend ainfi. la\ texture
de toutes les. parties plus forte , plus compare ; ce
qui établit dès-lor.s la différence de conftitution, enr
tre les deux fexes. 30. Que cette augmentation de
forces dans les fibres qui compofent le corps des mâles,
eft une caufe furajojitéeà celle qui produit l’augmentation
de forcés commune aux deux l’exes, entant
.que celle-ci n’eft que l ’effet du fimple accroifle-
ment., par laquelle caufe furajoûtée le forme rune
forte de rigidité dans les fibres des hommes en puher-
.té , qui leur devient propre, Qu e ç’eft cette rigidité;,.
tout étant égal, qui repd les hommes plus
.^obuftes iplus vigoureux ,en général'que les femmes,
E U N plus fufceptibles qu’elles de fupporter la fatigue, la
violence même des exercices, des travaux du corps,
&c. Ne s’enfuit-il pas de-là que cette rigidité s’éta-
bliffant proportionnément dans toutes les .parties
du corps, dans l’état naturel, ne doit rendre nulle
part les changemens qui s’enfuivent, aufîi fenfibles
que dans les organes dont la moindre altération fait
appercevoir plus aifément que dans les autres, une
différence marquée dans l’exercice de leurs fonctions
? ces organes font, fans contredit, les bords de
la glotte, relativement aux modifications des fons
qu’ils ont la faculté de produire par leurs vibrations
caufées par le frotement des colonnes ou filets'd’air
qui agiffent comme un archet, in modutn pleclri, fur
ces bords membraneux & flexibles : ceux-ci devenus
plus épais, plus forts, par la caufe furajoûtée qui eft
commune à tous les organes dans les mâles, c’eft-à-
dire l’addition du fluide féminal à la lymphe nourricière
, doivent être ébranlésplus difficilërhent, & n’ê-
tre fufceptibles, azteris paribus, que d’un moindre
nombre de vibrations, mais plus etendues : par conféquent
les fons qu’elles produifent doivent être
moins aigus , & enfuité devenir graves, de plus en
plus, en raifon inverfe de l’augmentation d’épaif-
feur & de rigidité dans les fibres qui compofent les
cordes vocales : ce qu’il falloit établir pour l’explication
dont il s’agit. Delà s’enfuit celle de tout ce
qui a rapport au phénomène principal , qui eft le
changement de la v o ix , dans le tems où la femence
commence à fe féparer dans les tefticules.
On fe rend aifément raifon de' ce que les eunuques
n’éproUVent pas ce changement à cet âge ; ils
fuivent, à tous égards, le fort des femmes: le corps
de ceux-là, comme de celles-ci, ne fe fortifie que
par la caufe unique de l’açcroifTement qui leur eft
commune ; ils reftent par conféquent débiles, foi-
bles comme elles-; avec une voix grêle., comme
elles , ils font privés, comme. elles-, de la
marque oftenfible de virilité, qui eft la barbe $ pour
l’accroiflement de laquelle il faut apparemment un
fluide nourricier plus plaftique , tel que celui .qui eft
préparé dans le corps des mâles, en un plus grand
degré-de force fythaltique dans les folides en général
; force qui produit cet effet aumenton & d’autres
proportionnés, dans toutes les parties du corps, tels
qu’une plus grande vigueur dans les mufçles, plus
d’aétiyité dans les organes des fecrétions ,
Ces conjeâures fur les caufes du défaut de barbe
, femblent d’autant plus fondées, que l’on voit les
honimes d’un tempérament délicat & comme féminin,
n’avoir prefque point ou très-peu de cette forte
de poil ; & au contraire, les femmes vigoureufes
& robuftes avoir au menton, fur la levre fupérjeu-
re fur-tput, des poils allez longs & aifez forts pour
qu’on puiftb leur donner aufîi le nom de barbe; car,
on dpitpbferyer, à ce fujet, que toutes les femmes
ont du poil fur ces parties du vif âgé, comme fur plufieurs
autres parties du corps.; niais, que ce poil eft
ordinairement follet & ,peu fenfible ,jCur-tout .aux
blonde ; quelles fionjmes put aufti d.u poil fur p resque
toutes les parties du corps, mais plus fort, tout
étant égal, que celui dps femmes ; qu’il en eft cependant
dec celles - ci qui font plus velues que certains,
hommes, dont il en eft qui ont très-peü de .poji,
les eunuques fur-tout , à proportion qu’ils -font' d’un
tempérament ; plus délicat , plus efféminé , & ,yice
verfâ. C ’eft de cette .obfervation qu’eft -né le proverbe
f, yir pilofùs, & fortis & luxuriofus : voilà pair
cpftféquent encore une forte de.correfpondance, entre
les poils jte. les parties de la génération ; d’oÙ
on peut tirer une conféquence avantageufe. à l’explication
donnée :;d’pù.on eft toujours pluSj en droit
de (Conclure ,que. la différente çomplexion femble
faire : toute la,; différence dans les deux foxes ; &que
E U N lar çomplexion plus forte dans les hommes dépend
principalement du recrément féminal. Mais fur tou^
tes ces particularités, vqycîPo il .
Nous finirons ces recherches fur la nature de la
caufe qui vient d’être établie, concernant les fuites
de la féparation de la liqueur fpermatique, à l’égard
de la voix fur-tout, en appuyant la théorie qui a été
donnée de ces effets, par les obfervations fuivantes.
Les adultes à qui les tefticules ont été emportés ,
par accident ou de toute autre maniéré , deviennent
efféminés , perdent peu-à-peu les forces du
corps, la barbe ; en un mot leur tempérament dégénère
entièrement : mais le changement eft fur-tout
fenfible par rapport à la v o ix , qui de mâle, de grave
qu’elle étoit, devient grêle, aiguë,comme celle
des femmes. Boerhaave, Comment. in propr. inflii.
§ . 658. fait mention d’un foldat qui avoit éprouvé
tous ces effets, après avoir perdu les tefticules par
un coup de feu. Les jeunes gens qui contra&ent la
criminelle habitude d’abufer d’eux - mêmes par la
iriaftupration, ou qui fe livrent trop tôt & immodérément
à l’exercice vénérien , en s’énervant par
ces excès d’évacuation de femence dont ils fruftrent
la maffe des humeurs, perdent fouvent la v o ix , ou
au moins difeontinuent de la prendre grave ; & fi
elle n’avoit pas encore eu le tems de devenir telle ,
elle refte’ grêle & aiguë comme celle des femmes,
plus lorig-tems qu’il n’eft naturel ; ce qui ne fe répare
quelquefois jamais b ien ,fi la caufe de ce defor-
dre eft devenue habituelle, parce que toutes les autres
parties-du corps reftent foibles à proportion ,
&C. Vojye^M A STU PR A T IO N .
Les grandes maladies , qui caufent un amaigriffe-
ment confidérable, qui jettent dans le marafme, produifent
aufîi des changemens dans la voix, la rendent
aiguë, grêle, dans ceux-mêmes qui l’avoient le plus
grave ; changement qu’il faut bien diftinguer, & qui
eft réellement bien différent de la foiblefle de la v o ix ,
qui eft aufîi trèsgfouvent un autre effet des mêmes
caufes alléguées. Ces changemens du ton habituel
de la v o ix , qui viennent d’être rapportés, ne pouvant
être attribués, qu’au défaut de réparation dans
les parties folides, dans les fibres en général, & en
particulier dans celles qui compofent les bords de la
glotte y dsrrif lefquels la diminution de volume eft
proportionnée à celle qui fe fait dans toutes les autres
parties, ne laiffent, ce femble, prefqu’aucun doute
fur la vérité de l’explication que l’on vient de propofer
, qui paroît d’ailleurs être fufceptible de quelque
utilité , Tans aucun inconvénient dans la pratique
médicinale, par les conféquences ultérieures qu’elle
peut fournir,concernarîtTes différens effets des mêmes
maladies comparées dans les deux fexes, dans
les mâles enfans & adultes, dans les eunuques, concernant
la difpofition à certaines maladies, qui fe
trouve plus dans un de ces états que dans un autre :
on,fe. bornera ici à en citer un exemple, d’où on peut
tirer là conféquence pour bien d’autres. Selon Pifon,
tome II. page 384. les eunuques & les femmes ne font
pas fujets à la goutte, non plus que les jeunes gens,
avant de s’être livrés à l’exercice vénérien. En effe
t, les obfervations contraires font très-rares, &c.
Voye1 Semence , V o i x , 6* G o p t t e . (</)
Eunuques , eumcchi, f. nj. pl. ( Hifi- eccléf.') eft
aufîi le nom qu’on donnoit.à une fefte d’hérétiques
qui avoient la manie de fe mutiler non-feulement
eux-mêmes & ceux qui adkéroient à leurs fentimens,
mais encore tous ceux qui tomboient entre leurs
mains.
vQuglques-uns croyent que le zeleinconfidéré d’O-
hgërîë donna o.ccafion à cette fefté. Il eft probable
aufîi qu’une fauffe idée de la perfection chrétienne,
prife d’un texte de S. Matthieu mal entendu, contribua
à accréditer cette extravagance. On donna
Jonte Vit
E V O i6t aufîi à ces hérétiques le nom de Valèfiens. Voyeç V a-
LESIENS. Chambers, ((r)
EUNOMIENS, f. m. pl. (Hiß. eccl.') fefte d’hérétiques
qui parurent dans le jv. fiecle. C’étoit une
branche des Ariens , ainfi nommée ÏÏEunome leur
ch ef, qui ajoûta plufieurs héréfies à celles d’Arius.
Cet homme fut fait évêque de Cyzique vers l’an 360*
& enfeigna d’abord fes erreurs en fecret, puis ouvertement
, ce qui le fit ehaffer de fon fiége. Les
Ariens tentèrent inutilement dé le placer fur celui de
Samofate : Vàlens le rétablit fur celui de Cyzique ;
mais après la morr de cet empereur il fut condamné
à l’ex il, & mourut en Cappadoce.
Eunome foûtenoit entr’autres chofes, qu’ii con-
noiffoit Dieu aufîi parfaitement que D ieufe connoif-
foit lui-même ; que le Fils de Dieu n’étoit Dieu que
de nom ; qu il ne s’etoit pas uni fubftantiellement à
1 humanité, mais feulement par fa vertu & par fes
operations ; que l^foi toute feule pouvoit fauver ,
quoique l’on commît les plus grands crimes, & qu’on
y perfeverat. Iirebaptifoit ceux qui avoient été déjà
baptifes au nom de la Trinité ; haïffant fi fort ce myfc
tere,^qu’il condamnoit la triple immerfion dans le
bapteme. Il fe déchaîna aufîi contre le culte des martyrs,
& l’honneur rendu aux reliques des faints. Les
Eunomiens foutinrent aufîi les mêmes erreurs : on les
appelloit autrement Troglodytes, T r o g lo d y t
e s . Diciionn. de Trévoux & Chambers. (G)
EUNOMIO - EUPSYCHIENS, f. m. pl. ( Hiß;
eed.) fefte d’hérétiques du jv. fiecle, qui fe fepare-
rent des Eunomiens pour une queftion de la connoif-
fance ou fcience de Jefus-Chrift, quoiqu’ils en con-
fervaffent d’ailleurs les principales erreurs. Voyez
Eunomiens.
Nicephore parle des Eunomio-Eupfychiens , livl
X I I . ch. x x x . comme étant les mêmes que Sozomene
appelle Eutychiens, Uv. V II. ch. xvij. Suivant ce dernier
hiftorien, le chef de cette feéle étoit un euno-
mien appellé Eutychc , & non pas Eupjyche, comme
le prétend Nicephore ; cependant ce dernier auteur,
copie Sozomene dans le paflage où il s’agit de ces
hérétiques,- ce qui prouve que tous deux parlent de
la même fe&e ; mais il n’eft pas facile de décider lequel
des deux fe trompe. M. de V alois, dans fes no-
tes fur Sozomene, s’eft contenté de remarquer cette
différence, fans rien prononcer ; & Fronton du Duc
en a fait autant dans fes notes fur Nicephore. V o y ez
le diciionn. de Trévoux & Chambers. (G~)
EVOC ATION , ( Littér.) opération religieufe du
paganifme, qu’on pratiquoit au fujet des mânes des
morts. Ce mot défigne aufîi la formule qu’on ém-
ployoit pour inviter les dieux tutélaires dés pays où
l’on portoit la guerre, à daigner les abandonner &
à venir s’établir chez les vainqueurs, qui leur prù-
mettoient en reconnoiffance des temples nouveaux.1
des autels & des facrifîces. Article de M. le Chevalier
D E J A U CO U R T .
Ev o c a t io n des dieux tutélaires, (Littéral. Hißj
anc.') Les Romains , entr’autres peuples, ne manquèrent
pas de pratiquer cette opération religieufe
& politique, avant la prife des villes , & lorfqu’ils
les voyoient réduites à l’extrémité : ne croyant pas
qu’il fût pofïible de s’en rendre les maîtres tant que.
leurs dieux tutélaires leurferoient favorables, & re-»
gardant comme une impiété dângereufe de les prendre
pour ainfi dire prisonniers, en s’emparant par
force de leurs temples, de leurs ftatues, & des lieux
qui leur étoient confacrés , ils évoquoient ces dieux
de leurs ennemis ; c’eft-à-dire qu’ils les invitoient.
par une formule religieufe à venir s’établir à Rome,
où ils trouveroient des ferviteurs plus zélés à leur
rendre les honneurs qui leur étoient dûs.
Tite-Live, livre V.décad. j . rapporte l’évocation.
que fit Camille des dieux Vtiens, en çes mots : « C ’eft:
X