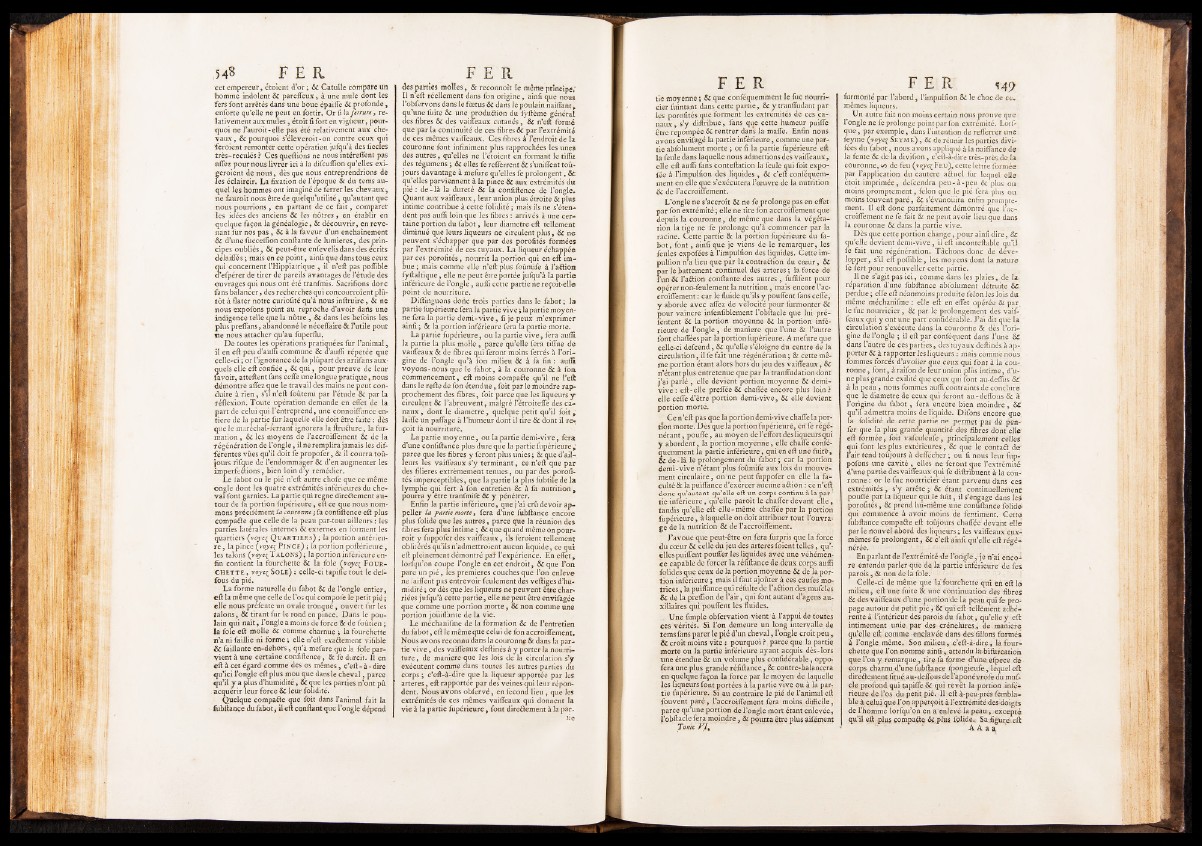
m F E R
cet empereur, étoient d’or ; Si Catulle compare un
homme indolent & pareffeux, à une mule dont les
fers font arrêtés dans une boue épaifl'e & profonde,
enforte qu’elle ne peut en fortir. Or fi la ferrure , relativement
aux mules, étoit fi fort en vigueur, pourquoi
ne l’aurôit-elle pas été relativement aux chevaux
, & pourquoi S’éleveroit-on contre ceux qui
feroient remonter cette opération jufqu’à des fiecîes
très-reculés? Ces queftions ne nous intéreffent pas
affez pour nous livrer ici à la difcuflion qu’elles exi-
geroient de nous, dès que nous entreprendrions dè
les éclaircir. La fixation de l’époque & du tems auquel
les hommes ont imaginé de ferrer les Chevaux-,
ne fauroit nous être de quelqu’utilité, qu’autant que
nous pourrions, en partant de ce fa it , comparer
les idées des anciens & les nôtres, en établir en
quelque façon la généalogie, & découvrir, en revenant
fur nos pa s, Si à la faveur d’un enchaînement
& d’une fuccelfion confiante de lumières, des principes
oubliés, Si peut-être enfevelisdans des écrits
délaiffés ; mais en ce point, ainfi que dans tous ceux
ui concernent l’Hippiatrique , il n’eft pas pofliblé
’efpérer de tirer de pareils avantages de l’étude des
ouvrages qui nous ont été tranfmis. Sacrifions dore
fans balancer, des recherches qui concourraient plutôt
à dater notre curiofité qu’à nous inftruire, & ne
nous expofons point au reproche d’avoir dails une
indigence telle que la nôtre, Si dans les befoins les
plus preffans, abandonné le néceffaire & l’utile pour
me nous attacher qu’au fuperflu.
De toutes les opérations pratiquées fur l’animal,
il en eft peu d’aufïi commune & d’aufii répétée que
celle-ci ; or l’ignorance de la plupart des ariifans auxquels
elle eft confiée, Si q u i, pour preuve de leur
lavoir, attellent fans ceffe une longue pratique, nous
démontre affez que le travail des mains ne peut conduire
à rien, s’il n’eft foûtenu par l’étude Si par la
réflexion. Toute opération demande en effet de la
part de celui qui l ’entreprend, une connoiffance entière
de la partie fur laquelle elle doit être faite : dès
que le maréchal-ferrant ignorera la ftruéture, la formation
, Si les moyens de l’accroiffement Si de la
régénération de l’ongle, il ne remplira jamais les différentes
vûes qu’il doit fe propofer, & il courra toujours
rifque de l’endommager Si d’en augmenter les
imperfections, bien loin d’y remédier.
Le fabot ou le pié n’eft autre chofe que ce même
ongle dont les quatre extrémités inférieures du cheval
font garnies. La partie qui régné directement autour
de la portion fupérieure, eft ce que nous nommons
précifément la couronne ; fa confidence eft plus
compade que celle de la peau par-tout ailleurs : les
parties latérales internes Si externes en forment les
quartiers (voyeç Q u art iers) ; la portion antérieure
, la pince (voye^ Pin c e ) ; la portion poftérieure,
les talons (vcyc{ TALONs) ; la portion inférieure enfin
contient la fourchette & la foie (yoye{ Fourc
h e t t e , voyt^ Sole) : celle-ci tapiffe tout le def-
fous du pié.
La forme naturelle du fabot Si de l’ongle entier,
eft la même que celle de l’os qui compofe le petit pié ;
elle nous préfente un ovale tronqué, ouvert fur les
talons, Si tirant fur le rond en pince. Dans le poulain
qui naît, l’ongle a moins de force & de foûtien ;
la foie eft molle Si comme charnue ; la fourchette
n’a ni faillie ni forme ; elle n’eft exaftement vifible
& faillante en-dehors, qu’à mefure que la foie parvient
à une cërtaine confiftence, & fe durcit. 11 en
eft à cet égard comme des os mêmes, c’eft-à-dire
qu’ici l’ongle eft plus mou que dans le che v a l, parce
qu’il y a plus d’humidité, & que les parties n’ont pu
acquérir leur force Si leur folidité.
Quelque compacte que foit dans l’animal fait la
fubftance du fabot, il eft confiant que l’ongle dépend
F E R
des partiès molles, & reconnoît le même principe;
Il n’eft réellement dans fon origine, ainfi que nous
l’obfervons dans le foetus Si dans le poulain naiffant *
qu’une fuite Si une production du fyftème général
des fibres Si des vaiffeaux cutanés, Si n’eft formé
que pàr la continuité de ces fibres Si par l’extrémité
de ces mêmes vailfeaux. Ces fibres à l’endroit de la
couronne font infiniment plus rapprochées les unes
des autres, qu’elles ne l’étoient en formant le tiffu
des tégumens ; Si elles fe refferrent Si s’unifient toujours
davantage à mefure qu’elles fe prolongent, St
qu’elles parviennent à la pince & aux extrémités du
pié : de - là la dureté & la confiftence de l’ongle-
Quant aux vailfeaux, leur union plus étroite & plus
intime contribue à cette folidité ; mais ils ne s’étendent
pas aulîi loin que les fibres : arrivés à une certaine
portion du fabot, leur diamètre eft tellement
diminué que leurs liqueurs ne circulent plus, Si ne
peuvent s’échapper que par des porofités formées
par l’extrémité de ces tuyaux. La liqueur échappée
par ces porofités, nourrit la portion qui en eft imbue
; mais comme elle n’eft plus foûmife à l’aCtion
fyftaltique, elle ne peut être portée jufqu’à la partie
inférieure de l’ongle, aulîi cette partie ne reçoit-elle
point de nourriture.
Diftinguons doiic trois parties dans le fabot ; la
partie fupérieure fera la partie vive ; la partie moyenne
fera la partie demi-vive, fi je peux m’exprimer
ainfi ; & la portion inférieure fera la partie morte.
La partie fupérieure, ou la partie v iv e , fera aulîi
la partie la plus molle , parce qu’elle fera tiffue de
vailfeaux & de fibres qui feront moins ferrés à l’origine
de l’ongle qu’à fon milieu Si à fa fin : aulîi
voyons-nous que le fabot, à la couronne & à fon
commencement, eft moins compacte qu’il ne l’eft
dans le relie de fon étendue, foit par le moindre rapprochement
des fibres, foit parce que les liqueurs y*
circulent Si l ’abreuvent, malgré l’étroiteffe des canaux
, dont le diamètre, quelque petit qu’il foit *
lailfe un palfage à l ’humeur dont il tire Si dont il reçoit
fa nourriture.
La partie moyenne, oit la partie demi-vive, fera
d’une confiftance plus dure que la partie fupérieure *
parce que les fibres y feront plus unies ; & que d’ailleurs
les vailfeaux s’y terminant, ce n’eft que par
des filières extrêmement tenues, ou par des porofî-
tés imperceptibles, que la partie la plus fubtile de la
lymphe qui fert à fon entretien Si à fa- nutrition %
pourra y être tranfmife Si y pénétrer.
Enfin la partie inférieure, que j’ai crû devoir ap-
peller la partie morte, fera d’une fubftance encore
plus folide que les autres, parce que la réunion des
fibres fera plus intime ; & que quand même on pour-
roit y fuppofer des vailfeaux, ils feroient tellement
oblitérés qu’ils n’admettroient aucun liquide, ce qui
eft pleinement démontré paf l ’expérience. En effet,
lonqu’on coupe l’ongle en cet endroit, Si que l’on
pare un pié , les premières couches que l’on enleve
ne lailfent pas entrevoir feulement des veltiges d’humidité
; or dès que les liqueurs ne peuvent être charriées
jufqu’à cette partie, elle ne peut être envifagée
que comme une portion m orte, Si non comme une
portion joüilfante de la vie.
Le méchanifme de la formation & de l’entretien
du fabot, eft le même que celui de fon accroilfement.
Nous avons reconnu dans la couronne & dans la partie
v iv e , des vailfeaux deftinés à y porter la nourriture
, de maniéré que les lois de la circulation s’y
exécutent comme dans toutes les autres parties du
corps ; c’eft-à-dire que la liqueur apportée par les
arteres, eft rapportée par des veines qui leur répondent.
Nous avons obfervé, en fécond lieu , que les
extrémités de ces mêmes vailfeaux qui-donnent la
vie à la partie fupérieure, font directement à la partie
tie moyenne ; & que conféquemittent le fuC nourricier
fuintant dans cette, partie, Si y tranffudant par
les porofités que Forment les extrémités de ces canaux
, s’y diltribue, fans que cette humeur puilfe
être repompée Si rentrer dans la malfe. Enfin nous
avons envilagé la partie inférieure, comme une partie
abfolument morte ; or fi la partie fupérieure eft
la feule dans laquelle nous admettions des vailfeaux,
elle eft aulîi fans conteftation la feule qui foit expo-
fée à l’impulfion des liquides , Si c’eft conféquem-
ment en elle que s’exécutera l’oeuvre de la nutrition
Si de l’accroilfement.
L ’ongle ne s’accroît Si ne fe prolonge pas en effet
par fon extrémité ; elle ne tire fon accroilfement que
depuis la couronne,''de même que dans la végétation
la tige ne fe prolonge qu’à commencer par la
racine. Cette partie & la portion fupérieure du fab
ot, fon t, ainfi que je viens de le remarquer, les'
feules expofées à l’impulfion des liquides. Cette im-
pullion n’a lieu que par la contraction du coeur, Si
par le battement continuel des arteres ; la force de
l’un Si l’aCtion conftante des autres, fuffifent pour
opérer non-feulement la nutrition, mais encore l’accroiffement
: car le fluide qu’ils y pouffent fans cefle,
y aborde avec affez de vélocité pour furmonter Si
pour vaincre infenfiblement l’obltacle que lui pré-
fentent Si la portion moyenne Si la portion inférieure
de l’ongle , de maniéré que l’une & l’autre
font chafféespar la portion fupérieure. A mefure que
celle-ci defeend, Si qu’elle s’éloigne du centre de la
circulation, il fe fait une régénération ; & cette même
portion étant alors hors du jeu des vailfeaux, Si
n’étant plus entretenue que par la tranffudation dont
j ’ai parlé , elle devient portion moyenne Si demi-
vive : eft-elle preffée & chaffée encore plus loin ?
elle ceffe d’être portion demi-vive, Si elle devient
portion morte.
Ce n’eft pas que la portion demi-vive chaffe la portion
morte. Dès que la portion fupérieure, en fe régénérant,
pouffe, au moyen de l’effort des liqueurs qui
y abordent, la portion moyenne, elle chaffe cônîe-
quemment la partie inférieure, qui en eft une fuitè ,
& de-là le prolongement du fabot; car la portion
demi-vive n’étant plus foûmife aux lois du mouvement
circulaire, on'ne peut fuppofer en elle la faculté
& la puiffance d’exercer aucune aCtion : ce n’eft:
donc qu’autant qu’elle eft un çorps continu à là patrie
inferieure, qu’èlle paraît le chaffer devant elle,
tandis qu’elle eft elle-même chaffée par la portion
fupérieure, à laquelle on doit attribuer tout l’oüvra-
ge de la nutrition Si de l’accroiffement.
J’avoue que peut-être on fera furpris que la forcé
du coeur Si celle du jeu des arteres foient telles, qu’elles
puiffent pouffer les liquides avec une véhémence
capable de forcer la réfiftance de deux corps aulîi
folides que ceux de la portion moyenne Si de la portion
inferieure ; mais il faut ajoûter à ces caufes motrices
, la puiffance qui réfulte de l’aétion des mufcles
& de la prelîion de l’air, qui font autant d’agens auxiliaires
qui pouffent lés fluides.
Une fimple obfervation vient à l’appui de toutes
ces vérités. Si l’on demeure un long intervalle de
tems fans parer le pié d’un cheval, l’ongle croît peu ,
& croît moins vîte : pourquoi ? parce que la partie
morte ou la partie inférieure ayant acquis dès-lors
une étendue Si un volume plus confidérable, oppor
fera une plus grande réfiftance, & contre-balancera
en quelque façon la force par le moyen de laquelle
les liqueurs font portées à la partie v ive ou à la par-;
tie fupérieure. Si au contraire le pié de ranimai eft
fou vent paré, l’accroiffement fera'moins difficile,
parce qu’une portion de l ’ongle mort étant enlevée,
i’obftacle fera moindre, & pourra être plus aifément
Tonie Ÿ l%
furmorité par l’abord, l’impulfion Si le choc de cernâmes
liqueurs.
Un autre fait non moins certain nous prouve que
l’ongle ne fe prolonge point par fon extrémité. Lorf»;
que, par exemple, dans l’intention de refferrer une
lèyme (yoye^ Se y m e ) , Si de réunir les parties divi-
fées du fabot, nous avons appliqué à la naiffanee de
la fente Si de la divifion, c’eft-à-dire très-près, de la
couronne, de feu (yoye{ Feu),'cette lettre formée
par l’application du cautere aétuel fur lequel elle
étoit imprimée, defeendra peu-à-peu & plus ou
moins promptement, félon que le pié fera, plus ou
moins l'ouvent paré, Si s’évanoüira enfin promptement.
Il eft donc parfaitement démontré que Tac-,
croiffement ne fe fait & ne peut avoir lieu que dans
la couronne Si dans la partie vive.
Dès que cette portion change, pour ainfi dire, St
qu’elle devient demi-vive, il eft inconteftable qu’il
fe fait une régénération. Tâchons donc de développer,
s’il eft pofliblé, les moyens dont la nature
fe fert pour renouveller cette partie.
Il ne s’agit pas ic i, comme dans les plaies, de la
réparation d’une fubftance abfolument détruite Sc
perdue ; elle eft néanmoins produite félon les lois du
même méchanifme : elle eft en effet opérée & part
Te fuc nourricier, Si par-le prolongement des vaiffeaux
qui y ont une part conlidérable. J’ai dit que la
circulation s’exécute dans la. couronne & dès l’origine
de l’ongle ; il eft par conféquent dans l’une Si
dans l’autre de ces parties, des tuyaux deftinés à apporter
& à rapporter les liqueurs : mais comme nous
fommes forcés d’avouer que ceux qui font à la cou-,
ronne, font, à raifon de leur union plus intime, d’une
plus grande exilitê que ceux qui font aii-dêffus Si
à la peau , lious fommes aulîi contraints de conclure
que le diamètre de ceux qui feront au-deffous Si. à
l’origine du fab ot, fera encore bien moindre, S i
qu’il admettra moins de liquide. Difons encore que
la folidité de cette partie ne permet pas de pen-
fer que la plus grande quantité des fibres dont elle'
eft formée, foit vâfculeufe , principalement celles
qui font les plus extérieures, Si que le contaét de’
l’air tend toûjours à deflecher ; ou fi nous leur fup-
pofons une cavité , elles ne feront que l’ extrémité
d’une partie des vaiffeaux qui fe diftribuent à la couronne
: or le fuc nourricier étant parvenu dans ces
extrémités, s’y arrête-; & étant continuellement
pouffé par la liqueur qui le fuit, il s’engage dans les
porofités, Si prend lui-même .une confiftance folide-
qui commence à avoir moins de fentiment. Cettô
fubftance cc>mpa£te eft toûjôufs chaffée’ devant elle
par le nouvel abord des liqueurs ; les vaiffeaux eux-
mêmes fe prolongent, Si c’eft ainfi qu’elle éft régénérée.
" -■ ■
En parlant de l’extrémité de l ’ongle ,--jè n’aî enco-i
re entendu parler que :de la partie inférieure de fesü
parois, & non delà foie.' '
Celle-ci de même -que la'fourchette qui en eft lo
milieu, eft une fuite & unie continuation des fibres
& des vaiffeaux d’üne portion de la pèauJqiufe propage
autour dit petit pié , & qui eft tellement adhérente
à l’ intérieur de’s.parois .du fabot, qu’elle y eft
intimement unie, par dfts cr-énelüres j de > maniefe
qu’elle eft comme en.claÿéè dans des! filions formés
à l’pngle, même., Son milieu, j ,c’eft-à-dirp,; là fourchette
que l’omnomjnp aiftfi ,. attendu la>bifürcatioh
que l’on y remarque,, tire-ia forme d’üne. efpèce de
corps charnu d’une fiabftançe fpç>ngieufe,,!équeleft
direriement fîtué au-deffpus .de l’aponé.vrofe du mut
d e profond qui ta p if fe ,q u i revêt la portion inférieure
de i’os du petit pié... Il : eft à-peu-près fembla-
ble à celui que l ’on apperçoit à l’extrémité desdoigts
de l’homme lorfqu’on en aeulevéla peau j..,excepté
qu’il eft plus compacte, ê£.plü$ folide;; SaTigureuft